Revue Internationale 2015
- 1402 reads
Revue Internationale n°155
- 1333 reads
Editorial de la Revue internationale n°155 (été 2015)
- 1392 reads
En ce mi-2015, le centenaire de la Grande Guerre – comme on l’appelle toujours – est derrière nous. Les gerbes de fleurs devant les monuments aux morts se sont fanées depuis bien longtemps, les expositions temporaires dans les mairies sont consignées aux oubliettes, les politiciens ont fait leurs beaux discours hypocrites, et la vie peut reprendre son cours qui passe pour être “normale”.
Mais en 1915, la guerre est tout sauf terminé, au contraire. Plus personne n’a la moindre illusion que les soldats seront rentrés chez eux “avant Noël”. Depuis que l’avance de l’armée allemande a été stoppée sur la Marne en septembre 1914, le conflit s’est enlisé dans une guerre de tranchées. Lors de la deuxième bataille d’Ypres, en avril 1915, les allemands pour la première fois ont lâché des gaz de guerre qui seront bientôt utilisés par les armées des deux côtés. Les morts se comptent déjà par centaines de milliers.
La guerre sera longue, ses souffrances terribles, son coût ruineux. Comment faire accepter l’horreur aux populations qui le subissent ? C’est à cette tâche cynique que s’attèle les bureaux de propagande des différents Etats, et c’est le sujet de notre premier article. En ceci, comme en tant d’autres domaines, 1914 marque l’entrée dans une période charnière qui verra l’installation progressive d’un capitalisme d’Etat omniprésent, comme seule réponse possible à la décadence de sa forme sociale.
Avec 1915 nous commençons à voir aussi les premières signes d’une résistance ouvrière, notamment en Allemagne où la fraction parlementaire du parti socialiste, le SPD, ne vote plus unanimement les crédits de guerre comme il avait fait en août de l’année précédent. Les révolutionnaires Otto Rühle et Karl Liebknecht, qui les premiers ont rompu les rangs pour s’opposer à la guerre, sont rejoints par d’autres. Ce mouvement d’opposition à la guerre, regroupant une poignée de militants des différents pays belligérants, donnera lieu en septembre 1915 à la première conférence de Zimmerwald.
Les groupes qui se réunissaient dans le village suisse de Zimmer
wald étaient loin de présenter un front uni. A côté des bolcheviques révolutionnaires de Lénine, pour qui seule la guerre civile pour le renversement du capitalisme pouvait répondre à la guerre impérialiste, se trouvait un courant – bien plus nombreux – qui espérait encore trouver un terrain d’entente avec les partis socialistes passé à l’ennemi. On appelait ce courant “centriste”, et il allait jouer un rôle important dans les difficultés et dans la défaite de la révolution allemande de 1919. C’est justement le thème d’un texte interne écrit par Marc Chirik en décembre 1984 dont nous publions ici de larges extraits. L’USPD centriste n’est plus, mais on aurait tort de penser que le centrisme comme type de comportement politique n’ait disparu pour autant ; bien au contraire, comme le montre ce texte, il est même particulièrement caractéristique de la décadence du capitalisme.
Pour conclure, nous publions également dans la Revue Internationale n° 155 [2] un nouvel article dans notre série sur la lutte des classes en Afrique, en particulier ici en Afrique du Sud. Celui-ci traite de la période sombre qui va de la Deuxième Guerre mondiale à la reprise mondiale des luttes à la fin des années 1960 ; malgré la division imposée par le régime d’apartheid, il montre que la lutte ouvrière a bien survécu, et qu’elle est très loin de se résumer à un soutien accessoire au mouvement nationaliste dirigé par l’ANC de Nelson Mandela.
CCI, juillet 2015
Naissance de la démocratie totalitaire
- 5949 reads
La Propagande pendant la Première Guerre mondiale
"La manipulation habile et consciente des habitudes et des opinions des masses est une composante majeure de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme secret de la société constituent un gouvernement invisible qui est la véritable puissance dirigeante de notre société." Edward Bernays, Propaganda, 1928 1
Ce n'est pas au cours de la Première Guerre mondiale qu'a été inventée la propagande. Lorsqu’on admire les bas-reliefs sculptés sur les escaliers monumentaux de Persépolis, où les peuples en ligne apportent leur tribut et déposent les produits de l'Empire au pied du grand Roi Darius, ou les hauts faits des Pharaons immortalisés dans la pierre de Louxor, ou encore la Galerie des Glaces du château de Versailles, ce sont des œuvres de propagande que nous regardons, ayant pour but de communiquer la puissance et la légitimité du monarque à ses sujets. La mise en scène de la parade des troupes impériales à Persépolis aurait été tout-à-fait parlante pour l’Empire britannique du 19e siècle qui organisait lui-même des défilés immenses et colorés exhibant sa puissance militaire lors des Durbars de Delhi à l'occasion de grandes festivités royales.
Mais si en 1914 la propagande n’était pas quelque chose de nouveau, la guerre en transforma profondément la forme et la signification. Au cours des années qui suivirent la guerre, le terme "propagande" devint synonyme d'écœurement, signifiant la manipulation malhonnête ou la fabrication de l’information par l’État . 2 À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l’expérience du régime nazi et de la Russie stalinienne, la propagande prit une connotation encore plus sinistre : omniprésente à l‘exclusion de toute autre source d’information, envahissant tous les recoins de la vie privée, la propagande finit par se présenter comme une sorte de lavage de cerveau. Mais, en réalité, l’Allemagne nazie et la Russie stalinienne n’étaient que des caricatures grossières de l’appareil de propagande omniprésent mis en place dans les démocraties occidentales après 1918 qui développaient de façon de plus en plus sophistiquée les techniques qui avaient été mises en œuvre à grande échelle pendant la guerre. Lorsque Edward Bernays 3 dont nous avons cité le travail précurseur sur la propagande au début de cet article, quitta le US Comittee on Public Information ("Comité américain pour l’information publique" - en réalité le bureau gouvernemental pour la propagande guerrière) à la fin de la guerre, il s’établit à son compte comme consultant pour l’industrie privée, non en propagande mais en "relations publiques" - une terminologie qu’il inventa lui-même. C’était une décision délibérée et consciente : déjà à cette époque, Bernays savait que le terme "propagande" était entaché de façon indélébile aux yeux de l’opinion publique de la marque du "mensonge".
La Première Guerre mondiale a marqué le moment où l’État capitaliste prit pour la première fois le contrôle massif et totalitaire de l’information, à travers la propagande et la censure, dans un but unique : la victoire dans la guerre totale. Comme dans tous les autres aspects de la vie sociale – l’organisation de la production et des finances, le contrôle social de la population et, en particulier, de la classe ouvrière, la transformation de la démocratie parlementaire composée d’intérêts bourgeois divergents en une coquille vide – la Première Guerre mondiale marqua le début de l’absorption et du contrôle de la pensée et de l’action sociales. Après 1918, les hommes qui, comme Bernays, avaient travaillé pour les ministères de la propagande pendant la guerre, ont été employés dans l’industrie privée comme responsables des "public relations", consultants en publicité, experts en "communication" comme on les appelle aujourd’hui. Ceci ne voulait pas dire que l'État n'était plus impliqué, au contraire, le processus initié pendant la guerre d’une osmose constante entre l’État et l’industrie privée s’est poursuivi. La propagande ne s’en est pas allée mais elle a disparu : elle est devenue une partie si omniprésente et si normale de la vie quotidienne qu’elle est devenue invisible, un des éléments les plus insidieux et les plus puissants de la "démocratie totalitaire" d’aujourd’hui. Lorsque George Orwell écrivit son grand et alarmant roman, 1984 (écrit en 1948 d’où son titre), il imaginait un avenir dans lequel tous les citoyens auraient l’obligation d’installer chez eux un écran au moyen duquel ils seraient tous soumis à la propagande étatique : soixante ans plus tard, les gens achètent eux-mêmes leur télévision et se divertissent de leur propre chef avec des produits dont la sophistication éclipse le "Ministère de la Vérité" de Big Brother. 4
L'arrivée de la guerre posait aux classes dominantes un problème sans précédent au niveau historique, bien que ce soit de façon progressive que toutes les implications en sont apparues, avec la progression de la guerre elle-même. D'abord, c'était une guerre totale qui impliquait d'immenses masses de troupes : jamais auparavant il n'y avait eu une telle proportion de la population masculine sous les armes. Deuxièmement et, en partie, comme conséquence, la guerre incorporait toute la population civile à la production de fournitures militaires, directement pour l'offensive (canons, fusils, munitions, etc.) ainsi que pour l'équipement (uniformes, approvisionnement alimentaire, transports). La masse des hommes étaient appelée pour le front ; les masses des femmes travaillaient dans les usines et les hôpitaux. Il fallait aussi financer la guerre ; c'était impossible de prélever des montants aussi énormes à travers les impôts et une préoccupation majeure de la propagande étatique était de faire appel aux économies de la nation en vendant des bons de la défense nationale. Parce que toute la population devait participer directement à la guerre, toute la population devait être convaincue que la guerre était juste et nécessaire et ce n'était pas quelque chose qui était simplement donné d'avance :
"Les résistances psychologiques à la guerre dans les nations modernes sont si grandes que chaque guerre doit apparaître comme une guerre de défense contre un agresseur menaçant et meurtrier. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur ceux que le public doit haïr. Il ne faut pas que la guerre ait pour cause un système mondial d'affaires internationales ni la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes, mais la rapacité de l'ennemi. Culpabilité et innocence doivent être géographiquement établies et toute la culpabilité doit se trouver de l'autre côté de la frontière. Si la propagande veut mobiliser toute la haine des populations, elle doit veiller à ce que toutes les idées qui circulent fassent porter l'unique responsabilité sur l'ennemi. Des variations de ce thème peuvent être permises dans certaines circonstances que nous chercherons à spécifier, mais ce thème doit toujours être le schéma dominant.
Les gouvernements d'Europe occidentale ne peuvent jamais être tout-à-fait certains que le prolétariat existant dans leurs frontières et sous leur autorité qui a une conscience de classe se ralliera à leur clairon guerrier." 5
La propagande communiste et la propagande capitaliste
Etymologiquement, le terme propagande signifie ce qui doit être propagé, diffusé, du latin propagare : propager. Il fut utilisé en particulier par un organisme de l'église catholique créé en 1622 : la Congregatio de Propaganda Fide ("Congrégation de la Propagation de la Foi"). À la fin du 18e siècle, avec les révolutions bourgeoises, le terme commença à être également utilisé pour la propagande d'activités laïques, en particulier pour la diffusion d'idées politiques. Dans Que faire ?, Lénine citant Plekhanov écrivait que : "Le propagandiste inculque beaucoup d'idées à une seule personne ou un petit nombre de personnes ; l'agitateur n'inculque qu'une seule idée ou qu'un petit nombre d'idées ; en revanche il les inculque à toute une masse de personnes."
Dans son texte de 1897, "Les tâches des social-démocrates russes", Lénine insistait sur l'importance d' "une activité de propagande visant à faire connaître la doctrine du socialisme scientifique, (à) diffuser parmi les ouvriers une conception juste du régime économique et social actuel, des fondements et du développement de ce régime, des différentes classes de la société russe, de leurs rapports, de la lutte de ces classes entre elles, (…) une conception juste de la tâche historique de la social-démocratie internationale". Lénine insiste encore et encore sur la nécessité d'éduquer des ouvriers conscients ("Lettre à l'Union du Nord du POSDR", 1902) et, pour ce faire, les propagandistes doivent en premier lieu s'éduquer eux-mêmes, ils doivent lire, étudier, acquérir de l'expérience ("Lettre à un camarade sur nos tâches d'organisation", septembre 1902) , il insiste sur le fait que les socialistes se considèrent comme les héritiers du meilleur de la culture passée ("Quel héritage renions-nous ?", 1897). Pour les communistes, la propagande c'est donc l'éducation, le développement de la conscience et de l'esprit critique qui sont inséparables d'un effort volontaire et conscient de la part des ouvriers eux-mêmes pour acquérir cette conscience.
En comparaison, Bernays écrit : "La machine à vapeur, la presse multiple et l'école publique, ce trio de la révolution industrielle, ont ôté le pouvoir aux rois et l'ont donné au peuple. En fait le peuple a gagné le pouvoir que le roi a perdu. Car le pouvoir économique tend à venir après le pouvoir politique ; et l'histoire de la révolution industrielle montre comment ce pouvoir est passé du roi et de l'aristocratie à la bourgeoisie. Le suffrage universel a renforcé cette tendance et, finalement, même la bourgeoisie a peur face au peuple. Car les masses ont promis de devenir les rois.
Aujourd'hui cependant, une réaction est née dans la minorité qui a découvert un moyen puissant pour influencer les majorités. On a ainsi pu façonner l'esprit des masses qui jetteront leur force nouvellement gagnée dans la direction désirée. (…) L'alphabétisation universelle était supposée éduquer le commun des mortels pour qu'il sache contrôler son environnement. Une fois qu'il saurait lire et écrire, il aurait un esprit apte à diriger. Ainsi parlait la doctrine démocratique. Mais au lieu d'un esprit, l'alphabétisation universelle leur a donné des tampons pré-encrés de slogans publicitaires, d'éditoriaux, de données scientifiques publiées, de trivialités des tabloïds et de platitudes historiques, mais rien d'une pensée originale. Le tampon de chacun est le duplicata de millions d'autres de sorte que, quand ces millions sont exposés aux mêmes stimulations, ils reçoivent tous des empreintes identiques. (…)
En réalité, la pratique de la propagande depuis la guerre a pris des formes très différentes de celles qui prévalaient il y a vingt ans. Cette nouvelle technique peut avec justesse être qualifiée de nouvelle propagande.
Elle prend en considération non seulement l'individu, ni même l'esprit de masse seul, mais aussi, et en particulier, l'anatomie de la société, avec ses formations de groupes et de loyautés emboitées. Elle voit l'individu non seulement comme une cellule de l'organisme social mais comme une cellule organisée en une unité sociale. Touche un nerf à un point particulier et tu reçois une réponse automatique de certains membres spécifiques de l'organisme." 6
Bernays a été profondément impressionné par les théories de Freud, en particulier son œuvre Massenpsychologie und Ich-Analyse ("Psychologie des masses et analyse du moi") ; loin de chercher à éduquer et développer l'esprit conscient, il considérait que le travail du propagandiste était de manipuler l'inconscient. "Trotter et Le Bon, écrit-il, ont conclu que l'esprit de groupe ne pense pas dans le sens strict du terme. À la place des pensées, il a des impulsions, des habitudes et des émotions." Par conséquent, "si nous comprenons le mécanisme et les motivations de l'esprit de groupe, n'est-il pas possible de contrôler et d'enrégimenter les masses selon notre volonté sans qu'elles le sachent ?" 7 Au nom de qui une telle manipulation doit-elle être entreprise ? Bernays utilise l'expression "gouvernement invisible" et il est clair qu'il se réfère ici à la grande bourgeoisie ou même à ses échelons supérieurs : "Le gouvernement invisible tend à être concentré entre les mains de quelques-uns à cause de la dépense engendrée par la manipulation de la machine sociale qui contrôle les opinions et les habitudes des masses. Faire de la publicité à une échelle qui atteint des millions de personnes est coûteux. Atteindre et persuader les dirigeants qui dictent les pensées et les actes du public est également coûteux." 8
S'organiser pour la guerre
Le livre de Bernays a été écrit en 1928 et se base en grande partie sur son travail de propagandiste pendant la guerre. Mais en août 1914 ceci appartenait encore au futur. Les gouvernements européens étaient depuis longtemps habitués à manipuler la presse en lui fournissant des histoires et même des articles complets, mais maintenant, cela devait être organisé – comme la guerre elle-même – à une échelle industrielle : le but, comme l'écrivit le général allemand Ludendorff était de "façonner l'opinion publique sans le montrer". 9
Il y a une différence frappante entre la démarche adoptée par les puissances continentales et celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Sur le continent, la propagande était d'abord et avant tout une affaire militaire. L'Autriche fut la plus rapide à réagir : le 28 juillet 1914, alors que la guerre était encore un conflit localisé entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois, le KuK KriegsPressequartier ("Bureau de la presse de guerre impériale et royale") fut créé comme division du haut commandement de l'armée. En Allemagne, le contrôle de la propagande fut divisé au départ entre le Bureau de presse de l'État-major de l'armée et le Nachrichtenabteilung (Service des nouvelles) du Ministère des affaires étrangères qui se limitait à l'organisation de la propagande envers les pays neutres ; en 1917, les militaires créèrent le Deutsche Kriegsnachrichtendienst ("Service allemand des nouvelles de guerre") qui garda le contrôle de la propagande jusqu'à la fin. 10 En France, une Section d'information publiant des bulletins militaires et plus tard des articles fut mise en place en octobre 1914 comme division du renseignement militaire. Sous le général Nivelle, elle devint le Service d'Information pour les armées et c'est cette organisation qui accréditait les journalistes pour le front. Le Ministère des Affaires étrangères avait son propre Bureau de presse et de l'Information et ce n'est qu'en 1916 que les deux fusionnèrent en une Maison de la Presse unique.
La Grande-Bretagne, avec ses 150 ans d'expérience à la tête d'un vaste empire à partir de la population d'une petite île, était à la fois plus informelle et plus secrète. Le War Propaganda Bureau (Bureau de la Propagande de guerre) créé en 1914 n'était pas dirigé par les militaires mais par le politicien libéral Charles Masterman. Il ne fut jamais connu sous ce nom mais simplement sous celui de Wellington House, un immeuble qui abritait la National Insurance Commission que le Bureau de la Propagande utilisait comme façade. Au moins au début11 Masterman se concentra sur la coordination du travail d'auteurs connus comme John Buchan et HG Wells et les publications du Bureau étaient impressionnantes : en 1915, il avait imprimé 2,5 millions de livres et envoyait régulièrement des newsletters à 360 journaux américains. 12 A la fin de la guerre, la propagande britannique était entre les mains de deux magnats de la presse : Lord Northcliffe (propriétaire du Daily Mail et du Daily Mirror) était chargé de la propagande britannique d'abord aux États-Unis puis dans les pays ennemis, tandis que Max Aitken, plus tard Lord Beaverbrook, avait la responsabilité d'un véritable Ministère de l'Information qui devait remplacer le Bureau de la Propagande. Lloyd George, premier ministre britannique pendant la guerre, répondit aux protestations face à l'influence excessive qui était ainsi laissée aux barons de la presse, qu' "il avait pensé que seuls des hommes de presse pouvaient faire le travail" – selon Lasswell ; celui-ci poursuit en remarquant que "les journalistes gagnent leur vie en racontant leurs histoires dans un style bref et précis. Ils savent comment atteindre l'homme de la rue et utiliser son vocabulaire, ses préjugés et ses enthousiasmes (…), ils ne sont pas gênés par ce que le Dr Johnson a appelé ‘des scrupules inutiles’. Ils ressentent les mots, les états d'esprit et ils savent que le public n'est pas convaincu seulement par la logique mais qu'il est séduit par les histoires."13
Quand les Etats-Unis entrèrent en guerre en 1917, leur propagande prit immédiatement un caractère industriel, typique du génie logistique du pays. Selon George Creel qui dirigeait le Committee on Public Information, "une trentaine de livrets furent publiés en plusieurs langues, 75 millions d'exemplaires circulèrent en Amérique et des millions d'autres à l'étranger (…). Les Four-Minute Men 14 dirigeaient le service volontaire de 75 000 orateurs qui opéraient dans 5 200 communautés ; ils atteignirent un total de 775 190 discours 15 (…) ; ils utilisèrent 1 438 dessins préparés par les volontaires pour produire des affiches, affichettes de fenêtre et autres (…). Les films avaient beaucoup de succès commercial en Amérique et étaient efficaces à l'étranger, comme les Pershing's Crusaders ("Les croisés du Général Pershing"), l'American Answer ("La réponse de l'Amérique") et Under 4 Flags ("Sous 4 drapeaux"), etc." 16
La mention de volontaires est significative de la symbiose grandissante entre l'appareil d'État et la société civile qui caractérise le capitalisme d'État démocratique : ainsi l'Allemagne avait-elle sa "Ligue pangermanique" et son "Parti de la Patrie", la Grande-Bretagne son "Conseil des Sujets britanniques loyaux de l'Union de l'Empire britannique", et l'Amérique sa "Ligue patriotique américaine" et son "Ordre patriotique des Fils de l'Amérique" (qui étaient essentiellement des groupes d'auto-défense).
A une échelle plus vaste, l'industrie cinématographique 17 participait à la fois de façon indépendante et sous les auspices du gouvernement ainsi que dans un mélange moins formel des deux. En Grande-Bretagne, le Comité de recrutement parlementaire – qui n'était pas une agence gouvernementale au sens strict mais plutôt un groupement informel de députés – commissionna le film de recrutement You ! en 1915. D'autre part, le premier long métrage de guerre – The Battle of the Somme, 1916 – fut produit par un cartel industriel, le Comité britannique pour les films de guerre, qui paya pour avoir l'autorisation de filmer sur le front et vendit le film au gouvernement. Vers la fin de la guerre en 1917, Ludendorff créa le Universum-Film-AG (connu comme Ufa) dans le but d' "instruction patriotique" ; il était financé en commun par l'État et l'industrie privée et devait, après la guerre, devenir la plus importante compagnie cinématographique privée d'Europe. 18
Pour terminer sur une note technique : peut-être que le plus grand prix gagné grâce à la propagande de guerre fut le soutien des État-Unis. La Grande-Bretagne disposait d'un avantage immense ; dès le début de la guerre la Royal Navy avait coupé le câble transatlantique sous-marin de l'Allemagne et, à partir de ce moment-là, les communications entre l'Europe et l'Amérique ne pouvaient passer que par Londres. L'Allemagne tenta de répondre en utilisant le premier transmetteur radio du monde installé à Nauen mais c'était avant que la radio soit devenue un moyen de communication de masse et son impact resta marginal.
Le but de la propagande
Quel était le but de la propagande ? Sur le plan général, la propagande visait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant : regrouper toutes les énergies matérielles, physiques et psychologiques de la nation et les orienter dans un but unique – la défaite écrasante de l'ennemi.
La propagande directement orientée vers les troupes combattantes était relativement limitée. Cela peut sembler paradoxal mais cela révèle une certaine réalité au fondement de toute propagande : bien que son thème sous-jacent soit un mensonge – l'idée que la nation est unie, surtout les classes sociales, et que tous ont un intérêt commun à la défendre – elle perd de son efficacité quand elle diverge trop de la réalité vécue par ceux qu'elle cherche à influencer. 19
Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes au front raillaient généralement la propagande qui leur était destinée et réussirent à produire leur propre "presse" qui caricaturait la presse jaune qui leur était délivrée dans les tranchées : les Britanniques avaient le Wipers Times 20, les Français avaient Le Rire aux Éclats, Le Poilu et Le Crapouillot. Les troupes allemandes ne croyaient pas non plus à la propagande : en juillet 1915, un régiment saxon à Ypres envoya un message à la ligne britannique leur demandant : "Envoyez-nous un journal anglais pour que nous puissions connaître la vérité".
La propagande était également destinée aux troupes ennemies, les Français et les Britanniques notamment utilisant l'avantage de vents d'Ouest dominants pour envoyer des ballons et lancer des tracts sur l'Allemagne. Il y a peu de preuves que cela ait eu beaucoup d'effet.
La principale cible de la propagande était donc le front intérieur et non les troupes combattantes, et nous pouvons distinguer plusieurs buts dont l'importance varie selon les circonstances spécifiques de chaque pays. Trois ressortent en particulier :
- Le financement de la guerre. Dès le début, il était évident que le budget normal ne couvrirait pas les coûts du conflit qui augmentèrent dramatiquement au cours de la guerre. La solution était de faire appel aux économies accumulées de la nation au moyen des emprunts de guerre qui restaient volontaires, même dans les régimes autocratiques. 21
- Le recrutement pour les forces armées. Pour les puissances du continent européen où le service militaire obligatoire existait depuis longtemps 22, la question du recrutement ne se posait pas vraiment. Dans l'Empire britannique et aux Etats-Unis, il en allait différemment : la Grande-Bretagne n'introduisit la conscription qu'en 1916, le Canada en 1917, tandis qu'en Australie, deux referendums à ce sujet furent rejetés et le pays compta entièrement sur les volontaires ; aux Etats-Unis, un projet de loi était prêt dès que le pays entra en guerre mais le manque d'enthousiasme pour la guerre dans la population était tel que le gouvernement dut en fait "recruter" des américains pour soutenir le projet.
- Le soutien à l'industrie et à l'agriculture. La totalité de l'appareil productif de la nation doit constamment fonctionner à son plus haut rendement et être totalement orienté vers des buts militaires. Inévitablement, cela signifie l'austérité pour la population en général mais cela signifie aussi un grand bouleversement dans l'organisation de l'industrie et de l'agriculture : les hommes sur le front doivent être remplacés dans les champs et dans les usines par les femmes.
Voilà pour le front intérieur. Mais qu'en est-il pour l'étranger ? La guerre de 1914-18 fut pour la première fois dans l'histoire une guerre véritablement mondiale et de ce fait, l'attitude adoptée par les puissances neutres pouvaient avoir une importance critique. La question se posa immédiatement avec le blocus économique britannique de la côte allemande, imposé à tous les navires y compris ceux des puissances neutres : quelle attitude envers cette claire violation des accords internationaux sur la liberté des mers les gouvernements neutres allaient-ils adopter ? Mais l'effort de loin le plus important envers les États neutres fut, de la part des deux côtés, d'amener les Etats-Unis – seule grande puissance industrielle à ne pas s'être impliquée dès le début dans le conflit – à s'engager. L'intervention de l'Amérique au nom de l'Entente n'était absolument pas un résultat donné d'avance : elle pouvait rester neutre et ramasser les morceaux une fois que les Européens se seraient battus jusqu'à l'épuisement ; si elle entrait en guerre, elle pouvait tout aussi bien le faire dans le camp allemand : la Grande-Bretagne était son principal rival commercial et impérial et une vieille antipathie historique existait avec la Grande-Bretagne, remontant à la révolution américaine et à la guerre de 1812 entre les deux pays.
Les ressorts de la propagande
Les objectifs de la propagande que nous venons de présenter sont, en eux-mêmes, rationnels ou, du moins, accessibles à l'analyse rationnelle. Mais ceci ne répond pas à la question que la vaste masse de la population pourrait bien s’être posée : pourquoi devons-nous combattre ? Pourquoi la guerre ? Bref, pourquoi la propagande est-elle nécessaire ? Comment persuader des millions d'hommes de se lancer dans ce maelström de meurtre qu'était le front occidental, année après année ? Comment amener des millions de civils à accepter la boucherie de fils, de frères, de maris, l'épuisement physique du travail à l'usine, les privations du rationnement ?
Le raisonnement des sociétés précapitalistes ne s'applique plus. Comme le souligne Lasswell : "Les liens de loyauté et d'affection personnelles qui attachaient l'homme à son chef étaient dissous depuis longtemps. La monarchie et le privilège de classe avaient rendu l'âme ; l'idolâtrie de l'individu passe pour la religion officielle de la démocratie. C'est un monde atomisé…" 23 Mais le capitalisme n'est pas seulement l'atomisation de l'individu, il a aussi fait naître une classe sociale opposée à la guerre de façon inhérente et capable de renverser l'ordre existant, une classe révolutionnaire différente de toutes les autres parce que sa force politique se fonde sur sa conscience et sa compréhension. C'est une classe que le capitalisme lui-même a été forcé d'éduquer pour qu'elle remplisse son rôle dans le processus de production. Comment s'adresser alors à une classe ouvrière éduquée et formée au débat politique ?
Dans ces conditions, la propagande "est une concession à la rationalité du monde moderne. Un monde instruit, un monde éduqué préfère se développer sur la base d'arguments et d'informations (…) Tout un appareil d'érudition diffusée popularise les symboles et les formes d'appel pseudo-rationnel : le loup de la propagande n'hésite pas à s'habiller en peau de mouton. Tous les hommes éloquents de l'époque – les écrivains, les reporters, les éditeurs, les prêcheurs, les conférenciers, les professeurs, les politiciens – sont mis au service de la propagande et amplifient la voix du maître. Tout est conduit avec le décorum et l'habillage de l'intelligence car c'est une époque rationnelle qui demande que la viande crue soit cuite et garnie par des chefs adroits et compétents". Les masses doivent être gavées d'une émotion inavouable, qui devra donc être savamment cuite et garnie : "Une flamme nouvelle doit étouffer le chancre du désaccord et renforcer l'acier de l'enthousiasme belliqueux." 24
En un sens nous pouvons dire que le problème auquel était confrontée la classe dominante en 1914 était celle de perspectives différentes pour l'avenir : jusqu'à 1914, la Deuxième Internationale avait répété sans cesse, dans les termes les plus solennels, que la guerre qu'elle voyait à juste titre comme imminente serait menée dans l'intérêt de la classe capitaliste et avait appelé la classe ouvrière internationale à s'y opposer par la perspective de la révolution ou, au moins, par la lutte de classe massive et internationale 25 ; pour la classe dominante, la véritable perspective de la guerre, celle d'un épouvantable carnage en défense des intérêts d'une petite classe d'exploiteurs devait à tout prix être cachée. L'État bourgeois devait s'assurer du monopole de la propagande en brisant ou en séduisant les organisations qui exprimaient la perspective de la classe ouvrière et, en même temps, cacher sa propre perspective derrière l'illusion que la conquête de l'ennemi ouvrirait une nouvelle période de paix et de prospérité – un "nouvel ordre mondial" comme l'a dit George Bush dans le passé.
Ceci introduit deux aspects fondamentaux de la propagande de guerre : les "buts de guerre" et la haine de l'ennemi. Les deux sont étroitement liés : "Pour mobiliser la haine de la population contre l'ennemi, représenter la nation adverse comme un agresseur menaçant et meurtrier (…). C'est à travers l'élaboration des buts de guerre que le rôle d'obstruction de l'ennemi devient particulièrement évident. Représenter la nation adverse comme satanique : elle viole tous les standards moraux (les mœurs) du groupe et est une insulte à son estime de soi. Le maintien de la haine dépend du fait de compléter les représentations de l'ennemi menaçant, obstructeur, satanique, par l'assurance de la victoire finale." 26
Déjà avant la guerre, tout un travail avait été mené par des psychologues sur l'existence et la nature de ce que Gustave Le Bon 27 a appelé l'esprit de groupe, forme d'inconscient collectif formé par "la foule" dans le sens de la masse anonyme d'individus atomisés, coupés des obligations et des liens sociaux, qui est caractéristique de la société capitaliste, en particulier de la petite bourgeoisie.
Lasswell commente que "Toutes les écoles de pensée psychologique semblent être d'accord (…) sur le fait que la guerre est un type d'influence qui a de grandes capacités de libération des impulsions réprimées et autorise leur manifestation externe de façon directe. Il y a donc un consensus général selon lequel la propagande peut compter sur des alliés très primitifs et puissants pour mobiliser ses sujets dans la haine guerrière de l'ennemi". Il cite également John A Hobson, The psychology of jingoism (1900), 28 qui parle d' "un patriotisme grossier, nourri par les rumeurs les plus sauvages et les appels les plus violents à la haine et au désir animal de sang [qui] passe par contagion rapide dans la vie des foules des villes et se rend partout attractif par la satisfaction qu'il accorde aux désirs insatiables et sensationnels. C'est moins le sentiment sauvage de sa participation personnelle à la mêlée que le sentiment d'une imagination névrotique qui marque le Jingoisme." 29
Néanmoins, il y a ici une certaine contradiction. Le capitalisme, comme l'a dit Rosa Luxemburg, aime se présenter et, en fait, a une image de lui-même comme étant civilisé 30 ; cependant sous la surface gît un volcan bouillonnant de haine et de violence qui finalement explose ouvertement – ou est mis en action par la classe dominante. La question subsiste : cette violence est-elle un retour à des instincts primaires agressifs ou est-elle causée par la nature névrotique, antihumaine de la société capitaliste ? Il est certain que les êtres humains ont des instincts agressifs, asociaux comme ils ont des instincts sociaux. Cependant, il y a une différence fondamentale entre la vie sociale des sociétés archaïques et celle du capitalisme. Dans les premières, l'agression est contenue et régulée par l'ensemble du réseau d'interactions et d'obligations sociales en dehors desquelles la vie n'est pas seulement impossible mais même inimaginable. Dans le capitalisme, la tendance est au détachement de l'individu de tous les liens et de toutes les responsabilités sociales. 31 D'où un immense appauvrissement émotionnel et un manque de résistance aux instincts antisociaux.
Un élément important dans la culture de la haine dans la société capitaliste est la conscience coupable. Celle-ci n’est pas née avec le capitalisme : au contraire, si nous suivons le raisonnement de Freud elle est un acquis très ancien de la vie culturelle de l’homme. La capacité des êtres humains de réfléchir et de choisir entre deux actions différentes les met devant le bien et le mal, et donc des conflits moraux. Une conséquence de cette liberté même est le sentiment de culpabilité, qui est un produit de la culture avec sa source dans la capacité de réfléchir mais qui reste néanmoins en grande partie inconsciente et donc susceptible de manipulation. Un des moyens par lesquels l’inconscient gère la culpabilité est à travers la projection : le sentiment de culpabilité est projeté sur "l’autre". La haine de soi de la conscience coupable est soulagée par la projection vers l’extérieur, contre ceux qui souffrent de l’injustice et qui sont donc la cause du sentiment coupable. On pourrait objecter que le capitalisme n'est pas la première société dans laquelle le meurtre, l'exploitation et l'oppression ont existé – et c'est évidemment juste. La différence avec toutes les sociétés précédentes, c'est que le capitalisme prétend être basé sur "les droits de l'homme" : quand Genghis Khan massacrait la population de Khorasan, il ne prétendait pas le faire pour leur bien. Les peuples opprimés, asservis, exploités du capitalisme impérialiste pèsent sur la conscience de la société bourgeoise quelles que soient les auto-justifications (habituellement soutenues par l'église) qu'il peut inventer pour lui-même. Avant la Première Guerre mondiale, la haine de la société bourgeoise était dirigée logiquement contre les secteurs les plus opprimés de la société : c’est ainsi que les prédécesseurs des images haineuses de l’Allemand se trouvent dans les caricatures des Irlandais en Grande-Bretagne, ou des Noirs aux États-Unis, en particulier.
La haine de l'ennemi est bien plus efficace si elle peut être combinée à la conviction de sa propre vertu. Haine et humanitarisme sont donc de bons compagnons en temps de guerre.
Il est frappant que les régimes autocratiques plus arriérés d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ne furent pas capables de manier ces outils avec le succès et la sophistication de la Grande-Bretagne, de la France puis, plus tard, de l'Amérique. La plus caricaturale à cet égard est l'Autriche-Hongrie, empire multi-ethnique tentaculaire, en grande partie composé de minorités contaminées par un nationalisme indiscipliné. Sa caste dominante, aristocratique et semi-féodale, coupée des aspirations de sa population, n'avait rien de l'absence de scrupules versatile d'un Poincaré, d'un Clémenceau ou d'un Lloyd George. Sa vision sociale était limitée au cercle de Vienne, ville multiculturelle dont Stefan Zweig pouvait écrire que "la vie était douce dans cette atmosphère de conciliation spirituelle et, à son insu, chaque bourgeois de cette ville recevait d'elle une éducation à ce cosmopolitisme qui répudiait tout nationalisme étroit, qui l'élevait à la dignité de citoyen du monde." Il n'est pas étonnant que dans la propagande austro-hongroise soient combinés une imagerie médiévale et un style art nouveau : St George écrasant un ennemi incarné par un dragon anonyme et mythique ; ou un beau prince portant une armure étincelante et escortant sa dame vers le royaume lumineux de la paix (les deux affiches visent les emprunts de guerre).32

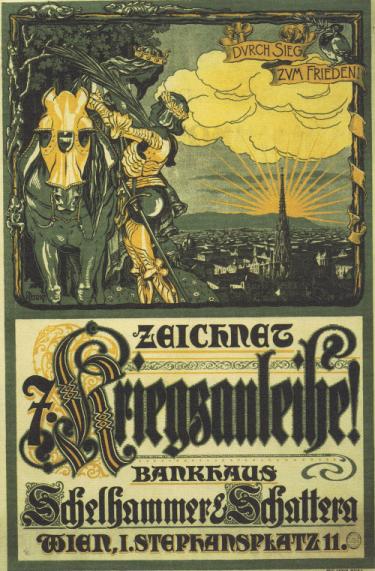
Malgré tout son autoritarisme prussien brutal, la caste aristocratique allemande conservait encore un certain sens de Noblesse oblige, au moins dans la vision qu'elle avait d'elle-même et qu'elle cherchait à montrer au monde extérieur. Selon Lasswell, l'inefficacité allemande provenait du manque d'imagination des militaires allemands qui gardèrent le contrôle de la propagande tout au long de la guerre ; mais il y avait plus que cela : début 1915, le Leitsätze der Oberzensurstelle (le bureau de la censure) établit pour les journalistes les lignes directrices suivantes : "Le langage envers les États ennemis peut être dur (…). La pureté et la grandeur du mouvement qui a saisi notre peuple requièrent un langage digne (…). Les appels barbares à la guerre, à l'extermination des autres peuples sont dégoûtants ; l'armée sait où doit régner la sévérité et où doit régner la clémence. Notre bouclier doit rester pur. Des appels de ce type de la part de la presse jaune ennemie ne sont pas une justification pour que nous adoptions nous-mêmes un même comportement."
La Grande-Bretagne et la France n'avaient pas de tels scrupules, comme on peut constater dans la carte postale française reproduite ci-dessous, ni non plus l'Amérique. 33
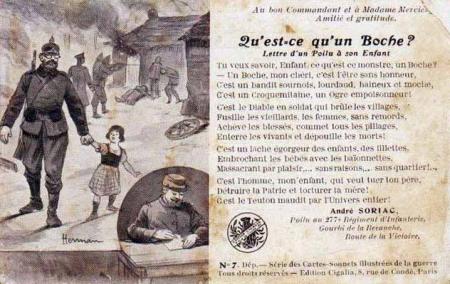
Le contraste entre la façon dont la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont traité l'affaire Edith Cavell est frappante à cet égard. Edith Cavell était une infirmière britannique qui travaillait en Belgique pour la Croix rouge. En même temps, elle aidait les troupes britanniques, françaises et belges à gagner l'Angleterre via la Hollande (il a été également suggéré sans être confirmé qu'elle travaillait pour le renseignement britannique). Cavell fut arrêtée par les Allemands, jugée, déclarée coupable de trahison sous la loi militaire allemande et exécutée par un peloton en 1915. Ce fut un cadeau du ciel pour les Britanniques qui firent un énorme scandale ayant pour but le recrutement en Grande-Bretagne et le discrédit de la cause allemande aux États-Unis. Un torrent d'affiches, de cartes postales, de brochures et même de timbres postes maintinrent constamment le destin tragique de l'infirmière Cavell devant les yeux du public (sur l'affiche, elle apparaît bien plus jeune qu'elle n'était).
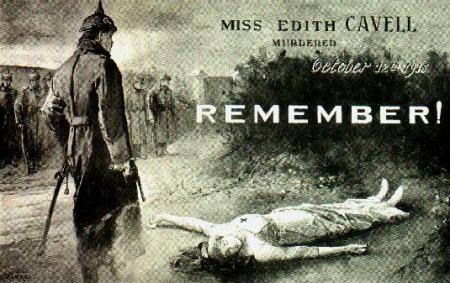
Non seulement l'Allemagne se montra totalement incapable de répondre mais tout autant de saisir des occasions. "Peu de temps après que les Alliés eurent fait le plus phénoménal vacarme autour de l'exécution de l'infirmière Cavell, les Français exécutèrent deux infirmières allemandes dans des circonstances tout à fait similaires", nous dit Lasswell. 34 Un journaliste américain demanda à l'officier chargé de la propagande allemande pourquoi ils n'avaient pas "fait un boucan d'enfer autour des infirmières que les Français avaient tuées l'autre jour", à quoi l'Allemand répondit : "Quoi ? Protester ? Les Français avaient parfaitement le droit de les exécuter !"
La Grande-Bretagne utilisa à fond l'occupation de la Belgique par l'Allemagne, non sans une bonne dose de cynisme puisque en fait l'invasion allemande contrecarrait tout simplement les plans de guerre britanniques. Elle propagea des histoires d'atrocités les plus macabres : les troupes allemandes tuaient les bébés à coups de baïonnette, faisaient de la soupe avec les cadavres, attachaient les prêtres la tête en bas au battant de la cloche de leur propre église, etc. Pour donner plus de véracité à ces contes fantaisistes, la Grande-Bretagne commissionna un rapport sur "Les prétendues atrocités allemandes", sous la responsabilité de James Bryce qui avait été un ambassadeur respecté aux États-Unis (1907-1913) et était connu comme un érudit imprégné et amateur de culture allemande (il avait étudié à Heidelberg) – présentant ainsi beaucoup de garanties d'impartialité. Puisque les atrocités sont inévitables quand une armée de conscrits commandée par des incompétents politiques est engagée au milieu d'une population civile révoltée 35, certains des cas condamnés par le "Rapport Bryce" sous le nom duquel il fut connu, étaient certainement vrais. Cependant, il est certain que le comité ne pouvait interviewer aucun témoin des atrocités supposées et que la majorité des cas était pure invention, en particulier les contes les plus révoltants de viol et de mutilation. Les Alliés n'étaient pas non plus au-dessus d'une touche de sensationnalisme pornographique, publiant des affiches de femmes dans des poses dénudées suggestives, appel simultané à la pruderie et à la grivoiserie.
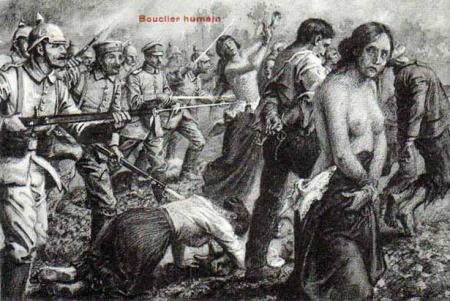
Les appels à aider les veuves et les orphelins belges lancés par des organisations comme le Committee for Belgian Relief (Comité pour l'aide à la Belgique), avec l'aide d'un illustre panel de stars de la littérature comprenant (en Grande-Bretagne) Thomas Hardy, John Galsworthy et George Bernard Shaw parmi les plus connus 36 ou les appels à alimenter des fonds pour la Croix rouge belge sont les précurseurs des interventions militaires "humanitaires" d'aujourd'hui (bien qu'on hésite à comparer le "talent" d'un Bernard Henri-Lévy à celui de Thomas Hardy). La détresse de la Belgique fut utilisée encore et encore dans toutes sortes de contextes : pour le recrutement, pour dénoncer la barbarie allemande ou encore le mépris pernicieux de ce pays pour les traités diplomatiques (beaucoup a été dit sur le reniement par l'Allemagne de son engagement à honorer et à défendre la neutralité de la Belgique) et, par-dessus tout, pour gagner la sympathie de l'Amérique à la cause franco-britannique.
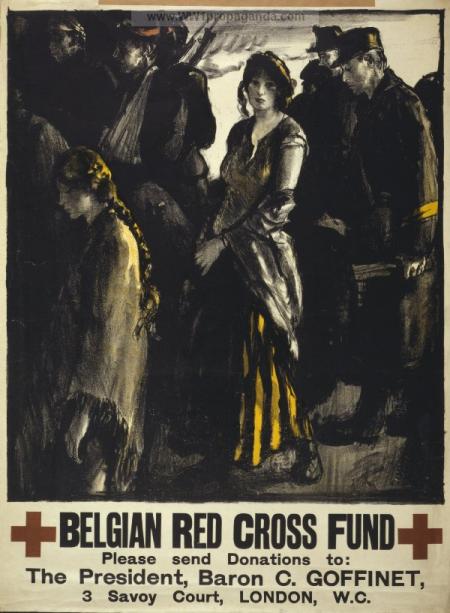
Les tentatives de l'Allemagne de répondre à ce barrage de campagnes haineuses de la part des Alliés, basées sur des histoires d'atrocités et une animosité culturelle, restèrent légalistes, au pied de la lettre et sans imagination. En effet, l'Allemagne restait sur la défensive et était constamment forcée de répondre aux attaques des Alliés mais n'utilisait pas efficacement les infractions des Alliés à la loi internationale – comme on l'a vu dans le cas Cavell.
Parlant des campagnes de haine et des atrocités, Lasswell écrit que : "Il est toujours difficile pour beaucoup d'esprits simples de la nation de mettre un visage sur un ennemi aussi vaste que toute une nation. Ils ont besoin d'avoir des individus sur qui porter leur haine. Il est donc important de distinguer une poignée de chefs ennemis et de leur faire porter le décalogue de tous les péchés." Et il poursuit : "Personne n'a été aussi maltraité de cette façon que le Kaiser". 37 Le Kaiser était présenté comme l'incarnation de tout ce qui est barbare, militariste, brutal, autocratique – "le chien fou de l'Europe" comme l'avait baptisé le Daily Express britannique, ou même "la bête de l'Apocalypse" selon le journal Liberté à Paris. On peut faire un parallèle évident avec l'utilisation de Saddam Hussein ou Osama Ben Laden par la propagande pour justifier les guerres en Irak et en Afghanistan.
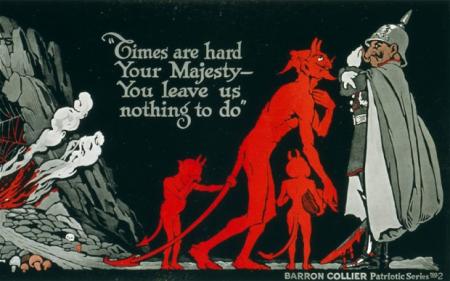
La haine de ce qui est différent, de tout ce qui n'appartient pas au groupe, est une puissante force d'unification psychologique. La guerre – et avant tout la guerre totale des masses nationales – requiert que les énergies psychologiques de la nation soient soudées en une tension unique. Toute la nation doit être consciente d'elle-même en tant qu'unité, ce qui veut dire éradiquer de la conscience le fait indubitable que cette unité n'existe pas, qu'elle est un mythe, puisqu'en réalité la nation est composée de classes opposées ayant des intérêts antagoniques. Une façon de réaliser cela est de distinguer une figure de proue de l'unité nationale, qui peut être réelle, symbolique ou les deux. Les régimes autocratiques avaient leur chef : le Tsar en Russie, le Kaiser en Allemagne, l'Empereur en Autriche-Hongrie. La Grande-Bretagne avait le Roi et l'image symbolique de Britannia, la France et les États-Unis avaient la République, respectivement incarnées par Marianne et par Liberty. L'inconvénient de ce symbolisme positif est qu'il peut être critiqué, en particulier si la guerre tourne mal. Le Kaiser après tout était aussi le symbole du militarisme prussien et de la domination des Junkers qui étaient loin de soulever un enthousiasme universel en Allemagne ; le Roi en Grande-Bretagne pouvait aussi être associé à la caste dominante, aristocratique, arrogante et privilégiée. La haine dirigée à l'extérieur de la nation, contre l'ennemi, ne présentait pas de tels désavantages. Les défaites de la personnalité haïe peuvent le rendre méprisable mais jamais moins haïssable tandis que ses victoires ne font que le rendre plus haïssable encore : "…le chef ou l'idée [peuvent] revêtir pour ainsi dire un caractère négatif, c'est-à-dire où la haine pour une personne déterminée [est] susceptible d'opérer la même union et de créer les mêmes liens affectifs que s'il agissait d'un dévouement positif à l'égard de cette personne." 38 Nous sommes tentés de dire que plus la société est fracturée, atomisée, plus aigües sont les véritables contradictions de classe en son sein, plus grand est le vide émotionnel et spirituel de sa vie mentale, plus grandes sont ses réserves de frustration et de haine et plus efficacement celles-ci peuvent être dirigées en haine contre un ennemi extérieur. Ou, pour le dire autrement, plus la société a évolué vers un totalitarisme capitaliste développé, qu'il soit stalinien, fasciste ou démocratique, plus la classe dominante utilisera la haine de l'extérieur comme moyen d'unifier un corps social atomisé et divisé.
Ce n'est qu'en 1918 qu'apparurent en Allemagne des affiches dont on peut dire qu'elles préfiguraient la propagande anti-juive nazie. Elles n'étaient pas dirigées contre les ennemis militaires de l'Allemagne mais contre la menace interne incarnée par la classe ouvrière et, en particulier, contre son élément le plus combatif, le plus conscient et le plus dangereux : Spartacus.
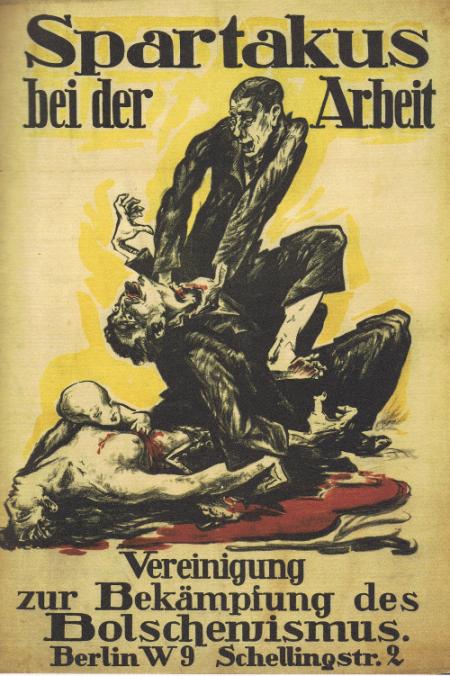
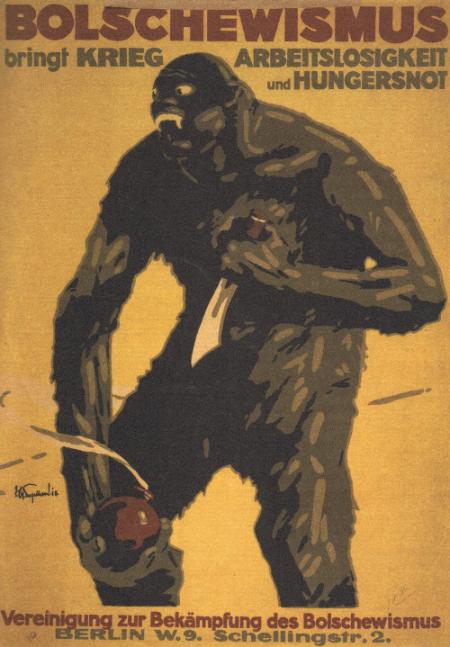
Ces affiches étaient reproduites à la fois par l' "Union de lutte contre le bolchevisme" de droite, alliée aux unités de corps-francs composées de soldats démobilisés et d'éléments lumpen qui allaient assassiner Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sur l'ordre du gouvernement social-démocrate. On se demande ce que les ouvriers pensaient de l'idée que le bolchevisme était responsable "[de la] guerre, [du] chômage et [de la] faim" comme le prétend l'affiche.
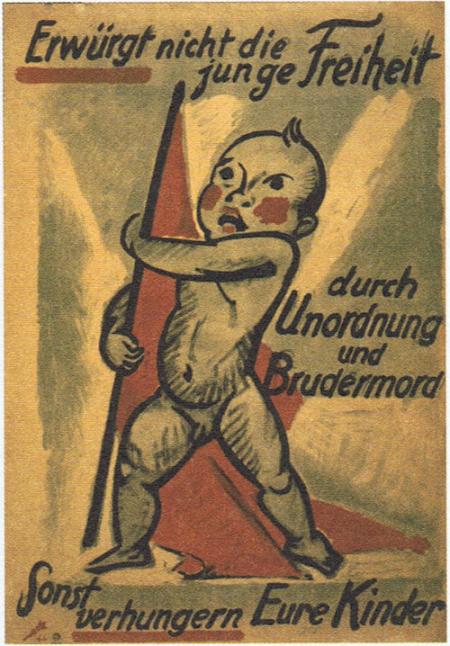
Tout comme le SPD a utilisé les corps-francs tout en les désavouant, l'affiche (ci-dessus) – vraisemblablement une affiche de la social-démocratie puisque le bébé étreint un drapeau rouge - évite de se référer directement au bolchevisme ou à Spartakus mais transmet pourtant le même message : "N'étranglons pas le bébé Liberté avec le désordre et le crime ! Sinon, nos enfants mourront de faim !"
La psychologie de la propagande
Pour Bernays, comme on l'a vu plus haut, la propagande ciblait "les impulsions, les habitudes et les émotions" des masses. Il nous semble indéniable que les théories de Le Bon, de Trotter et de Freud sur l'importance majeure de l'inconscient et, surtout, ce que Bernays appelle "l'esprit de groupe" ont fortement influencé la production de la propagande, au moins dans les pays alliés. Cela vaut donc la peine d'examiner ses thèmes à cette lumière. Plutôt que de nous préoccuper du message très direct – "Soutiens la guerre" – examinons quel est son véhicule : la source émotionnelle que la propagande cherchait à mettre à son service.
Nous sommes frappés d'abord par le fait que cette société extrêmement patriarcale, engagée dans une guerre dans laquelle les combattants sont tous des hommes et où la guerre est toujours un domaine strictement masculin, choisit des femmes comme symbole national : Britannia, Marianne, Liberty, Rome éternelle. Ces figures féminines peuvent être extrêmement ambigües. Britannia – un mélange d'Athéna et de l'autochtone Boadicée – tend à être sculpturale et royale mais elle peut également être maternelle, explicitement parfois ; Marianne à la poitrine dénudée est généralement héroïque mais elle peut avoir une allure simple à l'occasion, tout comme Roma ; Liberty parvient à jouer sur tous les tableaux – majestueuse, maternelle et séduisante tout à la fois.


La Grande-Bretagne et l'Amérique ont aussi leur symbole paternel : John Bull et Oncle Sam, tous deux sont présentés s'adressant sévèrement à l'extérieur de leur affiche "Wanting YOU ! For the armed forces".(…). Une affiche britannique présente avec optimisme un mariage entre Britannia et l'Oncle Sam.
Le véritable art de la propagande réside dans le fait de suggérer plutôt que de dire clairement, et cette combinaison ambigüe ou plutôt cette confusion de l'imagerie convie le message à travers toutes les émotions puissantes de l'enfance et de la famille. La culpabilité alimentée par le désir sexuel et la honte sexuelle est un puissant conducteur, en particulier pour les hommes jeunes vers qui sont dirigées les campagnes de recrutement. Ceci était critique dans les pays "anglo-saxons" dans lesquels la conscription fut tardivement introduite (Grande-Bretagne, Canada), ou très controversée (États-Unis) ou rejetée (Australie). En Grande-Bretagne, l'utilisation de la honte sexuelle était absolument explicite dans la "White Feather Campaign" orchestrée par l'amiral Charles Fitzgerald, avec le soutien enthousiaste des suffragettes et de ses dirigeantes, Emmeline et Christabel Pankhurst : dans cette campagne, de jeunes femmes étaient recrutées pour remettre une plume blanche –symbole traditionnel de lâcheté - aux hommes qui ne portaient pas l'uniforme. 39
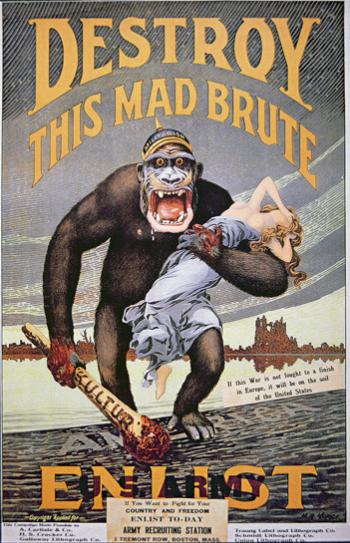
Le "King-Kong" coiffé d'un casque allemand (voir l'affiche ci-dessus) et portant une femme à demi-nue est une tentative typiquement américaine de manipuler les sentiments d'insécurité sexuelle. Le singe noir ravissant l'innocente blanche est un thème classique de la propagande anti-noire qui prévalut aux États-Unis jusque dans les années 1950 et 1960, qui jouait sur l' "animalité" et les prouesses sexuelles supposées des hommes noirs, dépeints comme une menace pour les femmes blanches "civilisées" et , évidemment par conséquent, pour son "protecteur" masculin. 40 Ceci permit à l'aristocratie des planteurs blancs dans le Sud des États-Unis d'attacher "la racaille blanche pauvre" à la défense de l'ordre existant de ségrégation et de domination de classe et à le soutenir, alors que ses véritables intérêts matériels auraient dû faire de ces travailleurs les alliés naturels des travailleurs noirs. 41 Le mythe de "la supériorité blanche" et le cortège d'émotions qui l'accompagnent de honte, de peur, de domination et de violence sexuelles infestaient la société américaine, y compris la classe ouvrière – avant la Première Guerre mondiale, le seul syndicat à avoir des sections dans lesquelles blancs et noirs étaient sur pied d'égalité était les syndicalistes-révolutionnaires IWW. 42
L'autre face de la pièce de la honte et de la peur sexuelles est l'image de "l'homme protecteur". Le soldat moderne, un travailleur en uniforme dont la vie dans les tranchées était faite de boue, de poux et de l'imminence de la mort sous les obus et les balles d'un ennemi qu'il ne voyait même pas, est dépeint encore et toujours comme le galant défenseur du foyer contre un ennemi bestial (souvent invisible).
Par ce biais, la propagande réussit un véritable détournement d’un des principes premiers du prolétariat : la solidarité. Depuis ses débuts la classe ouvrière a dû lutter pour la protection des femmes et des enfants, en particulier pour les soustraire des emplois les plus dangereux ou malsains, pour limiter leurs heures de travail, ou pour leur interdire le travail de nuit. En protégeant la fonction reproductrice assurée par les femmes, le mouvement ouvrier mettait en œuvre la solidarité entre les deux sexes, mais aussi envers les générations futures, tout comme la mise en place des premières caisses de retraite non contrôlées par l’État exprimait la solidarité envers les anciens ne pouvant plus travailler.
En même temps, et cela dès ses origines, le marxisme a à la fois défendu l'égalité des sexes comme condition sine qua non de la société communiste et a montré que l'émancipation des femmes à travers le travail salarié constituait une précondition de cet objectif.
Il est néanmoins indéniable que les attitudes patriarcales étaient profondément ancrées dans l'ensemble de la société et y compris dans la classe ouvrière : on ne se débarrasse pas de millénaires de patriarcat en quelques décennies. Afin d’affirmer leur indépendance, les femmes devaient toujours s’organiser dans des sections spéciales au sein des partis socialistes et des syndicats. A ce titre, l’exemple de Rosa Luxemburg est parlant : la direction du SPD a cru pouvoir réduire son influence en la poussant à se cantonner à l’organisation des "affaires féminines", ce qu’elle refusa net. La propagande chercha à subvertir la solidarité envers les femmes pour la transformer en idéal "chevaleresque" de protection des femmes, qui est évidemment la contrepartie de la réalité du statut inférieur des femmes dans la société de classe.
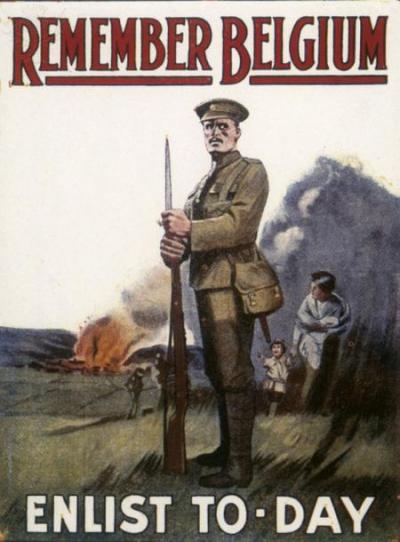
Cette idée d'un devoir masculin – plus particulièrement le devoir du chevalier – qui protège "la veuve et l'orphelin", les pauvres et les opprimés, plonge profondément ses racines dans la civilisation européenne, remontant aux efforts de l'église médiévale d'établir son autorité morale sur l'aristocratie guerrière. Il peut sembler "tiré par les cheveux" de faire le lien entre la propagande de 1914 avec une idéologie promue pour des raisons tout-à-fait différentes il y a mille ans. Mais les idéologies restent comme un sédiment dans les structures mentales de la société, même quand leurs sous-bassements matériels sont dépassés. De surcroit, ce qu’on ne peut qu’appeler le "médiévalisme" était utilisé par la bourgeoisie et la petite bourgeoisie en Allemagne et en Grande Bretagne – et donc par extension aux États-Unis – pendant la grande période d’industrialisation au 19e siècle afin d’asseoir le principe national. En Allemagne, où l’unité nationale était à construire, il y avait un effort tout à fait conscient de créer la vision d’un "volk" unifié par une culture commune ; cela se voit, par exemple, dans le grand projet des frères Grimm de ressusciter la culture populaire des contes et des légendes. En Grande Bretagne, la notion des "libertés des anglais libres" remontait à la Grande Charte signé par le roi Jean en 1206. Les références médiévales y exercèrent une forte influence en architecture, non seulement dans la construction d'églises – aucun quartier victorien ne pouvait exister sans église pseudo-médiévale – mais aussi dans celle des institutions scientifiques comme le magnifique Museum of Natural History ou des gares de chemin de fer comme St Pancras (tous deux à Londres).43 Non seulement les travailleurs vivaient dans un espace marqué par l'imagerie médiévale, les mêmes références pénétrèrent dans le mouvement ouvrier, par exemple dans le roman utopiste de Willam Morris, News from Nowhere ("Nouvelles de nulle part"). Même aux États-Unis, le premier véritable syndicat s'appelait "Knights of Labor" ("Les chevaliers du travail"). Les idéaux aristocratiques de "chevalerie" et de "galanterie" étaient donc très présents – et très réels – dans une société qui, sur le plan de la vie économique quotidienne, s'adonnait à l'avarice, à l'exploitation du travail la plus impitoyable et vivait un implacable conflit entre les classes capitaliste et prolétarienne.
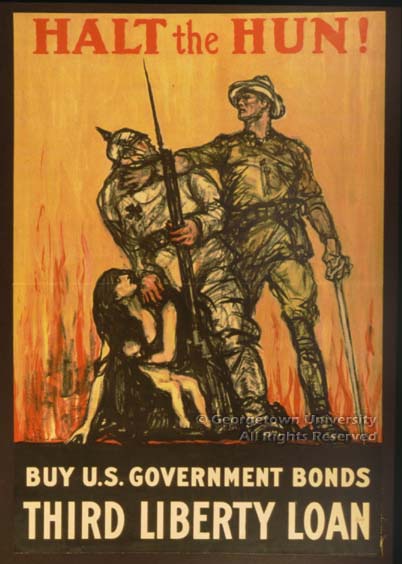
Si la propagande détournait la solidarité entre les sexes vers une idéologie chevaleresque réactionnaire, elle faisait également main basse sur la solidarité masculine entre ouvriers d’usine. En 1914, tous les ouvriers savaient quelle importance avait la solidarité sur les lieux de travail. Mais malgré l'Internationale, le mouvement ouvrier restait une collection d'organisations nationales : la solidarité au jour le jour s'exerçait envers des visages familiers. C'est surtout la propagande de recrutement qui a utilisé ces thèmes et nulle part plus qu'en Australie où la conscription n'existait pas. Montrer sa solidarité n'était plus lutter avec ses camarades contre la guerre, mais se joindre à ses camarades en uniforme, sur le front. Puisque ceci était nécessairement une solidarité masculine, il y a – comme dans "la défense de la famille" – une forte tonalité "masculine" dans beaucoup de ces affiches.
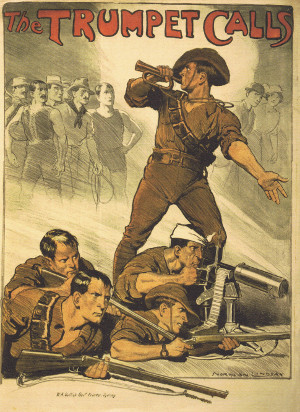
Inévitablement, la fierté et la honte vont ensemble de sorte que la fière affirmation de la masculinité qui accompagne (ou est supposée accompagner) le fait d'appartenir aux combattants comporte, comme contrepartie, la culpabilité de ne pas accomplir sa part et de ne pas partager les souffrances viriles de ses camarades. C'était peut-être un tel mélange d'émotions qui ont amené le poète Wilfred Owen à retourner au front après s'être remis d'une dépression nerveuse, malgré son horreur de la guerre et son profond dégoût pour les classes dominantes – et la presse jaune – qu'il tenait pour responsables de celle-ci. 44
Freud pensait non seulement que "l'esprit de groupe" était dirigé par l'inconscient émotionnel mais qu'il représentait un retour atavique à un état mental plus primitif caractéristique des sociétés archaïques et de l'enfance. Le moi, avec son calcul conscient habituel de son propre avantage, pouvait être submergé par "l'esprit de groupe" et, dans ces conditions, capable d'actions que l'individu n'envisagerait pas, autant pour le meilleur que pour le pire, capable d'une grande sauvagerie ou d'un grand héroïsme. Bernays et ses propagandistes partageaient sans aucun doute ce point de vue, du moins jusqu'à un certain point, mais ils étaient plus intéressés par les mécanismes de la manipulation que par la théorie et ils ne partageaient certainement pas le profond pessimisme de Freud sur la civilisation humaine et ses perspectives, surtout après l'expérience de la Première Guerre mondiale. Là où Freud était un scientifique dont le but était de développer la compréhension d'elle-même de l'humanité en rendant l'inconscient conscient, Bernays – et ses employeurs bien sûr- n'étaient intéressés par l'inconscient que dans la mesure où cela permettait de manipuler une masse qui devait rester inconsciente. Lasswell considère qu'on peut participer de "l'esprit de groupe" même si on est seul ; il dit que la propagande cherche à être omniprésente dans la vie de l'individu, à saisir toutes les occasions (publicités dans la rue, dans les transports, dans la presse) pour agir sur sa pensée en tant que membre du groupe. Nous touchons ici toute une série de questions bien trop complexes pour être traitées dans cet article : le rapport entre la psychologie individuelle profondément influencée par l'histoire personnelle et les "énergies psychologiques" dominantes (en l'absence d'un meilleur terme) dans l'ensemble de la société. Mais, à notre avis, il n'y a pas de doute que de telles "énergies psychologiques" existent et que les classes dominantes les étudient et cherchent à les utiliser pour manipuler les masses à leurs propres fins. C'est à leur propre péril si les révolutionnaires les ignorent – y compris parce qu'ils n'existent pas en dehors de la société bourgeoise et sont également soumis à son influence.
Aujourd'hui, la propagande guerrière de 1914 peut sembler naïve, absurde, grotesque même. La naïveté du 19e siècle a été cautérisée dans la société par deux guerres mondiales et cent ans de décadence et de guerres barbares. Le développement du cinéma, de la télévision et de la radio, l'omniprésence des médias visuels et l'éducation universelle qu'exige le processus de production ont rendu la société plus sophistiquée ; elle est également peut-être plus cynique. Mais cela ne l'immunise pas contre la propagande. Au contraire, non seulement les techniques de propagande ont été constamment raffinées, ce qui par le passé était simplement de la publicité commerciale est devenu l'une des principales formes de la propagande.
La publicité – comme Bernays disait qu'elle devait être – a depuis longtemps cessé d'être simplement de la pub pour des produits, elle promeut une vision du monde dans lequel le produit devient désirable et cette vision du monde est profondément, viscéralement bourgeoise (et petite-bourgeoise) et réactionnaire, et jamais plus que lorsqu'elle se prétend "rebelle".
Mais les buts de la propagande de la bourgeoisie ne sont pas seulement d'inculquer et de propager ; c'est aussi, peut-être même avant tout, de dissimuler, de cacher. Rappelons ce qu'écrivait Lasswell que nous avons cité au début de l'article : "Il ne faut pas que la guerre ait pour cause un système mondial d'affaires internationales ou la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes…" La différence avec la propagande communiste est saisissante car les communistes (comme Rosa Luxemburg l'a fait dans la Brochure de Junius) ont pour but de révéler, de mettre à nu, de rendre compréhensible l'ordre social auquel le prolétariat est confronté et donc d'ouvrir le changement révolutionnaire. La classe dominante cherche à submerger la pensée rationnelle et la connaissance consciente de l'existence sociale, elle cherche par le biais de la propagande de se servir de l’inconscient afin de manipuler et d’asservir. Ceci est d’autant plus vrai que la société est "démocratique", car là où il y a un semblant de choix et de "liberté" il faut s’assurer que la population fait "le bon choix" en toute liberté. Ainsi, le 20e siècle voit à la fois la victoire de la démocratie bourgeoise, et la montée en puissance et en sophistication de la propagande. La propagande des communistes au contraire cherche à aider la classe révolutionnaire à se libérer de l’emprise de l’idéologie de la société de classe y compris lorsque celle-ci est enfouie profondément dans l’inconscient. Elle cherche à allier la conscience rationnelle au développement des émotions sociales et à rendre chaque individu conscient de lui-même non comme un atome impuissant mais comme un maillon de la grande association qui s'étend non seulement géographiquement – parce que la classe ouvrière est par essence internationaliste – mais, également, historiquement, à la fois dans le passé et dans le futur qui doit être construit.
Jens / Gianni, 7 juin 2025
1 Propaganda, Ig Publishing 2005.
2 Un livre du pacifiste britannique, Arthur Ponsonby, Falsehood in wartime ("Mensonges en temps de guerre") publié en 1928 provoqua un énorme tollé car il rendait compte de façon détaillée du caractère mensonger des histoires colportées à grande échelle sur les atrocités commises par les Allemands : il fut réédité 11 fois entre 1928 et 1942.
3 Edward Bernays (1891-1995) est né à Vienne ; c’était le neveu de Sigmund Freud et de sa femme Anna Bernays. Sa famille déménagea à New York l’année qui suivit sa naissance mais, adulte, il resta en contact étroit avec son oncle et fut très influencé par ses idées ainsi que par les études sur la psychologie des foules publiées par Gustave Le Bon et William Trotter. Aux dires de tous, il fut profondément impressionné par l’impact que le Président américain, Woodrow Wilson, eut sur les foules européennes quand il fit le tour du continent à la fin de la guerre ; il attribua ce succès à la propagande américaine pour le programme de paix en "14 points" de Wilson. En 1919, Bernays ouvrit un bureau comme "Conseiller en Relations publiques" et devint un manager reconnu et très influent dans les campagnes de publicité pour de grandes compagnies américaines, en particulier pour le tabac américain (les cigarettes Lucky Strike) et la compagnie United Fruit. On peut considérer son livre Propaganda comme une publicité envers des clients potentiels. Toutes les citations du livre dans cet article sont traduites en français par nous.
4 Un exemple classique du rapport symbiotique entre la propagande étatique et les 'Relations publiques' privées est la campagne de publicité de 1954, dont la compagnie de Edward Bernays fut le cerveau ; au nom de la United Fruit Corporation, elle justifiait le renversement commandité par la CIA du gouvernement guatémaltèque récemment élu (qui avait l'intention de nationaliser les terres non cultivées détenues par la United Fruit) et son remplacement par un régime militaire d'escadrons de la mort fascistes, tout cela au nom de "la défense de la démocratie". Les techniques utilisées contre le Guatemala en 1954 avaient été esquissées par les bureaux étatiques de propagande au cours de la Première Guerre mondiale.
5 Harold Lasswell, Propaganda technique in the World War [3], 1927. Traduit de l'anglais par nous comme toutes les citations suivantes. Harold Dwight Lasswell (1902-1978) était à son époque l'un des principaux spécialistes américains en Science politique ; il introduisit le premier dans la discipline de nouvelles méthodes basées sur les statistiques, l'analyse de contenu, etc. Il s'intéressait particulièrement à l'aspect psychologique de la politique et au fonctionnement de "l'esprit de groupe". Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il travailla pour l'unité de guerre politique de l'armée. Bien qu'élevé dans une petite ville de l'Illinois, il fit des études importantes, et connut les travaux de Freud par l'entremise d'un de ses oncles, et ceux de Marx et Havelock Ellis par l'un de ses professeurs. Sa thèse de doctorat en 1927 que nous citons largement dans cet article fut probablement la première étude en profondeur de ce sujet.
6 Edward Bernays, op.cit. Propaganda, p. 47, 48, 55.
7 Op.cit., p. 73 et p. 71
8 Op.cit, p. 63
9 Lasswell, op.cit., p. 28
10 Voir Niall Ferguson, The Pity of War, Penguin Books, 1999, p. 224-225, traduit de l'anglais par nous.
11 Cf. notre article sur "L'Art et la propagande" (https://fr.internationalism.org/revue-internationale/201505/9218/lart-et... [4])
12 Ferguson, op. cit.
13 Op. cit., p. 32
14 Les Four-Minute Men sont une invention remarquable et tout-à-fait américaine. Des volontaires prenaient la parole pendant 4 minutes (sur des thèmes fournis par le Comité Creel) dans toutes sortes de lieux où il pourrait y avoir une audience : au coin des rues les jours de marché, au cinéma quand on changeait les bobines, etc.
15 Puisque les Etats-Unis n'entrèrent en guerre qu'en avril 1917, il y avait plus de mille prises de parole par jour. On estime que 11 millions de personnes les entendirent.
16 Cité dans Lasswell, op. cit. p.211-212. Nous nous sommes limités aux éléments les plus significatifs de la liste dressée par Lasswell.
17 Bien que muet, le cinéma était déjà un media important pour le divertissement du public. En Grande-Bretagne, rien qu'en 1917, il y avait déjà plus de 4 000 cinémas qui jouaient toutes les semaines pour des audiences de 20 millions (cf. John MacKenzie, Propaganda and Empire, Manchester University Press, 1984, p. 69)
18 Cf. Ferguson, op. cit, p. 226-225
19 Nous pouvons prendre deux exemples extrêmes pour illustrer cela : dans les années 1980, il était notoire que personne dans le bloc de l'Est ne croyait à la propagande officielle ; à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la population allemande ne croyait plus rien de ce qu'elle lisait dans la presse – à l'exception, pour certains, de l'horoscope qui était dument préparé chaque jour par le Ministère de la Propagande (Cf. Albert Speer, Inside the Third Reich, Macmillan 1970, p. 410-411)
20 "Wipers" est une distorsion anglaise de Ypres, la partie du front où était concentrée une grande partie de l'armée britannique et qui connut l'un des combats les plus meurtriers de la guerre.
21 La guerre était aussi financée par des emprunts à l'étranger, de façon importante par la France et la Grande-Bretagne aux Etats-Unis. "Comme le dit [le Président] Woodrow Wilson, ce qui est beau dans notre avantage financier sur la Grande-Bretagne et la France, c'est que lorsque la guerre sera finie, nous pourrons les forcer à adopter notre façon de voir." (Ferguson, op.cit., p. 329)
22 Et peu avant l'éclatement de la guerre, la France avait allongé la durée du service militaire à trois ans
23 Lasswell, op. cit. p. 222
24 Lasswell, op. cit. p. 221
25 C'était l'agitation publique, officielle de l'Internationale. Les événements devaient montrer de façon tragique que la force apparente de l'Internationale cachait une profonde faiblesses qui, en 1914, amena ses partis constitutifs à trahir la cause des ouvriers et à soutenir leurs classes dominantes respectives. Voir notre article Première Guerre mondiale: comment s'est produite la faillite de la Deuxième internationale [5], Revue internationale n°154
26 Lasswell, op.cit., p. 195
27 Gustave Le Bon (1841-1931) était un anthropologue et psychologue français dont l'œuvre majeure, La psychologie des foules, fut publiée en 1895.
28 John Atkinson Hobson (1858-1940) était un économiste britannique qui s'opposa au développement de l'impérialisme, pensant qu'il contenait les germes d'un conflit international. Lénine se basa largement sur l'œuvre majeure de Hobson, Imperialism, (avec laquelle il polémiqua) pour écrire L'impérialisme, stade suprême du capitalisme.
29 "Jingoism" est un terme anglais pour le patriotisme agressif, dérivé d'une chanson britannique populaire à l'époque de la guerre russo-turque de 1877 :
"We don't want to fight but by Jingo if we do
We've got the ships, we've got the men, we've got the money too
We've fought the Bear before, and while we"re Britons true
The Russians shall not have Constantinople".
30 Son "apparence cultivée" n'est pas seulement un masque. La société capitaliste contient aussi en elle-même une dynamique de développement de la culture, de la science, de l'art. Traiter cette question ici serait cependant trop long et nous éloignerait du sujet principal.
31 Ou, comme l'a dit Margaret Thatcher dans le passé, il n'y a pas de société, seulement des individus et leurs familles.
32 Plusieurs des images reproduites dans cet article sont tirées du livre d’Annie Pastor, Images de propagande 1914-1918, ou l’art de vendre la guerre.
33 La carte postale contient un "poème" supposé écrit par un fantassin français à sa sœur sur le thème "Qu'est-ce qu'un Boche ?" (terme péjoratif français pour Allemand) "Tu veux savoir, enfant, ce qu’est ce monstre, un boche ?
Un boche, mon chéri, c’est l’être sans honneur,
C’est un bandit sournois, lourdaud, haineux, et moche,
C’est un croquemitaine, un ogre empoisonneur.
C’est un diable en soldat qui brûle les villages,
Fusille les vieillards, les femmes, sans remords,
Achève les blessés, commet tous les pillages,
Enterre les vivants et dépouille les morts.
C’est un lâche égorgeur des enfants, des fillettes,
Embrochant les bébés avec des baïonnettes,
Massacrant par plaisir, sans raisons… sans quartier
C’est l’homme, mon enfant, qui veut tuer ton père,
Détruire ta Patrie et torturer ta mère,
C’est le teuton maudit par l’univers entier."
34 Op. cit., p. 32
35 Il suffit de se rappeler la Guerre du Viêtnam où des atrocités telles que le massacre de My Lai ont été fréquentes et attestées.
36 Cf. Lasswell, op. cit. p. 138
37 Lasswell, op. cit. p. 88. On peut cependant se demander si l'on doit considérer que c'est une "qualité" des esprits moins "simples" d'être capables de haïr toute une nation sans avoir de figure sur qui concentrer sa haine…
38 Freud, Psychologie collective et analyse du moi.
39 Comme on peut l'imaginer, les hommes en permission vivaient extrêmement mal le fait qu'on leur remette une plume blanche ; mais cela pouvait être également totalement dévastateur : le grand-père d'un des auteurs de cet article avait 17 ans et était apprenti dans la sidérurgie à Newcastle lorsque sa propre sœur lui remit une plume blanche, ce qui l'amena à s'engager dans la marine en mentant sur son âge.
40 Étant donné que – dans une société patriarcale dominée par les blancs - la prédation sexuelle était avant tout le fait d'hommes blancs sur les femmes noires, ceci serait presque drôle si ce n'était si vil.
41 Comme cela avait été le cas de façon embryonnaire au 18e siècle : cf. Howard Zinn, Histoire populaire des Etats-Unis
42 International Workers of the World
43 Même en France, où la référence fondamentale restait la Révolution de 1789 et la République, eut lieu le grand mouvement de restauration de l'architecture médiévale par Viollet-le-Duc, pour ne pas parler de la fascination exprimée en peinture pour la vie et les hauts faits du roi Louis IX (St Louis).
44 Les motivations de Owen étaient certainement plus complexes comme elles le sont pour chaque individu. Il était également officier et se sentait responsable de "ses" hommes.
Personnages:
- Freud [6]
- Edward Bernays [7]
- James Bryce [8]
- Harold Lasswell [9]
- Kaiser Guillaume II [10]
- Edith Cavell [11]
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [12]
- Rapport Bryce [13]
Questions théoriques:
- Démocratie [14]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [15]
Rubrique:
Conférence de Zimmerwald: les courants centristes dans les organisations politiques du prolétariat
- 1906 reads
L’article que nous publions ci-après est une contribution du camarade MC écrite pour le débat interne dans les années 1980 visant à combattre des positions centristes envers le conseillisme qui s'étaient développées au sein du CCI. MC était la signature de Marc Chirik (1907-1990), ex-militant de la Gauche communiste, principal membre fondateur du CCI (voir la Revue Internationale numéros 61 et 62).
Il peut paraître surprenant qu'un texte dont le titre fait référence à la Conférence de Zimmerwald qui s'est tenue en septembre 1915 contre la guerre impérialiste ait été écrit dans le cadre d'un débat interne dans le CCI sur la question du conseillisme. En réalité, comme le lecteur pourra le constater, ce débat a été amené à s'élargir à des questions plus générales qui se posaient déjà il y cent ans et qui gardent aujourd'hui toute leur actualité.
Nous avons rendu compte de ce débat sur le centrisme envers le conseillisme dans les numéros 40 à 44 de la Revue internationale (1985/86). Nous renvoyons le lecteur plus particulièrement au n° 42 de la Revue où l'article "Les glissements centristes vers le conseillisme" fait une présentation des origines et de l'évolution de ce débat, présentation que nous résumons ci-dessous afin que soient mieux compréhensibles certains aspects de la polémique de MC :
Lors du 5e congrès du CCI, et surtout à la suite de celui-ci, il s'était développé au sein de l'organisation une série de confusions dans l'analyse de la situation internationale et notamment une position qui, sur la question de la prise de conscience du prolétariat, reprenait les visions conseillistes. Cette position était défendue principalement par des camarades de la section en Espagne (désignée par "AP" dans le texte de MC, du nom de la publication de cette section, Acción Proletaria).
"Les camarades qui s'identifiaient avec cette analyse pensaient être en accord avec les conceptions classiques du marxisme (et donc du CCI) sur le problème de la conscience de classe. En particulier, ils ne rejetaient nullement de façon explicite la nécessité d'une organisation des révolutionnaires dans le développement de celle-ci. Mais en fait, ils avaient été conduits à faire leur une vision conseilliste :
- en faisant de la conscience un élément uniquement déterminé et jamais déterminant de la lutte de classe ;
- en considérant que 'le seul et unique creuset de la conscience de classe, c'est la lutte massive et ouverte', ce qui ne laissait aucune place aux organisations révolutionnaires ;
- en niant toute possibilité pour celles-ci de poursuivre un travail de développement et d'approfondissement de la conscience de classe dans les moments de recul de la lutte.
La seule différence majeure entre cette vision et le conseillisme, c'est que ce dernier va jusqu'au bout de sa démarche en rejetant explicitement la nécessité des organisations communistes, alors que nos camarades n'allaient pas jusque-là."
Un des thèmes majeurs de cette démarche, c'était le rejet de la notion de "maturation souterraine de la conscience" excluant de fait la possibilité pour des organisations révolutionnaires de développer et d'approfondir la conscience communiste en dehors des luttes ouvertes de la classe ouvrière.
Dès qu'il eut pris connaissance des documents exprimant cette vision, notre camarade MC écrivit une contribution pour la combattre. En janvier 1984, la réunion plénière de l'organe central du CCI adoptait une résolution prenant position sur les analyses erronées qui s'étaient exprimées auparavant, et notamment sur les conceptions conseillistes :
"Lorsque cette résolution fut adoptée, les camarades du CCI qui avaient auparavant développé la thèse de la 'non-maturation souterraine' avec toutes ses implications conseillistes s'étaient rendu compte de leur erreur. Aussi se prononcèrent-ils fermement en faveur de cette résolution et notamment son point 7 qui avait comme fonction spécifique de rejeter les analyses qu'ils avaient élaborées auparavant. Par contre, on vit surgir de la part d'autres camarades des désaccords sur ce point 7 qui les conduisirent soit à le rejeter en bloc, soit à le voter 'avec réserves' en rejetant certaines de ses formulations. On voyait donc apparaître dans l'organisation une démarche qui, sans soutenir ouvertement les thèses conseillistes, que la résolution condamnait, consistait à servir de bouclier, de parapluie à ces thèses en se refusant à une telle condamnation ou en atténuant la portée de celle-ci. Face à cette démarche, l'organe central du CCI était amené à adopter en mars 84 une résolution rappelant les caractéristiques :
a) de l'opportunisme en tant que manifestation de la pénétration de l'idéologie bourgeoise dans les organisations prolétariennes et qui s'exprime notamment par :
- un rejet ou une occultation des principes révolutionnaires et du cadre général des analyses marxistes ;
- un manque de fermeté dans la défense de ces principes ;
b) du centrisme en tant que forme particulière de l'opportunisme caractérisée par :
- une phobie à l'égard des positions franches, tranchantes, intransigeantes, allant jusqu'au bout de leurs implications ;
- l'adoption systématique de positions médianes entre les positions antagoniques ;
- un goût de la conciliation entre ces positions ;
- la recherche d'un rôle d'arbitre entre celles-ci ;
- la recherche de l'unité de l'organisation à tout prix y compris celui de la confusion, des concessions sur les principes, du manque de rigueur, de cohérence et de continuité dans les analyses.' (…)
Et la résolution conclut "qu'il existe à l'heure actuelle au sein du CCI, une tendance au centrisme -c'est-à-dire à la conciliation et au manque de fermeté- à l'égard du conseillisme."" (Revue Internationale n° 42, "Les glissements centristes vers le conseillisme)"
Face à cette analyse, un certain nombre de "réservistes", plutôt que de prendre en considération de façon sérieuse et rigoureuse les analyses de l'organisation, ont préféré, adoptant de fait une démarche centriste exemplaire, escamoter les vraies questions en se livrant à toute une série de contorsions aussi spectaculaires que lamentables. Le texte de McIntosh1, auquel répond la contribution de MC que nous publions ci-après, constitue une illustration flagrante de cet escamotage en défendant une thèse très simple (et inédite) : il ne peut y avoir de centrisme envers le conseillisme dans le CCI parce que le centrisme ne peut exister dans la période de décadence du capitalisme.
"En ne traitant dans son article que du problème du centrisme en général et dans l'histoire du mouvement ouvrier sans se référer à aucun moment à la façon dont la question s'est posée dans le CCI, il évite de porter à la connaissance du lecteur le fait que cette découverte (dont il est l'auteur) de la non-existence du centrisme dans la période de décadence, était la bienvenue pour les camarades "réservistes" (qui s'étaient abstenus ou avaient émis des "réserves" lors du vote de la résolution de janvier 84). La thèse de McIntosh, à laquelle ils se sont ralliés lors de la constitution de la "tendance", leur permettait de retrouver des forces contre l'analyse du CCI sur les glissements centristes envers le conseillisme dont ils étaient victimes et qu'ils s'étaient épuisés à combattre en essayant vainement de montrer (tour à tour ou simultanément) que "le centrisme c'est la bourgeoisie", "il existe un danger de centrisme dans les organisations révolutionnaires mais pas dans le CCI", "le danger centriste existe dans le CCI mais pas à l'égard du conseillisme"". (Revue Internationale n° 43, "Le rejet de la notion de "centrisme" : la porte ouverte à l'abandon des positions de classe").
Ainsi, comme on l'a dit plus haut, bien que le débat de 1985 portât à l’origine sur la question du conseillisme en tant que courant et vision politique, il a été amené à s’élargir sur la question plus générale du centrisme en tant qu’expression de la manière dont les organisations de la classe ouvrière subissent l’influence de l’idéologie dominante de la société bourgeoise. Comme le souligne MC dans l’article ci-dessous, le centrisme en tant que tel ne peut disparaître tant qu’existe la société de classe.
L’intérêt de cet article pour sa publication aujourd'hui vers l’extérieur consiste avant tout dans le fait qu'il porte sur l’histoire de la Première Guerre mondiale (question que nous abordons sous différents aspects dans la Revue Internationale depuis 2014) et notamment sur le rôle des révolutionnaires et le développement de la conscience dans la classe ouvrière et dans son avant-garde face à cet événement. La conférence de Zimmerwald, qui s'est tenue il y aura 100 ans en Septembre, fait partie de notre histoire, mais elle illustre aussi de façon très significative les difficultés et les hésitations des participants à rompre non seulement avec les partis traîtres de la Deuxième Internationale mais aussi avec toute l’idéologie conciliatrice et pacifiste qui espérait mettre fin à la guerre sans se lancer dans la lutte explicitement révolutionnaire contre la société capitaliste qui l’avait engendrée. Voici comment Lénine présentait la question en 1917 :
"Trois tendances se sont dessinées dans tous les pays, au sein du mouvement socialiste et international, depuis plus de deux ans que dure la guerre... Ces trois tendances sont les suivantes :
1. Les social-chauvins, socialistes en paroles, chauvins en fait (...) Ce sont nos adversaires de classe. Ils sont passés à la bourgeoisie (...).
2. La deuxième tendance et celle dite du "centre", qui hésite entre les social-chauvins et les véritables internationalistes (...) Le 'centre', c'est le règne de la phrase petite-bourgeoise bourrée de bonnes intentions, de l'internationalisme en paroles, de l'opportunisme pusillanime et de la complaisance pour les social-chauvins en fait. Le fond de la question, c'est que le 'centre' n'est pas convaincu de la nécessité d'une révolution contre son propre gouvernement, ne poursuit pas une lutte révolutionnaire intransigeante, invente pour s'y soustraire les faux fuyants les plus plats, bien qu'à résonance archi-'marxistes' (...) Le principal leader et représentant du 'centre' est Karl Kautsky, qui jouissait dans la 2ème Internationale (1889-1914) de la plus haute autorité et qui offre depuis août 1914 l'exemple d'un reniement complet du marxisme, d'une veulerie inouïe, d'hésitations et de trahisons lamentables.
3. La troisième tendance est celle des véritables internationalistes qui représente le mieux 'la gauche de Zimmerwald'." 2
Il serait cependant plus correct de dire, dans le contexte de Zimmerwald, que la droite est représentée non pas par les "social-chauvins", pour reprendre le terme de Lénine, mais par Kautsky et consorts –tous ceux qui formeront plus tard la droite de l’USPD 3– alors que la gauche est constituée par les bolcheviks et le centre par Trotsky et le groupe Spartakus de Rosa Luxemburg. Le processus qui mène vers la révolution en Russie et en Allemagne est justement marqué par le fait qu’une grande partie du "centre" est gagnée par les positions bolcheviques.
Par la suite, le terme centrisme ne sera pas utilisé de la même manière par tous les courants politiques. Pour les bordiguistes, par exemple, Staline et les staliniens dans les années 1930 sont toujours dénommés "centristes", la politique de Staline étant vue comme le "centre" entre la Gauche de l’Internationale (ce qu’on appelle aujourd’hui la Gauche communiste autour de Bordiga et Pannekoek en particulier) et la Droite de Boukharine. Bilan a retenu cette dénomination jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Pour le CCI, reprenant à son compte la démarche de Lénine, le terme centriste désigne la mouvance entre la gauche (révolutionnaire) et la droite (opportuniste, mais encore dans le camp prolétarien) : donc le stalinisme avec son programme du "socialisme dans un seul pays" n’est ni centriste ni opportuniste, mais fait partie du camp ennemi – du capitalisme. Comme le précise l’article qui suit, "le centrisme" ne représente pas un courant politique sur des positions spécifiques, mais plutôt une tendance permanente au sein des organisations politiques de la classe ouvrière, à chercher un "juste milieu" entre les positions révolutionnaires intransigeantes et celles représentant une forme de conciliation envers la classe dominante.
Le centrisme vu par (MIC) McIntosh
Dans mon article "Le centrisme et notre tendance informelle" paru dans le précédent numéro du Bulletin interne international (116), j’ai essayé de démontrer l’inconsistance des affirmations de McIntosh concernant la définition du centrisme dans la 2ème Internationale.
Nous avons pu voir la confusion établie par McIntosh :
- en identifiant le centrisme au réformisme ;
- en réduisant le centrisme à une « base sociale » qui serait constituée par les "fonctionnaires et les permanents de l’appareil de la social-démocratie et des syndicats" (la bureaucratie) ;
- en soutenant que "sa base politique" est donnée par l’existence d’un "programme précis" fixe ;
- en proclamant que l’existence du centrisme est liée exclusivement à une période déterminée du capitalisme, la période ascendante ;
- en ignorant complètement la persistance dans le prolétariat de la mentalité et des idées bourgeoises et petites-bourgeoises (l’immaturité de la conscience) dont il a le plus grand mal à se dégager ;
- en négligeant le fait de la pénétration constante de l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise au sein de la classe ouvrière ;
- en éludant totalement le problème d’un processus possible de dégénérescence d’une organisation prolétarienne.
Nous rappelons ces points, non pas simplement pour résumer l’article précédent mais aussi parce que beaucoup de ces points nous seront nécessaire pour démonter la nouvelle théorie de McIntosh sur la non existence du centrisme dans le mouvement ouvrier dans la période de décadence du capitalisme.
(…)
Le centrisme dans la période de décadence
McIntosh fonde son affirmation qu’il ne peut y avoir de courant centriste dans la période de décadence sur le fait qu’avec le changement de période l’espace occupé autrefois (dans la période ascendante) par le centrisme est désormais occupé par le capitalisme, et notamment par le capitalisme d’État. Ceci n’est que partiellement vrai. Ceci est vrai pour ce qui concerne certaines positions politiques défendues autrefois par le centrisme, mais est faux concernant "l’espace" séparant le programme communiste du prolétariat de l’idéologie bourgeoise. Cet espace (qui représente un terrain pour le centrisme) déterminé par l’immaturité (ou la maturité) de la conscience de classe et par la force de pénétration de l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise en son sein, peut tendre à se rétrécir, mais ne peut disparaître tant qu’existent les classes et, surtout, tant que la bourgeoisie reste la classe dominante de la société. Ceci reste également vrai même après la victoire de la révolution car tant qu’on peut parler du prolétariat comme classe, cela veut dire qu’il existe aussi d’autres classes dans la société et donc l’influence de leur idéologie et la pénétration de celle-ci dans la classe ouvrière. Toute la théorie marxiste sur la période de transition est fondée sur le fait que, contrairement aux autres révolutions dans l’histoire, la révolution prolétarienne ne clôt pas la période de transition mais ne fait que l’ouvrir. Seuls les anarchistes (et en partie les conseillistes) pensent qu’avec la révolution on saute à pieds joints directement du capitalisme au communisme. Pour les marxistes la révolution n’est que la condition préalable ouvrant la possibilité de la réalisation du programme communiste de la transformation sociale et d’une société sans classes. Ce programme communiste est défendu par la minorité révolutionnaire organisée en parti politique contre les positions des autres courants et organisations politiques qui se trouvent dans la classe et qui sont sur le terrain de classe, et cela, avant, pendant et après la victoire de la révolution.
À moins de considérer que toute la classe est déjà communiste-consciente ou le devient d’emblée avec la révolution, ce qui rend superflue sinon nuisible, l’existence de toute organisation politique dans la classe (sinon tout au plus une organisation avec une fonction strictement pédagogique, comme le veut le conseillisme de Pannekoek) ou bien de décréter que la classe ne peut avoir en son sein qu’un parti unique (comme le veulent les bordiguistes enragés), force nous est de reconnaître l’existence inévitable dans le prolétariat, à côté de l’organisation du parti communiste, d'organisations politiques confuses, plus ou moins cohérentes, véhiculant des idées petites bourgeoises et faisant des concessions politiques à des idéologies étrangères à la classe.
Dire cela c’est reconnaître l’existence au sein de la classe, dans toutes les périodes, de tendances centristes, car le centrisme n’est rien d’autre que la persistance dans la classe de courants politiques avec des programmes confus inconséquents, incohérents, pénétrés et véhiculant des positions relevant de l’idéologie petite-bourgeoise et lui faisant des concessions, oscillant entre cette idéologie et la conscience historique du prolétariat et tentant sans cesse de les concilier.
C’est justement parce que le centrisme ne peut être défini en terme d'un "programme précis" qu’il n’a pas, qu’on peut comprendre sa persistance en s’adaptant à chaque situation particulière, en changeant de position selon les circonstances du rapport de forces existant entre les classes.
Si c’est un non-sens de parler de centrisme en général, dans l’abstrait en terme de "base sociale" propre ou de "programme spécifique précis" mais qu’il faut le situer par rapport à d’autres courants politiques plus stables (en l’occurrence, dans le débat actuel, par rapport au conseillisme) on peut par contre parler d’une constance du comportement politique qui le caractérise : osciller, éviter de prendre une position claire et conséquente. (…)
Prenons un (…) exemple concret (…) édifiant du comportement centriste : McIntosh se réfère parfois dans son texte à la polémique Kautsky-Rosa Luxemburg de 1910. Comment a commencé cette polémique ? Elle a commencé par un article écrit par Rosa contre la politique et la pratique opportunistes de la direction du parti social-démocrate lui opposant la politique révolutionnaire de la grève de masse. Kautsky, en qualité de directeur de la Neue Zeit (organe théorique de la social-démocratie) refuse de publier cet article sous le prétexte que, tout en partageant l’idée générale de la grève de masse, il considère cette politique inadéquate dans ce moment précis, ce qui entrainerait nécessairement une réponse de sa part et une discussion entre deux membres de la tendance marxiste radicale face à la droite du parti, chose qu’il considère tout à fait regrettable. Devant ce refus, Rosa publie son article dans le Dortmunder Arbeiter Zeitung ce qui va obliger Kautsky à répondre et à s’engager dans la polémique que nous connaissons.
Quand j’ai annoncé, en septembre dans le SI 4, mon intention d’écrire un article mettant en lumière la démarche conseilliste des textes de AP, la camarade JA 5 a commencé par demander des explications sur le contenu et l’argumentation de cet article. Ces explications données, la camarade JA a trouvé cet article inopportun et suggérait d’attendre que le SI se mette préalablement d’accord, c’est-à-dire le "corriger" avant publication, de façon à ce que le SI dans son ensemble puisse le signer. Devant ce type de correction où il s’agissait d’arrondir les angles et de noyer le poisson, j’ai préféré le publier en mon nom propre. Une fois publié, JA trouvait cet article absolument déplorable du fait qu’il ne ferait que jeter le trouble dans l’organisation. Heureusement JA n’était pas la directrice (du Bulletin interne) comme l’était Kautsky [pour la Neue Zeit]et n’avait pas son pouvoir, car dans le cas contraire l’article n’aurait jamais vu le jour. Comme quoi avec 75 ans de décalage et de changement de période (ascendante et décadente) le centrisme a bien changé de visage et de positions mais a gardé le même esprit et la même démarche : éviter de soulever des débats pour ne pas "troubler" l’organisation.
Dans un de mes premiers articles polémiques contre les réservistes je disais que la période de décadence est par excellence la période de manifestations du centrisme. Un simple coup d’œil sur l’histoire de ces 70 ans nous fera immédiatement constater que, dans aucune autre période dans l’histoire du mouvement ouvrier, le centrisme ne s’est manifesté avec autant de force, avec autant de variantes et n’a fait autant de ravages que dans cette période de décadence du capitalisme. On ne peut être qu’absolument d’accord avec la définition très juste donnée par Bilan : qu’une Internationale ne trahit pas comme telle mais meurt, disparaît, cesse d’exister et que ce sont les partis devenus "nationaux" qui passent chacun du côté de sa bourgeoisie nationale. Ainsi, c’est dès le lendemain du 4 août 1914, quand les partis socialistes des pays belligérants signent leur trahison en votant les crédits de guerre, que commence à se développer, dans chaque pays, à côté des petites minorités restées fidèles à l’internationalisme, une opposition de plus en plus nombreuse, au sein des partis socialistes et de syndicats, contre la guerre et la politique de défense nationale. C’est le cas en Russie avec les menchéviks internationalistes de Martov, du groupe inter-rayons de Trotsky. C’est le cas en Allemagne avec le développement de l’opposition à la guerre qui va être exclue du parti SD pour donner naissance à l’USPD, c’est le cas en France avec le groupe syndicaliste-révolutionnaire de La Vie ouvrière de Monatte, Rosmer et Merrheim, de la majorité du parti socialiste d’Italie et celui de la Suisse, etc., etc. Tout cela constitue un courant varié pacifiste-centriste inconséquent qui s’oppose à la guerre au nom de la paix et non au nom du défaitisme révolutionnaire et de la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. C’est ce courant centriste qui organise la conférence socialiste contre la guerre de Zimmerwald en 1915 (où la gauche révolutionnaire conséquente et intransigeante représente une petite minorité réduite aux Bolcheviks russes, les tribunistes hollandais et les radicaux de Brême en Allemagne) et de Kienthal 1916 encore largement dominée par le courant centriste (où les Spartakistes de Rosa et de Liebknecht rejoignent enfin la gauche révolutionnaire). Ce courant centriste ne pose d’aucune façon la question de la rupture immédiate avec les partis socialistes devenus des partis social-chauvins et jusqu’auboutistes, mais pose la question de leur redressement dans l’unité organisationnelle6. La révolution commencée en février 17 en Russie trouve un parti bolchevique (et des soviets ouvriers et soldats soutenant le gouvernement de Kerenski-Milioukov dans sa presque totalité) qui se situe dans la position d’un soutien conditionnel au gouvernement bourgeois de Kerenski.
L’enthousiasme général produit dans la classe ouvrière dans le monde entier, suite à la victoire de la révolution d’octobre ne va pas beaucoup plus loin que de développer un immense courant fondamentalement centriste. Les partis et les groupes qui vont constituer et adhérer à l’Internationale communiste sont en grande majorité des partis encore profondément marqués par le centrisme. Dès 1920 on assiste aux premiers signes de l’essoufflement de la première vague révolutionnaire qui va aller vite en décroissant. Cela va se traduire sur le plan politique par un glissement centriste déjà très visible au 2ème Congrès de l’IC, par la prise de positions ambiguës et erronées sur des questions aussi importantes que celles du syndicalisme, du parlementarisme, de l’indépendance et de l’auto-détermination nationales. D’année en année, l’IC et les partis communistes qui la constituent vont suivre à un rythme accéléré le recul vers des positions centristes et la dégénérescence ; les tendances révolutionnaires-intransigeantes, devenues rapidement minoritaires dans les partis communistes, vont être tout à tour exclues de ces partis et vont subir elles-mêmes l’impact de la gangrène centriste comme ce fut le cas des différentes oppositions issues de l’IC et plus particulièrement de l’opposition de gauche de Trotsky pour finalement être entrainées à franchir les frontières de classe avec la guerre d’Espagne et la 2ème Guerre mondiale au nom de l’antifascisme et de la défense de l’État ouvrier dégénéré en Russie. La toute petite minorité qui reste fermement sur le terrain de classe et du communisme, comme la Gauche Communiste Internationale et la Gauche Hollandaise vont également subir le choc en retour de cette période noire qui a suivi au lendemain de la guerre, les uns comme les bordiguistes en se sclérosant et en régressant gravement politiquement, les autres comme la gauche hollandaise en se décomposant dans un conseillisme complètement dégénéré. Il faut attendre la fin des années 60, avec l’annonce de la crise ouverte, avec l’annonce d’une reprise de la lutte de classe, que ressurgissent de petits groupes révolutionnaires cherchant à se dégager de l’immense confusion de 68, pour s’efforcer péniblement de renouer avec le fil historique du marxisme-révolutionnaire.
(…) Il faut vraiment être frappé de cécité universitaire pour ne pas voir cette réalité. Il faut ignorer complètement l’histoire du mouvement ouvrier de ces 70 ans depuis 1914 pour affirmer péremptoirement, comme le fait McIntosh, que le centrisme n’existe pas et ne saurait exister dans la période de décadence. La phraséologie radicale grandiloquente, les indignations feintes, ne sauraient tenir lieu un tant soit peu d’argument sérieux.
Il est certes plus commode de faire la politique de l’autruche, en fermant les yeux pour ne pas voir la réalité et ses dangers, pour pouvoir d’autant plus facilement les nier. On se rassure ainsi à bon compte et on s’épargne bien des casse-têtes de réflexions. Ce n’est pas la méthode de Marx qui écrivait "Les communistes ne viennent pas pour consoler la classe ouvrière ; ils viennent pour la rendre encore plus misérable en la rendant consciente de sa misère". McIntosh suit la première voie en niant purement et simplement pour sa tranquillité et contre toute évidence, l’existence du centrisme dans la période de décadence. Pour les marxistes que nous devons être il s’agit de suivre l’autre voie : ouvrir tout grands les yeux pour reconnaître la réalité, la comprendre et la comprendre dans son mouvement et dans sa complexité. C’est donc à nous de tenter d’expliquer le pourquoi du fait indéniable que la période de décadence est aussi une période qui voit l’éclosion des tendances centristes.
La période de décadence du capitalisme et le prolétariat
(…) La période de décadence c’est l’entrée dans une crise historique, permanente, objective, du système capitaliste, posant ainsi le dilemme historique : son autodestruction, entrainant avec lui la destruction de toute la société, ou la destruction de ce système pour faire place à une nouvelle société sans classes, la société communiste. La seule classe susceptible de réaliser ce grandiose projet de sauver l’humanité est le prolétariat dont l’intérêt de se libérer de l’exploitation le pousse dans une lutte à mort contre ce système d’esclavagisme salarial capitaliste et qui, d’autre part, ne peut s’émanciper qu’en émancipant toute l’humanité.
Contrairement :
- à la théorie que c’est la lutte ouvrière qui détermine la crise du système économique du capitalisme (GLAT) ;
- à la théorie qui ignore la crise permanente historique et ne connaît que des crises conjoncturelles et cycliques offrant la possibilité de la révolution et, à défaut de sa victoire, permet un nouveau cycle de développement du capitalisme, ainsi à l’infini (A. Bordiga) ;
- à la théorie pédagogique pour laquelle la révolution n’est pas liée à une question de crise du capitalisme mais dépend de l’intelligence des ouvriers acquise au cours de leurs luttes (Pannekoek) ;
Nous affirmons avec Marx qu’une société ne disparaît pas tant qu’elle n’a pas épuisé toutes les possibilités de développement qu’elle contient en elle. Nous affirmons avec Rosa que c’est la maturation des contradictions internes au capital qui détermine sa crise historique, condition objective de la nécessité de la révolution. Nous affirmons avec Lénine qu’il ne suffit pas que le prolétariat ne veuille plus être exploité, mais il faut encore que le capitalisme ne puisse plus vivre comme auparavant.
La décadence c'est l’effondrement du système capitaliste sous le poids de ses propres contradictions internes. La compréhension de cette théorie est indispensable pour comprendre les conditions dans lesquelles se déroule et va se dérouler la révolution prolétarienne.
À cette entrée en décadence de son système économique, que la science économique bourgeoise ne pouvait ni prévoir ni comprendre, le capitalisme -sans pouvoir maitriser cette évolution objective- a répondu par une extrême concentration de toutes ses forces politiques, économiques et militaires qu’est le capitalisme d’État, à la fois pour faire face à l’exacerbation extrême des tensions inter-impérialistes et surtout face à la menace de l’explosion de la révolution prolétarienne dont il venait de prendre conscience avec l’éclatement de la révolution russe en 1917.
Si l’entrée en décadence signifie la maturité historique objective de la nécessité de la disparition du capitalisme, il n’en est pas de même de la maturation de la condition subjective (la prise de conscience par le prolétariat) pour pouvoir la réaliser. Cette condition est indispensable parce que, comme le disaient Marx et Engels : l’histoire ne fait rien par elle-même, ce sont les hommes (les classes) qui font l’histoire.
Nous savons qu’à l’encontre de toutes les révolutions passées dans l’histoire, dans lesquelles la prise de conscience des classes qui devaient les assumer jouait un rôle de second plan du fait qu’il ne s’agissait que d’un changement de système d’exploitation par un autre système d’exploitation, la révolution socialiste posant la fin de toute exploitation de l’homme par l’homme et de toute l’histoire des sociétés de classes, exige et pose comme condition fondamentale l’action consciente de la classe révolutionnaire. Or le prolétariat n’est pas seulement la classe à qui l’histoire impose la plus grande exigence qu’elle n’ait jamais posée à aucune autre classe ni à l’humanité, une tâche qui dépasse toutes les tâches que l’humanité a jamais affrontées, le saut de la nécessité à la liberté, mais encore le prolétariat se trouve devant les plus grandes difficultés. Dernière classe exploitée, il représente toutes les classes exploitées de l’histoire face à toutes les classes exploiteuses représentées par le capitalisme.
C’est la première fois dans l’histoire qu’une classe exploitée est amenée à assumer la transformation sociale et, de plus, une transformation qui porte avec elle la destinée et le devenir de toute l’humanité. Dans cette lutte titanesque, le prolétariat se présente au départ en état de faiblesse, état inhérent à toute classe exploitée, aggravé par le poids des faiblesses de toutes les générations mortes des classes exploitées qui pèse sur lui : manque de conscience, manque de conviction, manque de confiance, prenant peur de ce qu’elles osent penser et entreprendre, habitude millénaire de soumission à la force et à l’idéologie des classes dominantes. C’est pourquoi, contrairement à la marche des autres classes qui va de victoire en victoire, la lutte du prolétariat est faite par des avancées et et des reculs et qu'il ne parvient à sa victoire finale qu’à la suite d’une longue série de défaites.
(…) Cette suite dans la marche d’avancées et reculs de la lutte du prolétariat, dont Marx a déjà parlé au lendemain des évènements révolutionnaires de 1848, ne fait que s’accentuer et s’accélérer dans la période de décadence, du fait même de la barbarie de cette période qui pose au prolétariat la question de la révolution en termes plus concrets, plus pratiques, plus dramatiques, et cela se traduit, au niveau de la prise de conscience de la classe également en un mouvement accéléré et turbulent comme le déferlement des vagues dans une mer agitée.
Ce sont ces conditions (d’une réalité qui voit la maturité des conditions objectives et l’immaturité des conditions subjectives) qui déterminent le tourbillonnement dans la classe et font surgir une multitude de courants politiques divers et contradictoires, convergents et divergents, évoluant et régressant et notamment les différentes variétés du centrisme.
La lutte contre le capitalisme est en même temps une lutte et une décantation politique au sein même de la classe dans son effort vers la prise de conscience, et ce processus est d’autant plus violent et tortueux qu’il se déroule sous le feu nourri de l’ennemi de classe.
Les seules armes que possède le prolétariat dans sa lutte à mort contre le capitalisme et qui peuvent lui assurer la victoire ce sont : la conscience et son organisation. C’est dans ce sens et dans ce sens seulement que doit être comprise la phrase de Marx : "Il ne s'agit pas de savoir quel but tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier, se représente momentanément. Il s'agit de savoir ce que le prolétariat est et ce qu'il sera obligé historiquement de faire, conformément à cet être.".
(…) Les conseillistes interprètent cette phrase de Marx dans le sens que c’est chaque lutte ouvrière qui produit automatiquement la prise de conscience de la classe, niant la nécessité d’une lutte théorique-politique soutenue au sein de la classe (existence nécessaire de l’organisation politique-révolutionnaire). Nos réservistes ont glissé dans le même sens, lors des débats au BI plénier de janvier 84 et du vote du point 7 de la résolution. Aujourd’hui, (pour escamoter ce premier glissement) en s’alignant sur la thèse aberrante de McIntosh de l’impossibilité de l’existence de courants centristes dans la classe dans la période de décadence, ils ne font que poursuivre le même glissement, se contentant simplement de retourner la même pièce du côté face au côté pile.
Dire que dans cette période [de décadence du capitalisme] il ne saurait exister, ni avant, ni pendant, ni après la révolution aucun type de centrisme au sein de la classe, c’est ou bien considérer en idéaliste la classe comme uniformément consciente, absolument homogène et totalement communiste (rendant inutile l’existence même d’un parti communiste, comme le font les conseillistes conséquents) ou bien décréter que seul peut exister dans la classe un parti unique, en dehors duquel tout autre courant est par définition contre-révolutionnaire et bourgeois, tombant, par un curieux détour dans les pires manifestations de la mégalomanie du bordiguisme.
Les deux principales tendances du courant centriste
Comme nous l’avons déjà vu, le courant centriste ne se présente pas comme un courant homogène avec "un programme spécifique précis". C’est le courant politique le moins stable, le moins cohérent, tiraillé en son sein par l’attraction qui s’exerce sur lui par, d’un côté l’influence du programme communiste et, de l’autre, l’idéologie petite-bourgeoise. Cela est dû aux deux sources (existant en même temps et se croisant) qui lui donnent naissance et l’alimentent :
1) l’immaturité de la classe dans son mouvement de prise de conscience ;
2) La pénétration constante de l’idéologie petite-bourgeoise au sein de la classe.
Ces sources vont et poussent les courants centristes vers deux directions diamétralement opposées.
En règle générale c’est le rapport de forces existant entre les classes, à des périodes précises, le flux ou le reflux de la lutte de classe qui décident du sens de l’évolution ou de la régression des organisations centristes. (…) McIntosh voit, dans sa myopie congénitale, seulement la seconde source et ignore magistralement la première, comme il ignore les pressions contraires qui s’exercent sur le centrisme. Il ne connaît le centrisme que comme une "abstraction" et non dans la réalité de son mouvement. Quand McIntosh reconnaît le centrisme c’est quand celui-ci s’est définitivement intégré dans la bourgeoisie, c’est-à-dire quand le centrisme a cessé d’être centrisme et notre camarade est d’autant plus furieux et laisse éclater son indignation qu’il ne l’a ni connu ni reconnu auparavant.
C’est tout-à-fait dans la nature de nos minoritaires de s’acharner sur le cadavre d’une bête féroce qu’ils n’ont pas combattue de son vivant et qu’ils se gardent bien de reconnaître et de combattre aujourd’hui.
Examinons donc le centrisme alimenté par la première source, c’est-à-dire allant de l’immaturité vers la prise de conscience des positions de classe. Prenons l’exemple de l’USPD, bête noire découverte aujourd’hui et devenu le cheval de bataille de nos minoritaires.
La mythologie perse raconte que le diable, las de ses échecs à combattre le Bien et le Mal, a décidé, un beau jour, de changer de tactique en procédant d’une autre manière, ajoutant démesurément du bien au Bien. Ainsi quand Dieu a donné aux hommes le Bien de l’amour et du désir charnel, en augmentant et exaspérant ce désir, le diable a fait que les hommes se vautraient dans la luxure et le viol. De même quand Dieu a donné comme un bien le vin, le diable en augmentant le plaisir du vin a fait l’alcoolisme. On connaît le slogan : "un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts !".
Nos minoritaires font exactement la même chose aujourd’hui. Dans l’incapacité de défendre leur glissement centriste par rapport au conseillisme, ils changent de tactique. "Vous disiez centrisme, mais centrisme c’est la bourgeoisie ! En prétendant combattre le centrisme vous ne faites que l’habiliter en le situant et lui donnant le label de classe. Ainsi en le situant dans la classe vous vous faites son défenseur et ses apologistes."
Habile tactique d’inversement de rôle. Elle a parfaitement réussi au diable. Malheureusement pour eux, nos minoritaires ne sont pas des diables et entre leurs mains cette astucieuse tactique ne peut que faire long feu. Qui, quel camarade peut sérieusement croire à cette absurdité que la majorité du BI plénier de janvier 84 qui a décelé et mis en évidence l’existence d’un glissement centriste vers le conseillisme en notre sein et, depuis un an, ne fait que le combattre, serait en réalité le défenseur et l’apologiste du centrisme de Kautsky d’il y a 70 ans ? Nos minoritaires eux-mêmes ne le pensent pas. Ils cherchent plutôt à brouiller le débat sur le présent en divaguant sur le passé.
Pour revenir à l’histoire de l’USPD il faut commencer par rappeler le développement de l’opposition à la guerre dans la social-démocratie. L’Union sacrée contresignée par le vote unanime (moins le vote de Rühle) de la fraction parlementaire des crédits de guerre en Allemagne, stupéfia bien des membres de ce parti au point de les paralyser. La gauche qui va donner naissance à Spartakus est à ce point réduite que le petit appartement de Rosa sera assez grand pour se réunir au lendemain du 4 août 1914.
La gauche est non seulement réduite mais est en plus divisée en plusieurs groupes :
- la "gauche radicale" de Brême qui, influencée par les Bolcheviks, préconise la sortie immédiate de la social-démocratie ;
- ceux qui sont groupés autour de petits bulletins et revues comme celle de Borchardt (proche de la "gauche radicale") ;
- les délégués révolutionnaires (le plus important des groupes) rassemblant les représentants syndicaux des usines métallurgistes de Berlin et qui se situait politiquement entre le centre et Spartakus ;
- le groupe Spartakus ;
- et puis enfin le centre qui donnera naissance à l’USPD.
De plus, chacun des groupes ne représentera pas une entité homogène mais connaîtra des subdivisions en multiples tendances se chevauchant et s’entrecroisant, s’approchant et s’éloignant sans cesse. Toutefois l’axe principal de ces divisions restera toujours la régression vers la droite et l’évolution vers la gauche. Cela nous donne déjà une idée du bouillonnement qui se produit dans la classe ouvrière en Allemagne dès le début de la guerre (point critique de la période de décadence) et qui ira en s’accélérant au cours de celle-ci. Il est impossible dans les limites de cet article de donner des détails sur le développement de nombreuses grèves et manifestations contre la guerre en Allemagne. Aucun autre pays belligérant n’a connu un tel développement, même pas la Russie. Nous pouvons nous contenter de donner ici quelques points de référence, entre autres la répercussion politique de ce bouillonnement sur la fraction la plus droitière de la SD, la fraction parlementaire.
Le 4 août 1914, 94 sur 95 députés votent les crédits de guerre. Un seul vote contre, celui de Rühle, Karl Liebknecht, se soumettant à la discipline, vote également pour. En décembre 1914, à l’occasion d’un nouveau vote de crédits, Liebknecht rompt avec la discipline et vote contre.
En mars 1915, nouveau vote du budget y compris les crédits de guerre. "Seuls Liebknecht et Rühle voteront contre, après que trente députés, Haase et Ledebour (deux futurs dirigeants de l’USPD) en tête, eurent quitté la salle". (O.K. Flechtheim, Le parti communiste allemand sous la République de Weimar, Maspero, p. 38). Le 21 décembre 1915, nouveau vote de crédits au Reichstag, F. Geyer déclare au nom de vingt députés du groupe SD : "Nous refusons les crédits". "Lors de ce vote vingt députés refusèrent les crédits et vingt-deux autres quittèrent la salle" (Ibid.).
Le 6 janvier 1916, la majorité social-chauvine du groupe parlementaire exclut Liebknecht de ses rangs. Rühle se solidarise avec lui et est exclu également. Le 24 mars 1916, Haase rejette, au nom de la minorité du groupe SD au Reichstag, le budget d’urgence de l’État ; la minorité publie la déclaration suivante : "Le groupe parlementaire social-démocrate par 58 voix contre 33 et 4 abstentions nous a aujourd’hui enlevé les droits découlant de l’appartenance au groupe… Nous nous voyons contraints de nous grouper en une Communauté de travail social-démocrate".
Parmi les signataires de cette déclaration, nous trouvons les noms de la plupart des futurs dirigeants de l’USPD et notamment celui de Bernstein. La scission et l’existence désormais de deux groupes SD au Reichstag, un social-chauvin et l’autre contre la guerre, correspondent, à peu de chose près, à ce qui se passe dans le parti SD dans son ensemble, avec ses divisions et luttes de tendances acharnées, comme parmi la classe ouvrière.
Au mois de juin 1915 s’organise une action commune de toute l’opposition contre le comité central du parti. Un texte est diffusé sous forme de tract, portant la signature de centaines de permanents. Il y est dit en résumé : "Nous exigeons que le groupe parlementaire et la direction du parti dénoncent enfin l’Union sacrée et engagent sur toute la ligne la lutte de classe sur la base du programme et des décisions du parti, la lutte socialiste pour la paix" (Op. citée). Peu après est paru un Manifeste signé de Bernstein, Haase et Kautsky intitulé "‘L’impératif de l’heure’ dans lequel ils demandaient qu’on mette fin à la politique du vote des crédits." (Ibid.)
Suite à l’exclusion de Liebknecht du groupe parlementaire, "la direction de l’organisation SD de Berlin approuva par 41 voix contre 17 la déclaration de la minorité du groupe parlementaire. Une conférence réunissant 320 permanents du 8ème district électoral de Berlin approuva Ledebour." (Ibid.)
Sur le plan de la lutte des ouvriers on peut rappeler :
- 1915, quelques manifestations contre la guerre à Berlin groupant au plus 1000 personnes ;
- à l’occasion du 1er mai 1916, Spartakus groupe dans une manifestation 10 000 ouvriers des usines ;
- août 1916, suite à l’arrestation et la condamnation de K. Liebknecht pour son action contre la guerre, 55 000 métallurgistes de Berlin font la grève. Il y a également des grèves dans plusieurs villes de province.
Ce mouvement contre la guerre et contre la politique social-chauvine, va se poursuivre, s’élargir tout au long de la guerre et gagner de plus en plus les masses ouvrières, avec en leur sein une petite minorité de révolutionnaires (elle-même tâtonnante) et une forte majorité d’un courant centriste hésitant et allant se radicalisant. C’est ainsi qu’à la Conférence nationale de la SD, en septembre 1916, à laquelle participent minorité centriste et le groupe Spartakus, 4 orateurs déclaraient : "L’important n’était pas l’unité du parti mais l’unité dans les principes. Il fallait appeler les masses à gagner la lutte contre l’impérialisme et la guerre et imposer la paix en employant tous les moyens de force dont disposait le prolétariat." (Ibid.).
Le 7 janvier 1917 se tint une conférence nationale groupant tous les courants d’opposition à la guerre. Sur 187 délégués, 35 représentaient le groupe Spartakus. Une conférence qui adopte à l’unanimité un Manifeste… écrit par Kautsky et une résolution de Kurt Eisner. Les deux textes disaient : "Ce qu’elle demande (l’opposition), c’est une paix sans vainqueurs ni vaincus, une paix de réconciliation sans violence".
Comment expliquer que Spartakus vote une telle résolution, parfaitement opportuniste, pacifiste, lui qui, par la bouche de son représentant Ernst Meyer, "posa la question de l’arrêt des versements de cotisations de l’appartenance au parti" ?
Pour McIntosh, dans son simplisme, une telle question n’a pas de sens : la majorité de la social-démocratie étant devenue bourgeoise, le centrisme est donc aussi bourgeois, et Spartakus l’est également.
(…) Mais alors on peut se demander ce que faisaient les Bolcheviks et les Tribunistes de Hollande dans les Conférences de Zimmerwald et Kienthal, où, tout en proposant leur résolution de transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, ils ont finalement voté les manifeste et résolution qui étaient également pour la paix sans annexion ni contribution ? Dans la logique de McIntosh, les choses sont ou toutes blanches ou toutes noires d’éternité et pour l’éternité. Il ne voit pas le mouvement et il voit encore moins le sens où va le mouvement. Heureusement que McIntosh n’est pas médecin car il serait un médecin de malheur pour qui un malade est d’avance condamné et déjà vu comme un cadavre.
Il faut encore insister sur le fait que ce qui n’est déjà pas valable pour une vie d’homme est une totale absurdité au niveau d’un mouvement historique, comme celui du prolétariat. Ici le passage de la vie à la mort ne se mesure pas en secondes ni en minutes mais en années. Ce n’est pas la même chose le moment où un parti ouvrier signe son arrêt de mort et sa mort effective, définitive. Cela est peut être difficile à comprendre pour un phraséologue radical, mais est tout-à-fait compréhensible pour un marxiste qui n’a pas l’habitude de quitter le bateau comme les rats dès que celui-ci commence à prendre l’eau. Les révolutionnaires savent ce que représente historiquement une organisation à qui la classe a donné le jour et, tant qu’il reste un souffle de vie, ils luttent pour la sauver, pour la garder à la classe. Une telle question n’existait pas, il y a encore quelques années, pour la CWO, elle n’existe pas pour un Guy Sabatier et autres phraséologues pour qui l’Internationale communiste, le parti bolchevique ont été de tout temps la bourgeoisie. Elle n’existe pas non plus pour McIntosh. Les révolutionnaires peuvent se tromper à un moment précis mais pour eux cette question est de la plus haute importance. Pourquoi cela ? Parce que les révolutionnaires ne constituent pas une secte de chercheurs mais sont une partie vivante d’un corps vivant qu’est le mouvement ouvrier, avec ses moments de hauts et de bas.
La majorité social-chauvine de la SD comprenait mieux qu’un McIntosh le danger que représentait ce courant d’opposition à l’Union sacrée et à la guerre et procédait, en toute urgence, à des exclusions massives. C’est à la suite de ces exclusions que s’est constitué le 8 avril 1917 l’USPD. C’est avec beaucoup de réserves et après beaucoup d’hésitation que Spartakus a donné son adhésion à ce nouveau parti en posant comme condition de se réserver une "entière liberté de critique et d’action indépendante". Liebknecht a, plus tard, caractérisé de la manière suivante les rapports entre le groupe Spartakus et l’USPD : "Nous avons adhéré à l’USPD pour le pousser en avant, l’avoir à portée de notre fouet, en arracher les meilleurs éléments." Que cette stratégie fut valable à ce moment-là, c’est plus que douteux, mais une chose est claire : une telle question pouvait se poser pour Luxemburg et Liebknecht parce qu’ils considéraient, avec raison, l’USPD comme un mouvement centriste dans le prolétariat et non comme un parti de la bourgeoisie.
Il ne faut pas oublier que sur les 38 délégués qui participaient à Zimmerwald, la délégation d’Allemagne est de dix membres sous la direction de Ledebour et se compose de 7 membres de l’opposition centriste, 2 de Spartakus et 1 de la gauche de Brême et, à la Conférence de Kienthal il y a, sur 43 participants, 7 délégués venant d’Allemagne dont 4 des centristes, 2 de Spartakus et 1 de la gauche de Brême. Spartakus dans l’USPD, gardait son entière indépendance et se comportait à peu près comme les Bolcheviks dans les Conférences de Zimmerwald et Kienthal.
On ne peut comprendre ce qu’était l’USPD centriste sans le situer dans le contexte d’un formidable mouvement de masses en luttes. En avril 1917 éclate une grève de masse qui englobe, rien qu’à Berlin, 300 000 ouvriers. Par ailleurs se produit la première mutinerie de marins. En janvier 1918, à l’occasion des pourparlers de paix de Brest-Litovsk, c’est une vague de grèves qu’on estime à 1 million d’ouvriers. L’organisation de la grève était entre les mains de délégués-révolutionnaires très proches de l’USPD (chose non moins étonnante est de voir Ebert et Scheidemann faisant partie du comité de grève). Au moment de la scission, certains évaluent les adhérents à la SD à 248 000 et 100 000 à l’USPD. En 1919 l’USPD comporte près d’un million d’adhérents et cela dans les grands centres industriels. Il est impossible de relater ici toutes les vicissitudes des évènements révolutionnaires en Allemagne de 1918. Rappelons seulement que le 7 octobre se décide la fusion entre Spartakus et la gauche de Brême. Liebknecht, qui vient d'être libéré, entre dans l’organisation des délégués révolutionnaires qui s’attache à la préparation d’un soulèvement armé pour le 9 novembre. Mais entretemps éclate le 30 octobre le soulèvement de Kiel. A bien des égards, le début de la révolution en Allemagne rappelle celle de février 1917. Tout particulièrement pour ce qui concerne l’immaturité du facteur subjectif, l’immaturité de la conscience dans la classe. Tout comme en Russie, les congrès des conseils donneront leur investiture à des "représentants" qui étaient les pires jusqu’auboutistes tout le long de la guerre ; Ebert, Scheidemann, Landsberg à qui on ajoute trois membres de l’USPD : Haase, Dittman et Barth. Ces derniers qui font partie de la droite centriste, avec tout ce que cela comporte de veulerie, de lâcheté, d’hésitation, vont servir de caution "révolutionnaire" à Ebert-Scheidemann, pour peu de temps (du 20/12 au 29/12 de 1919), mais suffisamment pour leur permettre d’organiser, avec l’aide des junkers prussiens et des corps francs, les massacres contre-révolutionnaires.
La politique de semi-confiance semi-méfiance dans ce gouvernement qui sera celle de la direction de l’USPD, ressemble étrangement à celle du soutien conditionnel au gouvernement de Kerensky par la direction du parti bolchevique jusqu’à mai 1917, jusqu’au triomphe des Thèses d’avril de Lénine. La grande différence, toutefois, ne réside pas tant dans la fermeté du parti bolchevique sous la direction de Lénine et de Trotsky que dans la force, l’intelligence d’une classe expérimentée, sachant ramasser toutes ses forces contre le prolétariat comme le fut la bourgeoisie allemande, et l’extrême sénilité de la bourgeoisie russe.
Pour ce qui concerne l’USPD, il fut écartelé, comme tout courant centriste, entre une tendance de droite cherchant à se réintégrer dans le vieux parti passé à la bourgeoisie et une tendance de plus en plus forte à la recherche du camp de la révolution. On trouve ainsi l’USPD aux côtés de Spartakus dans les journées sanglantes de la contre-révolution à Berlin en janvier 1919, comme on le trouvera dans les différents affrontements dans les autres villes, comme ce fut le cas en Bavière, à Munich. L’USPD, comme tout autre courant centriste, ne pouvait se maintenir devant les épreuves décisives de la révolution. Il était condamné à éclater, il éclata.
Dès son Deuxième Congrès (6 mars 1919), les deux tendances s’affrontent sur plusieurs questions (syndicalisme, parlementarisme) mais surtout sur la question d’adhérer à l’Internationale communiste. La majorité rejeta l’adhésion. La minorité allait cependant se renforçant, quoiqu’à la Conférence nationale qui se tint en septembre, elle n’ait pas réussi encore à conquérir la majorité. Au Congrès de Leipzig, le 30 novembre de la même année, la minorité gagne dans la question du programme d’action, adopté à l’unanimité, au principe de la dictature des soviets, et il est décidé d’engager des pourparlers avec l’IC. Au mois de juin 1920, une délégation se rend à Moscou pour entamer ces pourparlers et pour participer au Deuxième Congrès de l’IC.
Le CE de l’IC avait préparé à ce sujet un texte contenant, à l’origine, 18 conditions et qui fut renforcé en ajoutant encore 3 conditions. Ce sont les 21 conditions d’adhésion à l’Internationale communiste. Après de violentes discussions internes, c’est par une majorité de 237 voix contre 156 que le congrès extraordinaire d’octobre 1920 s’est enfin prononcé pour l’acceptation des 21 conditions et l’adhésion à l’IC.
McIntosh, et derrière lui JA, ont découvert en août 1984, la critique faite depuis toujours par la gauche de l’IC, d’avoir laissé trop larges les mailles du filet pour l’adhésion à l’Internationale. Mais comme toujours, la découverte fort tardive de nos minoritaires n’est qu’une caricature qui tourne à l’absurde. Aucun doute que les 21 conditions contenaient, en elles-mêmes, des positions erronées, non seulement vues à partir de 1984 mais déjà pour l’époque, et critiquées par la gauche. Cela prouve quoi ? Que l’IC était bourgeoise ? Ou bien que l’IC était pénétrée par des positions centristes sur bien des questions et cela dès son début ? L’indignation soudaine de nos minoritaires cache difficilement et leur ignorance de l’histoire qu’ils semblent découvrir aujourd’hui et l’absurdité de leur conclusion que le centrisme ne peut exister dans la période présente de la décadence.
Voilà nos minoritaires, qui font des concessions au conseillisme, devenus des puristes. Décidément ils ne craignent pas de se rendre ridicule en se revendiquant d’un parti communiste vierge et pur, un parti tombant du ciel ou sortant de la cuisse de Jupiter tout armé. Même myopes qu’ils sont et ne voyant pas très loin dans le temps, ils devraient au moins pouvoir voir et comprendre cette courte histoire qu’est celle du CCI. D’où venaient, donc les groupes qui ont fini par se regrouper dans le CCI ? Nos minoritaires n’ont d’ailleurs qu’à commencer par se regarder eux-mêmes et leur propre trajectoire politique. D’où venaient donc RI ou WR, ou la section de Belgique, des USA, d’Espagne, d’Italie, et de la Suède ??? Ne venaient-ils pas d’un marais confusionniste, anarchisant et contestataire ???
Il n’y aura jamais de mailles assez serrées pour nous donner la garantie absolue contre la pénétration des éléments centristes ou leur surgissement de l’intérieur. L’histoire du CCI -sans déjà parler de l’histoire du mouvement ouvrier- est là pour démontrer que le mouvement révolutionnaire est un processus de décantation incessant. Il suffit de regarder nos minoritaires pour se rendre compte de la somme de confusions qu’ils ont été capables d’apporter en une année.
Voilà que McIntosh a découvert que le flot de la première vague de la révolution a également charrié des Smeral, des Cachin, des Frossard et des Serrati. McIntosh a-t-il déjà vu de la fenêtre de son université ce qu’est un flot révolutionnaire ?
Pour ce qui concerne le PCF, McIntosh écrit aussi l’histoire à sa façon en disant par exemple que le parti adhère à l’IC groupé autour de Cachin-Frossard. Ne sait-il rien de l’existence du Comité de la 3ème Internationale groupé autour de Loriot et de Souvarine, en opposition au Comité de reconstruction de Faure et Longuet ? Frossard et Cachin zigzaguaient entre ces deux comités, pour se rallier à la fin à la résolution du Comité de la 3ème Internationale pour l’adhésion à l’IC. Au Congrès de Strasbourg en février 1920, la majorité est encore contre l’adhésion. Au Congrès de Tours, décembre 1920, la motion pour l’adhésion à l’IC obtient 3208 mandats, la motion de Longuet pour l’adhésion avec réserve 1022 et l’abstention (groupe Blum-Renaudel) 397 mandats.
Les mailles n’étaient-elles pas suffisamment serrées ? Certainement. N’empêche que c’est ainsi qu’on doit comprendre ce qu’est un flot montant de la révolution. Nous discutons sur le fait de savoir si les partis bolchevique, Spartakus, les partis socialistes qui ont constitué ou adhéré à l’IC étaient des partis ouvriers ou des partis de la bourgeoisie. Nous ne discutons pas sur leurs erreurs mais sur leur nature de classe, et les Mic-Mac d’Intosh ne nous sont d’aucune aide en la matière. De même que McIntosh ne sait pas voir ce qu’est un courant de maturation, qui va de l’idéologie bourgeoise vers la conscience de classe, il ne sait pas non plus ce qui le différencie d’un courant qui dégénère, c’est-à-dire qui va de la position de classe vers l’idéologie bourgeoise.
Dans sa vision d’un monde fixe, figé, le sens du mouvement n’a aucun intérêt ni aucune place. C’est pourquoi il ne saurait comprendre ce que veut dire aider le premier qui s’approche en le critiquant, et combattre sans pitié le second qui s’éloigne. Mais surtout, il ne sait pas distinguer quand le processus de la dégénérescence d’un parti prolétarien est définitivement achevé. Sans refaire toute l’histoire du mouvement ouvrier nous pouvons lui donner un point de repère : un parti est définitivement perdu pour la classe ouvrière quand il ne sort plus de son sein aucune tendance, aucun corps vivant (prolétarien). Ce fut le cas à partir de 1921 pour les partis socialistes, ce fut le cas au début des années 30 pour les partis communistes. C’est avec raison qu’on pouvait parler d’eux en terme de centrisme jusqu’à ces dates.
Et pour terminer, il faut retenir que la Nouvelle théorie de McIntosh, qui veut ignorer l’existence du centrisme en période de décadence, rappelle fort ces gens qui, au lieu de se soigner, optent pour ignorer ce qu’ils appellent une "maladie honteuse". On ne combat pas le centrisme en le niant, en l’ignorant. Le centrisme, comme toute autre plaie qui peut atteindre le mouvement ouvrier, ne peut être soigné en le cachant, mais en l’exposant, comme disait Rosa Luxemburg, en pleine lumière. La nouvelle théorie de McIntosh repose sur la crainte superstitieuse du pouvoir maléfique des mots : moins on parle de centrisme mieux on se porte. Pour nous, au contraire, on doit savoir connaître et reconnaître le centrisme, savoir dans quelle période, de flux ou de reflux, il se situe et comprendre dans quel sens il évolue. Surmonter et combattre le centrisme est en dernière analyse le problème de la maturation du facteur subjectif, de la prise de conscience de la classe.
MC (Décembre 1984)
Conscience et organisation:
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud: de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1970
- 2059 reads
Dans l’article précédent sur le mouvement ouvrier en Afrique du Sud (Publié dans la Revue internationale n° 154), nous avons abordé l’histoire de l’Afrique du Sud en évoquant successivement la naissance du capitalisme, celle de la classe ouvrière, le système d’apartheid et les premiers mouvements de lutte ouvrière. Et nous avons terminé l’article en montrant que, suite à l’écrasement des luttes ouvrières des années 1920, la bourgeoisie (représentée alors par le Parti Travailliste et le Parti National afrikaner) parvint à paralyser durablement toutes les expressions de lutte de classe prolétarienne et qu’il fallut attendre la veille de la Seconde Guerre mondiale pour voir la classe ouvrière sortir de son profond sommeil. En clair, après l'écrasement de la grève insurrectionnelle de 1922 dans un terrible bain de sang et jusqu’à la fin des années 1930, le prolétariat sud-africain fut tétanisé et, de ce fait, laissa le terrain de la lutte aux partis et groupes nationalistes blancs et noirs.
Le présent article met en évidence l’efficacité redoutable contre la lutte de classe du système d’apartheid combiné à l’action des syndicats et des partis de la bourgeoisie et cela jusqu’à la fin des années 1960 où, face au développement inédit de la lutte de classe, la bourgeoisie dut "moderniser" son dispositif politique et remiser ce système. En d’autres termes, elle dut faire face au prolétariat sud-africain qui finit par reprendre ses luttes massivement en s’inscrivant ainsi dans les vagues de lutte qui marquèrent au niveau mondial la fin des années 1960 et le début des années 1970.
Pour évoquer cette période de luttes de la classe ouvrière, nous nous appuyons largement sur l’ouvrage Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, de Brigitte Lachartre 1, membre du Collectif de recherche et d’information sur l’Afrique australe - C.R.I.A.A.- le seul (à notre connaissance) qui se consacre véritablement à l’histoire des luttes sociales en Afrique du Sud.
Reprise éphémère de la lutte de classe durant la seconde boucherie de 1939-45
En fait, les préparatifs guerriers en Europe se traduisirent pour l’Afrique du Sud par l’accélération inattendue du processus de son industrialisation, les grands pays industriels constituant alors les principaux soutiens de l’économie sud-africaine: "(…) La période 1937-1945 fut marquée par une accélération brutale du processus industriel. L’Afrique du Sud, à l’époque, fut contrainte de développer ses propres industries de transformation étant donné la paralysie économique de l’Europe en guerre et ses exportations à travers le monde". (Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud)
Cela eut comme conséquence le recrutement massif d’ouvriers et l’augmentation des cadences de la production. Contre les cadences et la dégradation de ses conditions de vie, la classe ouvrière dut se réveiller brutalement en se lançant dans la lutte : "Pour les masses africaines, cette phase d’intensification industrielle se traduisit par une prolétarisation accélérée, encore accrue du fait qu’un quart de la population active blanche s’enrôlait alors dans le service militaire volontaire aux côtés des Alliés. Pendant cette période, les luttes ouvrières et les grèves aboutirent à des augmentations de salaires notables (13 % par an entre 1941 et 1944) et à une recrudescence du mouvement syndical africain. (…) Entre 1934 et 1945, on releva le chiffre record de 304 grèves dans lesquelles prirent part 58 000 Africains, métis et Indiens et 6 000 Blancs. En 1946, le syndicat des mineurs africains, organisation non reconnue légalement, déclencha une très importante vague de grèves à travers le pays qui fut réprimée dans le sang. Elle n’en avait pas moins réussi à mobiliser quelque 74 000 travailleurs noirs". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Dès lors, le régime sud-africain fut contraint de développer ses propres industries de transformation, étant entendu également qu’il devait remplacer une grande partie de la main-d’œuvre mobilisée dans la boucherie impérialiste. Cela signifie que l’Afrique du Sud avait déjà atteint, à ce moment-là, un certain niveau de développement technologique lui permettant de se passer (momentanément) de ses fournisseurs européens, ce qui fut un cas unique sur le continent noir.
Pour sa part, et de façon inattendue, la classe ouvrière put reprendre assez massivement son combat en réaction à la surexploitation liée à l’accélération des cadences. A travers un mouvement héroïque (dans un contexte de guerre où s’appliquait la loi martiale), elle put arracher des augmentations de salaire avant de se faire massacrer dans un bain de sang. Cette lutte défensive était cependant largement insuffisante pour influer positivement sur la dynamique de la lutte de classe, encore largement contenue par l’État bourgeois. En effet, celui-ci ne tarda pas à profiter du contexte guerrier pour renforcer son dispositif répressif et parvint finalement à infliger une lourde défaite à l’ensemble du prolétariat sud-africain. Cette défaite (comme celles subies précédemment) traumatisa pour longtemps la classe ouvrière et la plongea durablement dans l’inertie permettant ainsi à la bourgeoisie sud-africaine de consolider sa victoire sur le plan politique à travers en particulier l’officialisation du système d’apartheid. En clair, l’État sud-africain, qui était jusqu'alors dirigé par les Afrikaners après leur victoire aux élections législatives de 1948, décida de renforcer toutes les anciennes lois et mesures répressives 2 contre la masse prolétarienne en général. Ainsi, l’apartheid devint officiellement un système de gouvernance permettant de justifier et d’assumer ouvertement les actes les plus barbares contre la classe ouvrière dans ses diverses composantes ethniques et plus particulièrement à l’encontre des africains. Cela allait des "petites" vexations jusqu’aux pratiques les plus abjectes : toilettes séparées, cantines séparées, zones d’habitation séparées, bancs publics séparés, bus/taxis séparés, écoles séparées, hôpitaux séparés, etc. Et le tout se conclut par un article de loi visant à réprimer par l’emprisonnement quiconque se risquait à enfreindre ces monstrueuses lois. Et, effectivement, chaque année, plus de 300 000 personnes étaient arrêtées pour infraction aux lois abjectes. Ainsi, un ouvrier d’origine européenne risquait d’aller en prison s’il était surpris en train de boire un verre avec un noir ou un métis. Dans ce contexte où tout le monde risquait la prison, inutile d’envisager une discussion politique entre prolétaires d’ethnies différentes. 3
Cette situation pesa terriblement sur les capacités de lutte de la classe ouvrière dans son ensemble au point de la plonger à nouveau dans une période de "sommeil" (après celle des années 20) qui dura des années 1950 jusqu’au début des années 1970. Durant cette période, la lutte de classe était dévoyée principalement par les tenants de la lutte de "libération nationale" à savoir les partisans de l’ANC/PC, cause derrière laquelle ils entraîneront tant bien que mal les ouvriers sud-africains noirs jusqu’à la fin de l’apartheid.
Partis et syndicats détournent les luttes sur le terrain nationaliste
Partis et syndicats jouèrent un rôle de premier plan pour détourner systématiquement les luttes ouvrières sur le terrain du nationalisme blanc et noir. Il n’est pas nécessaire de faire un long développement sur le rôle qu‘a joué le Parti Travailliste contre la classe ouvrière, ceci étant évident du fait que, dès le lendemain de sa participation active à la boucherie mondiale de 1914-18, il se trouva au pouvoir pour mener ouvertement des violentes attaques contre le prolétariat sud-africain. D’ailleurs, à partir de ce moment-là, il cessa de revendiquer officiellement son appartenance "au mouvement ouvrier", ce qui ne l’empêchait pas de préserver ses liens avec les syndicats dont il était proche comme TUCSA. (Trade Union Confederation of South Africa). En outre, entre 1914 et la fin de l’apartheid, avant de se disloquer, il passait du gouvernement à l’opposition, et inversement, comme tout parti bourgeois "classique".
Pour plus de détail par rapport à l’ANC, nous renvoyons les lecteurs à l’article précédent de la série publié dans la Revue internationale n° 154. En fait, si nous l’évoquons ici, c’est surtout du fait de son alliance avec le PC et les syndicats qui lui permirent de jouer un double rôle d’encadrement et d’oppresseur de la classe ouvrière.
Quant au Parti Communiste, nous allons y revenir à propos d’une certaine opposition prolétarienne qu’il a dû rencontrer à ses débuts dans sa dérive nationaliste noire, en application des orientations de Staline et de la Troisième internationale en dégénérescence. Certes les informations en notre possession ne nous indiquent pas l’importance numérique ou politique de cette opposition prolétarienne au Parti communiste sud-africain, mais elle fut suffisamment forte pour attirer l’attention de Léon Trotski qui tenta de la soutenir.
Le rôle contre-révolutionnaire du Parti Communiste sud-africain sous l’impulsion de Staline
Le Parti Communiste sud-africain, en tant que "parti stalinisé", joua un rôle contre-révolutionnaire néfaste dans les luttes ouvrières dès le début des années 1930, alors que cet ancien parti internationaliste était déjà en proie à un processus de profonde dégénérescence. Après avoir participé aux combats pour la révolution prolétarienne au début de sa constitution dans les années 1920, le PC sud-africain fut très vite instrumentalisé par le pouvoir stalinien et, dès 1928, il exécuta docilement ses orientations contre-révolutionnaires notamment celles consistant à faire alliance avec la bourgeoisie noire. La théorie stalinienne du "socialisme en seul pays" s’accompagnait de l’idée suivant laquelle les pays sous-développés devaient obligatoirement passer par "une révolution bourgeoise" et que, dans cette optique, le prolétariat pouvait toujours lutter contre l’oppression coloniale mais pas question pour autant de lutter pour le renversement du capitalisme en vue d’instaurer un quelconque pouvoir prolétarien dans les colonies. Cette politique se traduisit concrètement, dès la fin des années 1920, par une "collaboration de classe" où le PC sud-africain fut d’abord la "caution prolétarienne" de la politique nationaliste de l’ANC avant de devenir définitivement son complice actif et ce jusqu’aujourd’hui. Ce qu’illustrent ces terribles paroles d’un secrétaire général du PC en s’adressant à Mandela : "Nelson(…) nous combattons le même ennemi (…), nous travaillons dans le contexte du nationalisme africain". 4
Une minorité internationaliste s’oppose à l’orientation nationaliste du PC sud-africain
Cette politique du PC sud-africain fut contestée par une minorité dont Trotski en personne tenta de soutenir l’effort mais, malheureusement, de façon erronée. En effet, au lieu de combattre résolument l’orientation nationaliste et contre-révolutionnaire préconisée par Staline en Afrique du Sud, Léon Trotski préconise en 1935 l’attitude suivante que les militants révolutionnaires doivent avoir vis-à-vis de l’ANC 5:
1. Les bolcheviks léninistes sont pour la défense du congrès (l’ANC), tel qu’il est, dans tous les cas où il reçoit des coups des oppresseurs blancs et de leurs agents chauvins dans les rangs des organisations ouvrières.
2. Les bolcheviks opposent, dans le programme du congrès, les progressistes et les tendances réactionnaires.
3. Les bolcheviks démasquent aux yeux des masses indigènes l’incapacité du congrès à obtenir la réalisation même de ses propres revendications, du fait de sa politique superficielle, conciliatrice, et lancent, en opposition au congrès, un programme de lutte de classe révolutionnaire.
4. S’ils sont imposés par la situation, des accords temporaires avec le congrès ne peuvent être admis que dans le cadre de tâches pratiques strictement définies, en maintenant la complète indépendance de notre organisation et notre totale liberté de critique politique.
C’est déconcertant de savoir que, malgré l’évidence du caractère contre-révolutionnaire de cette orientation stalinienne appliquée par le PC sud-africain vis-à-vis de l’ANC, Trotski chercha quand même à s’en accommoder par des détours tactiques. D’un côté il affirmait : "Les bolcheviks-léninistes sont pour la défense de l’ANC" et de l’autre : "Les bolcheviks démasquent aux yeux des masses indigènes l’incapacité du congrès à obtenir la réalisation même de ses propres revendications…".
Cela n’était rien d’autre que l’expression d’une politique d’accommodement et de conciliation avec une fraction de la bourgeoisie car, à ce moment-là, rien ne permettait d’entrevoir la moindre évolution possible de l’ANC vers une position de classe prolétarienne. Mais surtout, Trotski était incapable de voir le retournement du cours de la lutte de classe vers la contrerévolution qu’exprimait l’avènement du stalinisme.
On ne s'étonnera plus d'entendre le groupe trotskiste Lutte Ouvrière tenter (80 ans après), après avoir constaté le caractère erroné de l’orientation de Trotski, justifier cette orientation avec des contorsions typiquement trotskistes en disant, d’un côté : "La politique de Trotski n’a pas eu l’influence décisive mais il faut l’avoir à l’esprit …". D’autre côté, Lutte Ouvrière affirme que le PC sud-africain : "s’est mis entièrement au service de l’ANC et a continuellement cherché à en masquer le caractère bourgeois".
En effet, au lieu de dire simplement que la politique de Trotski en la matière était erronée et que le PC est devenu un parti bourgeois au même titre que l’ANC, LO fait des acrobaties hypocrites en cherchant à masquer la nature du parti stalinien sud-africain. Ce faisant LO tente de masquer son propre caractère bourgeois et des liens sentimentaux avec le stalinisme.
Le rôle de saboteurs des luttes des syndicats et la tentative d’un "syndicalisme révolutionnaire"
Il convient d’abord de dire que, de par leur rôle naturel de "négociateurs professionnels" et de "pacificateurs" des conflits entre la bourgeoisie et le prolétariat, les syndicats ne peuvent véritablement constituer des organes de lutte pour la révolution prolétarienne (marxiste), en particulier en période de décadence du capitalisme, comme l’illustre l’histoire de la lutte de classe depuis 1914.
Cependant, soulignons le fait que, avec la boucherie de 1914-18, des éléments ouvriers se réclamant de l’internationalisme prolétarien tentèrent de créer des syndicats révolutionnaires à l’instar des IWA (Industrial Workers of Africa), sur le modèle des IWW américains, ou encore de l’ICU (l’Industrial and Commercial Workers Union) : "(…) En 1917, une affiche fleurit sur les murs de Johannesburg, convoquant une réunion pour le 19 juillet : "Venez discuter des points d’intérêt commun entre les ouvriers blancs et les indigènes". Ce texte est publié par l’International Socialist League, une organisation syndicaliste révolutionnaire influencée par les IWW américains (…) et formée en 1915 en opposition à la Première Guerre mondiale et aux politiques racistes et conservatrices du Parti Travailliste sud-africain et des syndicats de métiers." 6 Comptant, au début, surtout des militants blancs, l’ISL s’oriente très vite vers les ouvriers noirs, appelant dans son journal hebdomadaire l’Internationale, à "construire un nouveau syndicat qui surmonte les limites des métiers, des couleurs de peau, des races et du sexe pour détruire le capitalisme par un blocage de la classe capitaliste".
Comme le montre la citation ci-après, des minorités véritablement révolutionnaires ont bien tenté de créer des syndicats "révolutionnaires" dans le but de détruire le capitalisme et sa classe dominante. Signalons que L’ICU naquit en 1919 suite à une fusion avec les IWA et connut un développement fulgurant. Mais, malheureusement, ce syndicat abandonna rapidement le terrain de l’internationalisme prolétarien : "Ce syndicat grossit énormément à partir de 1924 et connait un pic de 100 000 membres en 1927, ce qui en fait la plus grosse organisation d’Africains jusqu’à l’ANC des années 1950. Dans les années 1930, l’ICU établit même des sections en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe avant de décliner progressivement. L’ICU n’est pas officiellement une organisation syndicaliste révolutionnaire. Elle est plus influencée par des idéologies nationalistes et traditionalistes que l’anticapitalisme, et elle développe une certaine forme de bureaucratie" 7.
Comme on le voit, le syndicalisme "révolutionnaire" ne put se développer longtemps en Afrique du Sud comme le prétendent ses partisans. En fait L’ICU était un syndicat certes "radical" et combatif qui, dans un premier temps, put préconiser l’unité de la classe ouvrière. Mais, avant même la fin des années 1920, il s’orienta vers la défense exclusive de la "cause noire" sous prétexte que les syndicats officiels (blancs), eux, ne défendaient pas les ouvriers indigènes. Et d’ailleurs, dans le même sens, un des dirigeants les plus influents de l’ICU, Clements Kadalie 8, rejeta catégoriquement la notion de "lutte de classe" et cessa d’intégrer les ouvriers blancs (dont des membres du PC sud-africain) dans son syndicat. Finalement l’ICU périt au début des années 1930 sous les coups de boutoir du pouvoir en place et par ses propres contradictions. Cependant, par la suite, nombre de ses dirigeants purent poursuivre leurs actions syndicales dans d’autres groupements connus pour leur nationalisme syndical africain, tandis que les autres éléments optant pour l’internationalisme furent marginalisés ou se dispersèrent dans la nature.
Les syndicats conçus selon les lois du régime d’apartheid
Comme tous les États, le régime d’apartheid éprouva le besoin de syndicats face à la classe ouvrière mais, dans ce cas, ceux-ci devaient être modelés selon les principes du système ségrégationniste : "(…) La population syndiquée sud-africaine est organisée dans des syndicats cloisonnés entre eux en fonction de la race de leurs membres. Une première distinction est officiellement imposée entre les syndicats reconnus, c'est-à-dire enregistrés au ministère du Travail, et les organisations ouvrières non reconnues par le gouvernement, c'est-à-dire qui ne jouissent pas du statut officiel de syndicat ouvrier. Ce premier clivage est issu, d’une part, de la loi sur le règlement des conflits du travail bantou (…), qui maintenant les Africains hors du statut d’"employé" ne leur reconnaît pas le droit de former des syndicats à part entière ; d’autre part, de la loi sur la réconciliation dans l’industrie (…) qui autorise blancs, métis et indiens à se syndiquer mais interdit cependant la création de nouveaux syndicats mixtes." (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Au premier abord, on peut voir dans la conception du syndicalisme de l’État sud-africain un cynisme certain et un racisme très primaire. Mais, au fond, le but caché était d’éviter à tout prix la prise de conscience chez les ouvriers (de toutes origines) que les luttes de résistance de la classe ouvrière relevaient fondamentalement des affrontements entre la bourgeoisie et le prolétariat, c'est-à-dire, les deux véritables classes antagoniques de la société. Quel est justement le meilleur instrument de cette politique bourgeoise sur le terrain ? C’est évidemment le syndicalisme. De là, toutes ces lois et réglementations sur les syndicats décidées par le pouvoir de l’époque en vue d’une meilleure efficacité de son dispositif anti-prolétarien. Reste que la fraction africaine du prolétariat fut la principale cible du régime oppresseur car plus nombreuse et plus combative, d’où l’acharnement dont le pouvoir bourgeois fit preuve à son égard : "Depuis 1950, les syndicats africains ont vécu sous la menace de la loi sur la répression du communisme, qui donne au gouvernement le pouvoir de déclarer toute organisation, y compris un syndicat africain (mais non les autres syndicats) "illégale" pour le motif qu’elle se livre à des activités propres à favoriser les objectifs du communisme. (…) La définition du communisme inclut, entre autres, les activités visant à provoquer un "changement industriel, social ou économique". Ainsi, une grève, ou toute action organisée par un syndicat pour mettre un terme au système des emplois réservés ou obtenir des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail, peut fort bien être déclarée favorable au "communisme" et servir d’excuse pour mettre le syndicat hors la loi". 9
En fait, pour le pouvoir sud-africain, derrière les luttes ouvrières il y a le spectre de la remise en cause de son système, qu'il identifie à la lutte pour le communisme. Une telle perspective est, on le sait, loin de correspondre aux possibilités de cette période de contre-révolution défavorable aux luttes de la classe ouvrière sur son propre terrain de classe et où la lutte pour le communisme est identifiée à celle pour la mise en place de régimes de type stalinien. Cela n'empêche que, même dans ces conditions, les régimes en place, quels qu'ils soient, sont confrontés à la nécessité de faire obstacle à la tendance spontanée des ouvriers à lutter pour la défense de leurs conditions de vie et de travail. Le système d'apartheid étendu aux syndicats constituant alors le meilleur moyen d'y faire face, tout syndicat ne se pliant pas à ses règles courrait le risque d'être mis hors la loi.
Les principaux syndicats existants jusqu’aux années 1970
Ils sont les suivants :
- les syndicats d’origine européenne : ils ont toujours suivi les orientations du pouvoir colonial, et en particulier ont soutenu les efforts de guerre en 1914-18 comme en 1939/45. De même qu’ils assumèrent, jusqu’à la fin du système d’apartheid et au-delà, leur rôle de "défenseurs" des intérêts exclusifs des ouvriers blancs, y compris lors qu’ils comptaient des ouvriers de couleur dans leurs rangs. Il s’agit, d’une part, de la Confédération Sud-africaine du Travail (South African Confederation of Labor), considérée comme la centrale ouvrière la plus raciste et la plus conservatrice du pays (proche du régime d’apartheid) et, d’autre part, Le Conseil des Syndicats Sud-Africain (Trade Union Confederation of South Africa) dont les liens de complicité avec le Parti Travailliste sont très anciens. La plupart des travailleurs de couleur (des indiens ou des métis comme définis par le régime mais ni des blancs ni des noirs) se trouvent pour leur part tantôt dans les syndicats mixtes (surtout des blancs mais aussi quelques métis) tantôt dans les syndicats de "couleur".
- les syndicats africains : ils sont plus ou moins fortement liés au PC et à l’ANC, se proclamant défenseurs des ouvriers africains ainsi que pour la libération nationale. Il s’agit du Congrès des Syndicats Sud-Africain (SACTU - South African Congress of Trade Unions), la Fédération des Syndicats Libres d’Afrique du Sud (FOFATSA) et le Syndicat National des Mineurs (NUM - National Union of Miners).
En 1974, on comptait 1 673 000 syndiqués organisés d’une part en 85 syndicats exclusivement blancs et d’autre part en 41 syndicats mixtes lesquels regroupaient au total 45 188 membres blancs et 130 350 de couleur. Mais, bien que minoritaires par rapport aux syndiqués de couleur, les syndiqués blancs étaient bien entendu plus avantagés et mieux considérés que ces derniers : "(…) Les syndicats de travailleurs blancs sont concentrés dans des secteurs économiques protégés de longue date par le gouvernement et réservés en priorité à la main-d’œuvre afrikaner, base électorale du parti au pouvoir. En effet, les six syndicats blancs les plus importants numériquement (…), sont implantés dans les services publics et municipaux, l’industrie du fer et de l’acier, l’industrie automobile et la construction mécanique, les chemins de fer et les services portuaires". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Avec ce type de dispositif syndical, on comprend mieux les difficultés de la classe ouvrière blanche à se sentir proche des autres fractions sœurs (noire, métisse et indienne) car les barrières d’acier mises en place par le système de séparation furent visiblement insurmontables pour envisager la moindre action commune entre prolétaires face au même exploiteur.
On recensait (en 1974) 1 015 000 syndiqués organisés, d’une part, en syndicats exclusivement de couleur et, d’autre part, en syndicats mixtes (c'est-à-dire tous les syndiqués à l'exclusion des noirs africains). "En effet, les syndicats blancs sont racialement homogènes, tandis que les syndicats de métis ou d’Asiatiques le sont véritablement devenus sous la contrainte du gouvernement nationaliste" (Brigitte Lachartre, Ibid.).
Dans la même période de référence (1974), les noirs africains représentaient 70 % de la population active et quelque 6 300 000 d’entre eux étaient affiliés à des syndicats non reconnus officiellement, tout en n’ayant pas le droit de s’organiser. Voilà encore une aberration du système d’apartheid avec sa bureaucratie d’un autre âge où l’État et les employeurs pouvaient se permettre d’employer des gens tout en leur refusant le statut d’employé mais en les laissant cependant créer leurs propres syndicats. Quel pouvait être donc le but de la manœuvre du pouvoir dans cette situation ?
Il est clair que la tolérance des organisations syndicales africaines en milieu ouvrier par le pouvoir n’était nullement en contradiction avec son objectif visant à contrôler et à diviser la classe ouvrière sur une base ethnique ou nationaliste. En effet il est plus facile de contrôler une grève encadrée par des organisations syndicales "responsables" (même si pas reconnues) que d’avoir affaire à un mouvement de lutte "sauvage" sans dirigeants identifiés d’avance. D’ailleurs, sur ce plan, le régime sud-africain ne faisait que suivre une "recette" qu’appliquent tous les États face au prolétariat combatif.
La lutte de libération nationale contre la lutte de classe
En réaction à l’instauration officielle de l’apartheid (1948), qui se traduisit par l’interdiction formelle des organisations africaines, le PC et l’ANC mobilisèrent leurs militants, y compris syndicaux, et se lancèrent dans la lutte armée. Dès lors, la terreur fut employée de part et d’autre, la classe ouvrière en subit les conséquences et, en particulier, ne put éviter d’être enrôlée par les uns et les autres. En clair, voilà la classe ouvrière dans son ensemble prise durablement en otage par les nationalistes de tous bords. "Entre 1956 et 1964, les principaux leaders de l’ANC, du PAC 10, du Parti communiste sud-africain avaient été arrêtés. Les interminables procès auxquels ils furent soumis se soldèrent par la détention à vie ou le bannissement renouvelé des principaux chefs historiques (N. Mandela, W. Sisulu, R. Fischer…) tandis que des peines de prison très lourdes frappaient l’ensemble des militants. Ceux qui purent échapper à la répression, se refugièrent au Lesotho, au Ghana, en Zambie, en Tanzanie, au Botswana. (…) Par ailleurs, des camps militaires regroupent dans les pays frontaliers de l’Afrique du Sud les réfugiés ou "combattants de la liberté" qui suivent un entraînement militaire et se tiennent prêts à intervenir. A l’intérieur du pays, la décennie 1960-1970 est celle du silence : la répression a fait taire l’opposition et seules les protestations de quelques organisations confessionnelles et étudiantes se font entendre. Les grèves se comptent sur les doigts de la main et pendant que les travailleurs noirs courbent l’échine, les chefs noirs fantoches, désignés par le gouvernement nationaliste, collaborent à la politique de divisions du pays". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
À travers ce propos il apparait clairement que le prolétariat sud-africain fut enchaîné, coincé entre la répression du pouvoir en place et l’impasse de la lutte armée lancée par les nationalistes africains. Cela justifie amplement la passivité dont la classe ouvrière fit preuve durant cette longue période allant globalement des années 1940 jusqu'à1970 (mis à part l’épisode des luttes éphémères durant la Seconde boucherie mondiale). Mais surtout, cette situation fut l’occasion pour les partis et les syndicats d’occuper intégralement le terrain idéologique en vue d’empoisonner la conscience de classe en s’efforçant de transformer systématiquement toute lutte de la classe ouvrière en une lutte de "libération" chez les uns et en défense des intérêts des "ouvriers blancs" chez les autres. Evidemment tout cela ne pouvait que satisfaire les objectifs de l’ennemi de la classe ouvrière à savoir le capital national sud-africain.
Reprise véritable de la lutte de classe: vagues de grève entre 1972 et 1975
Après une longue période d’apathie où elle fut silencieuse et prise en tenaille par le pouvoir d’apartheid et les tenants de la lutte de libération, la classe ouvrière finit fort heureusement par reprendre ses luttes (cf. Brigitte Lachartre) en Namibie (colonie d’alors de l’Afrique du Sud) en s’inscrivant ainsi dans le processus des vagues de lutte au niveau mondial marquant la fin des années 1960 et les années 1970.
L’exemple namibien
Comme en Afrique du Sud, la classe ouvrière en Namibie se trouva, d’un côté, sous la coupe sanglante du régime policier sud-africain, et de l’autre côté, bien encadrée par les partisans de la lutte de libération nationale (SWAPO - South-West African People's Organisation). Mais, contrairement à la classe ouvrière en Afrique du Sud bénéficiant d’une longue expérience de lutte, ce fut celle de Namibie qui n’en avait pas (à notre connaissance) qui ouvrit le "bal" des luttes des années 1970 : "Onze ans s’étaient écoulés depuis les derniers mouvements de masse africains. Le pouvoir blanc avait mis ce répit à profit pour consolider son plan de développement séparé. Sur le front social, le calme et la stabilité pouvaient être proclamés bien haut à travers le monde. Deux séries d’événements vinrent cependant troubler la "paix blanche" de l’Afrique du Sud et réveiller les inquiétudes : la première se produisit à la fin de 1971 en Namibie, territoire illégalement occupé par l’Afrique du Sud et qui est, depuis 1965, agité par la résistance de l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (S.W.A.P.O.) au gouvernement central de Pretoria. La seconde se déroula dans le courant de 1972 en Afrique du Sud même, sous forme de grèves spectaculaires lancées par les conducteurs de bus de Johannesburg. On attribue généralement à ces deux vagues de troubles un rôle détonateur par rapport aux événements qui se déclenchèrent dès les premiers jours de janvier 1973". (Brigitte Lachartre, ibid.)
La première grève démarra donc en Namibie, à Windhoek (la capitale) et dans sa banlieue proche, à Katutura, où 6 000 travailleurs décidèrent de partir en lutte contre l’oppression politique et économique exercée sur eux par le pouvoir sud-africain. Et 12 000 autres travailleurs répartis sur une douzaine de centres industriels ne tardèrent pas à suivre le même mot d’ordre de grève de leurs camarades de Katutura. Voilà donc 18 000 grévistes croisant les bras plusieurs jours après le début du mouvement, soit un tiers de la population active estimée alors à 50 000. Et, malgré les menaces de répression de l’État et le violent chantage du patronat, la combattivité ouvrière resta intacte : "Deux semaines après le début de la grève presque tous les grévistes furent renvoyés dans les réserves. Les employeurs leur firent savoir qu’ils réembaucheraient les Ovambos (nom ethnique des grévistes) disciplinés, mais chercheraient leur main-d’œuvre ailleurs si ceux-ci n’acceptaient pas les conditions posées. Devant la fermeté des travailleurs, le patronat lança de larges campagnes de recrutement dans les autres réserves du pays ainsi qu’au Lesotho et en République d’Afrique du Sud : il ne parvint pas à recruter plus de 1 000 nouveaux travailleurs et fut contraint de s’adresser aux ouvriers ovambos". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
En clair, devant la pugnacité des ouvriers, le patronat se mit à la manœuvre en cherchant à diviser les grévistes, mais il fut contraint de céder : "Les contrats de travail contre lesquels s’était organisée la grève, firent l’objet de quelques modifications ; l’agence de recrutement (la SWANLA - South-West African Native Labour Association) fut démantelée et ses fonctions dévolues aux autorités bantoues avec l’obligation de créer des bureaux de recrutement dans chaque Bantoustan ; les termes de "maîtres" et de "serviteurs" furent remplacés dans les contrats par ceux "d’employeurs" et "d’employés". (B. Lachartre, Ibid.)
Evidemment, vu tout ce qui restait dans l’arsenal du système d’apartheid appliqué au monde du travail, on peut dire que la victoire des grévistes ne fut pas décisive. Soit, mais une victoire hautement symbolique et prometteuse eut égard au contexte dans lequel se déroula le mouvement de grève : "L’ampleur des grèves fut telle qu’elle rendit impossible toute action punitive de style traditionnel de la part du gouvernement". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Cela signifie que le rapport de forces commençait à évoluer en faveur de la classe ouvrière qui sut montrer avec détermination sa combativité et son courage face au pouvoir répressif. D’ailleurs l’expérience exemplaire du mouvement de lutte des ouvriers namibiens ne manqua pas de se répandre en Afrique du Sud même en s’y exprimant plus massivement encore.
Grèves et émeutes en Afrique du Sud entre 1972 et 1975
Après la Namibie, la classe ouvrière reprit sa lutte en Afrique du Sud courant 1972 où 300 conducteurs de bus à Johannesburg se mirent en grève, 350 à Pretoria, 2 000 dockers à Durban et 2 000 au Cap. Toutes ces grèves portèrent sur des revendications de salaire ou d’amélioration des conditions de travail. Et leur importance pouvait se mesurer à l’inquiétude de la bourgeoisie qui ne tarda pas à employer des moyens énormes pour venir à bout des mouvements : "La réaction du pouvoir et du patronat fut brutale et expéditive. Les 300 grévistes de Johannesburg furent arrêtés. Parmi ceux de Durban, 15 furent licenciés. Dans d’autres secteurs, à la Ferro Plastic Rubber Industries, ils furent pénalisés de 100 rands ou de 50 jours de prison pour arrêt de travail illégal. A Colgate-Palmolive (Boksburg) tout le personnel africain fut licencié. Dans une mine de diamants, les mineurs en grève furent condamnés à 80 jours de prison, leurs contrats annulés et ils furent renvoyés dans leurs réserves". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Cette réaction très dure exprime très clairement l’inquiétude palpable de la classe dominante. Cependant la brutalité dont la bourgeoisie sud-africaine fit preuve s’accompagna d’une dose de réalisme car des augmentations de salaire furent accordées à certains secteurs grévistes en vue d’y favoriser la reprise du travail. Et comme le dit Brigitte Lachartre : "Mi-victoire, mi- défaite, les grèves de 1972 eurent principalement pour effet de surprendre les pouvoirs publics, qui plantèrent brutalement le décor, en refusant de négocier avec les travailleurs noirs, en faisant intervenir la police et en licenciant les grévistes. Quelques indications chiffrées permettent de mesurer l’ampleur des événements qui secouèrent le pays au cours des années suivantes : de sources différentes, elles ne concordent pas exactement et sont plutôt sous-estimées. Selon le ministère du Travail, il y eut 246 grèves en 1973, qui touchèrent 75 843 travailleurs noirs. De son côté, le ministère de la Police déclare avoir fait intervenir les forces de police sur le lieu de 261 grèves pour la même année. Pour leur part, les militants syndicalistes de Durban estiment à 100 000 le nombre des travailleurs noirs qui firent grève dans le Natal au cours des trois premiers mois de 1973. Pour 1974, le chiffre de 374 grèves est donné pour le seul secteur industriel et celui des grévistes aurait été de 57 656. La seule province du Natal connut officiellement, de juin 1972 à juin 1974, 222 arrêts de travail ayant affecté 78 216 travailleurs. À la mi-juin 1974, l’on avait dénombré 39 grèves dans la métallurgie, 30 dans le textile, 22 dans le vêtement, 18 dans la construction, 15 dans le commerce et la distribution. (…) Les grèves sauvages se multiplient. Durban compte 30 000 grévistes à la mi-février 73, et le mouvement se répand à travers tout le pays".
Comme on peut le voir, l’Afrique du Sud fut pleinement entraînée dans les vagues successives de lutte qui intervinrent à partir de la fin des années 1960 et qui signaient ainsi l’ouverture d’un cours au développement des affrontements de classe au niveau mondial. Nombre de ces mouvements de grève durent se heurter à la dure répression du pouvoir et des milices patronales et se soldèrent par des centaines de morts et de blessés dans les rangs ouvriers. C’est dire la hargne et l’acharnement des forces de l’ordre du capital sur les grévistes ne faisant que réclamer des dignes conditions d’existence. De ce fait, il faut souligner ici le courage et la combativité de la classe ouvrière sud-africaine (en particulier noire) qui partit généralement en lutte en étant solidaire et en s’appuyant sur sa propre conscience, comme l’illustre l’exemple suivant :
"La première manifestation de colère eut lieu dans une usine de matériel de construction (briques et tuiles) : la Coronation Brick and Tile Co, située dans la banlieue industrielle de Durban. 2 000 travailleurs, soit tout le personnel africain de l’entreprise, se mirent en grève le 9 janvier 1973 au matin. Ils demandent qu’on double leur salaire (qui s’élevait alors à 9 rands par semaine) puis qu’on le triple. Une augmentation avait été promise l’année précédente mais n’était pas encore intervenue."
"Les ouvriers de la première usine racontent comment débuta la grève : Ils furent réveillés par un groupe de camarades, vers trois heures du matin, qui leur dit de se réunir sur le terrain de football au lieu d’aller pointer au travail. Une sorte de délégation partit alors en direction des entrepôts des environs d’Avoca afin de demander aux autres ouvriers de les rejoindre au stade. C’est dans la bonne humeur que se déroula cette première phase de la grève et le mot d’ordre fut accueilli très favorablement. Personne ne passa outre. La main-d’œuvre d’Avoca se rendit au stade à travers la ville en deux colonnes et sans se soucier de la circulation très dense dans les rues de la ville à cette heure-là, ni des interdictions qu’elles étaient en train d’enfreindre. En franchissant les grilles du stade, tous chantaient : "Filumuntu ufesadikiza", qui signifie "l’homme est mort, mais son esprit est toujours vivant". (The Durban Strikes, cité par Brigitte Lachartre, Ibid.)
Nous assistons ici à une forme de lutte très différente dont la classe ouvrière fit preuve en se prenant ainsi en charge sans consulter personne, c'est-à-dire ni les syndicats ni d’autres "médiateurs sociaux", ce qui ne put que dérouter les employeurs. En effet, comme attendu, le PDG de l’entreprise déclara ne pas vouloir discuter avec les grévistes dans un stade de football mais qu’il serait prêt à négocier seulement avec une "délégation". Mais puisqu’un comité d’entreprise existait déjà, les ouvriers refusèrent tout net la formation d’une délégation en scandant "nos demandes sont claires, nous ne voulons pas de comité, nous voulons 30 rands par semaine". Dès lors le gouvernement sud-africain se mit à la manœuvre en envoyant les autorités zouloues (sinistres fantoches) "dialoguer" avec les grévistes alors que la police se tenait prête à tirer. Au final, les grévistes durent reprendre le travail sous la pression multiple et combinée des diverses forces du pouvoir en acceptant ainsi une augmentation de 2,077 rands après avoir refusé précédemment une de 1,50. Les ouvriers reprirent le travail avec un fort mécontentement car insatisfaits de la faible augmentation de salaire obtenue. Cependant, la presse ayant fait largement écho du mouvement, d’autres secteurs prirent immédiatement le relais en se lançant dans la lutte. "Deux jours plus tard, 150 ouvriers d’une petite entreprise de conditionnement de thé (T.W. Beckett) cessèrent le travail en réclamant une augmentation de salaire de 3 rands par semaine. La réaction de la direction fut d’appeler la police et de licencier ceux qui refusaient de reprendre le travail. Il n’y eut pas de négociations. L’un des employés déclara : "On nous donna 10 minutes pour nous décider". Une centaine d’ouvriers refusèrent de reprendre le travail. Quelques jours plus tard, la direction fit savoir qu’elle réembaucherait les ouvriers licenciés, mais au salaire précédent. Presque personne ne reprit son poste. Ce ne fut que trois semaines après le début de la grève que l’entreprise annonça qu’une augmentation de 3 rands était accordée à tous. La quasi-totalité des ouvriers fut réembauchés. (…) En même temps que cette grève se déroulait chez Beckett, les ouvriers africains de plusieurs entreprises d’entretien et de réfection de bateaux (J.H. Skitt and Co. Et James Brown and Hamer) cessèrent également le travail. (…) La grève dura plusieurs jours et une augmentation de 2 à 3 rands par semaine fut finalement accordée". (Propos tirés de The Durban Strike, cité par Brigitte Lachartre, Ibid.)
Un phénomène nouveau se produisait : une série de grèves qui se terminent par des vraies victoires car, devant le rapport de force imposé par les grévistes, le patronat (en compagnie de l’État) était contraint de céder aux revendications salariales des ouvriers. En ce sens, le plus illustratif de cette situation fut le cas de l’entreprise Beckett qui accorda une augmentation de 3 rands par semaine, c’est à dire la même somme que réclamaient ses employés, tout en étant contrainte de reprendre la quasi-totalité des ouvriers qu’elle venait de licencier. Un autre fait très remarquable fut la solidarité consciente dans la lutte entre ouvriers d’ethnies différentes, en l’occurrence Africains et Indiens. Ce magnifique geste illustre la capacité de la classe ouvrière à s’unir dans la lutte en dépit des multiples divisions institutionnalisées par la bourgeoisie sud-africaine et sciemment cautionnées et appliquées par les syndicats et les partis nationalistes. Par conséquent, au bout du compte, on peut parler d’une glorieuse victoire ouvrière sur les forces du capital. En effet, ce fut un succès apprécié comme tel par les ouvriers eux-mêmes, ce qui par ailleurs encouragea d’autres secteurs à se lancer dans la grève, par exemple le service public : "Le 5 février, fut engagée l’action la plus spectaculaire, mais aussi la plus grosse de tensions : 3 000 employés de la municipalité de Durban se mirent en grève dans les secteurs de la voirie, des égouts, de l’électricité, des abattoirs. Le salaire hebdomadaire de ce personnel s’élevait alors à 13 rands ; les revendications portaient sur le doublement de ce salaire. La contestation fit tache d’huile et bientôt ce furent 16 000 ouvriers qui refusèrent l’augmentation de 2 rands faite par le conseil municipal. A noter qu’Africains et Indiens agirent le plus souvent en étroite solidarité, bien que la municipalité ait renvoyé chez eux un grand nombre d’employés indiens, afin, fut-il déclaré qu’ils ne soient pas molestés et forcés à la grève par les Africains ! S’il est vrai qu’Africains et Indiens ont des échelles de salaires différentes, les écarts de salaires entre eux ne sont pas très importants et varient le plus souvent entre très bas et bas. D’autre part, si les Indiens ont le droit de grève – ce que les Africains n’ont pas - ce droit ne s’applique pas qu’à certains secteurs d’activités et qu’en de certaines circonstances. Or, dans les services publics, considérés comme "essentiels", la grève est interdite à tous de la même manière". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Cette grève, qui voit une jonction dans la lutte entre les secteurs privé et public, constitue aussi un élément majeur exprimant très clairement le haut niveau atteint par la combativité et la conscience de classe du prolétariat sud-africain en ce début des années 1970. Ce d’autant plus que ces mouvements se déroulèrent comme toujours dans le même contexte de répression sanglante comme réponse automatique du régime ségrégationniste, notamment face à ceux considérés comme "illégaux". Et pourtant, en dépit de tout cela, la combativité restait intacte et même se développait : "La situation demeurait explosive : les travailleurs municipaux avaient refusé une augmentation de salaire de 15 % ; le nombre d’usines touchées par la grève augmentait encore et la plupart des ouvriers du textile n’avaient pas encore repris le travail. S’adressant aux grévistes de la municipalité, un des fonctionnaires les menaça de la force dont il était en droit d’user, puisque leur grève était illégale. (…) La foule se mit alors à lui lancer des quolibets et à lui enjoindre de descendre de son estrade. Tentant d’expliquer que le conseil municipal avait déjà accordé une augmentation de 15 %, il fut de nouveau interrompu par les ouvriers qui lui crièrent qu’ils voulaient 10 rands de plus. (…) L’atmosphère de ces meetings semble avoir été le plus souvent euphorique et les commentaires de la foule des grévistes plus cocasses que furieux. Les travailleurs donnaient l’impression de se soulager d’un poids qui les oppressait depuis longtemps. (…) Quant aux revendications formulées lors de ces manifestations, elles révèlent également cette excitation euphorique, car elles portaient sur des augmentations de salaires bien plus élevées que ce qui pouvait réellement être obtenu, allant parfois de 50 à 100 %".
On peut ici parler d’une classe ouvrière qui retrouve grandement sa conscience de classe et ne se contente plus d’augmentations de salaire mais devient plus exigeante par rapport au respect de sa dignité. Mais surtout, elle fait preuve de confiance en elle-même comme le montre l'épisode rapporté ci-dessus où les grèvistes se moquent ouvertement du représentant des forces de l’ordre venu les menacer. Bref, comme le dit l’auteur de cette citation, les ouvriers étaient bien euphoriques et loin d’être ébranlés par la répression policière de l’État. Au contraire, cette situation où le prolétariat sud-africain démontre sa confiance en lui-même, sa conscience de classe finit par semer désordre et panique au sein de la classe dominante.
La bourgeoisie réagit de façon désordonnée face aux grèves ouvrières
Evidemment, face à une vague de luttes d’une telle vigueur, la classe dominante ne put rester bras croisés. Mais visiblement les dirigeants du pays furent surpris par l’ampleur de la combativité et de la détermination des grévistes, d’où la dispersion et les incohérences des réactions des acteurs de la bourgeoisie.
En témoignent des déclarations de ceux-ci :
Le président de la république : "Des organisations subversives persistent dans leur volonté d’inciter des secteurs de la population à l’agitation. Leurs effets sont résolument contrés par la vigilance constante de la police sud-africaine. Les grèves sporadiques et les campagnes de protestation qui, à en croire certaines publications - organes du Parti communiste - sont organisées ou moralement soutenues par elles, n’ont abouti à aucun résultat significatif".
Le ministre du Travail : "Les grèves du Natal montrent, dans leur déroulement, qu’il ne s’agit pas d’un problème de salaires. (…) Tout indique qu’une action a été organisée et que les grévistes sont utilisés pour obtenir autre chose qu’une simple augmentation de salaire. L’action des ouvriers et leur mauvaise volonté à négocier montrent à l’évidence que l’agitation pour les droits syndicaux n’est pas la solution et que ce n’est qu’un écran de fumée qui cache bien autre chose…".
Un représentant du patronat : "Je ne sais pas qui le premier a eu l’idée de remplacer les grévistes par des détenus, mais cette solution mérite qu’on l’étudie. L’autre solution serait d’employer des Blancs, mais ils utilisent des pistolets à peinture, ce qui n’est guère praticable avec le vent qu’il fait. Quant aux prisonniers, on les utilise bien pour nettoyer le port et ses alentours…"
Un observateur à propos de l’attitude des syndicats face aux grèves : "Un autre aspect important de la situation sociale dans le pays fut particulièrement mis en lumière au cours de ces grèves : à savoir la perte d’influence considérable des syndicats officiels. Bien que des membres de tels syndicats se soient trouvés impliqués dans certaines de ces grèves, la plupart des organisations syndicales étaient conscientes que l’initiative était entièrement du côté des travailleurs africains non syndiqués et qu’il ne servait à rien de vouloir intervenir".
Cette série de réactions montre à l’évidence un sentiment de panique à tous les étages de l’État sud-africain et le phénomène est d’autant plus préoccupant pour la bourgeoisie que ces mouvements de grève furent déclenchés et souvent gérés par les ouvriers eux-mêmes, c'est-à-dire sans initiatives syndicales. Cette tentative d’autonomisation des luttes ouvrières explique très largement les divisions qui se manifestèrent ouvertement chez les tenants du pouvoir par rapport aux moyens à mettre en œuvre pour contrecarrer la dynamique de la classe ouvrière, comme l’illustre la citation suivante : "Les secteurs anglophones et internationaux du capital n’ont pas le même attachement aux doctrines racistes et conservatrices que les administrateurs de l’État. Pour eux, les concepts de productivité et de rentabilité priment – du moins au niveau du discours - sur l’idéologie officielle et les encombrantes législations sur la barrière de couleur (…). Les portes-parole les plus avancés du patronat dont Harry Oppenheimer - président de l’Anglo-Américan Corporation - est le chef de file, prône ainsi l’intégration progressive de la main-d’œuvre africaine dans les emplois qualifiés mieux rémunérés, l’amélioration des conditions de vie et de travail des ouvriers et mineurs noirs, ainsi que l’introduction, contrôlée et par étape, du syndicalisme africain". (Brigitte Lachartre, Ibid.)
Et, tirant les leçons des luttes ouvrières, ce grand patron (Oppenheimer) d’une des plus grandes sociétés diamantaires fut à l’initiative (avec d’autres) de la légalisation des syndicats africains afin de leur donner les moyens de mieux encadrer la classe ouvrière. Dans le même sens voici l’argumentaire d’un porte-parole du "Parti progressiste" allié proche du grand patron cité : "Les syndicats jouent un rôle important en ce qu’ils préviennent les désordres politiques, (…) qui, l’histoire le démontre suffisamment, succèdent la plupart du temps aux revendications d’ordre économique. Si l’on peut éviter ces désordres par le biais du syndicalisme et celui de négociations sur les salaires et les conditions de travail, l’on diminue d’autant les autres risques. Et ce n’est pas le syndicalisme qui risque d’aggraver la situation". Contrairement aux tenants de la "ligne dure" de l’apartheid, ce porte-parole de la bourgeoisie (qu’on peut qualifier d’"éclairé") voit bien l’importance du rôle que jouent les syndicats en faveur de la classe dominante en tant que forces d’encadrement de la classe ouvrière et de prévention des "risques" et des "désordres politiques".
La combativité ouvrière contraint la bourgeoisie à changer son dispositif législatif
Comme il fallait s’y attendre, en tirant les enseignements des vagues de lutte qui secouèrent le pays durant les premières années de 1970, la bourgeoisie sud-africaine ("éclairée") se devait de réagir en prenant une série de mesures en vue de faire face à la combativité montante d’une classe ouvrière prenant de plus en plus conscience de sa force et confiance en elle. "Les grèves de 1973 éclatèrent alors que les députés ouvraient la session parlementaire au Cap. Comme nous le rapportent les syndicalistes de Durban, des représentants des organisations d’employeurs et de Chambres de commerce se rendirent en délégation pour rencontrer le ministre du Travail afin de mettre en place les premiers pare-feu à l’agitation ouvrière. A cette occasion, les consultations État- patronat furent nombreuses et suivies ; les erreurs du passé ne furent pas répétées". (Brigitte Lachartre. Ibid)
En effet à l’issue d’une série de consultations entre l’État, les parlementaires et le patronat il fut décidé "d'assouplir" nombre de dispositifs répressifs en vue de prévenir les "grèves sauvages" en donnant ainsi plus de place aux syndicats africains afin qu'ils puissent assumer le "travail de contrôle" sur les ouvriers. Ce faisant la bourgeoisie sud-africaine devint plus "raisonnable" en tenant compte de l’évolution du rapport de forces imposée par la classe ouvrière à travers ses luttes massives.
Pour conclure provisoirement sur ces grandes vagues de grève, nous exposons les points de vue de Brigitte Lachartre (Ibid.) sur ces mouvements et celui d’un groupe de chercheurs de Durban, dont nous partageons pleinement l'essentiel concernant le bilan politique à tirer : "Le développement de la solidarité des travailleurs noirs au cours de l’action et la prise de conscience de leur unité de classe ont été soulignés par de nombreux observateurs. Cet acquis, non quantifiable, des luttes est considéré par eux comme le plus positif pour la poursuite de l’organisation du mouvement ouvrier noir."
Et selon l’analyse du groupe de chercheurs 11 cité par Brigitte Lachartre :
"Notons, par ailleurs, que la spontanéité des grèves fut une des raisons majeures de leur succès, comparée notamment avec les échecs relatifs des actions de masse menées par les Africains dans les années 50, dans une période d’activité politique pourtant intense. Il suffisait alors que les grèves soient visiblement organisées (…) pour que la police ait tôt fait de se saisir des responsables. A l’époque, les grèves telles qu’elles étaient organisées, constituaient une menace beaucoup plus grande pour le pouvoir blanc ; leurs exigences n’étaient pas négligeables et, du point de vue des Blancs, le recours à la violence apparaissait comme la seule issue possible.
Mais ce spontanéisme des grèves n’empêche pas que leurs revendications aient dépassé le cadre purement économique. Ces grèves étaient également politiques : le fait que les travailleurs demandaient le doublement de leur salaire n’est pas le signe de la naïveté ou de la stupidité des Africains. Il indique plutôt l’expression du rejet de leur situation et leur désir d’une société totalement différente. Les ouvriers retournèrent au travail avec quelques acquis modestes, mais ils ne sont pas plus satisfaits maintenant qu’ils l’étaient avant les grèves…"
Nous partageons plus particulièrement le dernier paragraphe de cette citation qui donne une conclusion cohérente à l’analyse globale du déroulement des luttes. En effet, comme le montrent ses diverses expériences, la classe ouvrière peut passer allègrement de la lutte économique à la lutte politique et vice versa. Mais retenons surtout l’idée suivant laquelle les grèves furent aussi très politiques. En effet, derrière les revendications économiques, la conscience politique de la classe ouvrière sud-africaine se développait et cela fut une source d’inquiétude pour la bourgeoisie sud-africaine. En d’autres termes, le caractère politique des vagues de grève des années 1972-1975 finit par provoquer des fissures sérieuses dans le système d’apartheid en obligeant les appareils politiques et industriels du capital à revoir leur dispositif d’encadrement de la classe ouvrière. Cela donna lieu à un vaste débat au sommet de l’État sud-africain sur la question de l’assouplissement des dispositifs répressifs et plus généralement sur la démocratisation de la vie sociale visant notamment la légalisation des syndicats noirs. Et de fait, dès 1973 (l’année de puissants mouvements de grève), dix-sept nouveaux syndicats noirs furent créés ou légalisés venant s’ajouter aux treize qui existaient auparavant. Autrement dit, ce fut ce débat déclenché par les luttes ouvrières qui aboutit au processus de démantèlement progressif de l’apartheid mais toujours sous la pression des luttes ouvrières. En clair en créant ou renforçant les forces syndicales, la bourgeoisie voulut en faire des "pompiers sociaux" aptes à éteindre le feu des luttes ouvrières. Par exemple, tout en conservant le mode de canalisation classique des mouvements sociaux (le nationalisme, le racisme et le corporatisme), la bourgeoisie y ajouta un nouveau volet de type "démocratique" en accordant ou élargissant les "droits politiques" (droits associatifs sous contrôle) aux populations noires. Ce fut ce même processus qui permit l’arrivée de l’ANC au pouvoir. Pour autant, comme on le verra par la suite, le pouvoir sud-africain ne pourra jamais abandonner ses autres moyens répressifs les plus traditionnels contre la classe ouvrière, à savoir ses forces armées policières et militaires. Ceci sera illustré dans l’article suivant notamment à travers le grand mouvement de lutte de Soweto en 1976.
Lassou, juin 2015
1 Editions Syros, Paris 1977. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que la simple lecture de l’ouvrage ne nous a pas permis de connaître réellement son auteur, ses influences politiques même si, au moment de la sortie de son livre, elle semble proche du milieu intellectuel de la gauche (voire l’extrême gauche) française, comme le suppose le propos suivant de son introduction : "(…) Qu’en dire à l’individu inquiet et conscient de la partie qui se joue en Afrique australe, au militant politique, syndicaliste, étudiant ? Lui parler des luttes qui s’y mènent, c’est, sans doute, ce qu’il attend. C’est aussi un moyen d’autant plus sûr d’attirer son attention qu’il lui sera démontré à quel point ces luttes sont proches de lui et combien leur issue dépend de la société à laquelle il appartient. C’est le choix qui a été fait ici : parler des luttes menées par le prolétariat noir au cours des dernières années. Non pas qu’il ne s’en produise pas d’autres à d’autres niveaux, et il en coûte de les passer sous silence (celles des intellectuelles de toutes races, des chrétiens progressistes…)."
Il se trouve que parmi les auteurs (chercheurs ou autres) que nous avons pu rencontrer dans nos recherches sur l’histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud, Brigitte Lachartre est la seule qui propose de se centrer sur la question des luttes ouvrières dans cette région en décrivant leur déroulement avec conviction et analyses détaillées. Au bout du compte, c’est pour cette raison que nous nous appuyons sur elle comme principale source documentaire. Bien entendu, le cas échéant, nous nous réservons le droit d’exprimer nos désaccords avec tel ou tel élément de ses points de vue.
2. Lois de 1924, promulguées par les Travaillistes et les Afrikaners alors au pouvoir.
3. Sur les difficultés "spécifiques" de la classe ouvrière blanche voir Revue internationale n° 154, chapitre "L’apartheid contre la lutte de classe", ou encore dans cet article, chapitre "La lutte de libération nationale contre la lutte de classe".
4. Voir Revue internationale n° 154.
5. Cercle Léon Trotski, Exposé du 29/01/2010, site Internet www.lutte-ouvrir [18]ère.org
6. Lucien van der Walt. Site Internet https://www.zabalaza.net [19]
7. Lucien van der Walt, Ibid.
9. Hepple A. Les travailleurs livrés à l’apartheid, cité par B. Lachartre, Ibid
10. Pan-Africanist Congress, une scission de l’ANC.
11. Auteurs de Durban Strikes 1973.
Géographique:
- Afrique du Sud [21]
