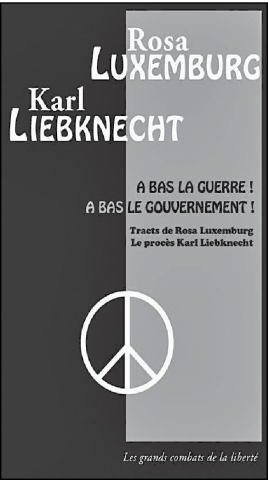Internationalisme n° 359 - 3e trimestre 2013
- 998 reads
Syrie: guerre impérialiste ou solidarité de classe
- 921 reads
Irak, Afghanistan, Liban, Egypte, Syrie, les massacres ne cessent de s’étendre. L’horreur et la barbarie capitalistes se répandent, les morts s’amoncellent. Véritable génocide en marche que rien ne semble pouvoir arrêter, la guerre impérialiste gagne encore et toujours du terrain. Le capitalisme en pleine décadence et décomposition entraîne le monde dans un chaos et une barbarie généralisés(1). L’utilisation des armes chimiques comme en Syrie actuellement n’est malheureusement qu’un des instruments de morts parmi bien d’autres. Mais cette perspective de destruction de l’humanité n’a rien d’irrémédiable. Le prolétariat mondial ne doit pas rester indifférent devant autant de massacres et de guerres, produits d’un système en pleine putréfaction. Seul le prolétariat en tant que classe révolutionnaire peut mettre définitivement fin à cette généralisation de la barbarie capitaliste. Communisme ou barbarie, plus que jamais l’humanité est confrontée à cette seule alternative.
La population syrienne sacrifiée sur l’autel des intérêts impérialistes
Le lundi 21 août, une attaque à l’arme chimique a fait des centaines de morts près de Damas, la capitale syrienne. Sur toutes les chaînes de télévision, dans tous les journaux s’étalaient des images insupportables d’enfants, de femmes et d’hommes agonisants. La bourgeoisie, sans aucun scrupule, se saisissait de cette tragédie humaine pour défendre toujours et encore ses sordides intérêts. Le régime de Bachar el Assad, boucher parmi les bouchers, venait de franchir la ligne rouge. Car officiellement, pour la classe bourgeoise, on peut massacrer à tour de bras mais pas avec des armes chimiques. Ce qu’elle appelle dans son jargon des armes sales, qui seraient bien différentes selon elle des armes propres, tels des bombes et obus en tout genre ou encore comme des bombes atomiques lancées en 1945 par les américains sur Hiroshima et Nagasaki. Mais l’hypocrisie de la bourgeoisie ne connaît pas de bornes. Depuis la Première Guerre mondiale de 1914-1918 où les gaz toxiques ont été employés massivement pour la première fois, faisant plusieurs centaines de milliers de morts, cette arme chimique n’a jamais cessé depuis d’être produite, « perfectionnée » et employée. Les accords de façade quant à sa non utilisation, notamment après les deux guerres mondiales et dans les années 1980 n’étant que déclarations de principes, ne visant aucunement à être appliquées. Et tel fut le cas ! Bien des théâtres de guerre depuis cette époque ont connu l’utilisation de ce type d’armes. Au Nord Yémen de 1962 à 1967, l’Egypte employa sans vergogne le gaz moutarde. Dans la guerre Iran-Irak en 1988, des villes telle Halabja ont été bombardées à l’arme chimique faisant plus de 5.000 morts, sous l’œil bienveillant et complice de la ‘communauté internationale’, des Etats-Unis à la France, en passant par l’ensemble des membres de l’ONU ! Mais l’utilisation de ce type d’armes n’est pas l’apanage des petits pays impérialistes, ou des dictatures à la Bachar el Assad, comme voudrait nous le faire croire la bourgeoisie. L’utilisation la plus massive de l’arme chimique à ce jour, à côté des bombardements au napalm, fut l’œuvre des Etats-Unis pendant la guerre du Vietnam. Il s’agissait de déverser massivement de l’herbicide contaminé à la dioxine afin de détruire les rizières et les forêts. Il fallait tout raser et réduire la population vietnamienne et le Vietcong à la famine. Terres brûlées et désertifiées, population grillée et asphyxiée... voilà l’œuvre de l’action du capitalisme américain au Vietnam, qui aujourd’hui avec d’autres grandes puissances occidentales, telle la France, s’apprêtent à intervenir en Syrie pour y défendre prétendument la population. Depuis le début de cette guerre en Syrie, il y a eu plus de 100.000 morts et au moins un million de réfugiés dans les pays limitrophes. Au-delà des discours déversés à longueur de temps par l’ensemble des médias bourgeois, la classe ouvrière doit savoir quelles sont les véritables causes du déchaînement de la guerre impérialiste en Syrie.
En Syrie, c’est la société capitaliste décadente qui est responsable
La Syrie est actuellement au cœur du développement des tensions inter-impérialistes et du chaos qui s’étend depuis l’Afrique du Nord jusqu’au Pakistan. Si la bourgeoisie syrienne s’affronte dans la guerre au sein d’un pays maintenant en ruines, elle peut s’appuyer pour continuer son jeu de massacre sur l’appétit insatiable de bon nombre d’impérialismes de tout acabit. Dans la région, l’Iran, le Hezbollah libanais, l’Arabie saoudite, Israël, la Turquie..., tous sont impliqués plus ou moins directement dans ce conflit sanglant. Les plus puissants impérialismes du monde y défendent également leurs plus sordides intérêts. La Russie, la Chine, la France, l’Angleterre et les Etats-Unis participent eux aussi à la propagation de cette guerre et à son extension dans l’ensemble de la région. Devant leur impuissance croissante à contrôler un tant soit peu la situation, ils y sèment encore plus le chaos et la destruction, suivant parfois cette vieille stratégie de la terre brûlée (« si je ne peux dominer cette région, qu’elle brûle »).
Durant la guerre froide, cette période qui va officiellement de 1947 à 1991 et la chute de l’URSS, deux blocs s’opposaient, l’Est et l’Ouest, avec à leur tête respectivement la Russie et les Etats-Unis. Ces deux super-puissances dirigeaient d’une main de fer leurs « alliés » ou « satellites », contraints à l’obéissance face à l’ogre ennemi. Le terme qualifiant cet ordre mondial s’appelait la discipline de bloc. Cette période historique fut lourde de danger pour l’humanité, puisque si la classe ouvrière n’avait pas été en mesure de résister, même passivement, à l’embrigadement idéologique guerrier, une troisième conflagration mondiale aurait été possible. Depuis l’effondrement de l’URSS, il n’y a plus de blocs, plus de risque d’une troisième guerre mondiale généralisée. Seulement, la discipline de bloc aussi a volé en éclats. Chaque nation joue depuis sa propre carte, les alliances impérialistes sont de plus en plus éphémères et de circonstance... ainsi, les conflits se multiplient sans qu’aucune bourgeoisie ne puisse finalement rien contrôler. C’est le chaos, la décomposition grandissante de la société.
Ainsi, l’affaiblissement accéléré de la première puissance impérialiste mondiale, les Etats-Unis, participe activement de l’enfoncement de tout le Moyen et Proche-Orient dans la barbarie. Au lendemain de l’attaque chimique aux alentours de Damas, les bourgeoisies française et anglaise, suivies beaucoup plus timidement par la bourgeoisie américaine, ont déclaré de manière tonitruante qu’un tel forfait ne pouvait rester impuni. La réponse militaire était imminente et serait proportionnelle au crime qui venait de se produire. Seulement voilà, la bourgeoisie américaine et certaines bourgeoisies occidentales dans son sillage, viennent de connaître deux revers retentissants dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak, pays en totale décomposition. Comment intervenir en Syrie sans se retrouver dans la même situation ? Mais plus encore, ces bourgeoisies ont à faire avec ce qu’elles appellent l’opinion publique, au moment même où la Russie envoie de nouveaux bateaux de guerres dans la région. La population ne veut pas de cette intervention ! Elle ne croit plus majoritairement aux mensonges de sa propre bourgeoisie. L’opinion publique défavorable à cette intervention, y compris sous la forme de bombardements limités dans le temps, pose un problème aux bourgeoisies occidentales.
Voici ce qui a finalement contraint la bourgeoisie anglaise à renoncer à intervenir militairement en Syrie, au prix de désavouer elle-même ses premières déclarations va-t-en-guerre ! C’est aussi la preuve que la bourgeoisie occidentale n’a pas de « bonne solution », que des mauvaises : soit elle n’intervient pas (comme vient de le choisir la Grande-Bretagne) et alors c’est un immense aveu de faiblesse ; soit elle intervient (comme cela semble se dessiner vraisemblablement pour les Etats-Unis et la France) et alors elle n’en retirera rien d’autre que toujours plus de chaos, d’instabilité et de tensions impérialistes incontrôlables.
Seul le prolétariat peut, en détruisant le capitalisme, venir à bout de la barbarie
Le prolétariat ne peut pas rester indifférent à toute cette barbarie. Ce sont des exploités, des familles entières qui se font massacrer, pourchasser par toutes les cliques impérialistes. Chiites ou sunnites, laïcs ou druzes... il n’y a de ce point de vue aucune différence. La réaction humaine et saine est de vouloir faire quelque chose, « tout de suite », d’arrêter ces crimes abominables. C’est ce sentiment qu’exploitent les grandes démocraties pour chaque fois mener et justifier leurs offensives guerrières au nom de « l’humanitaire ». Et chaque fois, la situation mondiale empire. Il s’agit donc d’un piège.
La seule façon pour l’humanité d’exprimer sa véritable solidarité envers toutes ces victimes du capitalisme pourrissant, c’est de mettre à bas ce système qui produit toutes ces horreurs. Un tel bouleversement ne se fera effectivement pas en un jour. Mais si ce chemin est long, c’est le seul à mener réellement à un monde sans guerre ni patrie, sans misère ni exploitation. Car la classe ouvrière n’a pas de drapeaux nationaux à défendre. Le pays où elle vit est le lieu de son exploitation et pour certains dans le monde, le lieu de leur mort, broyés par les armes de la classe capitaliste. Il est de la responsabilité de la classe ouvrière d’opposer au nationalisme guerrier bourgeois son internationalisme. Aussi difficile que soit ce chemin, il est nécessaire et... possible ! La classe ouvrière d’aujourd’hui doit se rappeler que la Première Guerre mondiale n’a pas pris fin de par la bonne volonté des belligérants, pas plus que par la défaite de l’Allemagne. C’est la révolution prolétarienne qui y a mis fin et elle seule.
Tino/31.08.2013
1)Lire p.4 la partie de la résolution du XX° congrès du CCI sur les tensions impérialiste
Rubrique:
L'Egypte nous montre l'alternative: socialisme ou barbarie
- 1214 reads
Face à l'agitation sociale en Égypte, l'armée a prouvé qu'elle reste la fraction la plus à même d'assurer le pouvoir et la défense des intérêts globaux de la bourgeoisie nationale.
Partout dans le monde, le sentiment que l'ordre actuel des choses ne peut plus continuer comme avant grandit. Suite aux révoltes du "Printemps arabe", au mouvement des Indignados en Espagne et celui des Occupy aux Etats-Unis, en 2011, l'été 2013 a vu des foules énormes descendre dans la rue en Turquie et au Brésil.
Des centaines de milliers de personne, voire des millions, ont protesté contre toute sorte de maux: en Turquie c'était la destruction de l'environnement par un "développement" urbain insensé, l'intrusion autoritaire de la religion dans la vie privée et la corruption des politiciens ; au Brésil, c'était l'augmentation des tarifs des transports en commun, le détournement de la richesse vers les dépenses sportives de prestige alors que la santé, les transports, l'éducation et le logement périclitent – et encore une fois, la corruption des politiciens. Dans les deux cas, les premières manifestations ont rencontré une répression policière brutale qui n'a fait qu'élargir et approfondir la révolte. Et dans les deux cas, le fer de lance du mouvement n'était pas les "classes moyennes" (c'est-à-dire, en langage médiatique, n'importe quelle personne qui possède encore un emploi), mais la nouvelle génération de la classe ouvrière qui, bien qu'éduquée, n'a qu'une maigre perspective de trouver un emploi stable et pour qui vivre au sein d'une économie "émergente" signifie surtout observer le développement de l'inégalité sociale et la richesse répugnante d'une minuscule élite d'exploiteurs.
En juin et juillet, c'était encore au tour des Égyptiens de descendre par millions dans les rues, revenant à la Place Tahrir qui fut l'épicentre de la révolte de 2011 contre le régime Moubarak. Eux aussi étaient poussés par de vrais besoins matériels, dans une économie qui n'est pas tant "émergente" que plutôt stagnante ou en régression. En mai, un ancien ministre des finances, un des principaux économistes égyptiens, soulignait dans un entretien au Guardian, que "L'Egypte souffre de sa plus grave crise économique depuis la Grande Dépression. Dans ses effets sur les plus démunis, la situation économique du pays est la pire depuis les années 1930". Et l'article de continuer : "Depuis la chute de Hosni Moubarak en 2011, l'Egypte a connu une chute dramatique des revenus à la fois de l'investissement étranger et du tourisme, suivie par une chute de 60% dans les réserves de devises, un déclin de 3% de la croissance, et une dévaluation rapide de la livre égyptienne. Tout cela a causé une augmentation vertigineuse des prix de la nourriture et du chômage, et une pénurie de carburant et de gaz pour la cuisine (...) Actuellement, selon les chiffres du gouvernement égyptien, 25,2% des Égyptiens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23,7% ne sont que guère au-dessus".
Le gouvernement islamiste "modéré" dirigé par Morsi et les Frères musulmans (avec le soutien des islamistes "radicaux") s'est rapidement révélé tout aussi corrompu que l'ancien régime, alors que ses tentatives d'imposer une "moralité" islamique étouffante a provoqué, comme en Turquie, un ressentiment énorme parmi la jeunesse urbaine.
Mais alors que les mouvements en Turquie et au Brésil, qui en pratique sont dirigés contre le pouvoir en place, ont généré un véritable sentiment de solidarité et d'unité parmi tous ceux qui participaient à la lutte, la perspective en Égypte est bien plus sombre : celle de la division de la population derrière différentes fractions de la classe dominante, voire la descente dans une guerre civile sanglante. La barbarie qui a englouti la Syrie ne nous montre que trop clairement ce que cela pourrait être.
Le piège de la démocratie
On a affublé les événements de 2011 en Égypte et en Tunisie du nom de "révolution". Mais une révolution est autre chose que des manifestations des masses dans les rues – même si cela est un point de départ nécessaire. Nous vivons une époque où la seule révolution possible est mondiale, prolétarienne et communiste : une révolution non pas pour changer de régime mais pour démanteler l'Etat ; non pas pour une gestion plus "juste" du capitalisme, mais pour le renversement du rapport social capitaliste tout entier ; non pas pour la gloire de la nation mais pour l'abolition des nations et la création d'une communauté humaine planétaire.
Les mouvements sociaux que nous voyons aujourd'hui sont encore loin de la conscience d'eux-mêmes et de l'auto-organisation nécessaires pour créer une telle révolution. Certes, ce sont des pas dans cette direction, qui expriment un effort profond du prolétariat de se trouver, de retrouver son passé et son avenir. Mais ce sont des pas hésitants, qui pourront être facilement dévoyés par la bourgeoisie, dont l'idéologie est profondément enracinée et constitue un énorme obstacle dans les esprits des exploités eux-mêmes. La religion est certes un de ces obstacles idéologiques, un "opium" qui prêche la soumission envers l'ordre dominant. Mais encore plus dangereuse est l'idéologie démocratique.
En 2011, les masses dans la Place Tahrir exigeaient la démission de Moubarak et la "fin du régime". Et on a effectivement poussé Moubarak dehors – surtout après le surgissement d'une vague puissante de grèves à travers le pays, ajoutant une dimension de plus à la révolte sociale. Mais le régime capitaliste est plus que le simple gouvernement en place : au niveau social, c'est tout le rapport basé sur le travail salarié et la production pour le profit. Au niveau politique, c'est la bureaucratie, la police, et l'armée. Et c'est aussi la façade de la démocratie parlementaire, où régulièrement au bout de quelques années, on offre aux masses le choix d'une nouvelle bande d'escrocs pour les plumer. En 2011, l'armée – que beaucoup de manifestants croyaient "unie" au peuple – est intervenue pour virer Moubarak et organiser les élections. Les Frères musulmans, qui tiraient leur grande force des régions rurales les plus arriérées mais qui étaient également le parti le mieux organisé dans les centres urbains, ont gagné les élections et, depuis, ont fait la plus claire des démonstrations possibles que changer de gouvernement par les élections ne change rien. Et pendant ce temps, le véritable pouvoir est resté en place comme dans tant d'autres pays : celui détenu au sein de l'armée, la seule force réellement capable d'assurer l'ordre capitaliste sur le plan national.
Lorsque les masses se sont déplacées de nouveau vers la Place Tahrir en juin, elles étaient pleines d'indignation contre le gouvernement Morsi et contre la réalité quotidienne de leurs conditions de vie face à une crise économique qui n'est pas simplement "égyptienne" mais mondiale et historique. Malgré le fait que beaucoup d'entre eux ont pu voir le vrai visage répressif de l'armée en 2011, l'idée que "le peuple et l'armée ne font qu'un" était très répandue, et a trouvé une nouvelle vie lorsque l'armée a commencé à prévenir Morsi qu'il devrait écouter le peuple ou faire face aux conséquences. Quand Morsi a été renversé par un coup d'Etat militaire quasiment sans effusion de sang, les scènes de célébrations ont été importantes sur la Place Tahrir. Est-ce que cela veut dire que le mythe démocratique ne tient plus les masses ? Non : l'armée prétend agir au nom de la "vraie démocratie" trahie par Morsi, et promet d'organiser de nouvelles élections.
Ainsi le garant de l'Etat, l'armée, intervient de nouveau, afin d'empêcher que la colère des masses ne se retourne contre l'Etat lui-même. Mais elle le fait cette fois-ci au prix de divisions profondes qu’elle a semées au sein de la population. Que ce soit au nom de l'Islam ou de la légitimité démocratique du gouvernement Morsi, un nouveau mouvement de protestation est né, qui exige le retour du régime Morsi et qui refuse de travailler avec ceux qui l'ont démis. La réponse de l'armée fut rapide : un massacre impitoyable des manifestants devant le QG de la Garde républicaine. Il y a eu aussi des accrochages, dont certains mortels, entre des groupes rivaux de manifestants.
Le danger de guerre civile et la force capable de l'empêcher
Les guerres en Libye et en Syrie ont démarré avec des manifestations populaires contre les régimes en place. Mais dans les deux cas, la faiblesse de la classe ouvrière et la force des divisions tribales et sectaires ont fait que ces révoltes furent rapidement englouties par des conflits armés entre factions bourgeoises. Et dans les deux cas, ces conflits locaux ont immédiatement acquis une dimension internationale: en Libye, la Grande- Bretagne et la France, discrètement soutenues par les États-Unis, sont intervenues pour armer et "guider" les forces rebelles ; en Syrie, le régime Assad a survécu grâce au soutien de la Russie, de la Chine, de l'Iran, du Hezbollah et autres vautours du même acabit, alors que l'Arabie saoudite et le Qatar ont armé les rebelles avec le soutien plus ou moins ouvert de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans les deux cas, l'élargissement du conflit a accéléré la chute dans le chaos et l'horreur.
Le même danger existe en Egypte aujourd'hui. L'armée n'est absolument pas prête à lâcher le pouvoir. Pour l'instant, les Frères musulmans ont promis de réagir pacifiquement au coup d'Etat militaire, mais à côté de l'islamisme "pragmatique" d'un Morsi, il y a des factions plus extrêmes qui sont déjà adossées au terrorisme. La situation ressemble de manière sinistre à celle de l'Algérie après 1991, quand l'armée a renversé un gouvernement islamiste "porté par les urnes", provoquant ainsi une guerre civile sanglante entre l'armée et des groupes islamistes armés comme le FIS. Comme d'habitude, la population civile en avait été la principale victime: on a estimé le nombre de morts entre 50.000 et 200 000.
La dimension impérialiste est également présente en Egypte. Les États-Unis ont exprimé leur regret à propos du coup d'État militaire, mais leurs liens avec l'armée sont anciens et profonds, et ils n'aiment pas le moins du monde le type d'islamisme prôné par Morsi ou par Erdogan en Turquie. Les conflits qui s'étendent aujourd'hui depuis la Syrie vers l'Irak et le Liban pourraient également atteindre une Égypte déstabilisée.
Mais la classe ouvrière en Égypte est une force bien plus formidable qu'en Syrie ou en Libye. Elle a une longue tradition de luttes combatives contre l'État et ses syndicats officiels qui remonte au moins jusqu'aux années 1970. En 2006 et en 2007, des grèves massives se sont étendues à partir des usines textiles hautement concentrées, et cette expérience de défiance ouverte envers le régime a alimenté le mouvement de 2011, fortement marqué par l'empreinte de la classe ouvrière à la fois dans ses tendances à l'auto-organisation qui sont apparues sur la Place Tahrir et dans les quartiers, comme dans la vague de grèves qui ont finalement convaincu la classe dominante de se débarrasser de Moubarak. La classe ouvrière en Égypte n'est pas immunisée contre les illusions démocratistes qui imprègnent tout le mouvement social, mais il ne sera pas facile non plus pour les cliques bourgeoises de la convaincre d'abandonner ses intérêts de classe et de l'attirer dans le cloaque de la guerre impérialiste.
La capacité potentielle de la classe ouvrière de barrer le chemin à la barbarie se voit non seulement dans son histoire de grèves autonomes et d'assemblées générales, mais aussi dans les expressions explicites de conscience qui sont apparues dans les manifestations de rue : dans des pancartes qui proclament "Ni Morsi, ni les militaires !", ou "La révolution, pas un coup d'État !", ainsi que dans des prises de position plus directement politiques comme la déclaration des "camarades du Caire" publiée récemment sur le site libcom: "Nous voulons un avenir qui ne soit gouverné ni par l'autoritarisme minable et le capitalisme de copinage des Frères musulmans, ni par l'appareil militaire qui maintient sa poigne de fer sur la vie politique et économique, ni par un retour aux anciennes structures de l'ère Moubarak. Même si les rangs des manifestants qui descendront dans la rue le 30 juin ne sont pas unis autour de cet appel, il doit être le nôtre – cela doit être notre position parce que nous n'accepterons pas un retour aux périodes sanglantes du passé".(1)
Cependant, tout comme « le printemps arabe » a trouvé son véritable sens avec le soulèvement de la jeunesse prolétarienne en Espagne, qui a donné lieu à un questionnement bien plus profond de la société bourgeoise, la capacité de la classe ouvrière en Égypte de barrer la route à de nouveaux massacres ne pourra être réalisée qu'à travers la solidarité active et la mobilisation massive des prolétaires dans les vieux centres du capitalisme mondial.
Il y a cent ans, face à la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg rappelait solennellement à la classe ouvrière que le choix offert par un ordre capitaliste sur le déclin était entre le socialisme ou la barbarie. L'incapacité de la classe ouvrière de mener à bien les révolutions qui ont répondu à la guerre de 1914-18 a eu comme conséquence un siècle de véritable barbarie capitaliste. Aujourd'hui, les enjeux sont plus élevés encore, parce que le capitalisme s'est donné les moyens de détruire toute vie sur la terre entière. L'effondrement de la vie sociale et le règne des bandes armées meurtrières – c'est ça, le chemin de la barbarie qui est illustré par ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. La révolte des exploités et des opprimés, la lutte massive pour défendre la dignité humaine et un véritable avenir – c'est ça, la promesse des révoltes sociales en Turquie et au Brésil. L'Égypte se tient à la croisée des chemins de ces deux choix radicalement opposés, et dans ce sens il est symbolique du dilemme auquel est confrontée toute l'espèce humaine.
Amos/10.07.2013
1 https://libcom.org/forums/news/we-can-smell-tear-gas-rio-taksim-tahrir-29062013 [2]
Rubrique:
Manifestations au Brésil: la répression policière provoque la colère de la jeunesse
- 1159 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article de Revolução Internacional, organe de presse du CCI au Brésil.
Une vague de protestations contre l’augmentation du prix des transports collectifs se déroule actuellement dans les grandes villes du Brésil, particulièrement dans la ville de São Paulo mais aussi à Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Aracaju et Natal. Cette mobilisation rassemble des jeunes, étudiants et lycéens et dans une moindre mesure, cependant non négligeable, des travailleurs salariés et autonomes (prestataires de services individuels).
La bourgeoisie brésilienne, avec à sa tête le PT (Parti du Travail) et ses alliés, a insisté pour réaffirmer que tout allait bien. Et cela alors que la réalité perceptible montre qu’il existe de grosses difficultés pour contenir l’inflation au moment où sont adoptées des mesures de soutien à la consommation des ménages afin d’éviter que l’économie n’entre en récession. Sans aucune marge de manœuvre, la seule alternative sur laquelle elle peut s’appuyer pour contenir l’inflation consiste d’une part à augmenter les taux d’intérêt et de l’autre à réduire les dépenses des services publics (éducation, santé et aide sociale).
Ces dernières années, beaucoup de grèves ont éclaté contre la baisse des salaires et la précarisation des conditions de travail, de l’éducation et du système de soins. Cependant, dans la majorité des cas, les grèves ont été isolées par le cordon sanitaire des syndicats liés au gouvernement "pétiste" (dominé par le PT) et le mécontentement a été contenu afin qu’il ne remette pas en question la "paix sociale" au bénéfice de l’économie nationale. C’est dans ce contexte qu’intervient l’augmentation du prix des transports à São Paulo et dans le reste du Brésil : toujours plus de sacrifices pour les travailleurs afin de soutenir l’économie nationale, c’est-à-dire le capital national.
Sans aucun doute, les exemples de mouvements qui ont explosé de par le monde ces dernières années, avec la participation de la jeunesse, mettent en évidence que le capitalisme n’a pas d’autre alternative à offrir pour le futur de l’humanité que l’inhumanité. C’est pour cela que la récente mobilisation en Turquie a eu un écho aussi fort dans les protestations contre le coût des transports au Brésil. La jeunesse brésilienne a montré qu’elle ne veut pas accepter la logique des sacrifices imposée par la bourgeoisie et s’inscrit dans les luttes qui ont secoué le monde ces dernières années comme la lutte des enfants de la classe ouvrière en France (lutte contre le CPE en 2006), de la jeunesse et des travailleurs en Grèce, Egypte et Afrique du Nord, des Indignés en Espagne, des "Occupy" aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Une semaine de protestations et la réaction brutale de la bourgeoisie
Encouragées par le succès des manifestations dans les villes de Porto Alegre et de Goiânia, qui ont dû faire face à une forte répression et qui, malgré celle-ci, ont réussi à obtenir la suspension de l’augmentation du prix des transports, les manifestations à São Paulo ont commencé le 6 juin. Elles furent appelées par le Mouvement pour le libre accès aux transports (MPL, Movimento Passe Livre), groupe constitué majoritairement par des jeunes étudiants influencés par les positions de gauche, et aussi anarchistes, qui a vu une augmentation surprenante de ses adhérents pour atteindre entre 2.000 à 5.000 personnes. D’autres mobilisations intervinrent ensuite les 7, 11 et 13 juin. Dès le début, la répression fut brutale et s’est soldée par de nombreuses arrestations et de nombreux jeunes blessés. Il faut ici souligner le courage et la combativité des manifestants et la sympathie qu’ils ont suscitée rapidement dans la population, dès le début, à un point tel que cela a surpris les organisateurs.
Face aux manifestations, la bourgeoisie a déchaîné un niveau de violence peu commun dans l’histoire de mouvements de ce type, parfaitement pris en charge par les médias qui se sont empressés de qualifier les manifestants de vandales et d’irresponsables. Une personne haut placée dans la hiérarchie étatique, le procureur de justice Rogério Zagallo, s’est illustré publiquement en conseillant à la police de bastonner et tuer : "Cela fait deux heures que j’essaie de regagner mon domicile mais il y a une bande de singes révoltés qui bloquent les stations Faria Lima et Marginal Pinheiros. Quelqu’un pourrait-il informer la Troupe de Choc (Tropa de Choque : unité d’élite de la police militaire) que cette zone fait partie de ma juridiction et que s’ils tuent, ces fils de putes, c’est moi qui instruirai l’enquête policière (…). Comment ne pas avoir la nostalgie de l’époque où ce genre de choses se résolvait avec une balle en caoutchouc dans le dos de ces merdes".
En plus de cela, on a vu une succession de discours d’hommes politiques appartenant à des partis adversaires entre eux, comme le gouverneur d’État Geraldo Alckmin, du PSDB (parti de la social-démocratie brésilienne) et le maire de São Paulo, du PT, tous deux vociférant en défense de la répression policière et condamnant le mouvement. Une telle syntonie n’est pas commune, vu que le jeu politique de la bourgeoisie consiste typiquement à attribuer la responsabilité des problèmes qui se posent à la fraction de la bourgeoisie qui se trouve momentanément au pouvoir.
En réponse à la répression croissante et au rideau de fumée des principaux journaux, chaînes de télévision et radio, davantage de participants se sont réunis à chaque mobilisation, jusqu’à 20.000 personnes jeudi dernier, le 13 juin. La répression fut encore plus féroce et cela se traduisit par 232 arrestations et de nombreux blessés.
Il vaut la peine de souligner l’apparition d’une nouvelle génération de journalistes. Quoiqu’encore minoritaires, à travers une claire manifestation de solidarité, ils ont rendu compte des violences policières et, en même temps, en ont été les victimes. Conscients des manipulations toujours présentes dans les éditoriaux des grands médias, ces journalistes sont parvenus, d’une certaine manière, à faire percevoir que les actes de violence des jeunes sont une réaction d’autodéfense et que, certaines fois, les déprédations effectuées essentiellement contre des cabinets gouvernementaux et de la justice sont des manifestations non contenues d’indignation contre l’État. En plus de cela, des actes émanant de provocateurs, ceux que la police utilise habituellement dans les manifestations, ont également été rapportés.
La mise en évidence d’une série de manipulations qui constituait un démenti aux versions de source étatique officielle, des médias et de la police tentant de falsifier les faits, de démoraliser et criminaliser un mouvement légitime, eut pour effet de multiplier la participation des manifestants et d’augmenter le soutien de la population. En ce sens, il est important de souligner la grande contribution qu’a eue l’action sur les réseaux sociaux d’éléments actifs dans le mouvement ou sympathisant avec lui. Par peur que la situation devienne incontrôlable, certains secteurs de la bourgeoisie commencent à changer de discours. Les grandes entreprises de communication, dans leurs journaux et télévisions, après une semaine de silence sur la répression policière ont finalement fait état des "excès" de l’action policière. Certains hommes politiques, de la même manière, ont critiqué les "excès" sur lesquels ils promettent d’enquêter.
La violence de la bourgeoisie à travers son État, quel que soit son visage, démocratique ou "radical", a comme fondement la terreur totalitaire contre les classes qu’elle exploite ou opprime. Si avec l’État démocratique, cette violence n’est pas aussi ouverte que dans les dictatures et est plus cachée, de manière à ce que les exploités acceptent leurs conditions d’exploités et s’identifient à elles, cela ne signifie pas que l’État renonce aux méthodes de répression physique les plus variées et modernes lorsque la situation l’exige. Ce n’est donc pas une surprise si la police déchaîne une telle violence contre le mouvement. Cependant, comme dans l’histoire de l’arroseur arrosé, on a vu que l’accroissement de la répression n’a fait que provoquer une solidarité croissante au Brésil et même dans le monde, encore que de façon très minoritaire. Des mobilisations en solidarité sont déjà prévues en dehors du Brésil, principalement à l’initiative de Brésiliens vivant à l’étranger. Il faut dire clairement que la violence policière est dans la propre nature de l’État et que ce n'est pas un cas isolé ou un "excès" de démonstration de force par la police comme voudraient le faire croire les médias bourgeois et les autorités liées au système. En ce sens, il ne s’agit pas d’un échec des "dirigeants" et cela n’avance à rien de "demander justice" ou encore demander un comportement plus courtois de la police car, pour faire face à la répression et imposer un rapport de force, il n’existe pas d’autre moyen que l’extension du mouvement vers de larges couches de travailleurs. Pour cela, nous ne pouvons pas nous adresser à l’État et lui demander l’aumône. La dénonciation de la répression et de l’augmentation du prix des transports doit être prise en charge par l’ensemble de la classe ouvrière, en l’appelant à venir grossir les actions de protestation dans une lutte commune contre la précarisation et la répression.
Les manifestations, qui sont loin d’être terminées, se sont étendues à tout le Brésil et les protestations ont été présentes au début de la Coupe des Confédérations de football de 2013 qui fut marquée par les huées adressées à la présidente Dilma Rousseff, ainsi qu’au président de la FIFA, Joseph Blatter, avant le match d’ouverture du tournoi entre le Brésil et le Japon(1). Tous deux n’ont pu dissimuler à quel point ils furent incommodés par ces marques d’hostilité et ont abrégé leur discours afin de limiter la confusion. Autour du stade s’est aussi déroulée une grande manifestation à laquelle participèrent environ 1.200 personnes en solidarité avec le mouvement contre l’augmentation du coût des transports. Elles aussi furent fortement réprimés par la police qui blessa 27 personnes et en mit 16 en détention. Afin de renforcer encore la répression, l’État déclara que toute manifestation à proximité des stades durant la coupe des Confédérations serait interdite, sous le prétexte de ne pas porter préjudice à cet événement, à la circulation des personnes et véhicules, ainsi qu’au fonctionnement des services publics.
Les limites du mouvement pour la gratuité des transports et quelques propositions
Comme on le sait, ce mouvement s’est développé à l’échelle nationale grâce à sa propre dynamique et à la capacité de mobilisation des jeunes étudiants et lycéens contre l’augmentation des prix des transports. Cependant, il est important de prendre en compte qu’il a comme objectif, à moyen et long terme, de négocier l’existence d’un transport public gratuit pour toute la population et mis à disposition par l’État.
Et c’est exactement là que se situe la limite de sa principale revendication, vu qu’un transport universel et gratuit, cela ne peut exister dans la société capitaliste. Pour arriver à cela, la bourgeoisie et son État devraient accentuer plus encore le degré d’exploitation de la classe ouvrière et autres travailleurs, à travers une augmentation des impôts sur les salaires. Ainsi, il faut prendre en compte que la lutte ne doit pas être placée dans la perspective d’une réforme impossible, mais toujours dans celle de faire que l’État révoque ses décrets.
Actuellement, les perspectives du mouvement semblent dépasser les simples revendications contre l’augmentation des tarifs des transports. Déjà des manifestations sont prévues la semaine prochaine dans des dizaines de villes grandes et moyennes.
Le mouvement doit être vigilant vis-à-vis de la gauche du capital, spécialisée dans la récupération des manifestations pour les diriger vers des impasses, comme par exemple demander que les tribunaux de justice résolvent les problèmes et que les manifestants rentrent à la maison.
Pour que ce mouvement se développe, il est nécessaire de créer des lieux pour écouter et discuter collectivement les différents points de vue à propos de la lutte. Et cela n’est possible qu’au moyen d’assemblées générales avec la participation de tous, où est garanti indistinctement le droit de parole à tout manifestant. En plus de cela, il faut appeler les travailleurs salariés, les convier à des assemblées et à des actions de protestation car eux et leurs familles sont concernés par l’augmentation du prix des transports.
Le mouvement de protestation qui s’est développé au Brésil constitue un démenti cinglant à la campagne de la bourgeoisie brésilienne, soutenue en cela par la bourgeoisie mondiale, selon laquelle le Brésil est un "pays émergent" en voie de dépasser la pauvreté et de mettre en route son propre développement. Une telle campagne a été particulièrement promue par Lula qui est mondialement connu pour avoir prétendument tiré de la misère des millions de Brésiliens alors qu’en réalité sa grande réalisation pour le capital est d’avoir réparti des miettes parmi les masses les plus pauvres afin de les maintenir dans l’illusion et accentuer la précarité du prolétariat brésilien en général.
Face à l’aggravation de la crise mondiale et de ses attaques contre les conditions de vie du prolétariat, il n’y a pas d’autre issue que la lutte contre le capitalisme.
Revolução Internacional /16.06.2013
1)Les dépenses somptuaires de l’État et du gouvernement entreprises pour la préparation de la Coupe du Monde de football en 2014 et les JO de 2016 prévus au Brésil alimentent aussi la colère d’une grande partie de la population ainsi davantage pressurée (NdT).
Rubrique:
Les tensions impérialistes dans la phase de décomposition (extraits de la résolution sur la situation internationale, XXe congrès du CCI)
- 1094 reads
Nous publions ci-dessous la partie consacrée aux tensions impérialistes de la résolution sur la situation internationale adoptée lors du dernier congrès international du CCI. Cette résolution sera bientôt disponible dans son intégralité (1) comme le bilan de ce XX° congrès, sur notre site Internet internationalism.org [5].
1
Depuis un siècle, le mode de production capitaliste est entré dans sa période de déclin historique, de décadence. C’est l’éclatement de la Première Guerre mondiale, en août 1914, qui a signé le passage entre la “Belle Époque”, celle de l’apogée de la société bourgeoise, et “l’Ère des guerres et des révolutions”, comme l’a qualifiée l’Internationale communiste lors de son premier congrès, en 1919. Depuis, le capitalisme n’a fait que s’enfoncer dans la barbarie avec à son actif, notamment, une Seconde Guerre mondiale qui a fait plus de 50 millions de morts. Et si la période de “prospérité” qui a suivi cette horrible boucherie a pu semer l’illusion que ce système avait pu enfin surmonter ses contradictions, la crise ouverte de l’économie mondiale, à la fin des années 60, est venue confirmer le verdict que les révolutionnaires avaient déjà énoncé un demi-siècle auparavant: le mode de production capitaliste n’échappait pas au destin des modes de production qui l’avaient précédé. Lui aussi, après avoir constitué une étape progressive dans l’histoire humaine, était devenu un obstacle au développement des forces productives et au progrès de l’humanité. L’heure de son renversement et de son remplacement par une autre société était venue.
2
En même temps qu’elle signait l’impasse historique dans laquelle se trouve le système capitaliste, cette crise ouverte, au même titre que celle des années 1930, plaçait une nouvelle fois la société devant l’alternative: guerre impérialiste généralisée ou développement de combats décisifs du prolétariat avec, en perspective, le renversement révolutionnaire du capitalisme. Face à la crise des années 1930, le prolétariat mondial, écrasé idéologiquement par la bourgeoisie suite à la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23, n’avait pu apporter sa propre réponse, laissant la classe dominante imposer la sienne: une nouvelle guerre mondiale. En revanche, dès les premières atteintes de la crise ouverte, à la fin des années 1960, le prolétariat a engagé des combats de grande ampleur: Mai 1968 en France, le “Mai rampant” italien de 1969, les grèves massives des ouvriers polonais de la Baltique en 1970 et beaucoup d’autres combats moins spectaculaires mais tout aussi significatifs d’un changement fondamental dans la société: la contre-révolution avait pris fin. Dans cette situation nouvelle, la bourgeoisie n’avait pas les mains libres pour prendre le chemin d’une nouvelle guerre mondiale. Il s’en est suivi plus de quatre décennies de marasme croissant de l’économie mondiale, accompagné d’attaques de plus en plus violentes contre le niveau et les conditions de vie des exploités. Au cours de ces décennies, la classe ouvrière a mené de multiples combats de résistance. Cependant, même si elle n’a pas subi de défaite décisive qui aurait pu inverser le cours historique, elle n’a pas été en mesure de développer ses luttes et sa conscience au point de présenter à la société, ne serait-ce qu’une ébauche de perspective révolutionnaire. “Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s’affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l’histoire ne saurait pourtant s’arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l’ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de “gel”, de “stagnation” de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s’aggraver, l’incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l’ensemble de la société et l’incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l’immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société” (“La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste”, Revue internationale no 62). C’est donc une nouvelle phase de la décadence du capitalisme qui s’est ouverte depuis un quart de siècle. Celle où le phénomène de la décomposition sociale est devenu une composante déterminante de la vie de toute la société.
3
Le terrain où se manifeste de façon la plus spectaculaire la décomposition de la société capitaliste est celui des affrontements guerriers et plus généralement des relations internationales. Ce qui avait conduit le CCI à élaborer son analyse sur la décomposition, dans la seconde moitié des années 1980, c’était la succession d’attentats meurtriers qui avaient frappé de grandes villes européennes, notamment Paris, au milieu de la décennie, des attentats qui n’étaient pas le fait de simple groupes isolés mais d’États constitués. C’était le début d’une forme d’affrontements impérialistes, qualifiés par la suite de “guerres asymétriques”, qui traduisait un changement en profondeur dans les relations entre États et, plus généralement, dans l’ensemble de la société. La première grande manifestation historique de cette nouvelle, et ultime, étape dans la décadence du capitalisme a été constituée par l’effondrement des régimes staliniens d’Europe et du bloc de l’Est en 1989. Immédiatement, le CCI avait mis en avant la signification que cet événement revêtait du point de vue des conflits impérialistes : “La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux “partenaires” d’hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l’heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (...). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible” (Revue internationale no 61, “Après l’effondrement du bloc de l’Est, déstabilisation et chaos”) Depuis, la situation internationale n’a fait que confirmer cette analyse :
– 1re guerre du Golfe en 1991;
– guerre dans l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001;
– deux guerres en Tchétchénie (en 1994-1995 et en 1999-2000);
– guerre en Afghanistan à partir de 2001 qui se poursuit encore, 12 ans après;
– la guerre en Irak de 2003 dont les conséquences continuent de peser de façon dramatique sur ce pays, mais aussi sur l’initiateur de cette guerre, la puissance américaine;
– les nombreuses guerres qui n’ont cessé de ravager le continent africain (Rwanda, Somalie, Congo, Soudan, Côte d’Ivoire, Mali, etc.);
– les nombreuses opérations militaires d’Israël contre le Liban ou la Bande de Gaza répliquant aux tirs de roquettes depuis les positions du Hezbollah ou du Hamas.
4
En fait, ces différents conflits illustrent de façon dramatique combien la guerre a acquis un caractère totalement irrationnel dans le capitalisme décadent. Les guerres du XIXe siècle, aussi meurtrières qu’elles aient pu être, avaient une rationalité du point de vue du développement du capitalisme. Les guerres coloniales permettaient aux États européens de se constituer un Empire où puiser des matières premières ou écouler leurs marchandises. La Guerre de Sécession de 1861-65 en Amérique, remportée par le Nord, a ouvert les portes à un plein développement industriel de ce qui allait devenir la première puissance mondiale. La guerre franco-prussienne de 1870 a été un élément décisif de l’unité allemande et donc de la création du cadre politique de la future première puissance économique d’Europe. En revanche, la Première Guerre mondiale a laissé exsangues les pays européens, “vainqueurs” aussi bien que “vaincus”, et notamment ceux qui avaient eu la position la plus “belliciste” (Autriche, Russie et Allemagne). Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle a confirmé et amplifié le déclin du continent européen où elle avait débuté, avec une mention spéciale pour l’Allemagne qui était en 1945 un champ de ruines, à l’image aussi du Japon, autre puissance “agressive”. En fait, le seul pays qui ait bénéficié de cette guerre fut celui qui y était entré le plus tardivement et qui a pu éviter, du fait de sa position géographique, qu’elle ne se déroule sur son territoire, les États-Unis. D’ailleurs, la guerre la plus importante qu’ait menée ce pays après la seconde mondiale, celle du Vietnam, a bien montré son caractère irrationnel puisqu’elle n’a rien rapporté à la puissance américaine malgré un coût considérable du point de vue économique et surtout humain et politique.
5
Cela dit, le caractère irrationnel de la guerre s’est hissé à un niveau supérieur dans la période de décomposition. C’est bien ce qui s’est illustré, par exemple, avec les aventures militaires des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Ces guerres, elles aussi, ont eu un coût considérable, notamment du point de vue économique. Mais leur bénéfice est des plus réduits, sinon négatif. Dans ces guerres, la puissance américaine a pu faire étalage de son immense supériorité militaire, mais cela n’a pas permis qu’elle atteigne les objectifs qu’elle recherchait; stabiliser l’Irak et l’Afghanistan et obliger ses anciens alliés du bloc occidental à resserrer les rangs autour d’elle. Aujourd’hui, le retrait programmé des troupes américaines et de l’OTAN d’Irak et d’Afghanistan laisse une instabilité sans précédent dans ces pays avec le risque qu’elle ne participe à l’aggravation de l’instabilité de toute la région. En même temps, c’est en ordre dispersé que les autres participants à ces aventures militaires ont quitté ou quittent le navire. Pour la puissance impérialiste américaine, la situation n’a cessé de s’aggraver: si, dans les années 1990, elle réussissait à tenir son rôle de “gendarme du monde”, aujourd’hui, son premier problème est d’essayer de masquer son impuissance face à la montée du chaos mondial comme le manifeste, par exemple, la situation en Syrie.
6
Au cours de la dernière période, le caractère chaotique et incontrôlable des tensions et conflits impérialistes s’est illustré une nouvelle fois avec la situation en Extrême-Orient et, évidemment, avec la situation en Syrie. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à des conflits qui portent avec eux la menace d’un embrasement et d’une déstabilisation bien plus considérables.
En Extrême-Orient on assiste à une montée des tensions entre États de la région. C’est ainsi qu’on a vu au cours des derniers mois se développer des tensions impliquant de nombreux pays, des Philippines au Japon. Par exemple, la Chine et le Japon se disputent les îles Senkaku/Diyao, le Japon et la Corée du Sud l’île Take-shima- Dokdo, alors que d’autres tensions se font jour impliquant aussi Taiwan, le Vietnam ou la Birmanie. Mais le conflit le plus spectaculaire concerne évidemment celui opposant la Corée du Nord d’un côté et, de l’autre, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Prise à la gorge par une crise économique dramatique, la Corée du Nord s’est lancée dans une surenchère militaire qui, évidemment, vise à faire du chantage, notamment auprès des États-Unis, pour obtenir de cette puissance un certain nombre d’avantages économiques. Mais cette politique aventuriste contient deux facteurs de gravité. D’une part, le fait qu’elle implique, même si c’est de façon indirecte, le géant chinois, qui reste un des seuls alliés de la Corée du Nord, alors que cette puissance tend de plus en plus à faire valoir ses intérêts impérialistes partout où elle le peut, en Extrême-Orient, évidemment, mais aussi au Moyen-Orient, grâce notamment à son alliance avec l’Iran (qui est par ailleurs son principal fournisseur d’hydrocarbures) et aussi en Afrique où une présence économique croissante vise à préparer une future présence militaire quand elle en aura les moyens. D’autre part, cette politique aventuriste de l’État nord-coréen, un État dont la domination policière barbare témoigne de la fragilité fondamentale, contient le risque d’un dérapage, de l’entrée dans un processus incontrôlé engendrant un nouveau foyer de conflits militaires directs avec des conséquences difficilement prévisibles mais dont on peut déjà penser qu’elles constitueront un autre épisode tragique venant s’ajouter à toutes les manifestations de la barbarie guerrière qui accablent la planète aujourd’hui.
7
La guerre civile en Syrie fait suite au “printemps arabe” qui, en affaiblissant le régime d’Assad, a ouvert la boîte de Pandore d’une multitude de contradictions et de conflits que la main de fer de ce régime avait maintenue sous le boisseau pendant des décennies. Les pays occidentaux se sont prononcés en faveur du départ d’Assad mais ils sont bien incapables de disposer d’une solution de rechange sur place alors que l’opposition à celui-ci est totalement divisée et que le secteur prépondérant de celle-ci est constitué par les islamistes. En même temps, la Russie apporte un soutien militaire sans faille au régime d’Assad qui, avec le port de Tartous, lui garantit la présence de sa flotte de guerre en Méditerranée. Et ce n’est pas le seul État puisque l’Iran n’est pas en reste de même que la Chine: la Syrie est devenue un nouvel enjeu sanglant des multiples rivalités entre puissances impérialistes de premier ou de deuxième ordre dont les populations du Moyen-Orient n’ont cessé de faire les frais depuis des décennies. Le fait que les manifestations du “Printemps arabe” en Syrie aient abouti non sur la moindre conquête pour les masses exploitées et opprimées mais sur une guerre qui a fait plus de 100.000 morts constitue une sinistre illustration de la faiblesse dans ce pays de la classe ouvrière, la seule force qui puisse mettre un frein à la barbarie guerrière. Et c’est une situation qui vaut aussi, même si sous des formes moins tragiques, pour les autres pays arabes où la chute des anciens dictateurs a abouti à la prise du pouvoir par les secteurs les plus rétrogrades de la bourgeoisie représentés par les islamistes, comme en Égypte ou en Tunisie, ou par un chaos sans nom comme en Libye.
Ainsi, la Syrie nous offre aujourd’hui un nouvel exemple de la barbarie que le capitalisme en décomposition déchaîne sur la planète, une barbarie qui prend la forme d’affrontements militaires sanglants mais qui affecte également des zones qui ont pu éviter la guerre mais dont la société s’enfonce dans un chaos croissant comme par exemple en Amérique latine où les narcotrafiquants, avec la complicité de secteurs de l’État, font régner la terreur.
CCI
1) La question de l’impérialisme est le premier point traité par cette résolution. Viennent ensuite la destruction de l’environnement, la crise économique et enfin la lutte de classe.
Rubrique:
Mouvement social en Turquie: le remède à la terreur d’État n’est pas la démocratie
- 955 reads
Nous publions ci-dessous des extraits de la traduction d’un article réalisé par notre section en Turquie – une jeune section, à la fois dans l’histoire du CCI et du fait de l’âge de ses membres. En tant que révolutionnaires et partie de la génération qui a conduit la révolte, ces camarades se sont activement impliqués dans le mouvement. Nous encourageons nos lecteurs à se rendre sur notre site pour une lecture complète de cet article qui est à la fois un premier rapport “sur le vif” fourmillant de détails concrets sur la vie de ce mouvement et une première tentative d’analyse de sa signification. C’est ici ce dernier aspect que nous avons choisi de mettre particulièrement en lumière à travers notre choix d’extraits. Quelle est la nature de ce mouvement ? A quelle dynamique internationale participe-t-il ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Quelles perspectives laisse-t-il entrevoir ?... Voici autant de questions qui sont en effet au cœur des enjeux de la période actuelle et à venir.
Le mouvement a commencé contre l’abattage des arbres effectué en vue de détruire le parc Gezi de la place Taksim à Istanbul, et il a pris une ampleur inconnue dans l’histoire de la Turquie jusqu’à ce jour. (...) On ne peut comprendre le véritable caractère de ce mouvement qu’en le remplaçant dans son contexte international. Et vu sous cet angle, il devient clair que le mouvement en Turquie est en continuité directe non seulement avec les révoltes du Moyen Orient de 2011 – les plus importants d’entre eux (Tunisie, Égypte, Israël) eurent une empreinte très forte de la classe ouvrière – mais en particulier du mouvement des Indignés en Espagne et Occupy aux États-Unis, là où la classe ouvrière représentait non seulement la majorité de la population dans son ensemble mais aussi des participants au mouvement. Il en est de même de la révolte actuelle au Brésil et également du mouvement en Turquie, dont l’immense majorité des composantes appartient à la classe ouvrière, et particulièrement la jeunesse prolétarienne.
(…) Le secteur qui a participé le plus largement était celui nommé :“la génération des années 1990”. L’apolitisme était l’étiquette apposée sur les manifestants de cette génération, dont beaucoup ne pouvaient se souvenir de l’époque précédent le gouvernement AKP (1) Le Parti pour la justice et le développement, islamiste “modéré”, est au pouvoir depuis 2002 en Turquie. Cette génération, dont on disait qu’elle n’était pas investie dans les événements et dont les membres ne cherchaient qu’à se sauver eux-mêmes, a compris qu’il n’y avait pas de salut en restant seul et en avait assez des discours du gouvernement lui disant ce qu’elle devait être et comment elle devait vivre. Les étudiants, et particulièrement les lycéens, ont participé aux manifestations de façon massive. Les jeunes ouvriers et les jeunes chômeurs étaient largement présents dans le mouvement. Les ouvriers et les chômeurs éduqués étaient également présents.
Dans certains secteurs de l’économie où travaillent principalement des jeunes dans des conditions précaires et où il est habituellement difficile de lutter – particulièrement dans le secteur des services – les salariés se sont organisés sur la base des lieux de travail mais d’une façon qui transcendait chaque lieu de travail particulier et ils ont participé ensemble aux manifestations. On trouve des exemples d’une telle participation parmi les livreurs des boutiques de kebab, le personnel des bars, les travailleurs des centres d’appel et des bureaux. En même temps, le fait que ce genre de participation ne l’a pas emporté sur la tendance des ouvriers à aller aux manifestations individuellement a constitué une des faiblesses les plus significatives du mouvement. Mais cela a été typique aussi des mouvements dans d’autres pays, où la primauté de la révolte dans la rue a été une expression pratique du besoin de dépasser la dispersion sociale créée par les conditions existant dans la production et la crise capitalistes – en particulier, le poids du chômage et de l’emploi précaire.
Mais ces mêmes conditions, couplées aux immenses assauts idéologiques de la classe dominante, ont rendu difficile à la classe ouvrière de se voir en tant que classe et a contribué à renforcer l’idée chez les manifestants qu’ils étaient essentiellement une masse de citoyens individuels, des membres légitimes de la communauté “nationale”. Tel est le chemin contradictoire vers la reconstitution du prolétariat en classe, mais il ne fait pas de doute que ces mouvements sont un pas dans cette voie.
Une des principales raisons pour laquelle une masse significative de prolétaires mécontents de leurs conditions de vie ont organisé des manifestations avec une telle détermination se trouve aussi dans l’indignation et le sentiment de solidarité contre la violence policière et la terreur de l’État. Malgré cela, différentes tendances politiques bourgeoises ont été actives, essayant d’influencer le mouvement de l’intérieur pour le maintenir dans les frontières de l’ordre existant, pour éviter qu’il ne se radicalise et pour empêcher les masses prolétariennes qui avaient pris les rues contre la terreur étatique de développer des revendications de classe sur leurs propres conditions de vie. Ainsi, alors qu’on ne peut évoquer de revendication ayant emporté l’unanimité dans le mouvement, ce qui a généralement dominé celui-ci étaient les revendications démocratiques. La ligne appelant à “plus de démocratie” qui s’est formée autour d’une position anti AKP et, en fait, anti-Erdogan n’exprimait par essence rien d’autre qu’une réorganisation de l’appareil d’Etat turc sur un mode plus démocratique.
L’impact des revendications démocratiques sur le mouvement a constitué sa plus grande faiblesse idéologique. Car Erdogan lui-même a construit toutes ses attaques idéologiques contre le mouvement autour de cet axe de la démocratie et des élections ; les autorités gouvernementales bien qu’avec des monceaux de mensonges et de manipulations, ont répété à satiété l’argument selon lequel, même dans les pays considérés plus démocratiques, la police utilise la violence contre les manifestations illégales – ce en quoi elles n’avaient pas tort. De plus, la ligne visant à obtenir des droits démocratiques liait les mains des masses devant les attaques de la police et la terreur étatique, et pacifiait leur résistance.
(…) Cela dit, l’élément le plus actif dans cette tendance démocratique qui semble avoir pris le contrôle de la Plate-forme de Solidarité de Taksim se trouve dans les confédérations syndicales de gauche comme le KSEK et le DISK. (…) La Plate-forme de Solidarité de Taksim et donc la tendance démocratique, du fait qu’elle était constituée de représentants de toutes sortes d’associations et d’organisations, a tiré sa force non pas d’un lien organique avec les manifestants mais de la légitimité bourgeoise, des ressources mobilisées et du soutien de ses composantes.
(…) La gauche bourgeoise est une autre tendance qu’il faut mentionner. La base des partis de gauche, qu’on peut aussi définir comme la gauche légale bourgeoise, a été pour une large part coupée des masses. De façon générale, elle a été à la queue de la tendance démocratique. Les cercles staliniens et trotskistes, ou la gauche radicale bourgeoise, étaient aussi pour une grande part coupés des masses. Ils étaient influents dans les quartiers où ils ont traditionnellement une certaine force. Bien que s’opposant à la tendance démocratique au moment où cette dernière essayait de disperser le mouvement, ils l’ont généralement soutenue. Les analyses de la gauche bourgeoise étaient, pour la plus grande part, limitées à se réjouir du “soulèvement populaire” et à essayer de présenter ses porte-paroles comme les leaders du mouvement. Même les appels à une grève générale, une ligne traditionnellement mise en avant par la gauche, n’a pas vraiment eu d’écho au sein de celle-ci à cause de l’atmosphère de joie aveugle. Son slogan le plus largement accepté parmi les masses était “épaule contre épaule contre le fascisme”.
(…) En plus des tendances mentionnées ci-dessus, on peut parler d’une tendance prolétarienne ou de plusieurs tendances prolétariennes au sein du mouvement.
(…) De façon générale, une partie significative des manifestants défendait l’idée que le mouvement devait créer une auto-organisation qui devait lui permettre de déterminer son propre futur. La partie des manifestants qui voulait que le mouvement s’unisse avec la classe ouvrière était composée d’éléments qui étaient conscients de l’importance et de la force de la classe, qui étaient contre le nationalisme même s’il leur manquait une claire vision politique. (…) [Cependant], la faiblesse commune des manifestations dans toute la Turquie est la difficulté à créer des discussions de masse et à gagner le contrôle du mouvement grâce à des formes d’auto-organisation sur la base de ces discussions. Les discussions de masse semblables à celles qui se sont développées dans les mouvements à travers le monde ont été notablement absentes dans les premiers jours. Une expérience limitée de la discussion de masse, des réunions, des assemblées générales, etc., et la faiblesse de la culture du débat en Turquie ont sans aucun doute joué sur cette faiblesse. En même temps, le mouvement a senti la nécessité de la discussion et les moyens pour l’organiser ont commencé à émerger. La première expression de la conscience du besoin de discuter a été la formation d’une tribune ouverte dans le Parc Gezi. Celle-ci n’a pas attiré beaucoup l’attention ni duré bien longtemps, mais elle a eu néanmoins un certain impact.
(…) Si on regarde ce mouvement à l’échelle du pays, l’expérience la plus cruciale est fournie par les manifestants d’Eskişehir. Dans une assemblée générale sur la place de la Résistance d’Eskişehir, des comités ont été créés afin d’organiser et de coordonner les manifestations. (…) Enfin, à partir du 17 juin, dans les parcs de différents quartiers d’Istanbul, des masses de gens inspirées par les forums du parc Gezi ont mis en place des assemblées de masse également intitulées : “forums”. Parmi ces quartiers où se sont organisés des forums, il y a Beşiktaş, Elmadağ, Harbiye, Nişantaşı, Kadıköy, Cihangir, Ümraniye, Okmeydanı, Göztepe, Rumelihisarüstü, Etiler, Akatlar, Maslak, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Sarıyer, Yeniköy, Sarıgazi, Ataköy et Alibeyköy. Les jours suivants, d’autres se sont tenus à Ankara et dans d’autres villes. Du coup, de peur de perdre le contrôle sur ces initiatives, la Plateforme de Solidarité de Taksim a commencé elle-même à faire des appels en faveur de ces forums.
(…) Bien que, par bien des aspects, la résistance du parc Gezi soit en continuité avec le mouvement des Occupy aux États-Unis, des Indignés en Espagne et des mouvements de protestation qui ont renversé Moubarak en Égypte et Ben Ali en Tunisie, elle a aussi ses particularités : comme dans tous ces mouvements, en Turquie, il y a un poids vital du jeune prolétariat. L’Égypte, la Tunisie et la résistance du parc Gezi ont en commun la volonté de se débarrasser d’un régime qui est perçu comme étant une “dictature”. (…) Mais, contrairement au mouvement en Tunisie qui a organisé des comités locaux, et en Espagne ou aux États-Unis où les masses ont généralement assumé la responsabilité du mouvement à travers des assemblées générales, en Turquie cette dynamique est restée au début très limitée.
(…) [De même] Les questions les plus débattues portaient sur les problèmes pratiques et techniques des affrontements avec la police. (…) La similitude avec Occupy aux États-Unis était qu’une occupation effective [de la rue] a eu lieu ; même si en Turquie, les occupations surpassaient en nombre, par une participation massive, celles des États-Unis. De même, en Turquie comme aux États-Unis, il y a une tendance parmi les manifestants à comprendre l’importance de l’implication dans la lutte de la partie du prolétariat au travail.
(…) Bien que le mouvement en Turquie n’ait pas réussi à établir un lien sérieux avec l’ensemble de la classe ouvrière, les appels à la grève via les réseaux sociaux ont rencontré un certain écho qui s’est manifesté à travers plus d’arrêts de travail qu’aux États Unis. En dépit de ses particularités, il ne fait pas de doute que le mouvement de cette “canaille” est une partie intégrante de la chaîne des mouvements sociaux internationaux.
(…) Un des meilleurs indicateurs qui montrent que ce mouvement fait partie de la vague internationale se trouve dans son inspiration des manifestants brésiliens. Les manifestants turcs ont salué la réponse venue de l’autre rive du monde avec les mots d’ordre : “Nous sommes ensemble, Brésil + Turquie !” et “Brésil, résiste !” (en turc). Et puisque le mouvement a inspiré des manifestations au Brésil contenant des revendications de classe, il peut à l’avenir favoriser la naissance de revendications de classe en Turquie. (…) Malgré toutes les faiblesses et les dangers qui menacent ce mouvement, si les masses en Turquie n’avaient pas réussi à devenir un maillon de la chaîne des révoltes sociales qui secouent le monde capitaliste, le résultat serait un bien plus grand sentiment d’impuissance. Le surgissement d’un mouvement social d’une ampleur jamais vue depuis 1908 dans ce pays est donc d’une importance historique. (…).
Dünya Devrimi/21.06.2013
1)Le Parti pour la justice et le développement, islamiste « modéré » est au pouvoir depuis 2002 en Turquie.
Rubrique:
Cycle de discussion du printemps 2013: lutte anticapitaliste et organisation
- 1270 reads
Dans la période actuelle, il existe une nécessité de réflexion et d’approfondissement concernant les leçons à tirer des mouvements de lutte qui ont eu lieu les années passées, comme le « printemps arabe », le combat des « Indignés » ou le mouvement « Occupy ». En outre, toute rencontre de gens engagés pour discuter et apprendre à se connaître est essentielle pour dépasser l’éparpillement du mouvement internationaliste. Voilà pourquoi le CCI, incité aussi à le faire par quelques courriers dans ce sens (1), avait décidé de tenir un cycle de discussion au printemps 2013 sur le thème « lutte et organisation ». Il s’agissait de deux soirées de discussion pendant lesquelles les participants pouvaient engager entre eux et avec le CCI des échanges sur leurs questionnements, leurs expériences et leurs interprétations des mouvements.
En introduction aux deux soirées, le CCI avait prévu un exposé qui fournissait une base solide pour les discussions (2). Les participants ont en général fort apprécié ces introductions, même s’ils trouvaient celle de la deuxième soirée assez abstraite et ardue à comprendre. Le débat a cependant permis de donner plus de chair aux axes de l’introduction. Le premier exposé a introduit le thème de la lutte comme moteur de l’histoire et a fourni un cadre historique pour commenter et analyser les mouvements de lutte récents. Le deuxième exposé a mis l’accent sur le développement de la conscience de classe dans et par les mouvements de lutte, la conscience de classe stimulant à son tour l’expansion des luttes. Les deux soirées ont fait surgir de nombreux points de discussion communs. Aussi, cet article traitera les deux sessions de discussion comme un ensemble.
Est-ce que la classe ouvrière est une classe révolutionnaire ?
Une des questions principales portait sur la nature même de la classe ouvrière. Les participants reconnaissaient certes l’existence de cette classe, mais doutaient du caractère révolutionnaire du prolétariat. Pourquoi est-ce elle et pas d’autres couches exploitées et opprimées de la société, telles les femmes, les immigrés, les homosexuels, les pauvres, etc., qui peut être à la base du développement d’une autre société ? Ne devons-nous pas nous battre contre bien d’autres injustices que l’exploitation des travailleurs ? Qu’en est-il par exemple de l’exploitation de la nature, des femmes, etc.
Dans la discussion, une distinction a été opérée entre le prolétariat comme entité sociologique et comme entité politico-culturelle. Les travailleurs ont été caractérisés comme ce groupe de gens qui vendent leur force de travail pour un salaire et qui créent de la plus-value par leur travail commun (3). Face à eux, il y a évidemment la bourgeoisie, la classe qui contrôle les outils de production, le processus de production et les produits du travail, parce qu’elle possède et gère les moyens de production. Ces définitions ne sont pas strictement sociologiques, elles ne sont pas fondamentalement fondées sur une répartition d’un groupe de gens selon leur sexe, la couleur de leur peau, leurs revenus ou leur profession. Elles rendent compte du rôle que joue un groupe d’êtres humains dans le processus productif social global. Dans ce rapport social, la classe ouvrière est la classe qui ne dispose d’aucun contrôle sur ce processus.
Comme la force de travail fournit aussi aux hommes la capacité d’exprimer leur force vitale, leurs sentiments et leurs pensées et que les travailleurs sont précisément obligés de vendre celle-ci et de la soumettre aux besoins du capitalisme, la classe ouvrière est aussi la classe la plus aliénée. « Le travail, seul lien qui les unisse encore aux forces productives et à leur propre existence, a perdu chez eux toute apparence de manifestation de soi, et ne maintient leur vie qu'en l'étiolant » (4). Marx et Engels formulent précisément des appréciations élogieuses envers les formes de société précapitalistes, dans lesquelles le travail fournissait encore souvent une certaine satisfaction aux producteurs, même s’ils étaient exploités et s’ils devaient céder une partie des produits de leur travail. Dans le capitalisme toutefois, toute activité humaine est réduite à être une marchandise abstraite et « froide » et ainsi, la force de travail elle-même est réduite à n’être qu’une marchandise, l’être humain plein de qualités potentielles est réduit à n’être qu’un numéro, une « masse grise ». Cette « déshumanisation » du prolétariat en fait « une classe avec des chaînes radicales, (…), une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances universelles et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on ne lui a pas fait de tort particulier, mais un tort en soi, une sphère qui ne puisse plus s'en rapporter à un titre historique, mais simplement au titre humain, (…), une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper, sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans, par conséquent, les émanciper toutes, qui soit, en un mot, la perte complète de l'homme, et ne puisse donc se reconquérir elle-même que par le regain complet de l'homme » (5). Pour se libérer en tant que classe exploitée et opprimée, le prolétariat doit créer une nouvelle sorte de société, « où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » (6).
Différents intervenants ont affirmé qu’à côté de la lutte ouvrière, il fallait encore tenir compte d’autres luttes spécifiques, telles la lutte pour les droits des femmes et des immigrés et contre le racisme. Selon eux, le prolétariat peut supprimer l’exploitation capitaliste, avec toutes les conséquences directes de celle-ci, mais cela n’entraînera pas automatiquement la disparition de toute forme d’oppression. La discussion a mis en évidence que l’accentuation d’une autre identité n’implique ni la même dynamique unitaire, ni surtout la même perspective que l’identité de classe, bien au contraire. Ainsi la dynamique du mouvement « Occupy » aux USA s’est souvent bloquée parce qu’on mettait trop souvent l’accent sur ces « catégories » spécifiques d’oppression. La question de la discrimination des noirs a mené par exemple à des tensions et des divisions au sein des assemblées avant qu’une véritable discussion puisse s’ouvrir sur les problèmes mondiaux. L’antiracisme était dans ce cas plus un frein qu’un stimulant pour la lutte. Sur la côte ouest des USA par contre, où les protestataires d’Occupy se reconnaissaient beaucoup plus dans le combat de la classe ouvrière, le mouvement s’est développé de manière plus radicale (7).
La classe ouvrière peut-elle s’unir ?
Une deuxième série de questions exprimait des doutes concernant la capacité de la classe ouvrière à développer des forces suffisantes pour renverser le capitalisme. Même si elle a une nature révolutionnaire, n’est-elle pas trop divisée ? Est-elle capable de placer cette identité spécifique avant toutes sortes d’autres identités (de sexe, de couleur de peau, d’origine, d’âge, …) ? Peut-elle s’unir dans un monde capitaliste où les entreprises se délocalisent vers des régions où la force de travail est la moins chère et aiguisent ainsi la concurrence entre travailleurs ?
Une intervention a souligné qu’il ne fallait pas voir les choses de manière empirique. En 1914, peu de gens soutenaient que le prolétariat engagerait dans quelques années une vague révolutionnaire internationale. Il en allait de même dans les années avant 1968, lorsque aussi bien la bourgeoisie que certains révolutionnaires prolétariens pensaient que la classe ouvrière était « morte » (8).
Aujourd’hui, la classe ouvrière est effectivement divisée. Cela s’exprime e.a. par le fait que beaucoup de prolétaires individuels s’attribuent en premier lieu toutes sortes d’autres identités. Ces identités se fondent souvent sur une base réelle. Ainsi, un homme n’est pas une femme et on ne peut changer son lieu de naissance. Mais est-ce que chaque identité offre une perspective pour le futur ? Est-ce que chacune d’elle peut mettre en marche un processus et mener à la fin de l’exploitation capitaliste et de l’Etat ? Il suffit de penser aux conséquences dramatiques de l’identité nationale qui a été mise en avant par de nombreux travailleurs en Egypte.
La classe ouvrière est donc divisée, parce qu’elle est encore faible. Par conséquent, elle n’est pas faible parce qu’elle est divisée (9). La concurrence économique « … isole les individus les uns des autres (…) malgré le fait qu’elle les réunit. C’est pourquoi cela dure longtemps avant que ces individus arrivent à s’unir … » (10). Le prolétariat tire sa force de sa solidarité et de sa conscience de soi en tant que force révolutionnaire. Ces deux éléments se développent de concert dans la lutte contre l’Etat et le capital, lorsque la concurrence disparaît. A ce moment, la classe ouvrière, constituée d’une mosaïque d’êtres différents, percevra de manière de plus en plus claire son existence en tant que classe séparée. Les participants à la discussion étaient d’accord pour affirmer que cela n’avait aucun sens de tenter de convaincre les prolétaires un à un qu’ils appartenaient à la même classe internationale. Une telle approche est la conception des missionnaires.
Quelle forme de lutte ?
Comment surmonter la division au sein de la classe ouvrière ? Comment peut-elle développer une force suffisante pour faire vaciller le capitalisme ? Quelles formes de lutte favorisent le développement de la solidarité et de la conscience et lesquelles l’entravent par contre ?
Différents participants ont aussitôt établi un lien avec la question des syndicats, étant donné que ces derniers sont présentés comme les symboles du mouvement ouvrier historique. Ils sont généralement identifiés comme la forme « classique » et même reconnue par l’Etat de la « lutte ouvrière ». Plusieurs présents ont souligné de façon fort correcte que les syndicats n’étaient pas aux avant-postes lors des mouvements de lutte discutés dans le cycle. Bien au contraire, ils ont freiné et divisé les mouvements. Un participant a toutefois voulu nuancer l’analyse en constatant qu’il ne fallait pas mettre tous les syndicats sur le même plan : ainsi, certains syndicats anarcho-syndicalistes auraient soutenu en 2012 la grève sauvage des mineurs dans les Asturies (Espagne). Mais dans quelle mesure une grève, où les mineurs se sont retranchés dans les mines, permet-elle une dynamique de développement de la solidarité et de la conscience ?
Beaucoup d’autres mouvements de lutte ont cependant endossé de manière spontanée une autre forme : l’occupation de rues et de plaines pour les transformer en lieux de débat public. Ces assemblées générales (AG) permettaient la clarification politique, qui favorisaient à leur tour le développement de la solidarité (les présents ont établi des comparaisons avec les soviets dans la Russie du début du 20ième siècle). Ces AG étaient des lieux de débat vivants, où la lutte était organisée par l’ensemble des travailleurs qui y participaient, indépendamment de leur profession ou de leur entreprise. Bien que les revendications et les slogans de ces mouvements de luttes planétaires révélaient souvent des illusions dans l’Etat démocratique et ne manifestaient pas toujours un internationalisme des plus intransigeants, la forme de lutte manifestait l’empreinte de la classe ouvrière. Ce n’est pas un hasard si le mouvement en Espagne est allé le plus loin, car c’est là aussi que la classe ouvrière a acquis d’un point de vue historique des expériences de lutte importantes. D’innombrables AG ont surgi des plus petites places jusqu’à la Puerta del Sol. Dans les AG, de nombreux sujets étaient discutés, aussi bien sur le plan économique (chômage, logement, austérité, …) que politique (la démocratie, l’Etat, …) et que culturel (l’art, les sciences, …).
Une discussion réussie ?
Différents sujet ont à peine été abordés et méritent plus de temps et une approche plus en profondeur. Nous songeons par exemple à la lutte de différentes minorités, la question syndicale et le rôle des minorités révolutionnaires. Pour beaucoup, cette discussion venait de s’ouvrir et ils sont partis avec plus de questions qu’ils n’en avaient au début. Ce n’est pas mauvais en soi, car toutes les questions et les divergences ne pouvaient être résolues en deux soirées. Au moins, les participants ne sont pas partis avec une aversion d’une confrontation constructive de positions. Nous voulons encourager cette approche pour continuer à approfondir les discussions politiques. Ceci aussi fait partie de la lutte pour une autre société qu’il faut mener avec une vision à long terme.
Alex, 21-09-2013
(1) Cf. « Réaction d’un lecteur », Internationalisme n°356, 2012
(2) Intro 1 (en néerlandais): https://nl.internationalism.org/node/1029 [6] et intro 2 (en néerlandais) : https://nl.internationalism.org/node/1030 [7]
(3) La plus-value est la nouvelle valeur que les travailleurs créent durant le processus productif et ajoutent à la matière première ou à la marchandise et qui dépasse les frais nécessaires à leur entretien et leur reproduction. C’est pourquoi elle est disponible pour être confisquée par les capitalistes. C’est la base du profit capitaliste.
(4) K. Marx et F. Engels (1845) L’idéologie allemande,
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450000d.htm [8]
(5) K. Marx (1843) Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1843/00/km18430000.htm [9]
(6) K. Marx et F. Engels (1848) Le manifeste du parti communiste,
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000b.htm [10]
(7) IKS/Occupy (2011), Oakland: Occupy movement seeks link with the working class, https://en.internationalism.org/icconline/201111/4578/oakland-occupy-movement-seeks-links-working-class [11]
(8) En 1964, l’intellectuel petit-bourgeois Marcuse écrivit son livre « l’homme unidimensionnel » dans lequel il analysait comment la classe ouvrière avait été absorbée par la société capitaliste et dès lors n’était plus porteuse de la révolution contre le capitalisme. Le mouvement international de mai ’68 a contredit totalement cette thèse.
(9) quelqu’un a utilisé cette formulation dans la discussion. Elle a été empruntée à Anton Pannekoek, astronome et marxiste, dans son article « Parti et classe ouvrière », écrit en 1936.
(10) K. Marx et F. Engels (1845) L’idéologie allemande
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450000d.ht [8]
Rubrique:
Grèce: soigner l'économie tue le malade
- 1003 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article rédigé par notre section en Grande-Bretagne, World Revolution, sur l'effondrement du système de soins en Grèce.
En décembre 2012, le quotidien allemand Frank-furter Allgemeine Zeitung rendait compte d’une visite en Grèce: "En octobre 2012, le traumatologue Georg Pier rapportait les observations suivantes sur la Grèce : des femmes sur le point d’accoucher se hâtaient désespérément d’un hôpital à l’autre; mais comme elles n’avaient pas d’assurance-maladie ou suffisamment d’argent, personne ne voulait les aider à mettre leur enfant au monde.
Des gens, qui jusqu’à présent faisaient partie des classes moyennes, cherchaient des restes de fruits et de légumes dans les poubelles. (…) Un vieil homme disait à un journaliste qu’il n’avait plus les moyens d’acheter les médicaments nécessaires pour soigner son problème cardiaque: sa pension avait été diminuée de 50% comme celle de beaucoup d’autres retraités. Il a travaillé pendant plus de quarante ans, pensant avoir fait les choses correctement; maintenant, il ne comprend plus le monde. Lorsque tu es admis dans un hôpital, tu dois apporter tes propres draps et ta propre nourriture. Comme le personnel d’entretien a été mis à la porte, les médecins et les infirmiers, qui n’ont pas reçu de salaire depuis des mois, ont commencé à nettoyer les toilettes. Il y a une pénurie de gants et de cathéters jetables. Devant les conditions hygiéniques déplorables dans plusieurs établissements, l’Union Européenne avertit du danger de propagation de virus infectieux."
Les mêmes conclusions étaient tirées par Marc Sprenger, chef du Centre Européen pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (ECDC). Le 6 décembre, il alerta [les autorités] sur l’effondrement du système de santé et des mesures d’hygiène en Grèce, ajoutant que cela pouvait aboutir à une pandémie dans toute l’Europe. Il y a une pénurie de gants à usage unique, de blouses et de serviettes de désinfection, de boules de coton, de cathéters, de rouleaux de papier pour couvrir les tables d’examen médical. Les patients ayant des maladies infectieuses, comme la tuberculose, ne reçoivent pas le traitement nécessaire, ce qui entraîne l’augmentation du risque de propagation de virus résistants en Europe.
Un contraste frappant entre ce qui est techniquement possible et la réalité du capitalisme
Au 19e siècle, beaucoup de patients (jusqu’à un tiers parfois) mouraient à cause d’un manque d’hygiène à l’hôpital, en particulier les femmes pendant l’accouchement. Ces drames pouvaient s’expliquer en grande partie par l’ignorance, parce que beaucoup de docteurs ne se lavaient pas les mains avant un traitement ou une opération et, souvent, ils allaient avec des blouses sales d’un patient à l’autre.
Les découvertes en hygiène, de Semmelweis ou Lister par exemple, permirent une réelle amélioration. Les nouvelles mesures d’hygiène et les découvertes sur la transmission des germes permirent une forte réduction des maladies nosocomiales.
Aujourd’hui, l’utilisation des gants et des instruments chirurgicaux à usage unique est une pratique courante dans la médecine moderne. Mais, tandis que l’ignorance du 19e siècle est une explication plausible de la mortalité importante dans les hôpitaux, les dangers qui deviennent évidents dans les hôpitaux en Grèce ne sont pas une manifestation de l’ignorance mais une expression de la menace qui pèse sur l’humanité; cette menace provient de la faillite d’un système de production totalement obsolète.
Si, aujourd’hui, la santé des habitants du cœur de la civilisation antique est menacée par le manque de fonds des hôpitaux ou par leur insolvabilité (ils ne peuvent plus acheter de gants à usage unique), si les femmes enceintes qui cherchent une prise en charge dans les hôpitaux sont renvoyées parce qu’elles n’ont pas d’argent ou pas d’assurance médicale, si les gens qui ont des maladies de cœur ne peuvent plus payer leurs médicaments…, cela devient une attaque contre la vie-même. Si, dans un hôpital, le personnel d’entretien, qui est indispensable dans la chaîne de l’hygiène, est licencié, si les docteurs et les infirmiers, qui n’ont pas reçu leur salaire depuis longtemps, doivent prendre en charge les tâches de nettoyage, cela apporte une lumière crue sur la "régénération" de l’économie. C’est le terme utilisé par la classe dominante pour justifier ses attaques brutales contre nous: la "régénération" se retourne en menace sur nos vies.
Après 1989, en Russie, l’espérance de vie a baissé de cinq ans à cause de l’effondrement du système de santé d’une part, mais aussi à cause de l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogue. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement en Grèce que le système de santé est démantelé petit à petit pour s’effondrer simplement. Dans un autre pays en faillite, l’Espagne, le système de santé est également en train d’être démoli. Dans le vieux centre industriel qu’est Barcelone, de même que dans d’autres grandes villes, les services des urgences ne sont parfois ouverts que quelques heures, pour faire des économies budgétaires. En Espagne, au Portugal et en Grèce, beaucoup de pharmacies ne reçoivent plus de médicaments vitaux. Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck ne fournit plus le médicament anti-cancéreux Erbitux aux hôpitaux grecs; Biotest, un laboratoire qui vend du plasma sanguin pour le traitement de l’hémophilie et du tétanos, a arrêté de fournir ses produits à cause du non-paiement des factures depuis juin dernier.
Jusqu’à présent, ces conditions médicales désastreuses étaient connues principalement dans les pays africains ou dans les régions dévastées par la guerre; mais maintenant, la crise dans les pays anciennement industrialisés a conduit à une situation telle que des domaines vitaux comme les soins de santé sont de plus en plus sacrifiés sur l’autel du profit. Ainsi, l’obtention d’un traitement médical n’est plus basé sur ce qui est techniquement possible: on ne reçoit le traitement que si on est solvable.(1)
Cette évolution montre que l’écart entre ce qui est techniquement possible et la réalité de ce système s’agrandit. Plus l’hygiène est menacée et plus nous risquons de voir apparaître des épidémies incontrôlables. Nous devons rappeler l’épidémie de grippe espagnole, qui s’est répandue à travers l’Europe après la fin de la Première Guerre mondiale, entraînant la mort de plus de vingt millions de personnes. La guerre, avec son cortège de famines et de privations, avait préparé les conditions de cette épidémie. La crise économique joue le même rôle dans l’Europe d’aujourd’hui. En Grèce, le taux de chômage frôlait les 25% au dernier trimestre de 2012; le chômage des jeunes de moins de 25 ans atteignait 57%, 65% des jeunes femmes sont sans emploi. Les prévisions indiquent toutes une augmentation plus rapide, jusqu’à 40% en 2015. La paupérisation accompagnant le chômage a déjà conduit à ce que "des zones résidentielles et des immeubles d’appartements ont été privés de fourniture de fuel pour défaut de paiement. Pour éviter d’avoir trop froid l'hiver chez eux, beaucoup de gens ont commencé à utiliser des poêles à bois; les gens coupent le bois illégalement dans les forêts proches. Au printemps 2012, un vieil homme s’est donné la mort devant le parlement d’Athènes; juste avant de mourir, il aurait crié: je ne veux pas laisser de dettes à mes enfants. Le taux de suicide a doublé en Grèce depuis ces trois dernières années."(2)
Après l’Espagne avec le détroit de Gibraltar, l’Italie avec Lampedusa et la Sicile, la Grèce est le point principal d’entrée pour les réfugiés qui fuient les zones dévastées par la guerre et les espaces paupérisés d’Afrique et du Moyen Orient. Le gouvernement a installé une gigantesque clôture le long de la frontière turque. Il a monté d’immenses camps de réfugiés dans lesquels plus de 55.000 clandestins étaient internés en 2011. Les partis politiques de l’aile droite essayent de susciter une atmosphère de pogrom contre ces réfugiés, leur reprochant d’importer des "maladies de l’étranger" et de s’emparer des ressources qui reviennent de droit aux "Grecs d’origine". Mais la misère qui conduit ces millions de gens à fuir leur pays natal et qui se répand inexorablement dans les hôpitaux et les rues de l’Europe provient de la même source: un système social qui est devenu un obstacle à tout progrès humain.
Dionis/04.01.2013
1) Dans les pays "émergents" comme l’Inde, de nouveaux hôpitaux privés voient sans arrêt le jour. Ils sont accessibles uniquement aux riches patients et encore plus aux patients solvables qui viennent de l’étranger. Ils offrent des traitements qui sont beaucoup trop chers pour la majorité des Indiens et beaucoup de patients étrangers qui viennent en tant que "touristes médicaux" dans les cliniques privées indiennes n’ont pas les moyens de s’offrir leur traitement médical chez eux.
2) Frankfurter Allgemeine Zeitung, décembre 2012