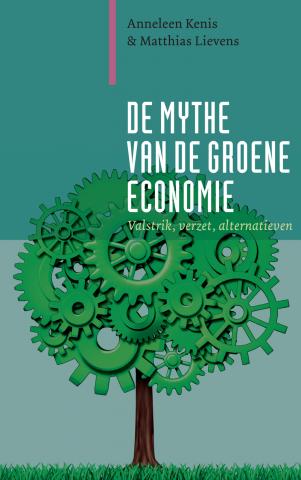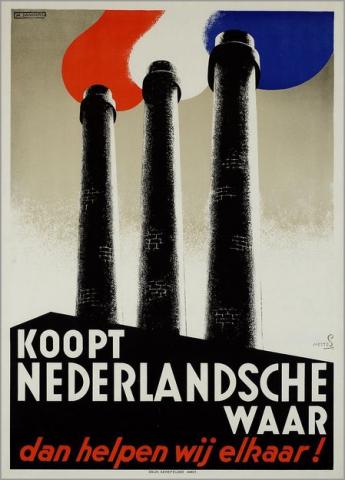Internationalisme no 358 - 2e trimestre 2013
- 1011 reads
Ecologie: piège, mystification et alternatives
- 1474 reads
Le livre « Le mythe de l'économie verte » (1), se présente comme une critique impitoyable de « l'économie verte », car il remet en cause bon nombre de solutions vedettes (le fracking par exemple) de cette soi-disant approche « alternative » : soit parce que celles-ci ne résolvent qu’un problème restreint, sans tenir compte de l’impact écologique destructif à long terme, soit parce que le remède se révèle plus terrible que le mal de par l'utilisation dans le cadre de « l’économie verte » de moyens qui mettent en marche des processus qui sont au moins autant, sinon encore plus polluant à moyen et à long terme.
Une critique apparemment dure de « l'économie verte » …
Dans le premier et le deuxième chapitre, la situation désastreuse est expliquée par le fait qu’on ne peut attendre aucune solution de la part du capitalisme parce que ce système considère la nature comme « un don gratuit » (2), qu’on peut utiliser à son gré.
Les auteurs essaient aussi de rechercher les racines de cette crise écologique et argumentent que celles-ci se trouvent dans l'expropriation du commons, les biens sociaux communautaires. Ils démontrent très minutieusement comment le capitalisme agit dans la dégradation de la nature et n’y porte un certain intérêt que quand elle peut être transformée en valeurs marchandes. Il en découle que tout ce à quoi le capitalisme touche en ce qui concerne la nature est voué à être saccagé ou détruit. Ils montrent enfin que « l'économie verte » elle aussi ne réussit pas à stopper les méfaits de la marchandisation de la nature, bien au contraire.
Avec des faits et des arguments à l’appui, ils décrivent comment toutes les solutions proposées déplacent seulement l'hypothèque qui pèse sur la société et essayent de rejeter la faute sur la population et « les citoyens ». Selon les auteurs, un des objectifs prioritaires est de réduire la consommation de pétrole et d’autres combustibles fossiles en tant que cause de pollution la plus importante qui doit être prise en main avec la plus grande urgence.
Ensuite, le livre porte essentiellement sur l'alternative écologique des commons - qui sont attaqués constamment par la libéralisation de l’économie - et sur l'échec évident du néolibéralisme en matière écologique. Quand il est question d'une nécessaire alternative, une critique est effectivement formulée par rapport au « socialisme réel » de l'USSR et des pays qui s’en inspirent, où la catastrophe écologique est flagrante à beaucoup d'endroits. (3) Mais dès qu›il est fait référence à Cuba, cette critique n’est soudainement plus valable. Cuba serait maintenant un exemple, le pays avec la plus petite empreinte écologique au monde, grâce sans doute à l'arrêt soudain des livraisons de pétrole après l'écroulement de l'USSR. Que Cuba a décimé l’essentiel de sa forêt subtropicale pour la culture de la canne à sucre au début des années 1960 et d'autres catastrophes écologiques, les auteurs apparemment n’en ont jamais entendu parler. Mais ce mythe-là a aussi depuis longtemps été dévoilé par des activistes cubains. (4)
… pour promouvoir la mystification « de la démocratie verte »
D'abord et avant tout, il faut dire que la science peut être une alliée de la classe ouvrière et plus largement de l'humanité. En outre, les études scientifiques qui peuvent se dégager aujourd’hui de la mainmise matérielle ou idéologique du capitalisme et de son sponsoring inévitable, sont plus que bienvenues. Pourtant la question se pose ici : Le livre explore-t-il effectivement jusqu’au fond la contradiction du système capitaliste en ce qui concerne « l'économie verte »? Une lecture attentive de l’ouvrage permet immédiatement de relever un certain nombre de contradictions dans l’argumentation.
D'une part, il est affirmé, de façon juste, que les solutions qui sont proposées par « l'économie verte », restent strictement dans le cadre de la possibilité de réaliser des profits. D'autre part, il est dit que les commons feraient exactement le contraire. Mais pour rendre aux biens sociaux communautaires tous leurs droits, l’aide d’une régulation par l’Etat (ou par des organes qui sont contrôlés ou promus par l'Etat, comme les syndicats) est pourtant invoquée. Etant donné que la suppression de l'exploitation capitaliste n'est en rien évoquée mais uniquement une autre régulation de la consommation, il s’agit en fait de demander le soutien à l'état bourgeois qui doit être réformé « écologiquement » pour mieux servir « les intérêts du peuple ». La présentation des régimes de Morales et de Chavez et du modèle par excellence Cuba comme des exemples d’une alternative, confirment cette logique d’une régulation de l'Etat, typique du « milieu gauchiste». Le fait que ces régimes soient non seulement totalitaires, mais aussi qu’ils aient réprimé plus d'une fois la protestation ouvrière avec violence- où des troupes ont été engagées à plusieurs reprises contre les usines en grève et les ouvriers agricoles- n'est pas mentionné.
Sur le plan des revendications, le livre est très ambigu : vanter les commons comme une action écologique créative alternative et en même temps quémander l'aide de l'Etat et des syndicats qui sont entièrement imbriqués dans la société capitaliste, c’est essayer de réconcilier l'eau et le feu. Ces derniers ne sont pas des acteurs neutres dans le contexte capitaliste: l'Etat garantit « l'ordre social global » et veille à ce que le système capitaliste puisse survivre, si nécessaire aux moyens d’élections démocratiques ou sinon par les armes. La structure syndicale s›occupe déjà depuis la première guerre mondiale de la discipline dans l'usine et ne vient jamais avec des exigences qui peuvent menacer l'intérêt national et le système. Les seuls qu’ils menacent sont les ouvriers, quand ils s’engagent dans une grève « sauvage » (comme récemment les ouvriers des sous-traitants de Ford-Genk en ont fait l’expérience).
Dans l’alternative des auteurs, ils avancent sans beaucoup de profondeur « une solution démocratique ». Mais qu›est-ce qu’une solution démocratique? Parfois elle semble se situer - selon les auteurs –à l’extérieur du capitalisme, à d’autres moments, elle semble devoir passer via des lois rapides car « le temps presse ». Pourtant ils ont eux-mêmes constaté auparavant que toutes les mesures « de l'économie verte » vont dans le sens du système et sont destructrices pour la nature. Il n'est pas clair avec quelles mesures ils vont renverser la tendance. D’un côté ils avancent quelques « succès », comme les cas d'autogestion en Argentine, au Mexique et en Grande-Bretagne, mais plus tard il apparait que ceux-ci ne sont que temporaires… Cela ressemble plutôt à des emplâtres sur une jambe de bois !
Les arguments avancés dans le livre ressemblent parfois à ceux de la partie « réformiste » du mouvement Occupy » et « Indignados » - (Democracia Real Ya - « une véritable démocratie maintenant» - en Espagne), qui par tous les moyens a essayé d’orienter le mouvement de protestation vers des objectifs concrets au sein du capitalisme, tandis qu’au sein de ces mouvements beaucoup de tendances prolétariennes se sont manifestées qui remettaient en question le système capitaliste.
D’autres alternatives sont énumérés: « l’ensemble des pays du Sud», le prolétariat écologique, « les citoyens » conscients, mais qui sont-ils, ces 99%? Ce qui frappe, c’est qu’aucun mot n’est soufflé à propos de la classe ouvrière. Existe-t’elle encore? Apparemment, pour les auteurs, elle ne compte pas. A la page192, ils affirment qu’un capitalisme vert fabrique des consommateurs à la place de « citoyens » ! « Aux citoyens conscients », il reviendrait dès lors la tâche d’empêcher la catastrophe écologique. La place centrale de la classe ouvrière dans le processus de production capitaliste a disparu. Seule reste l'indignation morale « du consommateur conscient », « du citoyen ». Toute protestation est de cette façon canalisée vers la sphère de la consommation, elle est retirée de celle de la production. Il devient ainsi impossible d’avoir une compréhension fine des rapports de production capitaliste et du rôle central de la classe ouvrière dans le renversement de ceux-ci.
Finalement, la critique radicale de l'économie verte apparaît n’être qu’un rideau de fumée pour faire avaler les recettes classiques de l’extrême-gauche: l'Etat, la « démocratie populaire», la réforme de la consommation comme une alternative au sein de la logique du /profit capitaliste.
Le marxisme propose-t-il une alternative ?
A la recherche d’alternatives en dehors du capitalisme où il sera mis fin à la production pour le profit (la valeur d'échange des marchandises) et où l’usage (la valeur d’usage) sera posée comme but, nous aboutissons nécessairement chez Marx et Engels.
Deux chercheurs académiques récents en particulier - John Bellamy Foster et Paul Burkett (4) - ont fourni une importante contribution sur la vision que Marx et Engels défendaient réellement concernant le rapport entre l’Homme et la Nature. Le résultat surprend agréablement au profit du marxisme. J. Bellamy Foster avait constaté que les Verts étaient fortement sous l’emprise du philosophe anglais Francis Bacon, un penseur matérialiste, qui était à la base de la fondation de la Royal Society of London (créée en 1660). Il a trouvé cela tellement remarquable qu’il a voulu investiguer plus loin. Par Bacon et sa vision matérialiste sur la nature, exprimée dans son travail « Novum Organum », il a abouti auprès des philosophes matérialistes et Epicure, en Grèce antique, et chez Lucrèce, dans la culture romaine antique. Via ce détour, il a « redécouvert » Marx (dont la thèse traitait d’Epicure). A partir de là, il a mis en évidence que « la critique verte » était au fond « idéaliste » et qu’elle attaquait de manière totalement infondée le marxisme pour son soi-disant « productivisme », sur la base d’une critique des positions de Staline et de beaucoup de partis et de groupes d’extrême-gauches. Son collègue P. Burkett menait une recherche complémentaire et apporta encore plus de données, venant surtout du Capital partie III, Théories au sujet de la plus-value, de Marx et de la Dialectique de la nature, de Engels. Mais par manque de place dans cet article, nous ne pouvons malheureusement pas développer ce point.
Le stalinisme a trahi à peu près tous les principes marxistes possibles : l'internationalisme prolétarien au profit de la patrie « socialiste », la violation de l'art et de la culture subordonnées à l'Etat tout-puissant, l’abandon du matérialisme historique en faveur du matérialisme vulgaire, la croissance monstrueuse de l’Etat au lieu de sa suppression, la mise de côté de l'analyse des rapports de production au profit de celle du mode de production. Cela leur a permis de promouvoir comme du « socialisme » leur système de production de plus-value - et donc d'exploitation. En fait, il s’agissait d’une forme de capitalisme d'état, étant donné que les rapports de production capitalistes continuaient à exister du fait même que la plus-value était réalisée globalement par l'Etat (la conception d’un « socialisme d'Etat » avait déjà été rejetée par Engels).
Dans les années du début de la révolution russe, on s'est basé minutieusement sur les avis de Marx & Engels au sujet de la nature. Lors du développement des nouveaux complexes industriels, il a été calculé quels dommages seraient causés à l’environnement et comment ceux-ci seraient compensés, e.a. par la création de parcs naturels, les zapovedniki (entre 1919 et 1929, 61 parcs naturels ont été créés avec une superficie totale de pas moins de 4 millions d’ha), dans lesquels les régions naturelles étaient protégées comme etaloni (modèles) pour pouvoir les comparer avec les terres cultivées (5). Lors de l'industrialisation forcée sous le stalinisme, les défenseurs de cette politique ont été liquidés au propre comme au figuré, avec toutes les conséquences qui s’en sont suivies pour l'environnement (6).
Au sein de la tradition marxiste, cela a signifié un sérieux coup pour la réflexion créative concernant la nature et l'équilibre écologique. À part Christopher Caudwell (7) et Amadeo Bordiga (8) (dans Le Fil du Temps), la réflexion sur le lien indissociable entre homme et nature s’est presque totalement arrêtée jusque dans les années 1980. Les communistes de gauche autour de Bordiga se basaient sur les idées de Engels concernant la suppression dans le socialisme de l'opposition entre la ville et la campagne: « La suppression de l'opposition entre la ville et la campagne n'est pas plus une utopie que la suppression de l'antagonisme entre capitalistes et salariés. Elle devient chaque jour davantage une exigence pratique autant du point de vue de la production industrielle que de la production agricole. Personne ne l'a défendue avec plus de force que Liebig dans ses ouvrages sur la chimie agricole, dans lesquels il demande que l'homme rende à la terre ce qu'il a reçu d'elle… … » (9). Ils posent aussi : « Nous nous trouvons là en plein dans le cadre des atroces contradictions que le marxisme révolutionnaire dénonce comme propre à la société bourgeoise aujourd’hui. Ces contradictions ne concernent pas seulement la répartition des produits du travail et les rapports qui en découlent entre les producteurs, mais elles s’étendent de manière indissociable à la répartition territoriale et géographique des instruments et des équipements de production et de transport, et donc des hommes eux-mêmes ; à aucune autre époque historique, peut-être, cette répartition n’a présenté des caractères aussi désastreux, aussi épouvantables…la lutte révolutionnaire pour la destruction des épouvantables agglomérations tentaculaires peut être ainsi définie : oxygène communiste contre cloaque capitaliste. Espace contre ciment » (Bordiga, p.124 et p. 155).
Pour l'humanité, il s’agit d’arrêter le Molloch du capitalisme par la révolution prolétaire, la seule qui peut et doit renverser ce système de production. Ce n’est qu’après qu’une autre logique peut se mettre en route qui rompe radicalement avec le principe du profit, qui exploite l'homme et la nature et menace de les détruire. Comme Caudwell l’a formulé : « D'ici le temps qu'une situation révolutionnaire mûrisse, il y aura une toute nouvelle superstructurequi existera de façon latente au sein de la classe exploitée, découlant de tout ce qu’elle a appris du développement des forces productives… C'est le rôle créatif des révolutions… La révolution prolétarienne est une conséquence de l'antagonisme croissant entre la superstructure bourgeoise et le travail prolétarien». Pour suivre ce chemin, nous avons besoin d’une analyse beaucoup plus radicale que celle qui nous est avancée par les auteurs du « mythe de l'économie verte ». Avec leurs arguments, on continue à rester prisonnier de la spirale descendante de la réflexion au sein des limites d’un système d'exploitation qui détruit tout.
JZ/6.12.12
(1) Anneleen Kennis & Matthias Lievens, « le mythe de l'économie verte », EPO, Anvers, 2012.
(2) Selon Adam Smith, économiste et père de la pensée économique capitaliste.
(3) 20% du territoire immense de l’ex-URSS est gravement pollué d’un point de vue écologique pour des générations entières.
(4) voir les contributions très intéressantes de l’activiste écologique cubain, Gilberto Romero, 'Cuba's environmental Crisis', Contacto, Magazine. (c) 1994-96 (c) 1994-96 et deux contributions critiques provenant du milieu anarchiste : Frank Fernández, 'Cuban Anarchism, the history of a movement', See Sharp Press Arizona 2001 en Sam Dolgoff 'The Cuban revolution, a critical perspective', Blackrose Books, Montreal 1976.
(5) John Bellamy Foster, 'Marx's Ecology', materialism and nature, Monthly Review Press, Nex York, 2000. Paul Burkett, 'Marx and Nature', a red and green perspective, St. Martins' press, New York, 1999.)
L'unique limite des deux chercheurs est que, même s’ils partent de points de vue matérialistes basés sur Marx & Engels, ils ne se sont pas référés dans la recherche de perspectives aux expériences effectives du mouvement ouvrier révolutionnaire, entre autre à l'héritage des communistes de gauche. Ceci ne réduit en rien la valeur d’une contribution qui permet la « réhabilitation » de l'analyse marxiste de l'homme & de la nature face aux falsifications staliniennes.
D’autres sources intéressantes à ce sujet sont : J. Grevin, Myth ou the Green Economy, in Revue Internationale 138, 2009 et le scientifique qui a imaginé le concept de la biosphère et qui a aussi souffert des poursuites staliniennes: Vladimir I. Vernadsky ; « The Biosphere », Moscow, 1926, reprint Copernicus-Springer Verlag, New York, 1997.
(6) Arran Gare dans 'Soviet Environmentalism', The Path not taken' in 'The Greening of Marxism', edited by Ted Benton, Guilford Press, New York London, 1996.
(7) Christopher Caudwell, Studies and further studies in a dying culture, Monthly Review Press, 1971, Men and Nature, pp151-2. Un marxiste critique qui est mort jeune pendant le guerre civile en Espagne.
(8) Amedeo Bordiga, in Espèce humaine et croûte terrestre, 341, Petite bibliothèque Payot, Paris 1978.
(9) Friedrich Engels, le problème du logement, SUN, Nijmegen.
Rubrique:
Face au poison de la division régionaliste et nationaliste: unité et solidarité ouvrière
- 1440 reads
Face à la crise généralisée catastrophique qui frappe son système, face au besoin croissant d’unité et de solidarité des prolétaires, la bourgeoisie cherche, par tous les moyens à distiller le poison de la division et de la confrontation, à nous entraîner sur le terrain obsolète de la compétition et de la concurrence, terrain indissociable du capitalisme lui-même. Par tous les moyens, la classe dominante cherche à pourrir l’esprit des prolétaires avec cette idée : “Vos intérêts sont ceux de telles ou telles fractions de la bourgeoisie.” Bien sûr, la bourgeoisie camoufle ceci en parlant des “intérêts supérieurs” de l’entreprise ou de la nation en général, comme si l’entreprise ou la nation n’existaient pas pour servir précisément les seuls intérêts de classe de nos exploiteurs.
Cette distillation du poison de la division a de nombreux visages. Ainsi nous assistons, depuis plusieurs années, à la montée en puissance des revendications régionalistes. En Espagne, tandis que les indépendantistes basques et catalans remportaient les élections locales, une manifestation monstre était organisée à Barcelone pour réclamer “une Catalogne indépendante (voir article).” De même, en Belgique, après la crise politique de 2010-2011 sur fond d’indépendantisme flamand, la Nieuw-Vlaamse Alliantie – Alliance néo-flamande – triomphait aux élections communales, notamment son chef de file, Bart De Wever, qui remportait haut la main un tas de communes dont la ville d’Anvers (voir article). Au Royaume-Uni, l’Écosse, région riche en ressources minières, organisera un référendum en 2014 à propos de son indépendance ! Dans une moindre mesure, en Italie, la puissante Ligue du Nord revendique, depuis des années, l’autonomie de la Padanie.
Partout, ces velléités indépendantistes s’accompagnent d’un discours écœurant dénonçant les ouvriers des autres régions qui, tels des vampires, suceraient le sang fiscal et économique des travailleurs locaux.
 La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement dans les médias de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs et cypriotes” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” !
La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement dans les médias de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs et cypriotes” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” !
Face à cette propagande nauséabonde, à ces préjugés bassement entretenus et cultivés, aux divisions, aux conflits des uns contre les autres, nous devons réaffirmer la nécessité de l’unité internationale de nos luttes.
Notre véritable force, c’est en effet la massivité de notre combat, l’union par-delà les secteurs, les races, les frontières et les nations. À un monde divisé et cloisonné par les intérêts privés du capital, ceux d’une classe d’exploiteurs arrogants, les fameux “1 %” dénoncés par les “Indignés”, nous devons opposer notre solidarité. Nous devons prendre conscience, nous qui travaillons dans des conditions de plus en plus inhumaines, que nous sommes tous les vraies victimes d’un système barbare à l’agonie. Face au chacun pour soi, nous devons nous rassembler, réfléchir et discuter ensemble, sur les moyens de défendre notre dignité et nos conditions de vie.
Internationalisme / 10 avril 2013
Rubrique:
Le lavage de cerveau nationaliste empêche une réaction unie
- 1439 reads
[1….]
2. La pression de la décomposition met en évidence les faiblesses de la bourgeoisie belge
(…) La division au sein des diverses fractions nationales exprime avant tout la pression croissante de la crise historique du capitalisme sur la cohésion de l’ensemble des bourgeoisies de la planète. De l’opposition entre Républicains et démocrates aux USA sur la politique à mener pour faire face à la dépression jusqu’aux oppositions entre les régions riches d’Italie du Nord ou d’Espagne (la Catalogne) (voir article) et les régions pauvres de ces pays, ou encore le surgissement dans des pays comme les Pays-Bas de fractions ouvertement anti-européennes, on peut constater que ces tensions s’exacerbent un peu partout. Dans ce cadre il est erroné de voir les tensions (sous-)nationalistes comme une «exception Belge»,
Ceci étant dit, il est également incontestable que la bourgeoisie belge est caractérisée par un manque évident d’homogénéité: depuis la création artificielle de l’État belge en 1830, des tensions existaient en son sein. Ces tensions entre fractions régionales se sont particulièrement développées depuis la première guerre mondiale et se sont exacerbées depuis l’ouverture de la crise historique à la fin des années 1960. Le dernier avatar de ces tensions a été la montée en puissance lors des dernières élections du parti autonomiste flamand NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie). Pendant les 18 mois de négociations interminables, suivant les élections fédérales de juin 2010, les diverses fractions se sont déchirées comme des loups enragés afin de se positionner le mieux possible pour assurer leur survie dans la lutte sans merci qui est engagée sur le marché mondial, perdant même de vue à certains moments que cette lutte fratricide risquait de les mener tous à leur perte.
Si la bourgeoisie belge est effectivement divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent, lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussent ces conflits au second plan et s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs. Il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités.
3. La bourgeoisie exploite ses faiblesses dans un battage nationaliste intense contre la classe ouvrière
L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend que la bourgeoisie belge utilise habilement ses divisions internes contre la classe ouvrière dans un double objectif:
3.1. Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’État dans celles-ci.
Face au risque de défaut de paiement, tous les états européens ont lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire. Ces plans dévoilent toutefois de plus en plus le rôle de l’État, ce pseudo ‘État social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Loin d’être un arbitre au-dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, «l’État démocratique» se manifeste ici pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.
Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour au contraire embobiner cette dernière dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions attisent précisément les oppositions entre régions et communautés afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe «l’État démocratique» dans un imbroglio institutionnel.
De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise historique du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’État et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouvernements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphones, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces «réformes de l’État» ont abouti aux résultats suivants:
-accroître l’efficacité de l’exploitation: la «responsabilisation» des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus «performants» que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux implémenter la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.
-accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous le couvert de réorganisation des structures de l’État;
-diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.
3.2. Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière.
Lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie -à travers en particulier de ses syndicats- se sert de l’intensification du battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie. Cela aussi c’est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.
Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-état wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années ’80, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel et Ford). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: «Ce que nous faisons-nous mêmes, nous le faisons mieux» est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée et récemment, ce sont les travailleurs d’Opel et de Ford qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le «combat de la Flandre pour les sauver».
Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leurs salaires et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants flamands et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser.
[4….]
5. Contexte et perspectives pour les luttes ouvrières
Le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompu depuis l’été 2008, a caché aux travailleurs la réalité de la crise et des enjeux et a créé des conditions difficiles pour leur mobilisation, pour leur lutte et surtout pour l’extension de celle-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. Il serait par ailleurs illusoire de penser que la bourgeoisie s’attachera à dissiper le brouillard dans la période actuelle. Bien au contraire, elle tend à exploiter un certain soulagement au sein de la classe ouvrière du fait que les tensions au niveau de la gestion de l’État belge semblent réglées pour jouer à présent la carte de la nécessaire «unité nationale» face aux marchés en appelant à une «solidarité nationale» pour «défendre notre pays» contre les attaques d’un «monde extérieur agressif» et pour «corriger les erreurs du passé». Pour la classe ouvrière en Belgique, la situation a été difficile ces dernières années et cela va encore rester difficile pendant une certaine période.
(…) Tous les éléments avancés dans ce rapport démontrent bien que le décalage avec la situation sociale dans les autres pays d’Europe est plus une question de perception et de prise de conscience qu’une réalité objective: la réalité économique et sociale en Belgique est tout à fait parallèle à celles de pays comme la France ou les Pays-Bas.
Aussi, la situation sociale peut évoluer très vite, comme l’ont illustré le «printemps arabe» (…) en Tunisie et en Égypte et les mouvements des «Indignés» en Espagne ou «Occupy» aux États-Unis.
Ces mouvements depuis 2011, aussi limités qu’ils soient encore, révèlent une sincère volonté de débattre collectivement, de réfléchir collectivement et de lutter ensemble, de tourner le dos à l’individualisme du capitalisme. Le fait que ces mouvements se développent au niveau international leur donne leur importance décisive. Ils indiquent que la classe ouvrière en Belgique peut très vite retrouver le chemin de la lutte. Et une fois en mouvement, elle peut très bien réagir avec encore beaucoup plus de combativité et de détermination qu’ailleurs. Sur ce plan là aussi, contrairement aux campagnes de la bourgeoisie, la Belgique n’est pas une exception.
Internationalisme/novembre 2011