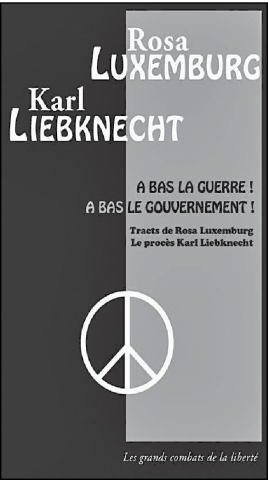Internationalisme - 2013
- 1222 reads
Internationalisme no 357 - 1er trimestre 2013
- 1011 reads
Après Ford-Genk, Arcelor Mittal, Caterpillar... encore plus d'austérité, de licenciements, de précarité... l'unification et la solidarité sont nécessaires!
- 1563 reads
Mais comment?
Après la fermeture de Ford-Genk, c’est 1.400 des 4.000 jobs qui sont supprimés chez Caterpillar. ArcelorMittal pour sa part arrête 7 de ses 12 lignes de production de l’acier à froid à Liège: 1.300 licenciements sont annoncés. Depuis 2011, 800 emplois avaient déjà disparu par la fermeture de la production à chaud.. À Bruxelles, à Gand, à Schoten et à Overpelt aussi, des licenciements ont été annoncés les deux dernières années. Ils font partie des 9.000 jobs qui disparaissent mondialement, selon ce que ArcelorMittal avait déjà annoncé en 2008 (1): la bourgeoisie belge «oublie» en effet souvent de mentionner les pertes d'emplois en France, en Espagne, au Luxembourg .... Et n’oublions pas d’autres drames dans des entreprises diverses, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger: Beckaert, Belfius, Carsid, Dow Chemical, Duferco, ING, NLMK, Philips, Siemens… Dans tous ces cas, il s’agit de licenciements, de fermetures d’unités de production ou d'autres mesures d'économie. Les services publics n'échappent pas à la vague des rationalisations: les réformes du secrétaire d'État Bogaert prévoient un nouveau système d'évaluation qui apportera entre autres une charge de travail plus lourde, des promotions plus compliquées, une réduction des primes pour le travail de nuit et le week-end (2). Dans les CPAS aussi, on taille drastiquement dans les budgets: A Beringen, Malines, Rochefort, Zelzate…, il y a des licenciements et des suppressions de postes. Les contrats des temporaires ne sont pas prolongés, les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés.
La Belgique n’échappe donc clairement pas à la crise: en 2012, près de 1.7000 emplois ont disparu (3), le nombre des faillites pour 2012 dépasse les 10.000 unités et le chômage augmente clairement, surtout parmi les jeunes (4). La fermeture de sites de production ici ne mène guère en outre à la réouverture d'autres à l’étranger. Il ne s’agit donc pas de simples «délocalisations», mais d’un rétrécissement effectif de la production mondiale. Et si de nouvelles unités de production ouvrent malgré tout, c’est pour presser encore plus le citron: ainsi Ford a déménagé une partie de la production de Genk vers Valence, où les salaires sont jusqu’à 42 % plus bas! Le malheur de l’un fait donc ... aussi le malheur de l’autre!
Qui est responsable de ce carnage? Est-ce Ford qui a trahi son «engagement» pour Genk? Est-ce Lakshmi Mittal qui s’est révélé un manager «non fiable»? Est-ce les gouvernements parce qu’ils ont avalé leurs promesses de protéger l'emploi? Non! La vraie cause pour ces catastrophes sociales n’est pas à chercher auprès d’entreprises spécifiques «non éthiques» de capitalistes «non fiables» ou de gouvernements «lâches». La généralité des attaques que la classe ouvrière subit en Belgique comme sur un plan mondial est la conséquence directe de la crise du capitalisme. De toute évidence, le capitalisme n’en peut plus!
Le capitalisme n'offre pas d'avenir
Depuis quelques années, les crises de l'immobilier, de la bourse, du commerce et de l'industrie, des banques et des dettes souveraines des États se succèdent sur le plan mondial. Entre-temps, la dette des États de la zone euro s’élève à 8.517 s'élève milliards d'euros, soit 95 pour-cent du produit intérieur brut de la zone (5). Quel Etat prendra le risque de financer ces dettes? Financer des dettes qui ne pourront jamais être repayées signifie en effet à terme devenir soi-même insolvable. C'est un risque qui menace par exemple l'Allemagne. Comment le système va-t-il alors financer cette relance absolument nécessaire, qui devrait arrêter le carnage dans l'économie? Toujours plus d'économies et de rationalisations diminueront encore plus fortement le pouvoir d'achat, avec pour conséquence que les produits seront encore moins vendus et donc qu’il y aura encore des rationalisations, des fermetures, des baisses des salaires…. Ou le système va-t-il écumer maintenant le marché de l'épargne en imposant des taux d’épargne faibles, comme en Belgique avec des taux d'intérêt qui plongent en dessous des 1%, alors que l'inflation s'élève à 2,76%? Dans ce cas, la réserve financière que beaucoup de familles ouvrières ont établie pour faire face aux contretemps potentiels, aux dettes courantes (emprunts) et à la pauvreté fondra comme neige au soleil. Quelle que soit la méthode choisie, à terme le pouvoir d'achat diminuera une fois de plus fortement.
Faire marcher la planche à billet alors, comme le font les EU, le Japon et le Royaume Uni en mettant sur le marché des emprunts à faible taux d'intérêt? Mais ainsi, on accroît le puits sans fond de la dette et on en revient au début du problème, car en fin de compte, pour chaque somme d’argent, une contrepartie en valeur réelle est nécessaire. Donc pas de l’argent fictif, comme c’est le cas de notre épargne que la banque fait circuler sous la forme d'un emprunt, tandis qu’on nous fait croire qu'il se trouve toujours sur notre compte. Pour rembourser les dettes il faut donc créer et vendre une nouvelle valeur effective (sous la forme de marchandises).
Comment surgit la nouvelle valeur? «La valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail totale contenue dans la marchandise. Une partie de cette quantité de travail est réalisée dans une valeur pour laquelle un équivalent est payé sous forme du salaire; une autre partie toutefois est réalisée dans une valeur pour laquelle aucun équivalent n'a été payé (la plus-value). Une partie du travail que comprend la marchandise est du travail payé; une partie est du travail non rémunéré» (6). Si les capitalistes de ce monde réussissent à vendre suffisamment leurs marchandises, ils empochent la plus-value et font du profit. «Évidemment, les ouvriers achètent ces marchandises… à la hauteur de leurs salaires. Il en reste donc une bonne partie encore à vendre. Sa valeur est équivalente à celle du travail des ouvriers qui ne leur a pas été payée. Elle seule a ce pouvoir magique pour le Capital de générer du profit. Les capitalistes eux aussi consomment… et ils ne sont d’ailleurs en général pas trop malheureux. Mais ils ne peuvent pas à eux seuls acheter toutes les marchandises porteuses de plus-value. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens. Le Capital ne peut s’acheter à lui-même, pour faire du profit, ses propres marchandises; ce serait comme s’il prenait l’argent de sa poche gauche pour le mettre dans sa poche droite. Personne ne s’enrichit ainsi, les pauvres vous le diront. Pour accumuler, se développer, le Capital doit donc trouver des acheteurs autres que les ouvriers et les capitalistes. Autrement dit, il doit impérativement trouver des débouchés en-dehors de son système, sous peine de se retrouver avec des marchandises invendables sur les bras et qui viennent engorger le marché: c’est alors la “crise de surproduction”!» (7)
Si les entreprises arrêtent de tourner aujourd’hui, ce n'est donc pas parce que les ouvriers ne veulent pas travailler ou parce qu’il n’y a plus de besoins, mais parce que les capitalistes n’y ont plus rien à gagner. Les débouchés solvables sont soit insuffisants soit inexistants et les profits ne peuvent donc être obtenus que par une exploitation sociale encore plus grande. Voilà pourquoi les entreprises ferment leurs portes, baissent les frais de production, augmentent la productivité, voilà pourquoi les frais improductifs (sécurité sociale, allocations de chômage, retraites) sont réduits de manière drastique. Le système capitaliste mondial est dans l’impasse!
Que pouvons-nous faire contre la dégradation de nos conditions de vie et de travail? Comment pouvons-nous faire face aux attaques? Dans son histoire, le capitalisme n'a jamais été pacifique, raisonnable, moral ou durable. Il n'a jamais concédé de son plein gré des améliorations aux ouvriers ou à d'autres exploités. Le mouvement ouvrier a toujours été un mouvement de lutte. Sans résistance, les exploiteurs gardent l’initiative. Ces dernières années, on constate à nouveau une combativité ascendante au sein de la classe ouvrière mondiale. En Belgique aussi, les ouvriers montrent des signes de combativité. Cela s’est vu à Ford-Genk et surtout auprès des sous-traitants, à ArcelorMittal Liège, dans les manifestations des fonctionnaires en 2012 et 2013… Mais le ras-le-bol et la combativité seuls ne sont pas suffisants pour développer une résistance efficace. L'indignation ne réussit pas véritablement à se transformer en un mouvement de résistance vigoureux. Pourquoi pas?
Le corporatisme = une voie sans issue
Pour construire un rapport de force, l'unité est nécessaire. Et pour y arriver, la solidarité est exigée. Mais la bourgeoisie en appelle aussi par le biais de ses différents organes, comme les syndicats, le gouvernement (national, ou régional ou local), les partis bourgeois, les mass media… à la «solidarité», mais de quelle sorte!
«La solidarité, bien sûr», avance le bourgeoisie, mais alors au sein de l’entreprise, du secteur et de la région. La solidarité «bourgeoise» enferme les ouvriers dans le corporatisme et le régionalisme.
Pourquoi les ouvriers de Liège et de Genk ne se sont-ils pas retrouvés, alors qu’ils ne sont séparés que par 50 km et que leurs problèmes sont les mêmes? Pourquoi les manifestations se tiennent-elles à différents endroits et à différents moments et en plus de manière aussi locales que possible? Ainsi la «marche pour l'avenir» s’est tenue le 11 novembre à Genk, alors que le 14 novembre avait lieu à Bruxelles une manifestation européenne. Le 26 janvier, il y avait une manifestation à Seraing, tandis que le 7 février, une manifestation de fonctionnaires était prévue à Bruxelles. Et une autre manifestation devait encore avoir lieu le 21 février à Bruxelles.
Ce fractionnement des ouvriers est orchestré par les syndicats en personne pour exterminer dans l’oeuf tout germe d’unification de la lutte et de discussion. Que les syndicats sabotent chaque forme de solidarité et d'unité, est bien ressenti par des parties du prolétariat: des ouvriers des sous-traitants de Ford-Genk se sont détachés des syndicats et se sont organisés dans un comité de grève indépendant. Mais est-ce bien suffisant? Malgré le mécontentement de ces ouvriers vis-à-vis des syndicats, ils n'ont pas rompu avec la logique corporatiste. Le comité exigeait en effet des primes de licenciement aussi élevées que celles des ouvriers de l'usine de Ford elle-même. Ils veulent être aussi «Ford» que ceux de «Ford». Est-ce suffisant d’être furieux au sujet d'une mauvaise répartition de la pauvreté? Ne faut-il donc pas exprimer un ras-le-bol de la pauvreté elle-même? Ne devons-nous pas être solidaires contre la pauvreté? La «solidarité» des syndicats correspond à l'acceptation de la misère au nom de l'économie nationale! Et c'est parfaitement compréhensible, car les syndicats sont depuis des dizaines d'années une partie intégrale de l'état capitaliste. Ils sont les chiens de garde des intérêts de l’Etat au sein des usines.
Pas de solidarité avec l'économie nationale!
«La solidarité, bien sûr», renchérit la bourgeoisie, mais alors avec les forces sociales et politiques au sein du système démocratique. La «solidarité» bourgeoise enferme les ouvriers dans la logique du capitalisme national.
Beaucoup d'ouvriers, dont ceux de Ford et d’ArcelorMittal, placent tout leur espoir dans l’intervention des autorités. Ils ont même plus souvent confiance dans les pouvoirs régionaux ou locaux que dans les autorités nationales. Aucun gouvernement ne peut toutefois offrir une réponse à leurs problèmes, étant donné que la tâche du gouvernement est la gestion et la défense des intérêts de l'économie nationale. Que l'Etat soit belge, flamand, wallon, catalan, écossais ou palestinien, aucun ne peut échapper à la faillite du capitalisme. Les gouvernements ne peuvent pas réaliser leurs promesses, par exemple pour assurer le maintien en activité des haut fourneaux à Liège (sous le contrôle direct de l'Etat ou par un repreneur privé). Ils racontent des bobards aux ouvriers. Rappelons-nous l’interminable et épuisante procédure avant la fermeture définitive d'Opel Anvers. Les intérêts nationaux demandent toujours plus de sacrifices et d'exploitation et sont donc antagoniques aux intérêts de la classe ouvrière. «Les ouvriers n'ont pas de patrie.» (8)
La démocratie n'est-elle pas un appareil politique du peuple et pour le peuple? Non! La démocratie capitaliste se distingue de la dictature ouverte par le fait qu’en apparence elle accorde un droit de décision à ses ressortissants. Ainsi elle lie la classe ouvrière à ses intérêts qui ne sont rien d'autre que les intérêts du capital national et donc du capitalisme. Ou comme le mouvement de l'Indignados en Espagne l’a affirmé: «c'est une dictature, mais tu ne le vois pas ». Rechercher la solidarité avec l'Etat démocratique mène au suicide pour la classe ouvrière.
L'élargissement, l'unification, la solidarité de classe!
En 2011 et en 2012 il y a eu de manière massive sur tous les continents des protestations, des grèves et des manifestations: de la Norvège jusqu'au Portugal, de l'Inde jusqu'à la Turquie, de l'Égypte jusqu'à la Chine. En septembre, des centaines de milliers de personnes ont manifesté au Portugal, des dizaines de milliers en Espagne, en Grèce et en Italie. Au Japon, depuis 1970, il n’y avait plus eu des manifestations contre les conditions de vie d’une telle ampleur (170.000 manifestants à Tokyo). Les mouvements les plus frappants ont été ceux des Indignés et d'Occupy en 2011, qui ont surtout été portés par les jeunes et les chômeurs en Espagne, en Grèce et aux EU. Partout la question était posée de comment faire face à de telles attaques, comment organiser la lutte, quelle perspective mettre en avant. Trois besoins centraux pour la lutte ont constamment été avancés: (a) l'élargissement et l'unification de la lutte, (b) le développement de la solidarité active parmi les travailleurs salariés, les chômeurs et les jeunes et (c) une large discussion au sujet de l'alternative pour le système actuel en faillite. Ces différents aspects dépendent l’un de l’autre et se nourrissent mutuellement.
Pour construire un rapport de force effectif contre le capitalisme, la classe ouvrière doit s’unifier au delà des frontières des entreprises, des secteurs, des régions et des nations. Un tel mouvement d’unification exige de la solidarité. Toute prime de licenciement, toute concession apparente du capital n’est qu’une aumône et ne remet pas en question les fondements de la misère. Une attitude défensive ne suffit pas. La solidarité mutuelle contre le système et sa logique est plus que jamais nécessaire. Les ouvriers en Pologne en 1980 l’ont bien compris, tout comme les ouvriers en Belgique en 1986. Des délégations massives ont été envoyées vers d’autres régions, villes, secteurs, lieux de travail… pour persuader les ouvriers de participer à une lutte commune. En Pologne, le mouvement s’est développé jusqu’à devenir le mouvement de lutte le plus important depuis 1968 et à faire vaciller le régime stalinien. En Belgique, le mouvement a connu son apogée au cours des mois avril et mai, quand les mineurs, les ouvriers de l'automobile, les métallurgistes, les enseignants, les lycéens, les éboueurs, les dockers, les ouvriers des transports en commun ont été impliqués… dans un tourbillon des grèves spontanées et de manifestations (pendant lequel les trains ont continué à rouler en fonction du mouvement de lutte!). Ceci a été le résultat d'une recherche active de la solidarité qui a nourri l'élargissement et l'unification de la lutte.
Comment développer cette solidarité? En ne faisant pas confiance aux syndicats ou à d'autres «spécialistes», mais bien à notre propre force en tant que classe. La force de la classe ouvrière ne se situe pas seulement dans sa capacité à arrêter une partie ou même la totalité de la production. La grève est une arme importante, mais doit être utilisée en fonction du renforcement de la solidarité de classe. La force du prolétariat se trouve surtout dans sa capacité à construire une nouvelle société. Elle est en effet le cœur de l'appareil de production: elle est constituée de l’ensemble des producteurs qui doivent chaque jour collaborer. Elle a la capacité de transformer la production: d'un système où la production est placée sous le signe du profit, vers un système où la production vise la satisfaction des nécessités et des besoins. Le fait que le prolétariat est la seule classe qui produit collectivement, fait qu’elle est aussi la seule classe qui peut développer une véritable solidarité. Cette solidarité et cette unité sont non seulement nécessaires, mais elles sont aussi possibles.
Alex/ 06.03.2013
(1) The New York Times, 2008, https://www.nytimes.com/2008/11/27/business/worldbusiness/27iht-steel.4.... [2]
(2) De Wereld Morgen, 2013, https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/07/federale-ambtenaren-be... [3]
(3) Le Soir, 2012, le https://archives.lesoir.be/l-annee-2012-a-co%FBte-17.000-jobs-en-chiffre... [4]…
(4) De standard, 2012, https://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121203_00390... [5]
(5) Reuters, 2013, https://graphics.thomsonreuters.com/F/09/EUROZONE_REPORT2.html [6]
(6) Marx, 1865,Salaire, prix et profit.
(7) Internationalisme n 353, «la crise de la dette, pourquoi?», 1ier trimestre 2012, https://fr.internationalism.org/isme353/la_crise_de_la_dette_pourquoi.html [7]
(8) Marx, 1848, manifeste communiste
Géographique:
- Belgique [8]
Situations territoriales:
Rubrique:
Intervention au Mali: encore une guerre au nom de la paix et de la libération des populations!
- 1101 reads
« Ce que nous avons fait était pour libérer... » : voici ce que le président Hollande pouvait déclarer devant les caméras lors de sa visite du 2 février dernier à Tombouctou. Difficile de ne pas se laisser prendre au jeu des apparences! En effet, c’est bien une foule en liesse, agitant des drapeaux tricolores et maliens, chantant et vantant les mérites du Président français, qui a accueilli le «héros national du Mali». Hollande, le «grand libérateur», ne s’est probablement pas trompé en y voyant «la journée la plus importante de sa vie politique». La communication est une arme stratégique et, comme Mitterrand l’avait fait à Sarajevo en son temps, Hollande a voulu marquer les esprits d’un sentiment de légitime victoire au nom d’un prétendu combat «pour la paix». Par contre, pas une image du conflit n’a filtré, pas l’ombre d’un cadavre, aucune trace des bombardements massifs de l’armée française au Nord du Mali, à peine quelques mots chuchotés des exactions des troupes maliennes. Circulez, il n’y a rien à voir! Tout cela ne porte pas à critique, tant le travail de propagande a été facilité par la terreur même des fondamentalistes et hordes mafieuses d’un côté et la liesse d’une population exsangue soulagée, pouvant enfin «se mettre à chanter» de l’autre! La cruauté des bandes armées qui régnaient au Nord du Mali ne fait aucun doute. Ces seigneurs de guerre sèment la mort et la terreur partout où ils passent. Mais, contrairement à ce que nous racontent en chœur politiciens et journalistes, les motifs de l’intervention française n’ont évidemment rien à voir avec les souffrances des populations locales. L’Etat français ne vise qu’à défendre ses sordides intérêts impérialistes. En réalité, l’allégresse des populations sera de courte durée. Quand une «grande démocratie» passe avec ses chars, l’herbe n’est jamais plus verte après! Au contraire, la désolation, le chaos, la misère, sont les preuves de leur intervention. La carte ci-dessous détaille les principaux conflits qui ont ravagé l’Afrique dans les années 1990 et les famines qui l’ont frappé. Le résultat est spectaculaire: chaque guerre – souvent opérée sous la bannière du droit à l’ingérence humanitaire, comme en Somalie en 1992 ou au Rwanda en 1994 – a entraîné de graves pénuries alimentaires. Il ne va pas en être autrement au Mali. Cette nouvelle guerre, paradoxalement, va déstabiliser la région entière et accroître considérablement le chaos.
Une guerre impérialiste
«Avec moi Président, c’est la fin de la ‘Françafrique’». Ce mensonge grossier de François Hollande pourrait prêter à rire s’il n’impliquait pas une logistique militaire imposante et de nouvelles victimes. Il y a autant de soldats mobilisés qu’en Afghanistan, 4000 hommes! Selon le ministre de la défense français : « Nous avons acheminé 10.000 tonnes de matériel en quinze jours. C’est autant que ce que nous avons transporté en un an lors du retrait d’Afghanistan. » L’utilisation du matériel aérien est particulièrement intensive, notamment avec les frappes aériennes au nord de Kidal.
La gauche n’a de cesse de mettre en avant son humanisme mais, depuis près d’un siècle, les valeurs dont elle se drape ne servent qu’à dissimuler sa réelle nature: une fraction bourgeoise qui comme les autres est prête à tout, à tous les crimes, pour défendre l’intérêt national. Car c’est bien de cela qu’il s’agit au Mali: défendre les intérêts stratégiques de la France. Comme François Mitterrand qui avait décidé d’intervenir militairement au Tchad, en Irak, en ex-Yougoslavie, en Somalie et au Rwanda, François Hollande prouve que les «socialistes» n’hésitent jamais à protéger leurs «valeurs» (entendre les intérêts bourgeois de la nation française) à la pointe de la baïonnette.
Depuis le début de l’occupation du Nord du pays par les islamistes, les grandes puissances, en particulier la France et les Etats-Unis, poussaient en coulisses les pays de la zone à s’impliquer militairement en leur promettant financements et moyens logistiques. Mais à ce petit jeu d’alliances et de manipulations, l’État américain semblait plus doué et gagner peu à peu en influence. Se faire ainsi damer le pion au cœur de son «pré-carré» était tout simplement inacceptable pour la France, elle se devait de réagir et de taper un grand coup: «A l’heure des décisions, la France a réagi en usant de son ‘droit-devoir’ d’ancienne puissance coloniale. Le Mali se rapprochait certes un peu trop des Etats-Unis, au point d’apparaître comme le siège officieux de l’Africom, le commandement militaire unifié pour l’Afrique, instauré en 2007 par George Bush et consolidé depuis par Barack Obama» (Courrier international du 17 janvier 2013).
En réalité, dans cette région du globe, les alliances impérialistes sont d’une infinie complexité et très instables. Les amis d’aujourd’hui peuvent devenir les ennemis de demain quand ils ne sont pas les deux en même temps! Ainsi, tout le monde sait que l’Arabie Saoudite et le Qatar, ces «Grands alliés» déclarés de la France et des Etats-Unis, sont aussi les principaux bailleurs de fonds des groupes islamiques agissants au Sahel. Il n’y a donc aucune surprise à lire dans les colonnes du Monde du 18 janvier, le Premier ministre du Qatar se prononcer contre la guerre que la France a engagée au Mali en mettant en doute la pertinence de l’opération «Serval». Et que dire des superpuissances que sont les Etats-Unis et la Chine qui soutiennent officiellement la France pour mieux agir en coulisses et continuer d’avancer leurs pions?
Selon Hollande, «le combat n'est pas terminé»
Conscient des difficultés, le président français n’a pas hésité à déclarer: «Le terrorisme a été repoussé, chassé, mais il n’a pas encore été vaincu. » Si Gao, centre névralgique de la lutte contre les islamistes radicaux a été reprise comme tout le nord du Mali, les zones montagneuses restent un ultime refuge pour des groupes terroristes bien armés et fanatisés, conditions qui rappellent la situation et le terrain difficiles de l’Afghanistan. On ne peut, en outre, s’empêcher aussi de faire un rapprochement avec la Somalie. «La violence dans le pays, à la suite des tragiques événements de Mogadiscio au début des années 1990, s’est propagée dans toute la Corne de l’Afrique qui, vingt ans après, n’a toujours pas retrouvé sa stabilité.» (A. Bourgi, Le Monde du 15 janvier 2013). Cette dernière idée doit être soulignée: la guerre en Somalie a déstabilisé toute la Corne de l’Afrique qui, «vingt ans après, n’a toujours pas retrouvé sa stabilité». Voilà ce que sont ces guerres prétendument «humanitaires» ou «antiterroristes». Quand les «grandes démocraties» brandissent le drapeau de l’intervention guerrière pour défendre le «bien-être des peuples», la «morale» et la «paix», elles laissent toujours derrière elles des champs de ruines où règne l’odeur de la mort.
De la Libye au Mali, de la Côte d’Ivoire à l’Algérie, le chaos se généralise
«Impossible (…) de ne pas noter que le récent coup d’Etat (au Mali) est un effet collatéral des rébellions du Nord, qui sont elles-mêmes la conséquence de la déstabilisation de la Libye par une coalition occidentale qui n’éprouve étrangement ni remords ni sentiments de responsabilité. Difficile aussi de ne pas noter cet harmattan kaki qui souffle sur le Mali, après être passé par ses voisins ivoirien, guinéen, nigérien et mauritanien » (Courrier international du 11 avril 2012). En effet, nombreux ont été les groupes armés qui se battaient aux côtés de Kadhafi qui se trouvent aujourd’hui au nord du Mali, et ailleurs, avec leurs armements après avoir vidé les caches d’armes libyens. Pourtant, en Libye aussi, la «coalition occidentale» intervenait prétendument pour faire régner l’ordre et la justice, pour le bien être du peuple libyen… Aujourd’hui, la même barbarie est subie par les opprimés de cette région du monde et le chaos ne cesse de s’étendre. Ainsi, avec cette guerre au Mali, l’Algérie elle même se trouve aujourd’hui déstabilisée. Depuis le début de la crise malienne, le pouvoir algérien menait un double jeu, comme l'ont montré deux faits significatifs: d’un côté la «négociation» ouverte avec certains groupes islamistes, laissant même certains s’approvisionner sur son sol en grosses quantités de carburant lors de leur offensive pour la conquête de la ville de Konna en direction de Bamako; d’un autre côté, Alger a autorisé le survol de son espace aérien aux avions français pour bombarder les groupes djihadistes au Nord du Mali. Ce positionnement contradictoire et la facilité avec laquelle les éléments d’AQMI ont pu accéder au site industriel le plus «sécurisé» du pays, tout cela a montré le caractère décomposé des rouages de l’Etat comme de la société. A l’instar des autres Etats du Sahel, l’implication croissante de l’Algérie ne peut qu’accélérer le processus de décomposition en cours.
Toutes ces guerres indiquent que le capitalisme est plongé dans une spirale extrêmement dangereuse et qui met en péril la survie même de l’humanité. Progressivement, des zones entières du globe plongent dans le chaos et la barbarie. S’entremêlent la sauvagerie des tortionnaires locaux (seigneurs de guerre, chefs de clans, bandes terroristes…), la cruauté des seconds couteaux impérialistes (petits et moyens Etats) et la puissance dévastatrice des grandes nations, chacun étant prêt à tout, à toutes les intrigues, à tous les coups bas, à toutes les manipulations, à tous les crimes, à toutes les atrocités… pour défendre ses minables et pathétiques intérêts. Les incessants changements d’alliances donnant à l’ensemble des allures de danse macabre.
Ce système moribond ne va cesser de s’enfoncer, ces conflits guerriers ne vont faire que s’étendre, embrasant des régions du globe toujours plus vastes. Choisir un camp, au nom du moindre mal, c’est participer à cette dynamique qui n’aura d’autre issue que la mort de l’humanité. Il n’y a qu’une seule alternative réaliste, qu’une seule façon de sortir de cet engrenage infernal: la lutte massive et internationale des exploités pour un autre monde, sans classe ni exploitation, sans misère ni guerre.
Amina/15.02.2013
Rubrique:
Tunisie, Egypte: l'impasse des "révolutions arabes"
- 1140 reads
Alors que les prétendues «révolutions arabes» fêtaient leur deuxième anniversaire, les émeutes et les manifestations massives qui se produisent ces derniers mois et ces dernières semaines en Égypte et en Tunisie sont venues rappeler à la face du monde que le départ des dictateurs Ben Ali et Moubarak n’avait rien réglé. Bien au contraire, la situation économique avec son cortège de chômage grandissant, de misère et d’attaques anti-ouvrières s’est aggravée. Et l’autoritarisme régnant comme la violence de la répression qui s’abattent aujourd’hui sur les manifestants n’ont rien à envier à ce qui prévalait auparavant.
Une colère et un courage immenses…
La Tunisie, où l’immolation par le feu du jeune Mohammed Bouazizi avait été le déclencheur du «Printemps arabe», traverse une grave crise sociale, économique et politique. Le taux de chômage officiel est de 17% et les grèves se multiplient dans de nombreux secteurs depuis des mois. La colère qui s’est exprimée si ouvertement et massivement dans de nombreuses villes du pays n’a donc pas explosé dans un ciel serein. En décembre déjà, de jeunes chômeurs s’étaient violemment opposés à la police dans la ville de Siliana, en protestation contre le programme d’austérité annoncé par le président Moncel Marzouki, provoquant des manifestations de solidarité contre la répression et ses 300 blessés, dont certains par chevrotines, dans plusieurs grandes villes et dans la capitale. Le président tunisien avait alors déclaré devant la tension sociale grandissante: «Nous n’avons pas une seule Siliana. J’ai peur que cela se reproduise dans plusieurs régions.» Et c’est l’assassinat de l’opposant laïc Chokri Belaïd qui a tout dernièrement poussé une nouvelle fois la population dans la rue, tandis que son enterrement était l’occasion pour les 50.000 personnes présentes dans le cortège funéraire d’appeler à «une nouvelle révolution» et de réclamer «Du pain, la liberté et la justice sociale», slogan principal de 2011. Dans une douzaine de villes, outre des postes de police, comme un commissariat du centre de Tunis, des locaux du parti islamiste Ennahda au pouvoir étaient attaqués, et l’armée déployée pour contenir les manifestations de masse à Sidi Bouzid d’où était partie la «révolution de jasmin» il y a deux ans.
Pour calmer la situation et récupérer le mouvement, le syndicat UGTT (Union générale de Tunisie) a appelé à une grève générale, une première depuis 35 ans en Tunisie, tandis que le gouvernement organisait un simulacre de changement parmi des dirigeants de l’État en attendant les élections législatives de juin. A l’heure actuelle, la tension semble être retombée mais il est clair que la colère va continuer à gronder d’autant que la promesse d’un prêt à venir du Fonds monétaire international va impliquer de nouvelles mesures d’austérité drastiques.
En Égypte, la situation n’est pas meilleure. Le pays est en cessation de paiement. En octobre dernier, la Banque mondiale a publié un rapport qui exprimait son «inquiétude» devant la multiplication des grèves, avec un record de 300 pour la seule première moitié de septembre. La fin de l’année avait vu se dérouler de nombreuses manifestations anti-gouvernementales, en particulier autour du referendum organisé par les Frères musulmans pour légitimer leur pouvoir, mais c’est depuis le 25 janvier, jour du deuxième anniversaire du déclenchement de la «révolution égyptienne», que la contestation s’est amplifiée. Jour après jour, des milliers de manifestants ont dénoncé les conditions de vie imposées par le nouveau gouvernement et réclamé le départ de Morsi.
Mais c’est encore la colère face à la répression qui a mis le feu aux poudres. En effet, l’annonce le 26 janvier de la condamnation à mort de 21 supporters du club al-Masry de Port-Saïd impliqués dans le drame de fin de match du 1er février 2012 (1) où 77 personnes avaient trouvé la mort, a été le prétexte à cette flambée de violence. Les manifestations pacifiques auxquelles avait appelé le Front du Salut National, la principale force d’opposition, ont donné lieu à des scènes de guérilla urbaine. Le soir du 1er février, place Tahrir et devant le palais présidentiel, des milliers de manifestants se sont livrés à une bataille rangée avec les forces de l’ordre. Le 2 février encore, ils étaient plusieurs milliers à jeter des pierres et des cocktails-Molotov contre l’enceinte du bâtiment. En une semaine, les émeutes violemment réprimées se sont soldées par plus de 60 morts, dont 40 à Port-Saïd. Une vidéo montrant un homme nu, battu par des policiers, n’a fait qu’aviver la colère déjà grande des manifestants.
Malgré le couvre-feu instauré par le régime, des manifestations avaient lieu dans trois villes situées sur le canal de Suez. Un manifestant déclarait: "Nous sommes dans les rues maintenant, car personne ne peut nous imposer sa parole (...) nous ne nous soumettrons pas au gouvernement."
Dans la ville d'Ismaïlia, outre les manifestations, des matches de football ont été organisés par les habitants pour défier le couvre-feu comme le durcissement du régime, et le siège des Frères musulmans était incendié.
Devant l’ampleur et la rage exprimée dans le mouvement, les policiers, craignant pour eux-mêmes, ont manifesté dans dix provinces le 12 février pour demander au gouvernement de ne pas les utiliser comme instruments de répression dans les troubles qui ébranlent le pays! Déjà, en décembre, nombre d’entre eux avaient refusé de s’affronter contre les manifestants au Caire et s’étaient déclarés opportunément «solidaires» de ces derniers.
… mais sans espoir…
Les leitmotivs qui peuvent s’entendre dans toutes ces manifestations sont: «Ennahda, dégage!» et «Morsi, dégage!», comme, il y a deux ans, on entendait «Ben Ali, dégage!» et «Moubarak, dégage!». Mais si, début 2011, l’heure était à l’espoir de changement, à l’ouverture d’une voie royale vers la liberté «démocratique», en 2013, l’heure est au désenchantement et à la colère. Cependant, au fond, s’exprime toujours la même illusion démocratique qui subsiste, ancrée fortement dans les esprits.. Celle-ci est entretenue par tout le battage idéologique actuel montrant du doigt le fanatisme religieux, présenté comme le grand responsable de la répression et des assassinats, ce qui masque en fait la continuité de l’appareil répressif de la bourgeoisie. C’est ce qu’on a vu de façon frappante en Égypte comme en Tunisie, où le pouvoir a réprimé sans vergogne, alors qu’il était impuissant jusqu’alors face aux grèves ouvrières parce que les illusions se paient et se paieront toujours plus dans des bains de sang. Après le départ des dictateurs «laïcs» sont venus les dirigeants religieux, qui tentent d’imposer «démocratiquement» une autre dictature, celle de la charia, sur laquelle tout est focalisé, mais il s’agit de la même: la dictature de la bourgeoisie et de son État sur la population, celle de l’exploitation forcenée de la classe ouvrière(2).
La même question se pose concernant la croyance en la possibilité de «changer la vie» en choisissant telle ou telle clique de la bourgeoisie. Car, comme on l’a encore vu récemment, ce sont aussi ces illusions-là qui ont fait le lit de la répression et de l’explosion de la violence étatique. Cela est particulièrement vrai dans ces pays conduits depuis des décennies par des fractions bourgeoises arriérées, maintenues à bout de bras par les pays développés, et dans lesquels aucune équipe de rechange avec une perspective viable, sinon les massacres de population, n’est possible. Il n’y a qu’à voir l’état de déliquescence des coalitions au pouvoir dans les deux pays, passant leur temps à se faire et se défaire, sans être en mesure de dessiner un programme économique à peu près crédible, la vitesse avec laquelle la situation de pauvreté s’est généralisée et accélérée, avec une crise agraire, donc d’alimentation, sans précédent. Ce n’est pas la question que les dirigeants seraient plus stupides qu’ailleurs, mais cela manifeste l’impasse complète dans laquelle se trouve la bourgeoisie de ces pays, qui n’a pas de marge de manœuvre, reflets de toute la bourgeoisie mondiale et du système capitaliste en entier qui n’ont aucune solution à offrir à l’humanité.
«Le peuple veut une autre révolution» criaient les jeunes chômeurs de Siliana. Mais si «révolution» veut dire changement de gouvernement ou de régime, en attendant d’être mangé tout cru par les nouveaux caciques au pouvoir, ou encore si cela signifie focalisation et combats de rue et affrontements contre telle ou telle fraction de la bourgeoisie, désorganisés face à des tueurs professionnels armés par les grandes puissances, ce n’est plus un leurre mais du suicide.
Il est significatif que si les populations égyptiennes et tunisiennes ont à nouveau relevé la tête c’est parce qu’en leur sein il existe une forte composante ouvrière, qu’on avait vu clairement s’exprimer en 2011 par une multitude de grèves. Mais c’est justement à elle qu’il revient de ne pas se laisser happer par toutes les illusions drainées par les anti-islamistes et/ou les pro- ou anti-libéraux de tout poil. La poursuite des grèves démontre en effet la force potentielle du prolétariat pour défendre ses conditions de vie et de travail et il faut saluer son immense courage.
… tant que la lutte ne se développera pas dans les pays centraux
Mais ses luttes ne pourront offrir une réelle perspective tant qu’elles resteront isolées. On avait assisté en 1979, en Iran, à une série de révoltes et de grèves ouvrières qui avaient aussi démontré la force des réactions prolétariennes mais qui, enfermées dans un cadre national faute de perspectives et d´une maturation insuffisante des luttes ouvrières au niveau mondial, avaient été étouffées par les illusions démocratiques et prises dans le carcan des affrontements entre cliques bourgeoises. C’est le prolétariat occidental, par son expérience et sa concentration, qui porte la responsabilité de donner une véritable perspective révolutionnaire. Les mouvements des Indignés en Espagne et des Occupy aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne se sont explicitement référés à la continuité des soulèvements en Tunisie et en Égypte, à leur immense courage et leur incroyable détermination. Le cri poussé lors du «printemps arabe», «Nous n’avons plus peur», doit effectivement être source d’inspiration pour tout le prolétariat mondial. Mais c’est seulement le phare de l’affirmation des assemblées ouvrières, au cœur du capitalisme, dressées contre les attaques du capitalisme en crise qui peut offrir une alternative permettant réellement le renversement de ce monde d’exploitation qui nous plonge toujours plus profondément dans la misère et la barbarie.
Il ne faut pas que la classe ouvrière minimise le poids réel dont elle dispose dans la société, de par sa place dans la production mais aussi et surtout dans ce qu’elle représente comme perspective pour toute la société et pour l’avenir du monde. En ce sens, si les ouvriers d'Égypte et de Tunisie ne doivent pas se laisser berner par les mirages de l’idéologie bourgeoise démocratique, il est de la responsabilité de ceux des pays centraux de leur montrer le chemin. C’est en Europe particulièrement que les prolétaires ont la plus longue expérience de confrontation à la démocratie bourgeoise et aux pièges les plus sophistiqués dont elle est capable. Il se doivent donc de cueillir les fruits de cette expérience historique et d’élever bien plus haut qu’aujourd’hui leur conscience. En développant leurs propres luttes, en tant que classe révolutionnaire, ils briseront l’isolement actuel des luttes désespérées qui secouent nombre de régions à travers la planète et redonneront ainsi l’espoir de la possibilité d’un nouveau monde à toute l’humanité.
Wilma/15.01.2013
1)Lire notre article sur notre site web : fr.internationalism.org/./drame_a_port_said_en_egypte_une_provocation_ policiere_pour_baillonner_la_revolte_populaire.html
2) Lire notre article sur notre site web : fr.internationalism.org/./egypte_un_changement_de_regime_n_est_pas_une _revolution
Rubrique:
L'internationalisme comme réponse à la problématique kurde: le nationalisme ne peut jamais être à la base d'une société sans classes
- 1638 reads
Début août 2012, une Rencontre internationale anarchiste s’est tenue dans la commune de St Imier (Jura suisse). Un des conférenciers était le porte-parole de Fekar (1). L'initiative de lui donner la parole a été prise par le groupe suisse du Forum des anarchistes germanophones, qui s'efforce de réunir les anarchistes turcs/kurdes dans une seule fédération.
Selon le conférencier, le PKK (Parti ouvrier kurde, un parti avec des origines maoïstes et staliniennes, en kurde: Partiya Karkerên Kurdistan) «serait arrivé à la conclusion, fin des années quatre-vingt-dix, que même si les Kurdes n'ont pas encore leur propre État, des problèmes avec l'autorité dans leur propre mouvement se posaient déjà, problèmes qui correspondent à ceux au sein d'un État. Le PKK s'est dès lors éloigné d'une «orientation prolétarienne» et d'un modèle d'un État national indépendant avec son propre gouvernement, et donc d'une forme d'État autoritaire. Il serait maintenant un modèle pour des formes de vie sociale «communalistes», dans lequel la liberté de la femme, mais également des «transsexuels» et fondamentalement de chaque individu est primordiale, dans lequel règne le respect des différences et où on vise à atteindre un bon équilibre écologique dans la nature.» Dixit le rapport synthétique d’un des participants (2). Jan Bervoets, un membre du comité de rédaction de la revue anarchiste aux Pays-Bas «Buiten de Orde» (en dehors de l'ordre), exprime ses réserves quant à la déclaration du porte-parole de Fekar. Il se demande si «Öcalan a été illuminé, ou si c'est plutôt l'adage «quand le renard prêche, prenez garde à vos poules» qui s'applique ici ». Mais en même temps, il laisse entendre que ce n'est pas totalement impossible que le PKK se développe réellement dans la direction d'une organisation avec des principes antiautoritaires et communalistes, dans lesquels l'individu est primordial: «Avons-nous tous ensemble vécu un moment historique, ou un tour d'illusionniste? L'histoire elle-même nous le dira. » Malgré les réserves exprimées ici, c'est une fois de plus le comble de la naïveté politique si souvent caractéristique de l'anarchisme, qui surgit. Le désir parmi les anarchistes de voir quelque part des expressions de principes anarchistes est si grand, qu'un spectre d'un principe anarchiste (antiautoritaire, communaliste, fédéraliste, la primauté de l'individu) est suffisant pour créer une ambiance de liesse chez beaucoup d'entre eux (ibid.).
À l'occasion de cette discussion dans le milieu anarchiste, un participant à la «journée d'été 2012» du CCI en Belgique nous a demandé quelle est la position du CCI par rapport aux développements récents au sein du PKK. Il ressort de la contribution ci-dessous que le PKK, quel que soit l'image positive qu'en trace le conférencier, n'a toujours rien à voir avec la lutte pour l'émancipation de l'humanité et sa libération du joug de la société de classes (3).
Les origines du P.K.K.
Le PKK a été fondé le 27 novembre 1978 au village Fis (Diyarbakir) par entre autre Abdullah Öcalan, Mazlum Dogan et 21 disciples. Son but était de mettre fin au «colonialisme» turc dans l'Est et le Sud-Est de la Turquie et la réalisation d'un État kurde indépendant et uni (4). Depuis sa création, Öcalan (apo) est le leader incontesté du PKK.
Au niveau idéologique, le PKK s'inspirait du maoïsme basé sur le stalinisme (ce que le conférencier invité à St Imier appelle «l'orientation prolétarienne»). D'une part, le pouvoir pouvait être conquis par le biais d'une armée de paysans et d'autre part, des alliés devaient être recherchés sur l'échiquier impérialiste du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, le PKK s'est déclaré prêt à utiliser tous les moyens, aussi terribles que certains actes puissent être. Le PKK a lancé une lutte armée, avec de nombreux attentats, également contre d'autres fractions kurdes. Certains insistent pourtant sur le fait que le PKK a rendu aux Kurdes turcs leur respect de soi et les a rendus conscients de leur identité kurde. De son côté, la Turquie, où la plus grande partie des Kurdes habite, s'est toujours opposée, malgré les promesses après la seconde guerre mondiale, contre toute forme d'autonomie et a joué la carte de l’assimilation. L'importance stratégique de la région, beaucoup plus encore que son importance économique, y a été déterminante. Les Kurdes étaient officiellement dénommés «Turcs des montagnes» et leur langue était classée comme un dialecte turc. Ils étaient tenus dans la pauvreté et devaient marcher au pas.

La guerre civile: champ de bataille de l'impérialisme mondial
Le 15 août 1984, des paysans kurdes, entraînés par le PKK, attaquaient des postes de police dans les villages Eruh (Siirt) et Şemdinli (Hakkâri), actions dans lesquelles deux agents turcs ont été tués. Ce fut le début de toute une série d'actions paramilitaires. Comme contre-attaque, les autorités turques ont décidé de recruter des milliers de Kurdes qui, en échange d'argent et d'armes, étaient postés comme gardes villageois contre le PKK.
En plus de leurs attentats contre les propriétaires fonciers, le PKK agissait sans pitié contre ces gardes villageois et contre tous les Kurdes qui montraient une quelconque sympathie avec l'autorité centrale turque. Le PKK a ainsi perdu la sympathie d'une partie de la population kurde, y compris celle d'autres fractions kurdes telle que celle de Massoud Barzani au Nord de l'Irak. La population du Kurdistan était donc prise en tenaille entre la guérilla du PKK d'une part et l'armée turque d’autre part. Dans ce conflit, le parti nationaliste, organisé sur des bases staliniennes, était également soutenu de façon stratégique par d'autres forces impérialistes dans la région qui l'utilisaient comme moyen de pression contre la Turquie.
Tout comme les autres partis bourgeois de gauche, le PKK se présentait à l’époque comme le défenseur du «socialisme». Grâce à la lutte armée contre le cruel gouvernement turque de l'époque, le PKK pouvait s'attirer une partie des ouvriers et des masses de pauvres qui étaient désespérés ou qui avaient des illusions, pour les entraîner dans une lutte nationaliste et impérialiste. En mars 1990, lors du Nouvel An kurde, des funérailles de membres du PKK abattus ont abouti à des manifestations massives.
Mais après l'effondrement du bloc russe en 1989 et l'effritement du bloc occidental rival, les cartes sur l'échiquier impérialiste étaient fortement secouées et le PKK perdait des anciens alliés. La Guerre du Golfe en 1991 en Irak avait ouvert la porte vers un «nouvel (dés) ordre mondial», dans lequel le nationalisme kurde était utilisé pour la énième fois comme appât pour recruter de la chair à canon. Dans le chaos croissant, avec le développement du «chacun pour soi», où toutes les puissances impérialistes, petites et grandes, veulent accroître leur influence dans l’importante région économique et stratégique du Moyen-Orient, le PKK continue à jouer sur les contradictions impérialistes dans la région, recevant le soutien de gouvernements tels que ceux de la Syrie, l'Iran, l'Irak, l'Arménie, la Grèce et d'autres pays impérialistes, y compris la Russie.
Pour survivre, le PKK devait changer son fusil d'épaule; il ne pouvait plus se présenter comme une formation purement maoïste-stalinienne. Et alors qu'au début des années 90, quelques trois mille guérilleros du PKK avaient conquis encore de fait le pouvoir dans l'Est de la Turquie, Öcalan devait chercher en même temps d'autres opportunités politiques afin de pouvoir se maintenir. À partir de ce moment, les confrontations militaires alternent avec des périodes de cessez-le-feu et de négociations. Un premier tournant est advenu au début des années 90, lorsque le président Turgut Özal a accepté de négocier. À part Özal, lui-même à moitié kurde, peu de politiciens turcs s'y intéressaient, pas plus qu'une partie du PKK lui-même, et après la mort du président, le 17 avril 1993, dans des circonstances suspectes, l'espoir d'une conciliation s'est évaporé. En juin 1993, Öcalan appelait de nouveau à la «guerre totale». D'autres épisodes ont suivi en 1995 et 1998 qui se sont soldés chaque fois par des échecs. Quand la lutte armée a pris des formes de plus en plus intenses, la Turquie a contraint la Syrie (pays dans lequel il s’était réfugié) à expulser Öcalan. Celui-ci a pris la fuite, mais a été finalement arrêté par des agents turcs le 15 février 1999. Il a été condamné à mort pour haute trahison, mais cette sentence, sous pression de l'Union Européenne (UE), a été commuée en réclusion perpétuelle. La Turquie avait en effet posé sa candidature à l'adhésion à l'UE et devait ainsi promettre d'améliorer la situation des Kurdes turcs au niveau des droits humanitaires. Depuis, Öcalan essaie de diriger son parti de la prison, à travers ses avocats. À partir d'août 1999, les guérilleros du PKK se retirent de la région et une série d'initiatives sont prises visant à élaborer le soi-disant «processus de paix et de démocratie».
Des manœuvres politiques pour cacher leur vraie nature
La stratégie pour conquérir leur place au sein de la bourgeoise dominante devait être modifiée, et après beaucoup de luttes (sanglantes) entre fractions au sein du mouvement, la carte de l'autonomie et du fédéralisme fut jouée afin de sortir de l'impasse politique. Le huitième Congrès du Parti PKK a approuvé le 16 avril 2002 cette soi-disant transformation «démocratique». Dès lors, il s’efforcerait d’obtenir la «libération» à travers des droits politiques pour les Kurdes en Turquie et renoncerait à la violence, bien que le leader de fait du PKK, Murat Karayilan déclarait encore en 2007 qu’un État indépendant reste toujours l'objectif principal de l'organisation. Lors de ce congrès, le PKK s'est transformé et une nouvelle branche politique a été créée, même si cela n'était qu'un acte purement tactique: le Congrès du Kurdistan pour la démocratie et la liberté (KADEK). Le PKK signalait à ce moment-là qu'il ne voulait poursuivre la lutte qu'avec des moyens démocratiques. Un porte-parole du PKK/KADEK déclarait cependant qu'il ne dissolverait pas sa branche armée, les Forces de défense du peuple (HPG), ni rendre ses armes pour des raisons de «légitime défense». L'organisation voulait maintenir sa capacité à effectuer des opérations armées afin de s'imposer comme partenaire à part entière dans les négociations. En avril, le KADEK élit sa direction mais les membres furent presque les mêmes que ceux du Conseil présidentiel du PKK. Le 15 novembre 2003, le KADEK est à son tour transformé dans une fraction encore plus «modérée», le Congrès du peuple du Kurdistan (KONGRA-GEL), dans une tentative de se rendre plus acceptable à la table des négociations et pour un mandat parlementaire.
Les négociations avec le gouvernement turc ne donnent pourtant pas les résultats escomptés, et Öcalan appelle en juin 2004 par le biais de ses avocats à reprendre les armes. Pour maintenir l'image démocratique, il s'empresse d'y ajouter qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre mais de «légitime défense». Entre 2004 et 2009, le PKK perpétra régulièrement des attentats et l'armée turque attaqua à plusieurs reprises les combattants du PKK dans le Nord de l'Irak. Ainsi, les deux parties ont maintenu la pression sur la chaudière.
En 2005, les nationalistes essaient dès à présent d'obtenir par voie légale une place au parlement turc. À cette fin, un parti pro-kurde soi-disant indépendant et large fut fondé, le Parti de la société démocratique (DTP), une organisation politique affiliée au PKK qui a envoyé plusieurs élus au parlement. Ce parti a cependant à son tour été interdit par les autorités turques en raison de ses liens étroits avec le PKK et a été remplacé en 2008 par le Parti pour la paix et la démocratie (BDP) pro-kurde (turc :Barış ve Demokrasi Partisi, kurde :Partiya Aştî û Demokrasiyê). Ce dernier est maintenant officiellement reconnu comme un parti social-démocrate. En 2009, il a participé pour la première fois aux élections municipales et il a remporté une large majorité dans le Sud-Est de la Turquie; depuis la dernière élection, 36 délégués siègent en tant qu'indépendants au parlement turc. Beaucoup de prisonniers du KCK (5) sont membres de ce parti.
Afin de couper l'herbe sous les pieds du PKK, le gouvernement turc entame en juillet 2009 une nouvelle contre-offensive, cette fois-ci présentée comme «démocratique»: le plan de réforme kurde. Les Kurdes recevraient leur propre radio-télévision publique, de nouveaux droits comme le droit à l’enseignement de la langue kurde, le droit aux noms de villages kurdes et les partis politiques kurdes pourraient participer à des voyages à l'étranger. Plus récemment, on essaie encore de gagner la sympathie des masses kurdes par des distributions charitables de nourriture, de frigos, de fours, etc…
Le chef du PKK, Öcalan, y répond de sa prison avec une nouvelle version de sa «feuille de route vers la paix» de 2003 (dont la publication ne sera pas autorisée par les autorités turques) (6). Le PKK annonce qu'il abandonnera la lutte armée et qu'il va envoyer des «brigades de la paix» à travers la frontière afin de soutenir la solution «démocratique» du conflit que le gouvernement turc a entamée. La première brigade, composée de 8 combattants du PKK et de 26 citoyens kurdes turcs qui avaient fui dans les années 90 en Irak, passe la frontière le 19 octobre à partir de l'Irak et est accueillie avec des drapeaux kurdes par des milliers de Kurdes turcs.
Désormais, les deux camps cachent leurs véritables intentions. Leurs intérêts capitalistes, nationalistes et impérialistes sont déguisés par un discours pacifiste et démocratique qui s'intègre mieux dans la nouvelle vision du monde. Les deux camps cherchent également à présenter des motifs religieux et à répondre ainsi à l'islamisme politique émergent, tel que l'appel d'Öcalan à former une alliance avec le mouvement islamiste turc autour de Gülen.
Mais c'est dans le contexte des nombreuses tensions dans la région du Moyen-Orient et des ravages de la crise économique mondiale que nous devons comprendre les efforts de la bourgeoisie turque et kurde, qui utilisent la «liberté» des Kurdes comme carte de négociation.
Que représentent l'autonomie kurde et le fédéralisme?
Alors que la stratégie du gouvernement de l'AKP (Parti de la justice et du développement) restait fondamentalement la même que celle des gouvernements précédents, sa tactique était nettement différente. Les représentants du mouvement kurde dans la politique turque furent ouvertement comblés d'intrigues et de faux gestes et en arrière-plan se sont tenues pendant trois ans des négociations avec des représentants du PKK en Europe dans la capitale norvégienne Oslo, tandis que le gouvernement poursuivait sa répression. Pendant ce processus, des milliers furent arrêtés dans les procès contre le KCK, des centaines de guérilleros kurdes furent tués alors qu'ils se retiraient pendant les «cessez-le-feu». Des manifestations furent sévèrement réprimées avec de nombreux blessés et plusieurs morts. La répression sociale fut encouragée dans les villes turques contre les Kurdes qui y habitaient, avec des tentatives de lynchage comme conséquence.
Les nationalistes du PKK ont répondu à la tactique du gouvernement AKP avec leur plan pour une autonomie démocratique pour la région. Au quatrième congrès du DTK (7) en août 2010 à Diyarbakir, la capitale officieuse du Kurdistan, le co-président Ahmet Turk a présenté le projet d'un Kurdistan libre et autonome par la création et la définition d'une autonomie au niveau juridique au sein de la constitution turque. Donc pas de séparatisme. En ce qui concerne la question historique de l'utilisation de la langue kurde, celle-ci doit être apprise à tous les groupes d'âge, de l'école primaire à l'université, localement et dans toutes les villes kurdes. Dans un Kurdistan libre et autonome, le kurde doit être la langue officielle, à côté du turc et des dialectes locaux. L'exploitation des ressources économiques dans les régions kurdes doit être entre les mains des dirigeants kurdes du Kurdistan libre et autonome. Il y aura également des représentants du Kurdistan libre et autonome dans le parlement turc afin de discuter de questions d'égalité de droits et de discussions connexes. Enfin, le Kurdistan libre et autonome doit avoir un drapeau qui diffère du drapeau de la République turque, à savoir un drapeau kurde avec ses propres logos et symboles qui sont basés sur l'histoire des Kurdes et du Kurdistan. Le débat évoluait dans la direction d'une Confédération des différentes régions kurdes dans la région. Selon le congrès, les peuples et les régions kurdes dans des pays tels que la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran appartiennent indéniablement au tissu du Kurdistan.
«Le modèle de l'autonomie démo-cratique est la solution la plus raisonnable, parce qu'il correspond le mieux à l'histoire et aux circonstances politiques dans lesquelles la Turquie se trouve. En effet, les Kurdes jouissaient d'un statut d'autonomie dans les frontières de l'Empire ottoman. D'où cette proposition qui ne se base pas sur le séparatisme. Au lieu de cela, nos peuples détermineront leur relation réciproque sur base de la libre volonté et l'union volontaire dans une patrie commune. Le modèle ne vise pas l'abolition de l'État, ni le changement des frontières. La Turquie démocratique et le Kurdistan autonome démocratique sont la formule concrète pour nos peuples pour se gouverner soi-même avec leur propre culture et identité, ainsi que leur droit de vivre librement. » (Déclaration de presse du PKK, 13.08.2010) (8).
Mais face à la répression incessante, il fallait encore renchérir et le 14 juillet 2011, le 5ème congrès kurde du DTK approuve une déclaration dans laquelle il déclare audacieusement et unilatéralement «l’autonomie démocratique» pour les Kurdes de Turquie, et appelle à ce qu'elle soit reconnue internationalement. La pression d'Ankara est intensifiée et le 24 juillet, le DTK annonce unilatéralement des élections dans 43 provinces. Le maire de Diyarbakir considéra ces élections comme un pas important vers l'autonomie. Bengi Yildiz, député parlementaire et délégué du BDP dans le DTK, a déclaré que la région autonome ne devait plus payer des impôts à Ankara.
Le récent sixième congrès du DTK, le 15 et 16 septembre 2012 à Diyarbakir, s'est tenu sous le slogan «de l'autonomie démocratique vers l'Unité nationale». La tâche principale était de renforcer les bases du PKK contre les tentatives des autorités turques de l'isoler et de l'affaiblir.
Le DTK devait devenir le parlement de tous ceux qui vivent au Kurdistan, Kurdes ou pas Kurdes. La situation en Syrie était également un point important à l’ordre du jour. Il ne faut pas oublier en effet que le PKK fait partie de l’Union des communautés du Kurdistan KCK, le proto-État du mouvement nationaliste kurde. Elle a quatre organisations militaires sœurs fortes dans la région: le PKK dans le Kurdistan turc, le Parti pour une vie libre du Kurdistan (PJAK) en Iran, le Parti pour de la solution démocratique du Kurdistan (PÇDK) en Irak et le Parti de l'union démocratique (PYD) en Syrie, qui récemment, avec l'accord tacite d'El Assad, a pris le contrôle de quatre villes (9).
Il ne ressort nulle part, ni des dix principes de la feuille de route du PKK en 2003 ou en 2009, ni de la déclaration du PKK en 2010, ni de la pratique du Kurdistan «autonome et libre» jusqu'à présent, que «le PKK se développe réellement en direction d'une organisation avec des principes antiautoritaires et communalistes, où l'individu est primordial». Pas d'illusions, camarades, la stratégie de la bourgeoisie kurde, dont le PKK en est un représentant majeur, consiste à s’intégrer dans l'État turc et à gouverner le Kurdistan turc en tant qu’appareil local de l'tat turc. Cette stratégie l’a contrainte à suivre au coup par coup les nombreuses sales manœuvres de son rival, ne serait-ce que pour pouvoir rester à la table des négociations. Les négociations de paix que le gouvernement turque AKP a entamées en janvier 2013, directement avec Öcalan ne sont qu'un pas de plus, logique dans ce processus. Ce qui n'empêche pas la poursuite des affrontements militaires entre les deux parties.
En effet, «Le PKK, même s'il n'a pas réussi à devenir un véritable État, agit comme l'appareil principal de la bourgeoisie nationaliste kurde en Turquie; il essaie de réaliser ses intérêts dans son domaine d'activité comme s'il était un véritable État et est tenu dans ses tentatives à compter sur le soutien direct ou indirect de tel ou tel État impérialiste dont les intérêts rivalisent avec ceux de l'impérialisme turc sur différents points. Alors que ses forces sont plus faibles que celles de l'État impérialiste turc, et ses intérêts plus limités, le PKK est dans ce cadre tout autant une partie intégrante de l'impérialisme mondial que l'État turc.» (Point 1 de la résolution adoptée par notre section en Turquie à propos des développements au Kurdistan, 02.2012, cf. note 3).
La bourgeoisie kurde veut survivre et pour cela, du capital doit être attiré vers la région. Sur ce terrain, la bourgeoisie kurde et la bourgeoisie turque ont des intérêts mutuels. Cela inclut également la transformation de la Turquie en un paradis de main d'œuvre à bon marché. Inutile de mentionner qu'une bonne partie sera composée de forces de travail kurdes qui travaillent déjà pour des salaires très bas dans de nombreux secteurs. La mise en œuvre de cette politique est déjà en pleine préparation au Kurdistan avec la nouvelle politique régionale des salaires minimaux. Les deux bourgeoisies ont donc intérêt dans une normalisation de la situation pour assurer la stabilité, notamment pour ne pas mettre en danger l'important projet stratégico-économique Nabucco (10). Mais le jeu pour répartir ces intérêts entre eux est joué très durement, à l'image du capitalisme impitoyable.
Y a-t-il une raison pour jubiler sur «la liberté de la femme qui serait primordiale» au sein du PKK?
Le PKK affirme qu'au sein de l'organisation, femmes et hommes sont traités de manière égale et que les femmes adhèrent au PKK sur une base volontaire. La question est de savoir si c'est un principe souhaitable, hérité de son «orientation prolétarienne», ou bien d'une illusion trompeuse.
Limitons-nous pour cet aperçu aux références des nombreux témoignages dans le livre 'PKK'da Semboller, Aktörler, Kadınlar' (Symboles, acteurs et femmes dans le PKK) (11) de Necati Alkan. Dans son livre, elle parle avec des centaines de femmes qui étaient dans les milices du PKK dans les montagnes du Sud-Est de la Turquie, à la frontière avec l'Irak, la Syrie et l'Iran. Selon le livre, la plupart d'entre elles ont fui l'oppression familiale et plus particulièrement le risque de mariage forcé ou de crime d'honneur dans les territoires kurdes traditionnels et dans la société turque. Elles se sont crues en sécurité. Mais contrairement à ce que notre conférencier Fekar affirmait, ces femmes témoignent aussi que dans les camps du PKK, elles ont été victimes de la violence masculine. Elles ont été enrôlées comme chair à canon dans les milices, endoctrinées idéologiquement, sans égard pour leur propre personnalité. Ensuite, quand elles ont voulu quitter le PKK, elles en étaient empêchées et contraintes à continuer à se battre dans ses rangs.
Nationalisme contre internationalisme
Ce texte vise à exposer l'hypocrisie et la pratique bourgeoise et nationaliste du PKK. Et il est illusoire de penser qu'une telle qu'organisation, qui, depuis sa fondation, ne s'est posée que des questions stratégiques et tactiques afin de conquérir sa place parmi les autres États-nations, et qui pour atteindre cette place a utilisé une terreur impitoyable envers tous et chacun (y compris contre les Kurdes eux-mêmes dans leur propre pays et dans les pays voisins), pourrait se transformer en une organisation internationaliste.
Dans l'ère actuelle du capitalisme, tous les mouvements ethniques qui luttent pour l'autodétermination ou la libération nationale, sont des mouvements réactionnaires. La participation ou le soutien à de tels mouvements reviennent à approuver les actions et les objectifs du capitalisme, parfois en collaboration ouverte avec les différentes forces impérialistes, sinon de façon déguisée. Comme le disait clairement Rosa Luxemburg au début du 20ème siècle, l'idée d'un «droit» abstrait à l'autodétermination nationale n'a rien à voir avec le marxisme, parce qu'elle occulte la réalité que chaque nation est divisée en classes sociales antagoniques. Si la formation de certains États-nations indépendants pouvait être soutenue par le mouvement ouvrier à une période où le capitalisme avait encore un rôle progressif à jouer, cette période a pris fin définitivement – comme Luxemburg a également montré – avec la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, la classe ouvrière n'a plus de tâches «démocratiques» ou «nationales» à remplir. Son unique avenir réside dans la lutte de classe internationale, non seulement contre les États nationaux existants, mais pour leur destruction révolutionnaire.
«Dans un monde désormais divisé et partagé en blocs impérialistes, toute lutte de «libération nationale», loin de constituer un quelconque mouvement progressif, se résume en fait à un moment de l'affrontement constant entre blocs rivaux dans lequel les prolétaires et paysans enrôlés, volontairement ou de force, ne participent que comme chair à canon.» (Plateforme du CCI, Le mythe contre-révolutionnaire de la libération nationale)
«Cela a encore une fois démontré, à la suite de toutes ces réformes et négociations, que la paix de la bourgeoisie ne peut qu'engendrer la guerre, que la solution de la problématique kurde ne saurait être le résultat d'un compromis avec l'État impérialiste turc, et que le PKK est en aucun cas une structure, loin de là, qui serait en mesure d'offrir quelque solution que ce soit. La question kurde ne peut pas être résolue dans la seule Turquie. La solution kurde ne peut être résolue par une guerre entre nations. La question kurde ne peut être résolue avec la démocratie. La seule solution de cette question réside dans la lutte unie des ouvriers kurdes et turcs avec les ouvriers du Moyen-Orient et du monde entier. La seule solution de la question kurde est la solution internationaliste. Seule la classe ouvrière peut porter haut la bannière de l'internationalisme contre la barbarie de la guerre nationaliste en refusant de mourir pour la bourgeoisie.» (Point 8 de la résolution adoptée par notre section en Turquie à propos des développements au Kurdistan, 0..2012 – voir note 3).
Rosa & Felix & Lac / 03.01.2013
1)Fekar: Fédération des associations kurdes en Suisse, www.fekar.ch/ [12]
2)https://www.vrijebond.nl/internationale-anarchistische-bijeenkomst-st-im... [13]
3)Voir aussi la résolution que la section du CCI en Turquie a adoptée à sa dernière conférence à propos des développements au Kurdistan: l'Internationalisme est la seule solution pour la question kurde! https://en.internationalism.org/icconline/201202/4676/internationalism-o... [14]
Voir pour d’autres sources de cet article également:
-Le Monde Diplomatique, 1 novembre 2007 archive cache PKK
-https://www.lenziran.com/2011/08/pkk-leader-murat-karayilan-exclusive-in... [15]
-https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10707935 [16]
-https://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=dtk-declares... [17]
4)Au cours des derniers siècles, les descendants du peuple kurde historique se sont dispersés sur différents États de la région: Iran, Irak, Turquie, Syrie, Arménie et Azerbaïdjan. Beaucoup d'entre eux ont en plus émigré vers des dizaines de pays à travers le monde.
5)KCK, l’Union des communautés du Kurdistans (Koma Civakên Kurdistan), le proto-État du mouvement nationaliste kurde. Techniquement parlant, il sert comme organe qui chapeaute tous les organes du PKK, tels que la formation politico-parlementaire Kongra-Gel (Congrès du peuple) et l'aile militaire HPG (Forces de défense du peuple, Hêzên Parastina Gel), le Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK) en Iran, le Parti pour une solution démocratique du Kurdistan (PÇDK) en Irak et le Parti de l'union démocratique (PYD) en Syrie; en plus de nombreux autres organes et organisations qui remplissent une fonction étatique.
6)La proposition de feuille de route (Road Map to Peace) est un document qui fait des propositions détaillées sur différents domaines du nouvel État qui doit être créé:
https://www.fekar.ch/index.php/en/english/88-abdullah-ocalans-three-phas... [18]
7)Pour compléter l'enchevêtrement d'organisations clandestines, semi-légales, licites et chapeautantes, liées ou sous le contrôle direct des idéologues nationalistes du PKK, il faut ici encore mentionner que le DTK, le Congrès populaire démocratique (en turc Demokratik Toplum Kongresi), une organisation chapeautant pro-kurde avec environ 850 délégués du monde politique, religieux, culturel, social et des ONG, jouera un rôle important dans les initiatives du PKK.
8)Déclaration de presse du PKK :
https://www.pkkonline.com/en/index.php?sys=article&artID=60 [19]
9)L'aile syrienne du parti a récemment, selon un accord non-officiel avec le gouvernement de Bashar ElAssad, conquis quatre villes au nord de la Syrie (des photos d'Öcalan et Bashar Assad ont été suspendues à divers endroits), alors que d'autres fractions de Kurdes en Syrie sont bien intentionnées envers l'opposition. Les Kurdes irakiens «indépendants» de Barzani essaient également de rompre le pouvoir du PKK-PYD. «Au début du conflit syrien, le PKK aurait conseillé à son allié syrien, le parti kurde PYD, de veiller à ce que les droits des Kurdes soient si possible étendus sous un nouveau gouvernement. Maintenant cependant, il semble que le gouvernement Assad qui se retrouve coincé, aurait retiré ses troupes des régions kurdes. «Le PYD contrôle depuis lors la région et garantit un minimum d'ordre public». Simultanément, le PKK a déplacé 1.500 combattants du Nord de l'Irak vers la région kurde en Syrie.» (https://ejbron.wordpress.com/2012/08/16/koerden-starten-groot-offensief-... [20])
«Le PYD tient cependant un double langage. Le parti doit son pouvoir actuel à Basjar al-Assad, qui a cédé des positions militaires aux combattants du PYD. Il est généralement admis qu'Assad a décidé de coopérer à cause de l'ennemi commun, la Turquie. Il pouvait être sûr que le PYD défendrait la frontière turque, et passait ainsi également le signal à Ankara de ne pas s'aventurer dans une intervention en Syrie. La chose la plus importante était que la coopération lui donnait la possibilité de se concentrer militairement sur les villes les plus importantes. (…) La montée en puissance de la sœur du PKK en Syrie, le PYD, est suivie avec méfiance, à la fois en Turquie et au Kurdistan irakien. Ankara craint que le Kurdistan syrien ne devienne le tremplin pour le PKK, qui opère actuellement surtout à partir du Kurdistan irakien, et a déjà menacé avec une intervention militaire. Le président irako-kurde Barzani a fait en sorte que le PYD ait été contraint de coopérer avec les autres partis kurdes, entre autres par l'entrainement militaire de jeunes kurdes syriens en Irak. Pour garder la pression, quelques six-cents de ceux-ci ont ensuite été cantonnés à la rivière frontalière entre les deux régions kurdes, et les parlementaires irako-kurdes ont déjà suggéré que les peshmergas, l'armée irako-kurde, pourrait intervenir en Syrie si cela s'avère nécessaire. Pour contrer le pouvoir du PYD, Barzani a organisé une rencontre entre les blocs kurdes et l'opposition syrienne organisée par la Turquie. La rencontre a pour but d'unifier l'opposition syrienne dans un seul front pour l'avenir de la Syrie. » (https://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3321328/2012/0... [21])
Voir aussi à propos de la Syrie : https://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-azadi/190712/syrie-les-kurdes-ont... [22]
10)https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabucco_gazoduc [23]
11)PKK’da Semboller, Aktörler, Kadinlar (Acteurs, Symboles et Femmes au sein du PKK) de Necati Alkan; https://www.kitapsarayi.nl/PKKda-Semboller-Aktoerler-Kadnlar-Necati-Alka... [24])
Rubrique:
La crise est-elle structurelle et peut-elle être contenue par une série de réformes et d'ajustements? (cycle de discussion sur la crise III)
- 1369 reads
«Karl Marx le disait déjà : L'État est de retour. Même les néo-libéraux purs et durs préconisent aujourd'hui la nationalisation.» Ainsi écrivait De Standaard au milieu de la crise, le 1er mars 2009. Des économistes et professeurs éminents, des dirigeants mondiaux veulent « moraliser » et réglementer l'économie depuis la nouvelle crise ouverte de 2009. L'ingérence de l'État et les nationalisations sont devenues presque monnaie courante dans tous les pays du monde : une vague de nationalisations a commencé en 2009 dans le secteur bancaire et l'industrie automobile aux États-Unis et la Grande-Bretagne. En Bolivie, Morales nationalise l'industrie du gaz, et au Venezuela Chavez fait de même avec le pétrole. La Russie nationalise en 2003 Yukos (exploitation pétrolière), la Hongrie est critiquée par l'UE en raison du contrôle excessif de l'État de l'industrie, des médias, des fonds des pensions, de la banque centrale, etc. Le Japon nationalise Tepco (distribution d'électricité), l'Argentine nationalise pour la deuxième fois en quelques années l'exploitation du pétrole. Les Pays-Bas nationalisent la banque ABN-Amro et pensent à re-nationaliser les chemins de fer, la Belgique et la France nationalisent la banque Dexia, l'Espagne de même,...
Thatcher, Reagan, Milton Friedman, l'école de Chicago, en bref le néo-libéralisme était l'épouvantail qui avait réduit la croissance économique en miettes. Mais il semblait que l'époque du néo-libéralisme était au bord de l'épuisement, écrivait Joseph Stiglitz dans Freefall. C'est ce qui donnait le ton pour ce qui est avancé depuis 2008 en chœur par tous les partis, mais surtout par la gauche et l'extrême-gauche : plus d'ingérence de l'État, plus de réglementation, plus de contrôle, plus de nationalisations.
Une poignée de déclarations : « Une banque étatique est un premier pas possible pour contrer la crise à court terme. » (De Bruyn, président Sp.a Rood, De Standaard 1/03/09) ; « … qu’une nationalisation complète du secteur financier est nécessaire. » (PSL, Alternative Socialiste, avril 2009) ; « Le PTB veut une banque publique » (PTB, Solidaire, 26/03/2009). « Le secteur bancaire dans son ensemble doit devenir propriété publique » (l'ultragauche aux Pays-Bas).
Ici se posent plusieurs questions :
- est-ce que la crise peut être contrée par l'ingérence de l'État (nationalisations) et un nouveau développement des forces productives mis en marche ?
- est-ce qu'une forte ingérence de l'État (nationalisations) peut garantir que la classe ouvrière soit épargnée ou au moins protégée ?
- Les expropriations (nationalisations) signifient quand même un affaiblissement de la propriété privée capitaliste. Par conséquent, « plus d'État » est progressif, une revendication que toute la classe ouvrière doit soutenir. Est-ce vrai ?
Est-ce que l'État à travers des nationalisations a jamais sorti le capitalisme du marasme?
Engels écrivait en 1878 :
« La période industrielle de haute pression, avec son gonflement illimité du crédit, aussi bien que le krach lui-même, par l'effondrement de grands établissements capitalistes, poussent à cette forme de socialisation de masses considérables de moyens de production qui se présente à nous dans les différents genres de sociétés par actions. Beaucoup de ces moyens de production et de communication sont, d'emblée, si colossaux qu'ils excluent, comme les chemins de fer, toute autre forme d'exploitation capitaliste. Mais, à un certain degré́ de développement, cette forme elle-même ne suffit plus; […] il faut finalement que le représentant officiel de la société́ capitaliste, l'État, en prenne la direction. La nécessité́ de la transformation en propriété́ d’État apparaît d'abord dans les grands organismes de communication : postes, télégraphes, chemins de fer. »
Mais il y ajoute :
« Car ce n’est que dans le cas où les moyens de production et de communication sont réellement trop grands pour être dirigés par les sociétés par actions, où donc l'étatisation est devenue une nécessité́ économique, c'est seulement en ce cas qu'elle signifie un progrès économique, même si c'est l'État actuel qui l'accomplit; qu'elle signifie qu'on atteint à un nouveau stade, préalable à la prise de possession de toutes les forces productives par la société́ elle-même. Mais on a vu récemment, depuis que Bismarck s'est lancé dans les étatisations, apparaître certain faux socialisme qui même, çà et là, a dégénéré en quelque servilité́, et qui proclame socialiste sans autre forme de procès, toute étatisation, même celle de Bismarck. Évidemment, si l'étatisation du tabac était socialiste, Napoléon et Metternich compteraient parmi les fondateurs du socialisme. Si l'État belge, pour des raisons politiques et financières très terre à terre, a construit lui-même ses chemins de fer principaux; si Bismarck, sans aucune nécessité́ économique, a étatisé́ les principales lignes de chemins de fer de la Prusse, simplement pour pouvoir mieux les organiser et les utiliser en temps de guerre, pour faire des employés de chemins de fer un bétail électoral au service du gouvernement et surtout pour se donner une nouvelle source de revenus indépendante des décisions du Parlement, - ce n'était nullement là des mesures socialistes, directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes. Autrement ce seraient des institutions socialistes que la Société́ royale de commerce maritime [...], la Manufacture royale de porcelaine et même, dans la troupe, le tailleur de compagnie […]. » (F. Engels, L’Anti-Dühring, Ch. II : Notions Théoriques, pp. 140-141)
Engels démontre que dans la période d'épanouissement du capitalisme, des nationalisations pouvaient avoir un caractère progressif (c'est-à-dire promouvoir le développement du capitalisme).
Mais il ajoute que beaucoup de nationalisations ne correspondaient pas à ce critère. Cette question est bien sûr parallèle avec le rôle progressif que l'État national jouait dans cette période de développement du jeune capitalisme.
Nous pouvons y revenir dans la discussion.
La transformation de la propriété des sociétés anonymes – qui de ce temps-là ne dépassaient pas les frontières de l'État-nation – en propriété de l'État était donc progressive. Le développement du capitalisme dans cette période de progrès était caractérisé par un transfert de propriété des capitalistes individuels à des sociétés à actions, et ensuite, selon les conditions, à la propriété de l'État. La concentration des forces productives dans les mains de groupes de capitalistes (ou de l'État) était alors un important pas en avant. Les signes de l'expansion de la production et de la concentration de la propriété étaient alors, en principe, l'État-nation unifié, dont la formation signifiait une amélioration en comparaison aux entités féodales fragmentées.
L'échelle de concentration de capital nécessaire pour le développement était dont un facteur crucial (le capital accumulé qui ne pouvait être accordé uniquement par l'attribution de crédit énorme). Et aussi l'intérêt général de la bourgeoisie nationale, sans laps dans une concurrence stérile.
Mais, rapidement, l'expansion de la production et la concentration de la propriété débordèrent les limites des Etats nationaux. Les grandes compagnies anonymes prirent de plus en plus un caractère international, créant à leur manière une division internationale du travail, et cela, en dépit de son caractère contradictoire, constituant une des contributions les plus importantes du capitalisme au progrès de l'humanité. Le caractère de plus en plus international de la production, commence alors à se heurter avec la division du monde en Etats nationaux. « L’État national », affirme le 1er Congrès de l'Internationale Communiste en 1919, « après avoir donné un élan vigoureux au développement capitaliste est amené à être trop étroit pour l’expansion des forces productives ».
Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente :
Personne ne prétendra que la nationalisation de l'industrie pétrolière au Mexique 1938, ou celle de l'Argentine ou de la banque Dexia en Belgique aujourd'hui sont advenues parce qu'économiquement parlant, leur gestion dépassait les limitations de la société (multinationale). Et personne ne verra un progrès économique dans la transformation de la propriété de ces multinationales déjà étendues, organisées mille fois mieux et bien plus puissantes que l'État mexicain, argentin, hongrois ou vénézuélien qui en acquiert la propriété. Une telle nationalisation, dit Engels, ne représente aucun progrès pour le capitalisme ou pour un développement des forces productives.
Les nationalisations commencèrent à changer de signification : dirigées chaque fois davantage contre la division internationale du travail croissante, elles constituèrent par conséquent, au lieu d'un progrès, une régression. Tandis que les nationalisations dans le passé étaient l'expression de la croissance et de l'expansion du capitalisme, actuellement, elles sont, au contraire, l'expression de la régression et de la décomposition chaque fois plus violente du système capitaliste.
Des nationalisations à caractère progressif ne sont donc plus possibles dans l’actuelle phase de décomposition du capitalisme.
La question de savoir si une forte ingérence de l'État (nationalisation) peut faire en sorte que la classe ouvrière soit épargnée, ou du moins protégé, ne saurait être répondue que par la négative.
Il ne s'agit plus de l'expansion des forces productives, mais de leur rétrécissement... avec une exception notable : celle de l'industrie de guerre. Depuis cette période, les nationalisations s'orientent sur la destruction des forces productives et des biens de consommation. Avant de disparaître de la scène historique, le capitalisme détruit une grande part de ce qu'il a créé lui-même : son magnifique appareil de production, le prolétariat moderne et la division internationale du travail, enchaînant chaque fois davantage les forces de production dans les limites des Etats nationaux.
Et nous constatons que depuis cette période qui a donné lieu à la première guerre mondiale, depuis que la survie de chaque nation dépend de sa capacité d'assurer sa position par la force et la violence (et à défendre sa place dans l'arène impérialiste) sur un marché mondial devenu trop étroit, l'économie capitaliste est devenu continuellement plus dépendante de son État. Dans le capitalisme en décadence, la tendance au capitalisme d'État est d'ailleurs devenue une tendance générale, universelle.
Ce que nous vivons aujourd'hui, depuis 2008, n'est donc point un changement radical dans la vision du rôle de l'État, mais au contraire la confirmation du rôle central que l'État joue pour éviter des catastrophes économiques. Ce rôle consiste à se réfugier derrière l'État afin de faire fonctionner une machine économique qui, spontanément, livrée à elle-même, s'est paralysée, coincée entre ses contradictions internes. C'est seulement en analysant les nationalisations et la tendance à « plus d’État » depuis 1914 comme faisant partie du processus de décomposition du capitalisme que nous pouvons comprendre leur véritable signification historique :
- la nationalisation de l'industrie de guerre dans tous les pays impliqués dans la Première Guerre mondiale;
- Avec le développement de la crise dans les années 1920, tous les régimes, le stalinisme, le fascisme, les démocraties se retrouvent dans une politique de nationalisations et d'ingérence accrue de l'État, comme le New Deal aux États-Unis en 1933, celui du Front populaire en France ou le Plan De Man en Belgique;
- Ensuite sont venus la nationalisation générale ou le contrôle étatique sur l'industrie de guerre dans les années de guerre 1940;
- Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, la politique de reconstruction est directement prise en charge par les États dans de nombreux pays, également à travers des nationalisations importantes de secteurs-clé de l'économie, y inclus dans l'Angleterre « libérale » et tout le bloc de l'Est nouvellement formé;
- Suit maintenant une période de guerre froide avec une course aux zones d'influence et la réorganisation de l'économie post-guerre. Cette période est également celle des décolonisations et est accompagnée d'une nouvelle série de nationalisations dans de nombreux pays;
- La nouvelle crise à partir des années 1970 est déjà mieux connue. Nous pouvons y revenir dans la discussion, et surtout sur la période du néo-libéralisme avec ses fausses contradictions.
Est-ce que les expropriations (nationalisations) signifient un affaiblissement du capitalisme ?
Il s’agit ici de la question de la propriété privée et de la propriété collective des moyens de production. L’affaiblissement de la propriété privée signifierait par conséquent un pas vers le « socialisme » et pour cette raison une revendication que la classe ouvrière doit soutenir.
Nationalisation ne signifie en aucune manière « propriété de la 'nation' », mais uniquement, exclusivement propriété de l'État. En d'autres termes : avec la « nationalisation », la propriété passe simplement des capitalistes individuels ou des compagnies capitalistes au « capitalisme collectif » (pour employer la formule d'Engels), c'est-à-dire l'État des capitalistes.
L'État bourgeois n'est « autre chose qu’une machine d’oppression d’une classe par une autre classe et cela autant dans la république démocratique que dans la monarchie » (Engels, préface à ‘La Guerre civile’ de Marx).
L'Etat est une institution née de la division de la société en classes ayant des intérêts irréconciliables, et sa fonction est de perpétuer cette division et avec elle «le droit de la classe possédante d’exploiter celle qui ne possède rien, et la domination de la première sur la seconde» (Engels). «L’État moderne n’est à son tour que l’organisation que cette société bourgeoise se donne pour défendre les conditions collectives extérieures du mode de production capitaliste, tant par les ouvriers que par les capitalistes individuels. L’État moderne, sous n’importe quelle forme, est en essence un outil capitaliste, l’État capitaliste, le capitaliste universel idéel.» (Friedrich Engels)
Les nationalisations ne sont pas du socialisme
En proclamant la possession privée des moyens de production comme la nature du capitalisme, on proclame en même temps qu'en dehors de cette possession privée, le capitalisme ne peut subsister. Le concept marxiste de la propriété privée des moyens de production, comme étant le fondement de la production capitaliste, semblait contenir l'autre formule : la disparition de la possession privée des moyens de production équivaudrait à la disparition de la société capitaliste, et donc est vue comme synonyme du socialisme. Or, le développement du capitalisme, ou plus exactement, le capitalisme dans sa phase décadente, nous présente une tendance plus ou moins accentuée mais également généralisée à tous les secteurs, vers la limitation de la possession privée des moyens de production, vers leur nationalisation.
La nature du capitalisme n’est pas donnée par la possession privée des moyens de production, qui n’est qu’une forme, propre à une période donnée du capitalisme, à la période du capitalisme libéral, mais dans la séparation entre les moyens de production et le producteur.
Ce qui donne un caractère capitaliste à la production, ce n'est pas la possession privée des moyens de production. La propriété privée et celle des moyens de production existaient aussi dans la société esclavagiste ainsi que dans la société féodale. Ce qui fait de la production une production capitaliste, c'est la séparation des moyens de production d'avec les producteurs, leur transformation en moyens d'acheter et de commander le travail vivant dans le but de lui faire produire de l'excédent, de la plus-value, c'est-à-dire la transformation des moyens de production perdant leur caractère de simple outil dans le processus de production, pour devenir et exister en tant que capital.
Le capitalisme c'est la séparation entre le travail passé, accumulé, entre les mains d'une classe, dictant et exploitant le travail vivant d'une autre classe. Peu importe comment la classe possédante répartit entre ses membres la part de chacun. Dans le régime capitaliste, cette répartition se modifie constamment par la lutte économique ou par la violence militaire.
A l'époque du capitalisme libéral, la forme sous laquelle existait le capital était essentiellement celle du capitalisme privé individuel.
« Possession privée des moyens de production = capitalisme » et « atteinte à la possession privée = socialisme » étaient des formules frappantes, mais n'étaient que partiellement vraies.
L'inconvénient ne surgit que lorsque la forme tend à se modifier. L'habitude prise de représenter le contenu par sa forme, parce que correspondant pleinement à un moment donné, se transforme en une identification qui n'existe pas, et conduit à l'erreur de substituer le contenu par la forme.
L'expropriation la plus poussée peut tout au plus faire disparaître les capitalistes en tant qu'individus jouissant de la plus-value, mais ne fait pas encore disparaître la production de la plus-value, c'est-à-dire le capitalisme.
« La grande différence entre le principe capitaliste et le principe socialiste de la production est celle-ci : les ouvriers trouvent-ils en face d’eux les moyens de production en tant que capital, et ne peuvent-ils en disposer que pour augmenter le surproduit et la plus-value au compte de leurs exploiteurs, ou bien, au lieu d’être occupés par ces moyens de production, les emploient-ils pour produire la richesse à leur propre compte. » (Marx)
Lac / mai 2012
Récent et en cours:
- Crise économique [26]
Rubrique:
Internationalisme no 358 - 2e trimestre 2013
- 1011 reads
Ecologie: piège, mystification et alternatives
- 1474 reads
Le livre « Le mythe de l'économie verte » (1), se présente comme une critique impitoyable de « l'économie verte », car il remet en cause bon nombre de solutions vedettes (le fracking par exemple) de cette soi-disant approche « alternative » : soit parce que celles-ci ne résolvent qu’un problème restreint, sans tenir compte de l’impact écologique destructif à long terme, soit parce que le remède se révèle plus terrible que le mal de par l'utilisation dans le cadre de « l’économie verte » de moyens qui mettent en marche des processus qui sont au moins autant, sinon encore plus polluant à moyen et à long terme.
Une critique apparemment dure de « l'économie verte » …
Dans le premier et le deuxième chapitre, la situation désastreuse est expliquée par le fait qu’on ne peut attendre aucune solution de la part du capitalisme parce que ce système considère la nature comme « un don gratuit » (2), qu’on peut utiliser à son gré.
Les auteurs essaient aussi de rechercher les racines de cette crise écologique et argumentent que celles-ci se trouvent dans l'expropriation du commons, les biens sociaux communautaires. Ils démontrent très minutieusement comment le capitalisme agit dans la dégradation de la nature et n’y porte un certain intérêt que quand elle peut être transformée en valeurs marchandes. Il en découle que tout ce à quoi le capitalisme touche en ce qui concerne la nature est voué à être saccagé ou détruit. Ils montrent enfin que « l'économie verte » elle aussi ne réussit pas à stopper les méfaits de la marchandisation de la nature, bien au contraire.
Avec des faits et des arguments à l’appui, ils décrivent comment toutes les solutions proposées déplacent seulement l'hypothèque qui pèse sur la société et essayent de rejeter la faute sur la population et « les citoyens ». Selon les auteurs, un des objectifs prioritaires est de réduire la consommation de pétrole et d’autres combustibles fossiles en tant que cause de pollution la plus importante qui doit être prise en main avec la plus grande urgence.
Ensuite, le livre porte essentiellement sur l'alternative écologique des commons - qui sont attaqués constamment par la libéralisation de l’économie - et sur l'échec évident du néolibéralisme en matière écologique. Quand il est question d'une nécessaire alternative, une critique est effectivement formulée par rapport au « socialisme réel » de l'USSR et des pays qui s’en inspirent, où la catastrophe écologique est flagrante à beaucoup d'endroits. (3) Mais dès qu›il est fait référence à Cuba, cette critique n’est soudainement plus valable. Cuba serait maintenant un exemple, le pays avec la plus petite empreinte écologique au monde, grâce sans doute à l'arrêt soudain des livraisons de pétrole après l'écroulement de l'USSR. Que Cuba a décimé l’essentiel de sa forêt subtropicale pour la culture de la canne à sucre au début des années 1960 et d'autres catastrophes écologiques, les auteurs apparemment n’en ont jamais entendu parler. Mais ce mythe-là a aussi depuis longtemps été dévoilé par des activistes cubains. (4)
… pour promouvoir la mystification « de la démocratie verte »
D'abord et avant tout, il faut dire que la science peut être une alliée de la classe ouvrière et plus largement de l'humanité. En outre, les études scientifiques qui peuvent se dégager aujourd’hui de la mainmise matérielle ou idéologique du capitalisme et de son sponsoring inévitable, sont plus que bienvenues. Pourtant la question se pose ici : Le livre explore-t-il effectivement jusqu’au fond la contradiction du système capitaliste en ce qui concerne « l'économie verte »? Une lecture attentive de l’ouvrage permet immédiatement de relever un certain nombre de contradictions dans l’argumentation.
D'une part, il est affirmé, de façon juste, que les solutions qui sont proposées par « l'économie verte », restent strictement dans le cadre de la possibilité de réaliser des profits. D'autre part, il est dit que les commons feraient exactement le contraire. Mais pour rendre aux biens sociaux communautaires tous leurs droits, l’aide d’une régulation par l’Etat (ou par des organes qui sont contrôlés ou promus par l'Etat, comme les syndicats) est pourtant invoquée. Etant donné que la suppression de l'exploitation capitaliste n'est en rien évoquée mais uniquement une autre régulation de la consommation, il s’agit en fait de demander le soutien à l'état bourgeois qui doit être réformé « écologiquement » pour mieux servir « les intérêts du peuple ». La présentation des régimes de Morales et de Chavez et du modèle par excellence Cuba comme des exemples d’une alternative, confirment cette logique d’une régulation de l'Etat, typique du « milieu gauchiste». Le fait que ces régimes soient non seulement totalitaires, mais aussi qu’ils aient réprimé plus d'une fois la protestation ouvrière avec violence- où des troupes ont été engagées à plusieurs reprises contre les usines en grève et les ouvriers agricoles- n'est pas mentionné.
Sur le plan des revendications, le livre est très ambigu : vanter les commons comme une action écologique créative alternative et en même temps quémander l'aide de l'Etat et des syndicats qui sont entièrement imbriqués dans la société capitaliste, c’est essayer de réconcilier l'eau et le feu. Ces derniers ne sont pas des acteurs neutres dans le contexte capitaliste: l'Etat garantit « l'ordre social global » et veille à ce que le système capitaliste puisse survivre, si nécessaire aux moyens d’élections démocratiques ou sinon par les armes. La structure syndicale s›occupe déjà depuis la première guerre mondiale de la discipline dans l'usine et ne vient jamais avec des exigences qui peuvent menacer l'intérêt national et le système. Les seuls qu’ils menacent sont les ouvriers, quand ils s’engagent dans une grève « sauvage » (comme récemment les ouvriers des sous-traitants de Ford-Genk en ont fait l’expérience).
Dans l’alternative des auteurs, ils avancent sans beaucoup de profondeur « une solution démocratique ». Mais qu›est-ce qu’une solution démocratique? Parfois elle semble se situer - selon les auteurs –à l’extérieur du capitalisme, à d’autres moments, elle semble devoir passer via des lois rapides car « le temps presse ». Pourtant ils ont eux-mêmes constaté auparavant que toutes les mesures « de l'économie verte » vont dans le sens du système et sont destructrices pour la nature. Il n'est pas clair avec quelles mesures ils vont renverser la tendance. D’un côté ils avancent quelques « succès », comme les cas d'autogestion en Argentine, au Mexique et en Grande-Bretagne, mais plus tard il apparait que ceux-ci ne sont que temporaires… Cela ressemble plutôt à des emplâtres sur une jambe de bois !
Les arguments avancés dans le livre ressemblent parfois à ceux de la partie « réformiste » du mouvement Occupy » et « Indignados » - (Democracia Real Ya - « une véritable démocratie maintenant» - en Espagne), qui par tous les moyens a essayé d’orienter le mouvement de protestation vers des objectifs concrets au sein du capitalisme, tandis qu’au sein de ces mouvements beaucoup de tendances prolétariennes se sont manifestées qui remettaient en question le système capitaliste.
D’autres alternatives sont énumérés: « l’ensemble des pays du Sud», le prolétariat écologique, « les citoyens » conscients, mais qui sont-ils, ces 99%? Ce qui frappe, c’est qu’aucun mot n’est soufflé à propos de la classe ouvrière. Existe-t’elle encore? Apparemment, pour les auteurs, elle ne compte pas. A la page192, ils affirment qu’un capitalisme vert fabrique des consommateurs à la place de « citoyens » ! « Aux citoyens conscients », il reviendrait dès lors la tâche d’empêcher la catastrophe écologique. La place centrale de la classe ouvrière dans le processus de production capitaliste a disparu. Seule reste l'indignation morale « du consommateur conscient », « du citoyen ». Toute protestation est de cette façon canalisée vers la sphère de la consommation, elle est retirée de celle de la production. Il devient ainsi impossible d’avoir une compréhension fine des rapports de production capitaliste et du rôle central de la classe ouvrière dans le renversement de ceux-ci.
Finalement, la critique radicale de l'économie verte apparaît n’être qu’un rideau de fumée pour faire avaler les recettes classiques de l’extrême-gauche: l'Etat, la « démocratie populaire», la réforme de la consommation comme une alternative au sein de la logique du /profit capitaliste.
Le marxisme propose-t-il une alternative ?
A la recherche d’alternatives en dehors du capitalisme où il sera mis fin à la production pour le profit (la valeur d'échange des marchandises) et où l’usage (la valeur d’usage) sera posée comme but, nous aboutissons nécessairement chez Marx et Engels.
Deux chercheurs académiques récents en particulier - John Bellamy Foster et Paul Burkett (4) - ont fourni une importante contribution sur la vision que Marx et Engels défendaient réellement concernant le rapport entre l’Homme et la Nature. Le résultat surprend agréablement au profit du marxisme. J. Bellamy Foster avait constaté que les Verts étaient fortement sous l’emprise du philosophe anglais Francis Bacon, un penseur matérialiste, qui était à la base de la fondation de la Royal Society of London (créée en 1660). Il a trouvé cela tellement remarquable qu’il a voulu investiguer plus loin. Par Bacon et sa vision matérialiste sur la nature, exprimée dans son travail « Novum Organum », il a abouti auprès des philosophes matérialistes et Epicure, en Grèce antique, et chez Lucrèce, dans la culture romaine antique. Via ce détour, il a « redécouvert » Marx (dont la thèse traitait d’Epicure). A partir de là, il a mis en évidence que « la critique verte » était au fond « idéaliste » et qu’elle attaquait de manière totalement infondée le marxisme pour son soi-disant « productivisme », sur la base d’une critique des positions de Staline et de beaucoup de partis et de groupes d’extrême-gauches. Son collègue P. Burkett menait une recherche complémentaire et apporta encore plus de données, venant surtout du Capital partie III, Théories au sujet de la plus-value, de Marx et de la Dialectique de la nature, de Engels. Mais par manque de place dans cet article, nous ne pouvons malheureusement pas développer ce point.
Le stalinisme a trahi à peu près tous les principes marxistes possibles : l'internationalisme prolétarien au profit de la patrie « socialiste », la violation de l'art et de la culture subordonnées à l'Etat tout-puissant, l’abandon du matérialisme historique en faveur du matérialisme vulgaire, la croissance monstrueuse de l’Etat au lieu de sa suppression, la mise de côté de l'analyse des rapports de production au profit de celle du mode de production. Cela leur a permis de promouvoir comme du « socialisme » leur système de production de plus-value - et donc d'exploitation. En fait, il s’agissait d’une forme de capitalisme d'état, étant donné que les rapports de production capitalistes continuaient à exister du fait même que la plus-value était réalisée globalement par l'Etat (la conception d’un « socialisme d'Etat » avait déjà été rejetée par Engels).
Dans les années du début de la révolution russe, on s'est basé minutieusement sur les avis de Marx & Engels au sujet de la nature. Lors du développement des nouveaux complexes industriels, il a été calculé quels dommages seraient causés à l’environnement et comment ceux-ci seraient compensés, e.a. par la création de parcs naturels, les zapovedniki (entre 1919 et 1929, 61 parcs naturels ont été créés avec une superficie totale de pas moins de 4 millions d’ha), dans lesquels les régions naturelles étaient protégées comme etaloni (modèles) pour pouvoir les comparer avec les terres cultivées (5). Lors de l'industrialisation forcée sous le stalinisme, les défenseurs de cette politique ont été liquidés au propre comme au figuré, avec toutes les conséquences qui s’en sont suivies pour l'environnement (6).
Au sein de la tradition marxiste, cela a signifié un sérieux coup pour la réflexion créative concernant la nature et l'équilibre écologique. À part Christopher Caudwell (7) et Amadeo Bordiga (8) (dans Le Fil du Temps), la réflexion sur le lien indissociable entre homme et nature s’est presque totalement arrêtée jusque dans les années 1980. Les communistes de gauche autour de Bordiga se basaient sur les idées de Engels concernant la suppression dans le socialisme de l'opposition entre la ville et la campagne: « La suppression de l'opposition entre la ville et la campagne n'est pas plus une utopie que la suppression de l'antagonisme entre capitalistes et salariés. Elle devient chaque jour davantage une exigence pratique autant du point de vue de la production industrielle que de la production agricole. Personne ne l'a défendue avec plus de force que Liebig dans ses ouvrages sur la chimie agricole, dans lesquels il demande que l'homme rende à la terre ce qu'il a reçu d'elle… … » (9). Ils posent aussi : « Nous nous trouvons là en plein dans le cadre des atroces contradictions que le marxisme révolutionnaire dénonce comme propre à la société bourgeoise aujourd’hui. Ces contradictions ne concernent pas seulement la répartition des produits du travail et les rapports qui en découlent entre les producteurs, mais elles s’étendent de manière indissociable à la répartition territoriale et géographique des instruments et des équipements de production et de transport, et donc des hommes eux-mêmes ; à aucune autre époque historique, peut-être, cette répartition n’a présenté des caractères aussi désastreux, aussi épouvantables…la lutte révolutionnaire pour la destruction des épouvantables agglomérations tentaculaires peut être ainsi définie : oxygène communiste contre cloaque capitaliste. Espace contre ciment » (Bordiga, p.124 et p. 155).
Pour l'humanité, il s’agit d’arrêter le Molloch du capitalisme par la révolution prolétaire, la seule qui peut et doit renverser ce système de production. Ce n’est qu’après qu’une autre logique peut se mettre en route qui rompe radicalement avec le principe du profit, qui exploite l'homme et la nature et menace de les détruire. Comme Caudwell l’a formulé : « D'ici le temps qu'une situation révolutionnaire mûrisse, il y aura une toute nouvelle superstructurequi existera de façon latente au sein de la classe exploitée, découlant de tout ce qu’elle a appris du développement des forces productives… C'est le rôle créatif des révolutions… La révolution prolétarienne est une conséquence de l'antagonisme croissant entre la superstructure bourgeoise et le travail prolétarien». Pour suivre ce chemin, nous avons besoin d’une analyse beaucoup plus radicale que celle qui nous est avancée par les auteurs du « mythe de l'économie verte ». Avec leurs arguments, on continue à rester prisonnier de la spirale descendante de la réflexion au sein des limites d’un système d'exploitation qui détruit tout.
JZ/6.12.12
(1) Anneleen Kennis & Matthias Lievens, « le mythe de l'économie verte », EPO, Anvers, 2012.
(2) Selon Adam Smith, économiste et père de la pensée économique capitaliste.
(3) 20% du territoire immense de l’ex-URSS est gravement pollué d’un point de vue écologique pour des générations entières.
(4) voir les contributions très intéressantes de l’activiste écologique cubain, Gilberto Romero, 'Cuba's environmental Crisis', Contacto, Magazine. (c) 1994-96 (c) 1994-96 et deux contributions critiques provenant du milieu anarchiste : Frank Fernández, 'Cuban Anarchism, the history of a movement', See Sharp Press Arizona 2001 en Sam Dolgoff 'The Cuban revolution, a critical perspective', Blackrose Books, Montreal 1976.
(5) John Bellamy Foster, 'Marx's Ecology', materialism and nature, Monthly Review Press, Nex York, 2000. Paul Burkett, 'Marx and Nature', a red and green perspective, St. Martins' press, New York, 1999.)
L'unique limite des deux chercheurs est que, même s’ils partent de points de vue matérialistes basés sur Marx & Engels, ils ne se sont pas référés dans la recherche de perspectives aux expériences effectives du mouvement ouvrier révolutionnaire, entre autre à l'héritage des communistes de gauche. Ceci ne réduit en rien la valeur d’une contribution qui permet la « réhabilitation » de l'analyse marxiste de l'homme & de la nature face aux falsifications staliniennes.
D’autres sources intéressantes à ce sujet sont : J. Grevin, Myth ou the Green Economy, in Revue Internationale 138, 2009 et le scientifique qui a imaginé le concept de la biosphère et qui a aussi souffert des poursuites staliniennes: Vladimir I. Vernadsky ; « The Biosphere », Moscow, 1926, reprint Copernicus-Springer Verlag, New York, 1997.
(6) Arran Gare dans 'Soviet Environmentalism', The Path not taken' in 'The Greening of Marxism', edited by Ted Benton, Guilford Press, New York London, 1996.
(7) Christopher Caudwell, Studies and further studies in a dying culture, Monthly Review Press, 1971, Men and Nature, pp151-2. Un marxiste critique qui est mort jeune pendant le guerre civile en Espagne.
(8) Amedeo Bordiga, in Espèce humaine et croûte terrestre, 341, Petite bibliothèque Payot, Paris 1978.
(9) Friedrich Engels, le problème du logement, SUN, Nijmegen.
Rubrique:
Face au poison de la division régionaliste et nationaliste: unité et solidarité ouvrière
- 1440 reads
Face à la crise généralisée catastrophique qui frappe son système, face au besoin croissant d’unité et de solidarité des prolétaires, la bourgeoisie cherche, par tous les moyens à distiller le poison de la division et de la confrontation, à nous entraîner sur le terrain obsolète de la compétition et de la concurrence, terrain indissociable du capitalisme lui-même. Par tous les moyens, la classe dominante cherche à pourrir l’esprit des prolétaires avec cette idée : “Vos intérêts sont ceux de telles ou telles fractions de la bourgeoisie.” Bien sûr, la bourgeoisie camoufle ceci en parlant des “intérêts supérieurs” de l’entreprise ou de la nation en général, comme si l’entreprise ou la nation n’existaient pas pour servir précisément les seuls intérêts de classe de nos exploiteurs.
Cette distillation du poison de la division a de nombreux visages. Ainsi nous assistons, depuis plusieurs années, à la montée en puissance des revendications régionalistes. En Espagne, tandis que les indépendantistes basques et catalans remportaient les élections locales, une manifestation monstre était organisée à Barcelone pour réclamer “une Catalogne indépendante (voir article).” De même, en Belgique, après la crise politique de 2010-2011 sur fond d’indépendantisme flamand, la Nieuw-Vlaamse Alliantie – Alliance néo-flamande – triomphait aux élections communales, notamment son chef de file, Bart De Wever, qui remportait haut la main un tas de communes dont la ville d’Anvers (voir article). Au Royaume-Uni, l’Écosse, région riche en ressources minières, organisera un référendum en 2014 à propos de son indépendance ! Dans une moindre mesure, en Italie, la puissante Ligue du Nord revendique, depuis des années, l’autonomie de la Padanie.
Partout, ces velléités indépendantistes s’accompagnent d’un discours écœurant dénonçant les ouvriers des autres régions qui, tels des vampires, suceraient le sang fiscal et économique des travailleurs locaux.
 La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement dans les médias de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs et cypriotes” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” !
La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement dans les médias de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs et cypriotes” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” !
Face à cette propagande nauséabonde, à ces préjugés bassement entretenus et cultivés, aux divisions, aux conflits des uns contre les autres, nous devons réaffirmer la nécessité de l’unité internationale de nos luttes.
Notre véritable force, c’est en effet la massivité de notre combat, l’union par-delà les secteurs, les races, les frontières et les nations. À un monde divisé et cloisonné par les intérêts privés du capital, ceux d’une classe d’exploiteurs arrogants, les fameux “1 %” dénoncés par les “Indignés”, nous devons opposer notre solidarité. Nous devons prendre conscience, nous qui travaillons dans des conditions de plus en plus inhumaines, que nous sommes tous les vraies victimes d’un système barbare à l’agonie. Face au chacun pour soi, nous devons nous rassembler, réfléchir et discuter ensemble, sur les moyens de défendre notre dignité et nos conditions de vie.
Internationalisme / 10 avril 2013
Rubrique:
Le lavage de cerveau nationaliste empêche une réaction unie
- 1439 reads
[1….]
2. La pression de la décomposition met en évidence les faiblesses de la bourgeoisie belge
(…) La division au sein des diverses fractions nationales exprime avant tout la pression croissante de la crise historique du capitalisme sur la cohésion de l’ensemble des bourgeoisies de la planète. De l’opposition entre Républicains et démocrates aux USA sur la politique à mener pour faire face à la dépression jusqu’aux oppositions entre les régions riches d’Italie du Nord ou d’Espagne (la Catalogne) (voir article) et les régions pauvres de ces pays, ou encore le surgissement dans des pays comme les Pays-Bas de fractions ouvertement anti-européennes, on peut constater que ces tensions s’exacerbent un peu partout. Dans ce cadre il est erroné de voir les tensions (sous-)nationalistes comme une «exception Belge»,
Ceci étant dit, il est également incontestable que la bourgeoisie belge est caractérisée par un manque évident d’homogénéité: depuis la création artificielle de l’État belge en 1830, des tensions existaient en son sein. Ces tensions entre fractions régionales se sont particulièrement développées depuis la première guerre mondiale et se sont exacerbées depuis l’ouverture de la crise historique à la fin des années 1960. Le dernier avatar de ces tensions a été la montée en puissance lors des dernières élections du parti autonomiste flamand NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie). Pendant les 18 mois de négociations interminables, suivant les élections fédérales de juin 2010, les diverses fractions se sont déchirées comme des loups enragés afin de se positionner le mieux possible pour assurer leur survie dans la lutte sans merci qui est engagée sur le marché mondial, perdant même de vue à certains moments que cette lutte fratricide risquait de les mener tous à leur perte.
Si la bourgeoisie belge est effectivement divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent, lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussent ces conflits au second plan et s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs. Il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités.
3. La bourgeoisie exploite ses faiblesses dans un battage nationaliste intense contre la classe ouvrière
L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend que la bourgeoisie belge utilise habilement ses divisions internes contre la classe ouvrière dans un double objectif:
3.1. Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’État dans celles-ci.
Face au risque de défaut de paiement, tous les états européens ont lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire. Ces plans dévoilent toutefois de plus en plus le rôle de l’État, ce pseudo ‘État social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Loin d’être un arbitre au-dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, «l’État démocratique» se manifeste ici pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.
Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour au contraire embobiner cette dernière dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions attisent précisément les oppositions entre régions et communautés afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe «l’État démocratique» dans un imbroglio institutionnel.
De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise historique du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’État et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouvernements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphones, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces «réformes de l’État» ont abouti aux résultats suivants:
-accroître l’efficacité de l’exploitation: la «responsabilisation» des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus «performants» que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux implémenter la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.
-accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous le couvert de réorganisation des structures de l’État;
-diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.
3.2. Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière.
Lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie -à travers en particulier de ses syndicats- se sert de l’intensification du battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie. Cela aussi c’est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.
Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-état wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années ’80, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel et Ford). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: «Ce que nous faisons-nous mêmes, nous le faisons mieux» est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée et récemment, ce sont les travailleurs d’Opel et de Ford qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le «combat de la Flandre pour les sauver».
Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leurs salaires et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants flamands et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser.
[4….]
5. Contexte et perspectives pour les luttes ouvrières
Le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompu depuis l’été 2008, a caché aux travailleurs la réalité de la crise et des enjeux et a créé des conditions difficiles pour leur mobilisation, pour leur lutte et surtout pour l’extension de celle-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. Il serait par ailleurs illusoire de penser que la bourgeoisie s’attachera à dissiper le brouillard dans la période actuelle. Bien au contraire, elle tend à exploiter un certain soulagement au sein de la classe ouvrière du fait que les tensions au niveau de la gestion de l’État belge semblent réglées pour jouer à présent la carte de la nécessaire «unité nationale» face aux marchés en appelant à une «solidarité nationale» pour «défendre notre pays» contre les attaques d’un «monde extérieur agressif» et pour «corriger les erreurs du passé». Pour la classe ouvrière en Belgique, la situation a été difficile ces dernières années et cela va encore rester difficile pendant une certaine période.
(…) Tous les éléments avancés dans ce rapport démontrent bien que le décalage avec la situation sociale dans les autres pays d’Europe est plus une question de perception et de prise de conscience qu’une réalité objective: la réalité économique et sociale en Belgique est tout à fait parallèle à celles de pays comme la France ou les Pays-Bas.
Aussi, la situation sociale peut évoluer très vite, comme l’ont illustré le «printemps arabe» (…) en Tunisie et en Égypte et les mouvements des «Indignés» en Espagne ou «Occupy» aux États-Unis.
Ces mouvements depuis 2011, aussi limités qu’ils soient encore, révèlent une sincère volonté de débattre collectivement, de réfléchir collectivement et de lutter ensemble, de tourner le dos à l’individualisme du capitalisme. Le fait que ces mouvements se développent au niveau international leur donne leur importance décisive. Ils indiquent que la classe ouvrière en Belgique peut très vite retrouver le chemin de la lutte. Et une fois en mouvement, elle peut très bien réagir avec encore beaucoup plus de combativité et de détermination qu’ailleurs. Sur ce plan là aussi, contrairement aux campagnes de la bourgeoisie, la Belgique n’est pas une exception.
Internationalisme/novembre 2011
Rubrique:
Internationalisme n° 359 - 3e trimestre 2013
- 998 reads
Syrie: guerre impérialiste ou solidarité de classe
- 921 reads
Irak, Afghanistan, Liban, Egypte, Syrie, les massacres ne cessent de s’étendre. L’horreur et la barbarie capitalistes se répandent, les morts s’amoncellent. Véritable génocide en marche que rien ne semble pouvoir arrêter, la guerre impérialiste gagne encore et toujours du terrain. Le capitalisme en pleine décadence et décomposition entraîne le monde dans un chaos et une barbarie généralisés(1). L’utilisation des armes chimiques comme en Syrie actuellement n’est malheureusement qu’un des instruments de morts parmi bien d’autres. Mais cette perspective de destruction de l’humanité n’a rien d’irrémédiable. Le prolétariat mondial ne doit pas rester indifférent devant autant de massacres et de guerres, produits d’un système en pleine putréfaction. Seul le prolétariat en tant que classe révolutionnaire peut mettre définitivement fin à cette généralisation de la barbarie capitaliste. Communisme ou barbarie, plus que jamais l’humanité est confrontée à cette seule alternative.
La population syrienne sacrifiée sur l’autel des intérêts impérialistes
Le lundi 21 août, une attaque à l’arme chimique a fait des centaines de morts près de Damas, la capitale syrienne. Sur toutes les chaînes de télévision, dans tous les journaux s’étalaient des images insupportables d’enfants, de femmes et d’hommes agonisants. La bourgeoisie, sans aucun scrupule, se saisissait de cette tragédie humaine pour défendre toujours et encore ses sordides intérêts. Le régime de Bachar el Assad, boucher parmi les bouchers, venait de franchir la ligne rouge. Car officiellement, pour la classe bourgeoise, on peut massacrer à tour de bras mais pas avec des armes chimiques. Ce qu’elle appelle dans son jargon des armes sales, qui seraient bien différentes selon elle des armes propres, tels des bombes et obus en tout genre ou encore comme des bombes atomiques lancées en 1945 par les américains sur Hiroshima et Nagasaki. Mais l’hypocrisie de la bourgeoisie ne connaît pas de bornes. Depuis la Première Guerre mondiale de 1914-1918 où les gaz toxiques ont été employés massivement pour la première fois, faisant plusieurs centaines de milliers de morts, cette arme chimique n’a jamais cessé depuis d’être produite, « perfectionnée » et employée. Les accords de façade quant à sa non utilisation, notamment après les deux guerres mondiales et dans les années 1980 n’étant que déclarations de principes, ne visant aucunement à être appliquées. Et tel fut le cas ! Bien des théâtres de guerre depuis cette époque ont connu l’utilisation de ce type d’armes. Au Nord Yémen de 1962 à 1967, l’Egypte employa sans vergogne le gaz moutarde. Dans la guerre Iran-Irak en 1988, des villes telle Halabja ont été bombardées à l’arme chimique faisant plus de 5.000 morts, sous l’œil bienveillant et complice de la ‘communauté internationale’, des Etats-Unis à la France, en passant par l’ensemble des membres de l’ONU ! Mais l’utilisation de ce type d’armes n’est pas l’apanage des petits pays impérialistes, ou des dictatures à la Bachar el Assad, comme voudrait nous le faire croire la bourgeoisie. L’utilisation la plus massive de l’arme chimique à ce jour, à côté des bombardements au napalm, fut l’œuvre des Etats-Unis pendant la guerre du Vietnam. Il s’agissait de déverser massivement de l’herbicide contaminé à la dioxine afin de détruire les rizières et les forêts. Il fallait tout raser et réduire la population vietnamienne et le Vietcong à la famine. Terres brûlées et désertifiées, population grillée et asphyxiée... voilà l’œuvre de l’action du capitalisme américain au Vietnam, qui aujourd’hui avec d’autres grandes puissances occidentales, telle la France, s’apprêtent à intervenir en Syrie pour y défendre prétendument la population. Depuis le début de cette guerre en Syrie, il y a eu plus de 100.000 morts et au moins un million de réfugiés dans les pays limitrophes. Au-delà des discours déversés à longueur de temps par l’ensemble des médias bourgeois, la classe ouvrière doit savoir quelles sont les véritables causes du déchaînement de la guerre impérialiste en Syrie.
En Syrie, c’est la société capitaliste décadente qui est responsable
La Syrie est actuellement au cœur du développement des tensions inter-impérialistes et du chaos qui s’étend depuis l’Afrique du Nord jusqu’au Pakistan. Si la bourgeoisie syrienne s’affronte dans la guerre au sein d’un pays maintenant en ruines, elle peut s’appuyer pour continuer son jeu de massacre sur l’appétit insatiable de bon nombre d’impérialismes de tout acabit. Dans la région, l’Iran, le Hezbollah libanais, l’Arabie saoudite, Israël, la Turquie..., tous sont impliqués plus ou moins directement dans ce conflit sanglant. Les plus puissants impérialismes du monde y défendent également leurs plus sordides intérêts. La Russie, la Chine, la France, l’Angleterre et les Etats-Unis participent eux aussi à la propagation de cette guerre et à son extension dans l’ensemble de la région. Devant leur impuissance croissante à contrôler un tant soit peu la situation, ils y sèment encore plus le chaos et la destruction, suivant parfois cette vieille stratégie de la terre brûlée (« si je ne peux dominer cette région, qu’elle brûle »).
Durant la guerre froide, cette période qui va officiellement de 1947 à 1991 et la chute de l’URSS, deux blocs s’opposaient, l’Est et l’Ouest, avec à leur tête respectivement la Russie et les Etats-Unis. Ces deux super-puissances dirigeaient d’une main de fer leurs « alliés » ou « satellites », contraints à l’obéissance face à l’ogre ennemi. Le terme qualifiant cet ordre mondial s’appelait la discipline de bloc. Cette période historique fut lourde de danger pour l’humanité, puisque si la classe ouvrière n’avait pas été en mesure de résister, même passivement, à l’embrigadement idéologique guerrier, une troisième conflagration mondiale aurait été possible. Depuis l’effondrement de l’URSS, il n’y a plus de blocs, plus de risque d’une troisième guerre mondiale généralisée. Seulement, la discipline de bloc aussi a volé en éclats. Chaque nation joue depuis sa propre carte, les alliances impérialistes sont de plus en plus éphémères et de circonstance... ainsi, les conflits se multiplient sans qu’aucune bourgeoisie ne puisse finalement rien contrôler. C’est le chaos, la décomposition grandissante de la société.
Ainsi, l’affaiblissement accéléré de la première puissance impérialiste mondiale, les Etats-Unis, participe activement de l’enfoncement de tout le Moyen et Proche-Orient dans la barbarie. Au lendemain de l’attaque chimique aux alentours de Damas, les bourgeoisies française et anglaise, suivies beaucoup plus timidement par la bourgeoisie américaine, ont déclaré de manière tonitruante qu’un tel forfait ne pouvait rester impuni. La réponse militaire était imminente et serait proportionnelle au crime qui venait de se produire. Seulement voilà, la bourgeoisie américaine et certaines bourgeoisies occidentales dans son sillage, viennent de connaître deux revers retentissants dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak, pays en totale décomposition. Comment intervenir en Syrie sans se retrouver dans la même situation ? Mais plus encore, ces bourgeoisies ont à faire avec ce qu’elles appellent l’opinion publique, au moment même où la Russie envoie de nouveaux bateaux de guerres dans la région. La population ne veut pas de cette intervention ! Elle ne croit plus majoritairement aux mensonges de sa propre bourgeoisie. L’opinion publique défavorable à cette intervention, y compris sous la forme de bombardements limités dans le temps, pose un problème aux bourgeoisies occidentales.
Voici ce qui a finalement contraint la bourgeoisie anglaise à renoncer à intervenir militairement en Syrie, au prix de désavouer elle-même ses premières déclarations va-t-en-guerre ! C’est aussi la preuve que la bourgeoisie occidentale n’a pas de « bonne solution », que des mauvaises : soit elle n’intervient pas (comme vient de le choisir la Grande-Bretagne) et alors c’est un immense aveu de faiblesse ; soit elle intervient (comme cela semble se dessiner vraisemblablement pour les Etats-Unis et la France) et alors elle n’en retirera rien d’autre que toujours plus de chaos, d’instabilité et de tensions impérialistes incontrôlables.
Seul le prolétariat peut, en détruisant le capitalisme, venir à bout de la barbarie
Le prolétariat ne peut pas rester indifférent à toute cette barbarie. Ce sont des exploités, des familles entières qui se font massacrer, pourchasser par toutes les cliques impérialistes. Chiites ou sunnites, laïcs ou druzes... il n’y a de ce point de vue aucune différence. La réaction humaine et saine est de vouloir faire quelque chose, « tout de suite », d’arrêter ces crimes abominables. C’est ce sentiment qu’exploitent les grandes démocraties pour chaque fois mener et justifier leurs offensives guerrières au nom de « l’humanitaire ». Et chaque fois, la situation mondiale empire. Il s’agit donc d’un piège.
La seule façon pour l’humanité d’exprimer sa véritable solidarité envers toutes ces victimes du capitalisme pourrissant, c’est de mettre à bas ce système qui produit toutes ces horreurs. Un tel bouleversement ne se fera effectivement pas en un jour. Mais si ce chemin est long, c’est le seul à mener réellement à un monde sans guerre ni patrie, sans misère ni exploitation. Car la classe ouvrière n’a pas de drapeaux nationaux à défendre. Le pays où elle vit est le lieu de son exploitation et pour certains dans le monde, le lieu de leur mort, broyés par les armes de la classe capitaliste. Il est de la responsabilité de la classe ouvrière d’opposer au nationalisme guerrier bourgeois son internationalisme. Aussi difficile que soit ce chemin, il est nécessaire et... possible ! La classe ouvrière d’aujourd’hui doit se rappeler que la Première Guerre mondiale n’a pas pris fin de par la bonne volonté des belligérants, pas plus que par la défaite de l’Allemagne. C’est la révolution prolétarienne qui y a mis fin et elle seule.
Tino/31.08.2013
1)Lire p.4 la partie de la résolution du XX° congrès du CCI sur les tensions impérialiste
Rubrique:
L'Egypte nous montre l'alternative: socialisme ou barbarie
- 1214 reads
Face à l'agitation sociale en Égypte, l'armée a prouvé qu'elle reste la fraction la plus à même d'assurer le pouvoir et la défense des intérêts globaux de la bourgeoisie nationale.
Partout dans le monde, le sentiment que l'ordre actuel des choses ne peut plus continuer comme avant grandit. Suite aux révoltes du "Printemps arabe", au mouvement des Indignados en Espagne et celui des Occupy aux Etats-Unis, en 2011, l'été 2013 a vu des foules énormes descendre dans la rue en Turquie et au Brésil.
Des centaines de milliers de personne, voire des millions, ont protesté contre toute sorte de maux: en Turquie c'était la destruction de l'environnement par un "développement" urbain insensé, l'intrusion autoritaire de la religion dans la vie privée et la corruption des politiciens ; au Brésil, c'était l'augmentation des tarifs des transports en commun, le détournement de la richesse vers les dépenses sportives de prestige alors que la santé, les transports, l'éducation et le logement périclitent – et encore une fois, la corruption des politiciens. Dans les deux cas, les premières manifestations ont rencontré une répression policière brutale qui n'a fait qu'élargir et approfondir la révolte. Et dans les deux cas, le fer de lance du mouvement n'était pas les "classes moyennes" (c'est-à-dire, en langage médiatique, n'importe quelle personne qui possède encore un emploi), mais la nouvelle génération de la classe ouvrière qui, bien qu'éduquée, n'a qu'une maigre perspective de trouver un emploi stable et pour qui vivre au sein d'une économie "émergente" signifie surtout observer le développement de l'inégalité sociale et la richesse répugnante d'une minuscule élite d'exploiteurs.
En juin et juillet, c'était encore au tour des Égyptiens de descendre par millions dans les rues, revenant à la Place Tahrir qui fut l'épicentre de la révolte de 2011 contre le régime Moubarak. Eux aussi étaient poussés par de vrais besoins matériels, dans une économie qui n'est pas tant "émergente" que plutôt stagnante ou en régression. En mai, un ancien ministre des finances, un des principaux économistes égyptiens, soulignait dans un entretien au Guardian, que "L'Egypte souffre de sa plus grave crise économique depuis la Grande Dépression. Dans ses effets sur les plus démunis, la situation économique du pays est la pire depuis les années 1930". Et l'article de continuer : "Depuis la chute de Hosni Moubarak en 2011, l'Egypte a connu une chute dramatique des revenus à la fois de l'investissement étranger et du tourisme, suivie par une chute de 60% dans les réserves de devises, un déclin de 3% de la croissance, et une dévaluation rapide de la livre égyptienne. Tout cela a causé une augmentation vertigineuse des prix de la nourriture et du chômage, et une pénurie de carburant et de gaz pour la cuisine (...) Actuellement, selon les chiffres du gouvernement égyptien, 25,2% des Égyptiens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23,7% ne sont que guère au-dessus".
Le gouvernement islamiste "modéré" dirigé par Morsi et les Frères musulmans (avec le soutien des islamistes "radicaux") s'est rapidement révélé tout aussi corrompu que l'ancien régime, alors que ses tentatives d'imposer une "moralité" islamique étouffante a provoqué, comme en Turquie, un ressentiment énorme parmi la jeunesse urbaine.
Mais alors que les mouvements en Turquie et au Brésil, qui en pratique sont dirigés contre le pouvoir en place, ont généré un véritable sentiment de solidarité et d'unité parmi tous ceux qui participaient à la lutte, la perspective en Égypte est bien plus sombre : celle de la division de la population derrière différentes fractions de la classe dominante, voire la descente dans une guerre civile sanglante. La barbarie qui a englouti la Syrie ne nous montre que trop clairement ce que cela pourrait être.
Le piège de la démocratie
On a affublé les événements de 2011 en Égypte et en Tunisie du nom de "révolution". Mais une révolution est autre chose que des manifestations des masses dans les rues – même si cela est un point de départ nécessaire. Nous vivons une époque où la seule révolution possible est mondiale, prolétarienne et communiste : une révolution non pas pour changer de régime mais pour démanteler l'Etat ; non pas pour une gestion plus "juste" du capitalisme, mais pour le renversement du rapport social capitaliste tout entier ; non pas pour la gloire de la nation mais pour l'abolition des nations et la création d'une communauté humaine planétaire.
Les mouvements sociaux que nous voyons aujourd'hui sont encore loin de la conscience d'eux-mêmes et de l'auto-organisation nécessaires pour créer une telle révolution. Certes, ce sont des pas dans cette direction, qui expriment un effort profond du prolétariat de se trouver, de retrouver son passé et son avenir. Mais ce sont des pas hésitants, qui pourront être facilement dévoyés par la bourgeoisie, dont l'idéologie est profondément enracinée et constitue un énorme obstacle dans les esprits des exploités eux-mêmes. La religion est certes un de ces obstacles idéologiques, un "opium" qui prêche la soumission envers l'ordre dominant. Mais encore plus dangereuse est l'idéologie démocratique.
En 2011, les masses dans la Place Tahrir exigeaient la démission de Moubarak et la "fin du régime". Et on a effectivement poussé Moubarak dehors – surtout après le surgissement d'une vague puissante de grèves à travers le pays, ajoutant une dimension de plus à la révolte sociale. Mais le régime capitaliste est plus que le simple gouvernement en place : au niveau social, c'est tout le rapport basé sur le travail salarié et la production pour le profit. Au niveau politique, c'est la bureaucratie, la police, et l'armée. Et c'est aussi la façade de la démocratie parlementaire, où régulièrement au bout de quelques années, on offre aux masses le choix d'une nouvelle bande d'escrocs pour les plumer. En 2011, l'armée – que beaucoup de manifestants croyaient "unie" au peuple – est intervenue pour virer Moubarak et organiser les élections. Les Frères musulmans, qui tiraient leur grande force des régions rurales les plus arriérées mais qui étaient également le parti le mieux organisé dans les centres urbains, ont gagné les élections et, depuis, ont fait la plus claire des démonstrations possibles que changer de gouvernement par les élections ne change rien. Et pendant ce temps, le véritable pouvoir est resté en place comme dans tant d'autres pays : celui détenu au sein de l'armée, la seule force réellement capable d'assurer l'ordre capitaliste sur le plan national.
Lorsque les masses se sont déplacées de nouveau vers la Place Tahrir en juin, elles étaient pleines d'indignation contre le gouvernement Morsi et contre la réalité quotidienne de leurs conditions de vie face à une crise économique qui n'est pas simplement "égyptienne" mais mondiale et historique. Malgré le fait que beaucoup d'entre eux ont pu voir le vrai visage répressif de l'armée en 2011, l'idée que "le peuple et l'armée ne font qu'un" était très répandue, et a trouvé une nouvelle vie lorsque l'armée a commencé à prévenir Morsi qu'il devrait écouter le peuple ou faire face aux conséquences. Quand Morsi a été renversé par un coup d'Etat militaire quasiment sans effusion de sang, les scènes de célébrations ont été importantes sur la Place Tahrir. Est-ce que cela veut dire que le mythe démocratique ne tient plus les masses ? Non : l'armée prétend agir au nom de la "vraie démocratie" trahie par Morsi, et promet d'organiser de nouvelles élections.
Ainsi le garant de l'Etat, l'armée, intervient de nouveau, afin d'empêcher que la colère des masses ne se retourne contre l'Etat lui-même. Mais elle le fait cette fois-ci au prix de divisions profondes qu’elle a semées au sein de la population. Que ce soit au nom de l'Islam ou de la légitimité démocratique du gouvernement Morsi, un nouveau mouvement de protestation est né, qui exige le retour du régime Morsi et qui refuse de travailler avec ceux qui l'ont démis. La réponse de l'armée fut rapide : un massacre impitoyable des manifestants devant le QG de la Garde républicaine. Il y a eu aussi des accrochages, dont certains mortels, entre des groupes rivaux de manifestants.
Le danger de guerre civile et la force capable de l'empêcher
Les guerres en Libye et en Syrie ont démarré avec des manifestations populaires contre les régimes en place. Mais dans les deux cas, la faiblesse de la classe ouvrière et la force des divisions tribales et sectaires ont fait que ces révoltes furent rapidement englouties par des conflits armés entre factions bourgeoises. Et dans les deux cas, ces conflits locaux ont immédiatement acquis une dimension internationale: en Libye, la Grande- Bretagne et la France, discrètement soutenues par les États-Unis, sont intervenues pour armer et "guider" les forces rebelles ; en Syrie, le régime Assad a survécu grâce au soutien de la Russie, de la Chine, de l'Iran, du Hezbollah et autres vautours du même acabit, alors que l'Arabie saoudite et le Qatar ont armé les rebelles avec le soutien plus ou moins ouvert de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans les deux cas, l'élargissement du conflit a accéléré la chute dans le chaos et l'horreur.
Le même danger existe en Egypte aujourd'hui. L'armée n'est absolument pas prête à lâcher le pouvoir. Pour l'instant, les Frères musulmans ont promis de réagir pacifiquement au coup d'Etat militaire, mais à côté de l'islamisme "pragmatique" d'un Morsi, il y a des factions plus extrêmes qui sont déjà adossées au terrorisme. La situation ressemble de manière sinistre à celle de l'Algérie après 1991, quand l'armée a renversé un gouvernement islamiste "porté par les urnes", provoquant ainsi une guerre civile sanglante entre l'armée et des groupes islamistes armés comme le FIS. Comme d'habitude, la population civile en avait été la principale victime: on a estimé le nombre de morts entre 50.000 et 200 000.
La dimension impérialiste est également présente en Egypte. Les États-Unis ont exprimé leur regret à propos du coup d'État militaire, mais leurs liens avec l'armée sont anciens et profonds, et ils n'aiment pas le moins du monde le type d'islamisme prôné par Morsi ou par Erdogan en Turquie. Les conflits qui s'étendent aujourd'hui depuis la Syrie vers l'Irak et le Liban pourraient également atteindre une Égypte déstabilisée.
Mais la classe ouvrière en Égypte est une force bien plus formidable qu'en Syrie ou en Libye. Elle a une longue tradition de luttes combatives contre l'État et ses syndicats officiels qui remonte au moins jusqu'aux années 1970. En 2006 et en 2007, des grèves massives se sont étendues à partir des usines textiles hautement concentrées, et cette expérience de défiance ouverte envers le régime a alimenté le mouvement de 2011, fortement marqué par l'empreinte de la classe ouvrière à la fois dans ses tendances à l'auto-organisation qui sont apparues sur la Place Tahrir et dans les quartiers, comme dans la vague de grèves qui ont finalement convaincu la classe dominante de se débarrasser de Moubarak. La classe ouvrière en Égypte n'est pas immunisée contre les illusions démocratistes qui imprègnent tout le mouvement social, mais il ne sera pas facile non plus pour les cliques bourgeoises de la convaincre d'abandonner ses intérêts de classe et de l'attirer dans le cloaque de la guerre impérialiste.
La capacité potentielle de la classe ouvrière de barrer le chemin à la barbarie se voit non seulement dans son histoire de grèves autonomes et d'assemblées générales, mais aussi dans les expressions explicites de conscience qui sont apparues dans les manifestations de rue : dans des pancartes qui proclament "Ni Morsi, ni les militaires !", ou "La révolution, pas un coup d'État !", ainsi que dans des prises de position plus directement politiques comme la déclaration des "camarades du Caire" publiée récemment sur le site libcom: "Nous voulons un avenir qui ne soit gouverné ni par l'autoritarisme minable et le capitalisme de copinage des Frères musulmans, ni par l'appareil militaire qui maintient sa poigne de fer sur la vie politique et économique, ni par un retour aux anciennes structures de l'ère Moubarak. Même si les rangs des manifestants qui descendront dans la rue le 30 juin ne sont pas unis autour de cet appel, il doit être le nôtre – cela doit être notre position parce que nous n'accepterons pas un retour aux périodes sanglantes du passé".(1)
Cependant, tout comme « le printemps arabe » a trouvé son véritable sens avec le soulèvement de la jeunesse prolétarienne en Espagne, qui a donné lieu à un questionnement bien plus profond de la société bourgeoise, la capacité de la classe ouvrière en Égypte de barrer la route à de nouveaux massacres ne pourra être réalisée qu'à travers la solidarité active et la mobilisation massive des prolétaires dans les vieux centres du capitalisme mondial.
Il y a cent ans, face à la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg rappelait solennellement à la classe ouvrière que le choix offert par un ordre capitaliste sur le déclin était entre le socialisme ou la barbarie. L'incapacité de la classe ouvrière de mener à bien les révolutions qui ont répondu à la guerre de 1914-18 a eu comme conséquence un siècle de véritable barbarie capitaliste. Aujourd'hui, les enjeux sont plus élevés encore, parce que le capitalisme s'est donné les moyens de détruire toute vie sur la terre entière. L'effondrement de la vie sociale et le règne des bandes armées meurtrières – c'est ça, le chemin de la barbarie qui est illustré par ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. La révolte des exploités et des opprimés, la lutte massive pour défendre la dignité humaine et un véritable avenir – c'est ça, la promesse des révoltes sociales en Turquie et au Brésil. L'Égypte se tient à la croisée des chemins de ces deux choix radicalement opposés, et dans ce sens il est symbolique du dilemme auquel est confrontée toute l'espèce humaine.
Amos/10.07.2013
1 https://libcom.org/forums/news/we-can-smell-tear-gas-rio-taksim-tahrir-29062013 [32]
Rubrique:
Manifestations au Brésil: la répression policière provoque la colère de la jeunesse
- 1159 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article de Revolução Internacional, organe de presse du CCI au Brésil.
Une vague de protestations contre l’augmentation du prix des transports collectifs se déroule actuellement dans les grandes villes du Brésil, particulièrement dans la ville de São Paulo mais aussi à Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Aracaju et Natal. Cette mobilisation rassemble des jeunes, étudiants et lycéens et dans une moindre mesure, cependant non négligeable, des travailleurs salariés et autonomes (prestataires de services individuels).
La bourgeoisie brésilienne, avec à sa tête le PT (Parti du Travail) et ses alliés, a insisté pour réaffirmer que tout allait bien. Et cela alors que la réalité perceptible montre qu’il existe de grosses difficultés pour contenir l’inflation au moment où sont adoptées des mesures de soutien à la consommation des ménages afin d’éviter que l’économie n’entre en récession. Sans aucune marge de manœuvre, la seule alternative sur laquelle elle peut s’appuyer pour contenir l’inflation consiste d’une part à augmenter les taux d’intérêt et de l’autre à réduire les dépenses des services publics (éducation, santé et aide sociale).
Ces dernières années, beaucoup de grèves ont éclaté contre la baisse des salaires et la précarisation des conditions de travail, de l’éducation et du système de soins. Cependant, dans la majorité des cas, les grèves ont été isolées par le cordon sanitaire des syndicats liés au gouvernement "pétiste" (dominé par le PT) et le mécontentement a été contenu afin qu’il ne remette pas en question la "paix sociale" au bénéfice de l’économie nationale. C’est dans ce contexte qu’intervient l’augmentation du prix des transports à São Paulo et dans le reste du Brésil : toujours plus de sacrifices pour les travailleurs afin de soutenir l’économie nationale, c’est-à-dire le capital national.
Sans aucun doute, les exemples de mouvements qui ont explosé de par le monde ces dernières années, avec la participation de la jeunesse, mettent en évidence que le capitalisme n’a pas d’autre alternative à offrir pour le futur de l’humanité que l’inhumanité. C’est pour cela que la récente mobilisation en Turquie a eu un écho aussi fort dans les protestations contre le coût des transports au Brésil. La jeunesse brésilienne a montré qu’elle ne veut pas accepter la logique des sacrifices imposée par la bourgeoisie et s’inscrit dans les luttes qui ont secoué le monde ces dernières années comme la lutte des enfants de la classe ouvrière en France (lutte contre le CPE en 2006), de la jeunesse et des travailleurs en Grèce, Egypte et Afrique du Nord, des Indignés en Espagne, des "Occupy" aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Une semaine de protestations et la réaction brutale de la bourgeoisie
Encouragées par le succès des manifestations dans les villes de Porto Alegre et de Goiânia, qui ont dû faire face à une forte répression et qui, malgré celle-ci, ont réussi à obtenir la suspension de l’augmentation du prix des transports, les manifestations à São Paulo ont commencé le 6 juin. Elles furent appelées par le Mouvement pour le libre accès aux transports (MPL, Movimento Passe Livre), groupe constitué majoritairement par des jeunes étudiants influencés par les positions de gauche, et aussi anarchistes, qui a vu une augmentation surprenante de ses adhérents pour atteindre entre 2.000 à 5.000 personnes. D’autres mobilisations intervinrent ensuite les 7, 11 et 13 juin. Dès le début, la répression fut brutale et s’est soldée par de nombreuses arrestations et de nombreux jeunes blessés. Il faut ici souligner le courage et la combativité des manifestants et la sympathie qu’ils ont suscitée rapidement dans la population, dès le début, à un point tel que cela a surpris les organisateurs.
Face aux manifestations, la bourgeoisie a déchaîné un niveau de violence peu commun dans l’histoire de mouvements de ce type, parfaitement pris en charge par les médias qui se sont empressés de qualifier les manifestants de vandales et d’irresponsables. Une personne haut placée dans la hiérarchie étatique, le procureur de justice Rogério Zagallo, s’est illustré publiquement en conseillant à la police de bastonner et tuer : "Cela fait deux heures que j’essaie de regagner mon domicile mais il y a une bande de singes révoltés qui bloquent les stations Faria Lima et Marginal Pinheiros. Quelqu’un pourrait-il informer la Troupe de Choc (Tropa de Choque : unité d’élite de la police militaire) que cette zone fait partie de ma juridiction et que s’ils tuent, ces fils de putes, c’est moi qui instruirai l’enquête policière (…). Comment ne pas avoir la nostalgie de l’époque où ce genre de choses se résolvait avec une balle en caoutchouc dans le dos de ces merdes".
En plus de cela, on a vu une succession de discours d’hommes politiques appartenant à des partis adversaires entre eux, comme le gouverneur d’État Geraldo Alckmin, du PSDB (parti de la social-démocratie brésilienne) et le maire de São Paulo, du PT, tous deux vociférant en défense de la répression policière et condamnant le mouvement. Une telle syntonie n’est pas commune, vu que le jeu politique de la bourgeoisie consiste typiquement à attribuer la responsabilité des problèmes qui se posent à la fraction de la bourgeoisie qui se trouve momentanément au pouvoir.
En réponse à la répression croissante et au rideau de fumée des principaux journaux, chaînes de télévision et radio, davantage de participants se sont réunis à chaque mobilisation, jusqu’à 20.000 personnes jeudi dernier, le 13 juin. La répression fut encore plus féroce et cela se traduisit par 232 arrestations et de nombreux blessés.
Il vaut la peine de souligner l’apparition d’une nouvelle génération de journalistes. Quoiqu’encore minoritaires, à travers une claire manifestation de solidarité, ils ont rendu compte des violences policières et, en même temps, en ont été les victimes. Conscients des manipulations toujours présentes dans les éditoriaux des grands médias, ces journalistes sont parvenus, d’une certaine manière, à faire percevoir que les actes de violence des jeunes sont une réaction d’autodéfense et que, certaines fois, les déprédations effectuées essentiellement contre des cabinets gouvernementaux et de la justice sont des manifestations non contenues d’indignation contre l’État. En plus de cela, des actes émanant de provocateurs, ceux que la police utilise habituellement dans les manifestations, ont également été rapportés.
La mise en évidence d’une série de manipulations qui constituait un démenti aux versions de source étatique officielle, des médias et de la police tentant de falsifier les faits, de démoraliser et criminaliser un mouvement légitime, eut pour effet de multiplier la participation des manifestants et d’augmenter le soutien de la population. En ce sens, il est important de souligner la grande contribution qu’a eue l’action sur les réseaux sociaux d’éléments actifs dans le mouvement ou sympathisant avec lui. Par peur que la situation devienne incontrôlable, certains secteurs de la bourgeoisie commencent à changer de discours. Les grandes entreprises de communication, dans leurs journaux et télévisions, après une semaine de silence sur la répression policière ont finalement fait état des "excès" de l’action policière. Certains hommes politiques, de la même manière, ont critiqué les "excès" sur lesquels ils promettent d’enquêter.
La violence de la bourgeoisie à travers son État, quel que soit son visage, démocratique ou "radical", a comme fondement la terreur totalitaire contre les classes qu’elle exploite ou opprime. Si avec l’État démocratique, cette violence n’est pas aussi ouverte que dans les dictatures et est plus cachée, de manière à ce que les exploités acceptent leurs conditions d’exploités et s’identifient à elles, cela ne signifie pas que l’État renonce aux méthodes de répression physique les plus variées et modernes lorsque la situation l’exige. Ce n’est donc pas une surprise si la police déchaîne une telle violence contre le mouvement. Cependant, comme dans l’histoire de l’arroseur arrosé, on a vu que l’accroissement de la répression n’a fait que provoquer une solidarité croissante au Brésil et même dans le monde, encore que de façon très minoritaire. Des mobilisations en solidarité sont déjà prévues en dehors du Brésil, principalement à l’initiative de Brésiliens vivant à l’étranger. Il faut dire clairement que la violence policière est dans la propre nature de l’État et que ce n'est pas un cas isolé ou un "excès" de démonstration de force par la police comme voudraient le faire croire les médias bourgeois et les autorités liées au système. En ce sens, il ne s’agit pas d’un échec des "dirigeants" et cela n’avance à rien de "demander justice" ou encore demander un comportement plus courtois de la police car, pour faire face à la répression et imposer un rapport de force, il n’existe pas d’autre moyen que l’extension du mouvement vers de larges couches de travailleurs. Pour cela, nous ne pouvons pas nous adresser à l’État et lui demander l’aumône. La dénonciation de la répression et de l’augmentation du prix des transports doit être prise en charge par l’ensemble de la classe ouvrière, en l’appelant à venir grossir les actions de protestation dans une lutte commune contre la précarisation et la répression.
Les manifestations, qui sont loin d’être terminées, se sont étendues à tout le Brésil et les protestations ont été présentes au début de la Coupe des Confédérations de football de 2013 qui fut marquée par les huées adressées à la présidente Dilma Rousseff, ainsi qu’au président de la FIFA, Joseph Blatter, avant le match d’ouverture du tournoi entre le Brésil et le Japon(1). Tous deux n’ont pu dissimuler à quel point ils furent incommodés par ces marques d’hostilité et ont abrégé leur discours afin de limiter la confusion. Autour du stade s’est aussi déroulée une grande manifestation à laquelle participèrent environ 1.200 personnes en solidarité avec le mouvement contre l’augmentation du coût des transports. Elles aussi furent fortement réprimés par la police qui blessa 27 personnes et en mit 16 en détention. Afin de renforcer encore la répression, l’État déclara que toute manifestation à proximité des stades durant la coupe des Confédérations serait interdite, sous le prétexte de ne pas porter préjudice à cet événement, à la circulation des personnes et véhicules, ainsi qu’au fonctionnement des services publics.
Les limites du mouvement pour la gratuité des transports et quelques propositions
Comme on le sait, ce mouvement s’est développé à l’échelle nationale grâce à sa propre dynamique et à la capacité de mobilisation des jeunes étudiants et lycéens contre l’augmentation des prix des transports. Cependant, il est important de prendre en compte qu’il a comme objectif, à moyen et long terme, de négocier l’existence d’un transport public gratuit pour toute la population et mis à disposition par l’État.
Et c’est exactement là que se situe la limite de sa principale revendication, vu qu’un transport universel et gratuit, cela ne peut exister dans la société capitaliste. Pour arriver à cela, la bourgeoisie et son État devraient accentuer plus encore le degré d’exploitation de la classe ouvrière et autres travailleurs, à travers une augmentation des impôts sur les salaires. Ainsi, il faut prendre en compte que la lutte ne doit pas être placée dans la perspective d’une réforme impossible, mais toujours dans celle de faire que l’État révoque ses décrets.
Actuellement, les perspectives du mouvement semblent dépasser les simples revendications contre l’augmentation des tarifs des transports. Déjà des manifestations sont prévues la semaine prochaine dans des dizaines de villes grandes et moyennes.
Le mouvement doit être vigilant vis-à-vis de la gauche du capital, spécialisée dans la récupération des manifestations pour les diriger vers des impasses, comme par exemple demander que les tribunaux de justice résolvent les problèmes et que les manifestants rentrent à la maison.
Pour que ce mouvement se développe, il est nécessaire de créer des lieux pour écouter et discuter collectivement les différents points de vue à propos de la lutte. Et cela n’est possible qu’au moyen d’assemblées générales avec la participation de tous, où est garanti indistinctement le droit de parole à tout manifestant. En plus de cela, il faut appeler les travailleurs salariés, les convier à des assemblées et à des actions de protestation car eux et leurs familles sont concernés par l’augmentation du prix des transports.
Le mouvement de protestation qui s’est développé au Brésil constitue un démenti cinglant à la campagne de la bourgeoisie brésilienne, soutenue en cela par la bourgeoisie mondiale, selon laquelle le Brésil est un "pays émergent" en voie de dépasser la pauvreté et de mettre en route son propre développement. Une telle campagne a été particulièrement promue par Lula qui est mondialement connu pour avoir prétendument tiré de la misère des millions de Brésiliens alors qu’en réalité sa grande réalisation pour le capital est d’avoir réparti des miettes parmi les masses les plus pauvres afin de les maintenir dans l’illusion et accentuer la précarité du prolétariat brésilien en général.
Face à l’aggravation de la crise mondiale et de ses attaques contre les conditions de vie du prolétariat, il n’y a pas d’autre issue que la lutte contre le capitalisme.
Revolução Internacional /16.06.2013
1)Les dépenses somptuaires de l’État et du gouvernement entreprises pour la préparation de la Coupe du Monde de football en 2014 et les JO de 2016 prévus au Brésil alimentent aussi la colère d’une grande partie de la population ainsi davantage pressurée (NdT).
Rubrique:
Les tensions impérialistes dans la phase de décomposition (extraits de la résolution sur la situation internationale, XXe congrès du CCI)
- 1094 reads
Nous publions ci-dessous la partie consacrée aux tensions impérialistes de la résolution sur la situation internationale adoptée lors du dernier congrès international du CCI. Cette résolution sera bientôt disponible dans son intégralité (1) comme le bilan de ce XX° congrès, sur notre site Internet internationalism.org [35].
1
Depuis un siècle, le mode de production capitaliste est entré dans sa période de déclin historique, de décadence. C’est l’éclatement de la Première Guerre mondiale, en août 1914, qui a signé le passage entre la “Belle Époque”, celle de l’apogée de la société bourgeoise, et “l’Ère des guerres et des révolutions”, comme l’a qualifiée l’Internationale communiste lors de son premier congrès, en 1919. Depuis, le capitalisme n’a fait que s’enfoncer dans la barbarie avec à son actif, notamment, une Seconde Guerre mondiale qui a fait plus de 50 millions de morts. Et si la période de “prospérité” qui a suivi cette horrible boucherie a pu semer l’illusion que ce système avait pu enfin surmonter ses contradictions, la crise ouverte de l’économie mondiale, à la fin des années 60, est venue confirmer le verdict que les révolutionnaires avaient déjà énoncé un demi-siècle auparavant: le mode de production capitaliste n’échappait pas au destin des modes de production qui l’avaient précédé. Lui aussi, après avoir constitué une étape progressive dans l’histoire humaine, était devenu un obstacle au développement des forces productives et au progrès de l’humanité. L’heure de son renversement et de son remplacement par une autre société était venue.
2
En même temps qu’elle signait l’impasse historique dans laquelle se trouve le système capitaliste, cette crise ouverte, au même titre que celle des années 1930, plaçait une nouvelle fois la société devant l’alternative: guerre impérialiste généralisée ou développement de combats décisifs du prolétariat avec, en perspective, le renversement révolutionnaire du capitalisme. Face à la crise des années 1930, le prolétariat mondial, écrasé idéologiquement par la bourgeoisie suite à la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23, n’avait pu apporter sa propre réponse, laissant la classe dominante imposer la sienne: une nouvelle guerre mondiale. En revanche, dès les premières atteintes de la crise ouverte, à la fin des années 1960, le prolétariat a engagé des combats de grande ampleur: Mai 1968 en France, le “Mai rampant” italien de 1969, les grèves massives des ouvriers polonais de la Baltique en 1970 et beaucoup d’autres combats moins spectaculaires mais tout aussi significatifs d’un changement fondamental dans la société: la contre-révolution avait pris fin. Dans cette situation nouvelle, la bourgeoisie n’avait pas les mains libres pour prendre le chemin d’une nouvelle guerre mondiale. Il s’en est suivi plus de quatre décennies de marasme croissant de l’économie mondiale, accompagné d’attaques de plus en plus violentes contre le niveau et les conditions de vie des exploités. Au cours de ces décennies, la classe ouvrière a mené de multiples combats de résistance. Cependant, même si elle n’a pas subi de défaite décisive qui aurait pu inverser le cours historique, elle n’a pas été en mesure de développer ses luttes et sa conscience au point de présenter à la société, ne serait-ce qu’une ébauche de perspective révolutionnaire. “Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s’affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l’histoire ne saurait pourtant s’arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l’ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de “gel”, de “stagnation” de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s’aggraver, l’incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l’ensemble de la société et l’incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l’immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société” (“La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste”, Revue internationale no 62). C’est donc une nouvelle phase de la décadence du capitalisme qui s’est ouverte depuis un quart de siècle. Celle où le phénomène de la décomposition sociale est devenu une composante déterminante de la vie de toute la société.
3
Le terrain où se manifeste de façon la plus spectaculaire la décomposition de la société capitaliste est celui des affrontements guerriers et plus généralement des relations internationales. Ce qui avait conduit le CCI à élaborer son analyse sur la décomposition, dans la seconde moitié des années 1980, c’était la succession d’attentats meurtriers qui avaient frappé de grandes villes européennes, notamment Paris, au milieu de la décennie, des attentats qui n’étaient pas le fait de simple groupes isolés mais d’États constitués. C’était le début d’une forme d’affrontements impérialistes, qualifiés par la suite de “guerres asymétriques”, qui traduisait un changement en profondeur dans les relations entre États et, plus généralement, dans l’ensemble de la société. La première grande manifestation historique de cette nouvelle, et ultime, étape dans la décadence du capitalisme a été constituée par l’effondrement des régimes staliniens d’Europe et du bloc de l’Est en 1989. Immédiatement, le CCI avait mis en avant la signification que cet événement revêtait du point de vue des conflits impérialistes : “La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux “partenaires” d’hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l’heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (...). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible” (Revue internationale no 61, “Après l’effondrement du bloc de l’Est, déstabilisation et chaos”) Depuis, la situation internationale n’a fait que confirmer cette analyse :
– 1re guerre du Golfe en 1991;
– guerre dans l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001;
– deux guerres en Tchétchénie (en 1994-1995 et en 1999-2000);
– guerre en Afghanistan à partir de 2001 qui se poursuit encore, 12 ans après;
– la guerre en Irak de 2003 dont les conséquences continuent de peser de façon dramatique sur ce pays, mais aussi sur l’initiateur de cette guerre, la puissance américaine;
– les nombreuses guerres qui n’ont cessé de ravager le continent africain (Rwanda, Somalie, Congo, Soudan, Côte d’Ivoire, Mali, etc.);
– les nombreuses opérations militaires d’Israël contre le Liban ou la Bande de Gaza répliquant aux tirs de roquettes depuis les positions du Hezbollah ou du Hamas.
4
En fait, ces différents conflits illustrent de façon dramatique combien la guerre a acquis un caractère totalement irrationnel dans le capitalisme décadent. Les guerres du XIXe siècle, aussi meurtrières qu’elles aient pu être, avaient une rationalité du point de vue du développement du capitalisme. Les guerres coloniales permettaient aux États européens de se constituer un Empire où puiser des matières premières ou écouler leurs marchandises. La Guerre de Sécession de 1861-65 en Amérique, remportée par le Nord, a ouvert les portes à un plein développement industriel de ce qui allait devenir la première puissance mondiale. La guerre franco-prussienne de 1870 a été un élément décisif de l’unité allemande et donc de la création du cadre politique de la future première puissance économique d’Europe. En revanche, la Première Guerre mondiale a laissé exsangues les pays européens, “vainqueurs” aussi bien que “vaincus”, et notamment ceux qui avaient eu la position la plus “belliciste” (Autriche, Russie et Allemagne). Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle a confirmé et amplifié le déclin du continent européen où elle avait débuté, avec une mention spéciale pour l’Allemagne qui était en 1945 un champ de ruines, à l’image aussi du Japon, autre puissance “agressive”. En fait, le seul pays qui ait bénéficié de cette guerre fut celui qui y était entré le plus tardivement et qui a pu éviter, du fait de sa position géographique, qu’elle ne se déroule sur son territoire, les États-Unis. D’ailleurs, la guerre la plus importante qu’ait menée ce pays après la seconde mondiale, celle du Vietnam, a bien montré son caractère irrationnel puisqu’elle n’a rien rapporté à la puissance américaine malgré un coût considérable du point de vue économique et surtout humain et politique.
5
Cela dit, le caractère irrationnel de la guerre s’est hissé à un niveau supérieur dans la période de décomposition. C’est bien ce qui s’est illustré, par exemple, avec les aventures militaires des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Ces guerres, elles aussi, ont eu un coût considérable, notamment du point de vue économique. Mais leur bénéfice est des plus réduits, sinon négatif. Dans ces guerres, la puissance américaine a pu faire étalage de son immense supériorité militaire, mais cela n’a pas permis qu’elle atteigne les objectifs qu’elle recherchait; stabiliser l’Irak et l’Afghanistan et obliger ses anciens alliés du bloc occidental à resserrer les rangs autour d’elle. Aujourd’hui, le retrait programmé des troupes américaines et de l’OTAN d’Irak et d’Afghanistan laisse une instabilité sans précédent dans ces pays avec le risque qu’elle ne participe à l’aggravation de l’instabilité de toute la région. En même temps, c’est en ordre dispersé que les autres participants à ces aventures militaires ont quitté ou quittent le navire. Pour la puissance impérialiste américaine, la situation n’a cessé de s’aggraver: si, dans les années 1990, elle réussissait à tenir son rôle de “gendarme du monde”, aujourd’hui, son premier problème est d’essayer de masquer son impuissance face à la montée du chaos mondial comme le manifeste, par exemple, la situation en Syrie.
6
Au cours de la dernière période, le caractère chaotique et incontrôlable des tensions et conflits impérialistes s’est illustré une nouvelle fois avec la situation en Extrême-Orient et, évidemment, avec la situation en Syrie. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à des conflits qui portent avec eux la menace d’un embrasement et d’une déstabilisation bien plus considérables.
En Extrême-Orient on assiste à une montée des tensions entre États de la région. C’est ainsi qu’on a vu au cours des derniers mois se développer des tensions impliquant de nombreux pays, des Philippines au Japon. Par exemple, la Chine et le Japon se disputent les îles Senkaku/Diyao, le Japon et la Corée du Sud l’île Take-shima- Dokdo, alors que d’autres tensions se font jour impliquant aussi Taiwan, le Vietnam ou la Birmanie. Mais le conflit le plus spectaculaire concerne évidemment celui opposant la Corée du Nord d’un côté et, de l’autre, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Prise à la gorge par une crise économique dramatique, la Corée du Nord s’est lancée dans une surenchère militaire qui, évidemment, vise à faire du chantage, notamment auprès des États-Unis, pour obtenir de cette puissance un certain nombre d’avantages économiques. Mais cette politique aventuriste contient deux facteurs de gravité. D’une part, le fait qu’elle implique, même si c’est de façon indirecte, le géant chinois, qui reste un des seuls alliés de la Corée du Nord, alors que cette puissance tend de plus en plus à faire valoir ses intérêts impérialistes partout où elle le peut, en Extrême-Orient, évidemment, mais aussi au Moyen-Orient, grâce notamment à son alliance avec l’Iran (qui est par ailleurs son principal fournisseur d’hydrocarbures) et aussi en Afrique où une présence économique croissante vise à préparer une future présence militaire quand elle en aura les moyens. D’autre part, cette politique aventuriste de l’État nord-coréen, un État dont la domination policière barbare témoigne de la fragilité fondamentale, contient le risque d’un dérapage, de l’entrée dans un processus incontrôlé engendrant un nouveau foyer de conflits militaires directs avec des conséquences difficilement prévisibles mais dont on peut déjà penser qu’elles constitueront un autre épisode tragique venant s’ajouter à toutes les manifestations de la barbarie guerrière qui accablent la planète aujourd’hui.
7
La guerre civile en Syrie fait suite au “printemps arabe” qui, en affaiblissant le régime d’Assad, a ouvert la boîte de Pandore d’une multitude de contradictions et de conflits que la main de fer de ce régime avait maintenue sous le boisseau pendant des décennies. Les pays occidentaux se sont prononcés en faveur du départ d’Assad mais ils sont bien incapables de disposer d’une solution de rechange sur place alors que l’opposition à celui-ci est totalement divisée et que le secteur prépondérant de celle-ci est constitué par les islamistes. En même temps, la Russie apporte un soutien militaire sans faille au régime d’Assad qui, avec le port de Tartous, lui garantit la présence de sa flotte de guerre en Méditerranée. Et ce n’est pas le seul État puisque l’Iran n’est pas en reste de même que la Chine: la Syrie est devenue un nouvel enjeu sanglant des multiples rivalités entre puissances impérialistes de premier ou de deuxième ordre dont les populations du Moyen-Orient n’ont cessé de faire les frais depuis des décennies. Le fait que les manifestations du “Printemps arabe” en Syrie aient abouti non sur la moindre conquête pour les masses exploitées et opprimées mais sur une guerre qui a fait plus de 100.000 morts constitue une sinistre illustration de la faiblesse dans ce pays de la classe ouvrière, la seule force qui puisse mettre un frein à la barbarie guerrière. Et c’est une situation qui vaut aussi, même si sous des formes moins tragiques, pour les autres pays arabes où la chute des anciens dictateurs a abouti à la prise du pouvoir par les secteurs les plus rétrogrades de la bourgeoisie représentés par les islamistes, comme en Égypte ou en Tunisie, ou par un chaos sans nom comme en Libye.
Ainsi, la Syrie nous offre aujourd’hui un nouvel exemple de la barbarie que le capitalisme en décomposition déchaîne sur la planète, une barbarie qui prend la forme d’affrontements militaires sanglants mais qui affecte également des zones qui ont pu éviter la guerre mais dont la société s’enfonce dans un chaos croissant comme par exemple en Amérique latine où les narcotrafiquants, avec la complicité de secteurs de l’État, font régner la terreur.
CCI
1) La question de l’impérialisme est le premier point traité par cette résolution. Viennent ensuite la destruction de l’environnement, la crise économique et enfin la lutte de classe.
Rubrique:
Mouvement social en Turquie: le remède à la terreur d’État n’est pas la démocratie
- 955 reads
Nous publions ci-dessous des extraits de la traduction d’un article réalisé par notre section en Turquie – une jeune section, à la fois dans l’histoire du CCI et du fait de l’âge de ses membres. En tant que révolutionnaires et partie de la génération qui a conduit la révolte, ces camarades se sont activement impliqués dans le mouvement. Nous encourageons nos lecteurs à se rendre sur notre site pour une lecture complète de cet article qui est à la fois un premier rapport “sur le vif” fourmillant de détails concrets sur la vie de ce mouvement et une première tentative d’analyse de sa signification. C’est ici ce dernier aspect que nous avons choisi de mettre particulièrement en lumière à travers notre choix d’extraits. Quelle est la nature de ce mouvement ? A quelle dynamique internationale participe-t-il ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Quelles perspectives laisse-t-il entrevoir ?... Voici autant de questions qui sont en effet au cœur des enjeux de la période actuelle et à venir.
Le mouvement a commencé contre l’abattage des arbres effectué en vue de détruire le parc Gezi de la place Taksim à Istanbul, et il a pris une ampleur inconnue dans l’histoire de la Turquie jusqu’à ce jour. (...) On ne peut comprendre le véritable caractère de ce mouvement qu’en le remplaçant dans son contexte international. Et vu sous cet angle, il devient clair que le mouvement en Turquie est en continuité directe non seulement avec les révoltes du Moyen Orient de 2011 – les plus importants d’entre eux (Tunisie, Égypte, Israël) eurent une empreinte très forte de la classe ouvrière – mais en particulier du mouvement des Indignés en Espagne et Occupy aux États-Unis, là où la classe ouvrière représentait non seulement la majorité de la population dans son ensemble mais aussi des participants au mouvement. Il en est de même de la révolte actuelle au Brésil et également du mouvement en Turquie, dont l’immense majorité des composantes appartient à la classe ouvrière, et particulièrement la jeunesse prolétarienne.
(…) Le secteur qui a participé le plus largement était celui nommé :“la génération des années 1990”. L’apolitisme était l’étiquette apposée sur les manifestants de cette génération, dont beaucoup ne pouvaient se souvenir de l’époque précédent le gouvernement AKP (1) Le Parti pour la justice et le développement, islamiste “modéré”, est au pouvoir depuis 2002 en Turquie. Cette génération, dont on disait qu’elle n’était pas investie dans les événements et dont les membres ne cherchaient qu’à se sauver eux-mêmes, a compris qu’il n’y avait pas de salut en restant seul et en avait assez des discours du gouvernement lui disant ce qu’elle devait être et comment elle devait vivre. Les étudiants, et particulièrement les lycéens, ont participé aux manifestations de façon massive. Les jeunes ouvriers et les jeunes chômeurs étaient largement présents dans le mouvement. Les ouvriers et les chômeurs éduqués étaient également présents.
Dans certains secteurs de l’économie où travaillent principalement des jeunes dans des conditions précaires et où il est habituellement difficile de lutter – particulièrement dans le secteur des services – les salariés se sont organisés sur la base des lieux de travail mais d’une façon qui transcendait chaque lieu de travail particulier et ils ont participé ensemble aux manifestations. On trouve des exemples d’une telle participation parmi les livreurs des boutiques de kebab, le personnel des bars, les travailleurs des centres d’appel et des bureaux. En même temps, le fait que ce genre de participation ne l’a pas emporté sur la tendance des ouvriers à aller aux manifestations individuellement a constitué une des faiblesses les plus significatives du mouvement. Mais cela a été typique aussi des mouvements dans d’autres pays, où la primauté de la révolte dans la rue a été une expression pratique du besoin de dépasser la dispersion sociale créée par les conditions existant dans la production et la crise capitalistes – en particulier, le poids du chômage et de l’emploi précaire.
Mais ces mêmes conditions, couplées aux immenses assauts idéologiques de la classe dominante, ont rendu difficile à la classe ouvrière de se voir en tant que classe et a contribué à renforcer l’idée chez les manifestants qu’ils étaient essentiellement une masse de citoyens individuels, des membres légitimes de la communauté “nationale”. Tel est le chemin contradictoire vers la reconstitution du prolétariat en classe, mais il ne fait pas de doute que ces mouvements sont un pas dans cette voie.
Une des principales raisons pour laquelle une masse significative de prolétaires mécontents de leurs conditions de vie ont organisé des manifestations avec une telle détermination se trouve aussi dans l’indignation et le sentiment de solidarité contre la violence policière et la terreur de l’État. Malgré cela, différentes tendances politiques bourgeoises ont été actives, essayant d’influencer le mouvement de l’intérieur pour le maintenir dans les frontières de l’ordre existant, pour éviter qu’il ne se radicalise et pour empêcher les masses prolétariennes qui avaient pris les rues contre la terreur étatique de développer des revendications de classe sur leurs propres conditions de vie. Ainsi, alors qu’on ne peut évoquer de revendication ayant emporté l’unanimité dans le mouvement, ce qui a généralement dominé celui-ci étaient les revendications démocratiques. La ligne appelant à “plus de démocratie” qui s’est formée autour d’une position anti AKP et, en fait, anti-Erdogan n’exprimait par essence rien d’autre qu’une réorganisation de l’appareil d’Etat turc sur un mode plus démocratique.
L’impact des revendications démocratiques sur le mouvement a constitué sa plus grande faiblesse idéologique. Car Erdogan lui-même a construit toutes ses attaques idéologiques contre le mouvement autour de cet axe de la démocratie et des élections ; les autorités gouvernementales bien qu’avec des monceaux de mensonges et de manipulations, ont répété à satiété l’argument selon lequel, même dans les pays considérés plus démocratiques, la police utilise la violence contre les manifestations illégales – ce en quoi elles n’avaient pas tort. De plus, la ligne visant à obtenir des droits démocratiques liait les mains des masses devant les attaques de la police et la terreur étatique, et pacifiait leur résistance.
(…) Cela dit, l’élément le plus actif dans cette tendance démocratique qui semble avoir pris le contrôle de la Plate-forme de Solidarité de Taksim se trouve dans les confédérations syndicales de gauche comme le KSEK et le DISK. (…) La Plate-forme de Solidarité de Taksim et donc la tendance démocratique, du fait qu’elle était constituée de représentants de toutes sortes d’associations et d’organisations, a tiré sa force non pas d’un lien organique avec les manifestants mais de la légitimité bourgeoise, des ressources mobilisées et du soutien de ses composantes.
(…) La gauche bourgeoise est une autre tendance qu’il faut mentionner. La base des partis de gauche, qu’on peut aussi définir comme la gauche légale bourgeoise, a été pour une large part coupée des masses. De façon générale, elle a été à la queue de la tendance démocratique. Les cercles staliniens et trotskistes, ou la gauche radicale bourgeoise, étaient aussi pour une grande part coupés des masses. Ils étaient influents dans les quartiers où ils ont traditionnellement une certaine force. Bien que s’opposant à la tendance démocratique au moment où cette dernière essayait de disperser le mouvement, ils l’ont généralement soutenue. Les analyses de la gauche bourgeoise étaient, pour la plus grande part, limitées à se réjouir du “soulèvement populaire” et à essayer de présenter ses porte-paroles comme les leaders du mouvement. Même les appels à une grève générale, une ligne traditionnellement mise en avant par la gauche, n’a pas vraiment eu d’écho au sein de celle-ci à cause de l’atmosphère de joie aveugle. Son slogan le plus largement accepté parmi les masses était “épaule contre épaule contre le fascisme”.
(…) En plus des tendances mentionnées ci-dessus, on peut parler d’une tendance prolétarienne ou de plusieurs tendances prolétariennes au sein du mouvement.
(…) De façon générale, une partie significative des manifestants défendait l’idée que le mouvement devait créer une auto-organisation qui devait lui permettre de déterminer son propre futur. La partie des manifestants qui voulait que le mouvement s’unisse avec la classe ouvrière était composée d’éléments qui étaient conscients de l’importance et de la force de la classe, qui étaient contre le nationalisme même s’il leur manquait une claire vision politique. (…) [Cependant], la faiblesse commune des manifestations dans toute la Turquie est la difficulté à créer des discussions de masse et à gagner le contrôle du mouvement grâce à des formes d’auto-organisation sur la base de ces discussions. Les discussions de masse semblables à celles qui se sont développées dans les mouvements à travers le monde ont été notablement absentes dans les premiers jours. Une expérience limitée de la discussion de masse, des réunions, des assemblées générales, etc., et la faiblesse de la culture du débat en Turquie ont sans aucun doute joué sur cette faiblesse. En même temps, le mouvement a senti la nécessité de la discussion et les moyens pour l’organiser ont commencé à émerger. La première expression de la conscience du besoin de discuter a été la formation d’une tribune ouverte dans le Parc Gezi. Celle-ci n’a pas attiré beaucoup l’attention ni duré bien longtemps, mais elle a eu néanmoins un certain impact.
(…) Si on regarde ce mouvement à l’échelle du pays, l’expérience la plus cruciale est fournie par les manifestants d’Eskişehir. Dans une assemblée générale sur la place de la Résistance d’Eskişehir, des comités ont été créés afin d’organiser et de coordonner les manifestations. (…) Enfin, à partir du 17 juin, dans les parcs de différents quartiers d’Istanbul, des masses de gens inspirées par les forums du parc Gezi ont mis en place des assemblées de masse également intitulées : “forums”. Parmi ces quartiers où se sont organisés des forums, il y a Beşiktaş, Elmadağ, Harbiye, Nişantaşı, Kadıköy, Cihangir, Ümraniye, Okmeydanı, Göztepe, Rumelihisarüstü, Etiler, Akatlar, Maslak, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Sarıyer, Yeniköy, Sarıgazi, Ataköy et Alibeyköy. Les jours suivants, d’autres se sont tenus à Ankara et dans d’autres villes. Du coup, de peur de perdre le contrôle sur ces initiatives, la Plateforme de Solidarité de Taksim a commencé elle-même à faire des appels en faveur de ces forums.
(…) Bien que, par bien des aspects, la résistance du parc Gezi soit en continuité avec le mouvement des Occupy aux États-Unis, des Indignés en Espagne et des mouvements de protestation qui ont renversé Moubarak en Égypte et Ben Ali en Tunisie, elle a aussi ses particularités : comme dans tous ces mouvements, en Turquie, il y a un poids vital du jeune prolétariat. L’Égypte, la Tunisie et la résistance du parc Gezi ont en commun la volonté de se débarrasser d’un régime qui est perçu comme étant une “dictature”. (…) Mais, contrairement au mouvement en Tunisie qui a organisé des comités locaux, et en Espagne ou aux États-Unis où les masses ont généralement assumé la responsabilité du mouvement à travers des assemblées générales, en Turquie cette dynamique est restée au début très limitée.
(…) [De même] Les questions les plus débattues portaient sur les problèmes pratiques et techniques des affrontements avec la police. (…) La similitude avec Occupy aux États-Unis était qu’une occupation effective [de la rue] a eu lieu ; même si en Turquie, les occupations surpassaient en nombre, par une participation massive, celles des États-Unis. De même, en Turquie comme aux États-Unis, il y a une tendance parmi les manifestants à comprendre l’importance de l’implication dans la lutte de la partie du prolétariat au travail.
(…) Bien que le mouvement en Turquie n’ait pas réussi à établir un lien sérieux avec l’ensemble de la classe ouvrière, les appels à la grève via les réseaux sociaux ont rencontré un certain écho qui s’est manifesté à travers plus d’arrêts de travail qu’aux États Unis. En dépit de ses particularités, il ne fait pas de doute que le mouvement de cette “canaille” est une partie intégrante de la chaîne des mouvements sociaux internationaux.
(…) Un des meilleurs indicateurs qui montrent que ce mouvement fait partie de la vague internationale se trouve dans son inspiration des manifestants brésiliens. Les manifestants turcs ont salué la réponse venue de l’autre rive du monde avec les mots d’ordre : “Nous sommes ensemble, Brésil + Turquie !” et “Brésil, résiste !” (en turc). Et puisque le mouvement a inspiré des manifestations au Brésil contenant des revendications de classe, il peut à l’avenir favoriser la naissance de revendications de classe en Turquie. (…) Malgré toutes les faiblesses et les dangers qui menacent ce mouvement, si les masses en Turquie n’avaient pas réussi à devenir un maillon de la chaîne des révoltes sociales qui secouent le monde capitaliste, le résultat serait un bien plus grand sentiment d’impuissance. Le surgissement d’un mouvement social d’une ampleur jamais vue depuis 1908 dans ce pays est donc d’une importance historique. (…).
Dünya Devrimi/21.06.2013
1)Le Parti pour la justice et le développement, islamiste « modéré » est au pouvoir depuis 2002 en Turquie.
Rubrique:
Cycle de discussion du printemps 2013: lutte anticapitaliste et organisation
- 1270 reads
Dans la période actuelle, il existe une nécessité de réflexion et d’approfondissement concernant les leçons à tirer des mouvements de lutte qui ont eu lieu les années passées, comme le « printemps arabe », le combat des « Indignés » ou le mouvement « Occupy ». En outre, toute rencontre de gens engagés pour discuter et apprendre à se connaître est essentielle pour dépasser l’éparpillement du mouvement internationaliste. Voilà pourquoi le CCI, incité aussi à le faire par quelques courriers dans ce sens (1), avait décidé de tenir un cycle de discussion au printemps 2013 sur le thème « lutte et organisation ». Il s’agissait de deux soirées de discussion pendant lesquelles les participants pouvaient engager entre eux et avec le CCI des échanges sur leurs questionnements, leurs expériences et leurs interprétations des mouvements.
En introduction aux deux soirées, le CCI avait prévu un exposé qui fournissait une base solide pour les discussions (2). Les participants ont en général fort apprécié ces introductions, même s’ils trouvaient celle de la deuxième soirée assez abstraite et ardue à comprendre. Le débat a cependant permis de donner plus de chair aux axes de l’introduction. Le premier exposé a introduit le thème de la lutte comme moteur de l’histoire et a fourni un cadre historique pour commenter et analyser les mouvements de lutte récents. Le deuxième exposé a mis l’accent sur le développement de la conscience de classe dans et par les mouvements de lutte, la conscience de classe stimulant à son tour l’expansion des luttes. Les deux soirées ont fait surgir de nombreux points de discussion communs. Aussi, cet article traitera les deux sessions de discussion comme un ensemble.
Est-ce que la classe ouvrière est une classe révolutionnaire ?
Une des questions principales portait sur la nature même de la classe ouvrière. Les participants reconnaissaient certes l’existence de cette classe, mais doutaient du caractère révolutionnaire du prolétariat. Pourquoi est-ce elle et pas d’autres couches exploitées et opprimées de la société, telles les femmes, les immigrés, les homosexuels, les pauvres, etc., qui peut être à la base du développement d’une autre société ? Ne devons-nous pas nous battre contre bien d’autres injustices que l’exploitation des travailleurs ? Qu’en est-il par exemple de l’exploitation de la nature, des femmes, etc.
Dans la discussion, une distinction a été opérée entre le prolétariat comme entité sociologique et comme entité politico-culturelle. Les travailleurs ont été caractérisés comme ce groupe de gens qui vendent leur force de travail pour un salaire et qui créent de la plus-value par leur travail commun (3). Face à eux, il y a évidemment la bourgeoisie, la classe qui contrôle les outils de production, le processus de production et les produits du travail, parce qu’elle possède et gère les moyens de production. Ces définitions ne sont pas strictement sociologiques, elles ne sont pas fondamentalement fondées sur une répartition d’un groupe de gens selon leur sexe, la couleur de leur peau, leurs revenus ou leur profession. Elles rendent compte du rôle que joue un groupe d’êtres humains dans le processus productif social global. Dans ce rapport social, la classe ouvrière est la classe qui ne dispose d’aucun contrôle sur ce processus.
Comme la force de travail fournit aussi aux hommes la capacité d’exprimer leur force vitale, leurs sentiments et leurs pensées et que les travailleurs sont précisément obligés de vendre celle-ci et de la soumettre aux besoins du capitalisme, la classe ouvrière est aussi la classe la plus aliénée. « Le travail, seul lien qui les unisse encore aux forces productives et à leur propre existence, a perdu chez eux toute apparence de manifestation de soi, et ne maintient leur vie qu'en l'étiolant » (4). Marx et Engels formulent précisément des appréciations élogieuses envers les formes de société précapitalistes, dans lesquelles le travail fournissait encore souvent une certaine satisfaction aux producteurs, même s’ils étaient exploités et s’ils devaient céder une partie des produits de leur travail. Dans le capitalisme toutefois, toute activité humaine est réduite à être une marchandise abstraite et « froide » et ainsi, la force de travail elle-même est réduite à n’être qu’une marchandise, l’être humain plein de qualités potentielles est réduit à n’être qu’un numéro, une « masse grise ». Cette « déshumanisation » du prolétariat en fait « une classe avec des chaînes radicales, (…), une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances universelles et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on ne lui a pas fait de tort particulier, mais un tort en soi, une sphère qui ne puisse plus s'en rapporter à un titre historique, mais simplement au titre humain, (…), une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper, sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans, par conséquent, les émanciper toutes, qui soit, en un mot, la perte complète de l'homme, et ne puisse donc se reconquérir elle-même que par le regain complet de l'homme » (5). Pour se libérer en tant que classe exploitée et opprimée, le prolétariat doit créer une nouvelle sorte de société, « où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » (6).
Différents intervenants ont affirmé qu’à côté de la lutte ouvrière, il fallait encore tenir compte d’autres luttes spécifiques, telles la lutte pour les droits des femmes et des immigrés et contre le racisme. Selon eux, le prolétariat peut supprimer l’exploitation capitaliste, avec toutes les conséquences directes de celle-ci, mais cela n’entraînera pas automatiquement la disparition de toute forme d’oppression. La discussion a mis en évidence que l’accentuation d’une autre identité n’implique ni la même dynamique unitaire, ni surtout la même perspective que l’identité de classe, bien au contraire. Ainsi la dynamique du mouvement « Occupy » aux USA s’est souvent bloquée parce qu’on mettait trop souvent l’accent sur ces « catégories » spécifiques d’oppression. La question de la discrimination des noirs a mené par exemple à des tensions et des divisions au sein des assemblées avant qu’une véritable discussion puisse s’ouvrir sur les problèmes mondiaux. L’antiracisme était dans ce cas plus un frein qu’un stimulant pour la lutte. Sur la côte ouest des USA par contre, où les protestataires d’Occupy se reconnaissaient beaucoup plus dans le combat de la classe ouvrière, le mouvement s’est développé de manière plus radicale (7).
La classe ouvrière peut-elle s’unir ?
Une deuxième série de questions exprimait des doutes concernant la capacité de la classe ouvrière à développer des forces suffisantes pour renverser le capitalisme. Même si elle a une nature révolutionnaire, n’est-elle pas trop divisée ? Est-elle capable de placer cette identité spécifique avant toutes sortes d’autres identités (de sexe, de couleur de peau, d’origine, d’âge, …) ? Peut-elle s’unir dans un monde capitaliste où les entreprises se délocalisent vers des régions où la force de travail est la moins chère et aiguisent ainsi la concurrence entre travailleurs ?
Une intervention a souligné qu’il ne fallait pas voir les choses de manière empirique. En 1914, peu de gens soutenaient que le prolétariat engagerait dans quelques années une vague révolutionnaire internationale. Il en allait de même dans les années avant 1968, lorsque aussi bien la bourgeoisie que certains révolutionnaires prolétariens pensaient que la classe ouvrière était « morte » (8).
Aujourd’hui, la classe ouvrière est effectivement divisée. Cela s’exprime e.a. par le fait que beaucoup de prolétaires individuels s’attribuent en premier lieu toutes sortes d’autres identités. Ces identités se fondent souvent sur une base réelle. Ainsi, un homme n’est pas une femme et on ne peut changer son lieu de naissance. Mais est-ce que chaque identité offre une perspective pour le futur ? Est-ce que chacune d’elle peut mettre en marche un processus et mener à la fin de l’exploitation capitaliste et de l’Etat ? Il suffit de penser aux conséquences dramatiques de l’identité nationale qui a été mise en avant par de nombreux travailleurs en Egypte.
La classe ouvrière est donc divisée, parce qu’elle est encore faible. Par conséquent, elle n’est pas faible parce qu’elle est divisée (9). La concurrence économique « … isole les individus les uns des autres (…) malgré le fait qu’elle les réunit. C’est pourquoi cela dure longtemps avant que ces individus arrivent à s’unir … » (10). Le prolétariat tire sa force de sa solidarité et de sa conscience de soi en tant que force révolutionnaire. Ces deux éléments se développent de concert dans la lutte contre l’Etat et le capital, lorsque la concurrence disparaît. A ce moment, la classe ouvrière, constituée d’une mosaïque d’êtres différents, percevra de manière de plus en plus claire son existence en tant que classe séparée. Les participants à la discussion étaient d’accord pour affirmer que cela n’avait aucun sens de tenter de convaincre les prolétaires un à un qu’ils appartenaient à la même classe internationale. Une telle approche est la conception des missionnaires.
Quelle forme de lutte ?
Comment surmonter la division au sein de la classe ouvrière ? Comment peut-elle développer une force suffisante pour faire vaciller le capitalisme ? Quelles formes de lutte favorisent le développement de la solidarité et de la conscience et lesquelles l’entravent par contre ?
Différents participants ont aussitôt établi un lien avec la question des syndicats, étant donné que ces derniers sont présentés comme les symboles du mouvement ouvrier historique. Ils sont généralement identifiés comme la forme « classique » et même reconnue par l’Etat de la « lutte ouvrière ». Plusieurs présents ont souligné de façon fort correcte que les syndicats n’étaient pas aux avant-postes lors des mouvements de lutte discutés dans le cycle. Bien au contraire, ils ont freiné et divisé les mouvements. Un participant a toutefois voulu nuancer l’analyse en constatant qu’il ne fallait pas mettre tous les syndicats sur le même plan : ainsi, certains syndicats anarcho-syndicalistes auraient soutenu en 2012 la grève sauvage des mineurs dans les Asturies (Espagne). Mais dans quelle mesure une grève, où les mineurs se sont retranchés dans les mines, permet-elle une dynamique de développement de la solidarité et de la conscience ?
Beaucoup d’autres mouvements de lutte ont cependant endossé de manière spontanée une autre forme : l’occupation de rues et de plaines pour les transformer en lieux de débat public. Ces assemblées générales (AG) permettaient la clarification politique, qui favorisaient à leur tour le développement de la solidarité (les présents ont établi des comparaisons avec les soviets dans la Russie du début du 20ième siècle). Ces AG étaient des lieux de débat vivants, où la lutte était organisée par l’ensemble des travailleurs qui y participaient, indépendamment de leur profession ou de leur entreprise. Bien que les revendications et les slogans de ces mouvements de luttes planétaires révélaient souvent des illusions dans l’Etat démocratique et ne manifestaient pas toujours un internationalisme des plus intransigeants, la forme de lutte manifestait l’empreinte de la classe ouvrière. Ce n’est pas un hasard si le mouvement en Espagne est allé le plus loin, car c’est là aussi que la classe ouvrière a acquis d’un point de vue historique des expériences de lutte importantes. D’innombrables AG ont surgi des plus petites places jusqu’à la Puerta del Sol. Dans les AG, de nombreux sujets étaient discutés, aussi bien sur le plan économique (chômage, logement, austérité, …) que politique (la démocratie, l’Etat, …) et que culturel (l’art, les sciences, …).
Une discussion réussie ?
Différents sujet ont à peine été abordés et méritent plus de temps et une approche plus en profondeur. Nous songeons par exemple à la lutte de différentes minorités, la question syndicale et le rôle des minorités révolutionnaires. Pour beaucoup, cette discussion venait de s’ouvrir et ils sont partis avec plus de questions qu’ils n’en avaient au début. Ce n’est pas mauvais en soi, car toutes les questions et les divergences ne pouvaient être résolues en deux soirées. Au moins, les participants ne sont pas partis avec une aversion d’une confrontation constructive de positions. Nous voulons encourager cette approche pour continuer à approfondir les discussions politiques. Ceci aussi fait partie de la lutte pour une autre société qu’il faut mener avec une vision à long terme.
Alex, 21-09-2013
(1) Cf. « Réaction d’un lecteur », Internationalisme n°356, 2012
(2) Intro 1 (en néerlandais): https://nl.internationalism.org/node/1029 [36] et intro 2 (en néerlandais) : https://nl.internationalism.org/node/1030 [37]
(3) La plus-value est la nouvelle valeur que les travailleurs créent durant le processus productif et ajoutent à la matière première ou à la marchandise et qui dépasse les frais nécessaires à leur entretien et leur reproduction. C’est pourquoi elle est disponible pour être confisquée par les capitalistes. C’est la base du profit capitaliste.
(4) K. Marx et F. Engels (1845) L’idéologie allemande,
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450000d.htm [38]
(5) K. Marx (1843) Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1843/00/km18430000.htm [39]
(6) K. Marx et F. Engels (1848) Le manifeste du parti communiste,
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000b.htm [40]
(7) IKS/Occupy (2011), Oakland: Occupy movement seeks link with the working class, https://en.internationalism.org/icconline/201111/4578/oakland-occupy-movement-seeks-links-working-class [41]
(8) En 1964, l’intellectuel petit-bourgeois Marcuse écrivit son livre « l’homme unidimensionnel » dans lequel il analysait comment la classe ouvrière avait été absorbée par la société capitaliste et dès lors n’était plus porteuse de la révolution contre le capitalisme. Le mouvement international de mai ’68 a contredit totalement cette thèse.
(9) quelqu’un a utilisé cette formulation dans la discussion. Elle a été empruntée à Anton Pannekoek, astronome et marxiste, dans son article « Parti et classe ouvrière », écrit en 1936.
(10) K. Marx et F. Engels (1845) L’idéologie allemande
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450000d.ht [38]
Rubrique:
Grèce: soigner l'économie tue le malade
- 1003 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article rédigé par notre section en Grande-Bretagne, World Revolution, sur l'effondrement du système de soins en Grèce.
En décembre 2012, le quotidien allemand Frank-furter Allgemeine Zeitung rendait compte d’une visite en Grèce: "En octobre 2012, le traumatologue Georg Pier rapportait les observations suivantes sur la Grèce : des femmes sur le point d’accoucher se hâtaient désespérément d’un hôpital à l’autre; mais comme elles n’avaient pas d’assurance-maladie ou suffisamment d’argent, personne ne voulait les aider à mettre leur enfant au monde.
Des gens, qui jusqu’à présent faisaient partie des classes moyennes, cherchaient des restes de fruits et de légumes dans les poubelles. (…) Un vieil homme disait à un journaliste qu’il n’avait plus les moyens d’acheter les médicaments nécessaires pour soigner son problème cardiaque: sa pension avait été diminuée de 50% comme celle de beaucoup d’autres retraités. Il a travaillé pendant plus de quarante ans, pensant avoir fait les choses correctement; maintenant, il ne comprend plus le monde. Lorsque tu es admis dans un hôpital, tu dois apporter tes propres draps et ta propre nourriture. Comme le personnel d’entretien a été mis à la porte, les médecins et les infirmiers, qui n’ont pas reçu de salaire depuis des mois, ont commencé à nettoyer les toilettes. Il y a une pénurie de gants et de cathéters jetables. Devant les conditions hygiéniques déplorables dans plusieurs établissements, l’Union Européenne avertit du danger de propagation de virus infectieux."
Les mêmes conclusions étaient tirées par Marc Sprenger, chef du Centre Européen pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (ECDC). Le 6 décembre, il alerta [les autorités] sur l’effondrement du système de santé et des mesures d’hygiène en Grèce, ajoutant que cela pouvait aboutir à une pandémie dans toute l’Europe. Il y a une pénurie de gants à usage unique, de blouses et de serviettes de désinfection, de boules de coton, de cathéters, de rouleaux de papier pour couvrir les tables d’examen médical. Les patients ayant des maladies infectieuses, comme la tuberculose, ne reçoivent pas le traitement nécessaire, ce qui entraîne l’augmentation du risque de propagation de virus résistants en Europe.
Un contraste frappant entre ce qui est techniquement possible et la réalité du capitalisme
Au 19e siècle, beaucoup de patients (jusqu’à un tiers parfois) mouraient à cause d’un manque d’hygiène à l’hôpital, en particulier les femmes pendant l’accouchement. Ces drames pouvaient s’expliquer en grande partie par l’ignorance, parce que beaucoup de docteurs ne se lavaient pas les mains avant un traitement ou une opération et, souvent, ils allaient avec des blouses sales d’un patient à l’autre.
Les découvertes en hygiène, de Semmelweis ou Lister par exemple, permirent une réelle amélioration. Les nouvelles mesures d’hygiène et les découvertes sur la transmission des germes permirent une forte réduction des maladies nosocomiales.
Aujourd’hui, l’utilisation des gants et des instruments chirurgicaux à usage unique est une pratique courante dans la médecine moderne. Mais, tandis que l’ignorance du 19e siècle est une explication plausible de la mortalité importante dans les hôpitaux, les dangers qui deviennent évidents dans les hôpitaux en Grèce ne sont pas une manifestation de l’ignorance mais une expression de la menace qui pèse sur l’humanité; cette menace provient de la faillite d’un système de production totalement obsolète.
Si, aujourd’hui, la santé des habitants du cœur de la civilisation antique est menacée par le manque de fonds des hôpitaux ou par leur insolvabilité (ils ne peuvent plus acheter de gants à usage unique), si les femmes enceintes qui cherchent une prise en charge dans les hôpitaux sont renvoyées parce qu’elles n’ont pas d’argent ou pas d’assurance médicale, si les gens qui ont des maladies de cœur ne peuvent plus payer leurs médicaments…, cela devient une attaque contre la vie-même. Si, dans un hôpital, le personnel d’entretien, qui est indispensable dans la chaîne de l’hygiène, est licencié, si les docteurs et les infirmiers, qui n’ont pas reçu leur salaire depuis longtemps, doivent prendre en charge les tâches de nettoyage, cela apporte une lumière crue sur la "régénération" de l’économie. C’est le terme utilisé par la classe dominante pour justifier ses attaques brutales contre nous: la "régénération" se retourne en menace sur nos vies.
Après 1989, en Russie, l’espérance de vie a baissé de cinq ans à cause de l’effondrement du système de santé d’une part, mais aussi à cause de l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogue. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement en Grèce que le système de santé est démantelé petit à petit pour s’effondrer simplement. Dans un autre pays en faillite, l’Espagne, le système de santé est également en train d’être démoli. Dans le vieux centre industriel qu’est Barcelone, de même que dans d’autres grandes villes, les services des urgences ne sont parfois ouverts que quelques heures, pour faire des économies budgétaires. En Espagne, au Portugal et en Grèce, beaucoup de pharmacies ne reçoivent plus de médicaments vitaux. Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck ne fournit plus le médicament anti-cancéreux Erbitux aux hôpitaux grecs; Biotest, un laboratoire qui vend du plasma sanguin pour le traitement de l’hémophilie et du tétanos, a arrêté de fournir ses produits à cause du non-paiement des factures depuis juin dernier.
Jusqu’à présent, ces conditions médicales désastreuses étaient connues principalement dans les pays africains ou dans les régions dévastées par la guerre; mais maintenant, la crise dans les pays anciennement industrialisés a conduit à une situation telle que des domaines vitaux comme les soins de santé sont de plus en plus sacrifiés sur l’autel du profit. Ainsi, l’obtention d’un traitement médical n’est plus basé sur ce qui est techniquement possible: on ne reçoit le traitement que si on est solvable.(1)
Cette évolution montre que l’écart entre ce qui est techniquement possible et la réalité de ce système s’agrandit. Plus l’hygiène est menacée et plus nous risquons de voir apparaître des épidémies incontrôlables. Nous devons rappeler l’épidémie de grippe espagnole, qui s’est répandue à travers l’Europe après la fin de la Première Guerre mondiale, entraînant la mort de plus de vingt millions de personnes. La guerre, avec son cortège de famines et de privations, avait préparé les conditions de cette épidémie. La crise économique joue le même rôle dans l’Europe d’aujourd’hui. En Grèce, le taux de chômage frôlait les 25% au dernier trimestre de 2012; le chômage des jeunes de moins de 25 ans atteignait 57%, 65% des jeunes femmes sont sans emploi. Les prévisions indiquent toutes une augmentation plus rapide, jusqu’à 40% en 2015. La paupérisation accompagnant le chômage a déjà conduit à ce que "des zones résidentielles et des immeubles d’appartements ont été privés de fourniture de fuel pour défaut de paiement. Pour éviter d’avoir trop froid l'hiver chez eux, beaucoup de gens ont commencé à utiliser des poêles à bois; les gens coupent le bois illégalement dans les forêts proches. Au printemps 2012, un vieil homme s’est donné la mort devant le parlement d’Athènes; juste avant de mourir, il aurait crié: je ne veux pas laisser de dettes à mes enfants. Le taux de suicide a doublé en Grèce depuis ces trois dernières années."(2)
Après l’Espagne avec le détroit de Gibraltar, l’Italie avec Lampedusa et la Sicile, la Grèce est le point principal d’entrée pour les réfugiés qui fuient les zones dévastées par la guerre et les espaces paupérisés d’Afrique et du Moyen Orient. Le gouvernement a installé une gigantesque clôture le long de la frontière turque. Il a monté d’immenses camps de réfugiés dans lesquels plus de 55.000 clandestins étaient internés en 2011. Les partis politiques de l’aile droite essayent de susciter une atmosphère de pogrom contre ces réfugiés, leur reprochant d’importer des "maladies de l’étranger" et de s’emparer des ressources qui reviennent de droit aux "Grecs d’origine". Mais la misère qui conduit ces millions de gens à fuir leur pays natal et qui se répand inexorablement dans les hôpitaux et les rues de l’Europe provient de la même source: un système social qui est devenu un obstacle à tout progrès humain.
Dionis/04.01.2013
1) Dans les pays "émergents" comme l’Inde, de nouveaux hôpitaux privés voient sans arrêt le jour. Ils sont accessibles uniquement aux riches patients et encore plus aux patients solvables qui viennent de l’étranger. Ils offrent des traitements qui sont beaucoup trop chers pour la majorité des Indiens et beaucoup de patients étrangers qui viennent en tant que "touristes médicaux" dans les cliniques privées indiennes n’ont pas les moyens de s’offrir leur traitement médical chez eux.
2) Frankfurter Allgemeine Zeitung, décembre 2012