Internationalisme no 355 - 3e trimestre 2012
- 1526 reads
Elections communales : rien que du bluff et des illusions
- 1241 reads
L'avenir ne se décide plus dans le bulletin de vote, mais dans la lutte sociale : classe contre classe
Avec l’automne, voici le retour du carnaval électoral, cette fois-ci sur le plan communal ; et avec lui, le cortège inépuisable de bluff, de magouilles politiciennes, de mensonges, d’illusions. Une fois de plus on nous appellera à remplir notre "devoir de citoyen", à participer par notre vote au choix d’une bonne gestion du système, d’un meilleur fonctionnement des services publics, cette fois-ci sur le plan communal, à nous mobiliser pour la "défense de la démocratie". En réalité, les dés sont pipés d’avance : c’est toujours la bourgeoisie qui gagne les élections. Que la gauche ou la droite l’emporte, Janssens ou De Wever, Reynders ou Di Rupo, tel candidat ou tel autre, pour les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, cela signifie de toute façon la même politique d’attaques incessantes sur leurs conditions de vie.
C’est pourquoi, aujourd’hui le CCI souligne plus que jamais que la classe ouvrière n’a rien à attendre du terrain électoral. Cette attitude des révolutionnaires n’est pas liée aux spécificités des élections communales qui se dérouleront en octobre en Belgique, mais découle, comme le texte ci-dessous le rappelle, des caractéristiques générales du développement du capitalisme depuis le début du siècle précédent.
Face à l’angoisse de l’avenir, à la peur du chômage, au ras-le-bol de l’austérité et de la précarité, la bourgeoisie utilise les élections afin de pourrir la réflexion des ouvriers, en exploitant les illusions encore très fortes au sein du prolétariat.
Le refus de participer au cirque électoral ne s’impose pas de manière évidente au prolétariat du fait que cette mystification est étroitement liée à ce qui constitue le cœur de l’idéologie de la classe dominante, la démocratie. Toute la vie sociale dans le capitalisme est organisée par la bourgeoisie autour du mythe de l’Etat “démocratique”. Ce mythe est fondé sur l’idée mensongère suivant laquelle tous les citoyens sont “égaux” et “libres” de “choisir”, par le vote, leurs représentants politiques et le parlement est présenté comme le reflet de la “volonté populaire”. Cette escroquerie idéologique est difficile à déjouer pour la classe ouvrière du fait que la mystification électorale s’appuie en partie sur certaines vérités. La bourgeoisie utilise, en la falsifiant, l’histoire du mouvement ouvrier en rappelant les luttes héroïques du prolétariat pour conquérir le droit de vote. Face aux grossiers mensonges propagandistes, il est nécessaire de revenir aux véritables positions défendues par le mouvement ouvrier et ses organisations révolutionnaires. Et cela, non pas en soi, mais en fonction des différentes périodes de l’évolution du capitalisme et des besoins de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
La question des élections au 19e siècle dans la phase ascendante du capitalisme
Le 19e siècle est la période du plein développement du capitalisme pendant laquelle la bourgeoisie utilise le suffrage universel et le Parlement pour lutter contre la noblesse et ses fractions rétrogrades. Comme le souligne Rosa Luxemburg, en 1904, dans son texte Social-démocratie et parlementarisme : “Le parlementarisme, loin d’être un produit absolu du développement démocratique, du progrès de l’humanité et d’autres belles choses de ce genre, est au contraire une forme historique déterminée de la domination de classe de la bourgeoisie et ceci n’est que le revers de cette domination, de sa lutte contre le féodalisme. Le parlementarisme bourgeois n’est une forme vivante qu’aussi longtemps que dure le conflit entre la bourgeoisie et le féodalisme”. Avec le développement du mode de production capitaliste, la bourgeoisie abolit le servage et étend le salariat pour les besoins de son économie. Le Parlement est l’arène où les différents partis bourgeois s’affrontent pour décider de la composition et des orientations du gouvernement en charge de l’exécutif. Le Parlement est le centre de la vie politique bourgeoise mais, dans ce système démocratique parlementaire, seuls les notables sont électeurs. Les prolétaires n’ont pas le droit à la parole, ni le droit de s’organiser.
Sous l’impulsion de la 1ère puis de la 2e Internationale, les ouvriers vont engager des luttes sociales d’envergure, souvent au prix de leur vie, pour obtenir des améliorations de leurs conditions de vie (réduction du temps de travail de 14 à 10 heures, interdiction du travail des enfants et des travaux pénibles pour les femmes…). Dans la mesure où le capitalisme était alors un système en pleine expansion, son renversement par la révolution prolétarienne n’était pas encore à l’ordre du jour. C’est la raison pour laquelle la lutte revendicative sur le terrain économique au moyen des syndicats et la lutte de ses partis politiques sur le terrain parlementaire permettaient au prolétariat d’arracher des réformes à son avantage. “Une telle participation lui permettait à la fois de faire pression en faveur de ces réformes, d’utiliser les campagnes électorales comme moyen de propagande et d’agitation autour du programme prolétarien et d’employer le Parlement comme tribune de dénonciation de l’ignominie de la politique bourgeoise. C’est pour cela que la lutte pour le suffrage universel a constitué, tout au long du 19e siècle, dans un grand nombre de pays, une des occasions majeures de mobilisation du prolétariat”. (1) Ce sont ces positions que Marx et Engels vont défendre tout au long de cette période d’ascendance du capitalisme pour expliquer leur soutien à la participation du prolétariat aux élections.
La question des élections au 20e siècle, dans la phase de décadence du capitalisme
A l’aube du 20e siècle, le capitalisme a conquis le monde. En se heurtant aux limites de son expansion géographique, il rencontre la limitation objective des marchés : les débouchés à sa production deviennent de plus en plus insuffisants. Les rapports de production capitalistes se transforment dès lors en entraves au développement des forces productives. Le capitalisme, comme un tout, entre dans une période de crises et de guerres de dimension mondiale.
Un tel bouleversement va entraîner une modification profonde du mode d’existence politique de la bourgeoisie, du fonctionnement de son appareil d’Etat et, a fortiori, des conditions et des moyens de la lutte du prolétariat. Le rôle de l’Etat devient prépondérant car il est le seul à même d’assurer “l’ordre”, le maintien de la cohésion d’une société capitaliste déchirée par ses contradictions. Les partis bourgeois deviennent, de façon de plus en plus évidente, des instruments de l’Etat chargés de faire accepter la politique de celui-ci.
Le pouvoir politique tend alors à se déplacer du législatif vers l’exécutif et le Parlement bourgeois devient une coquille vide qui ne possède plus aucun rôle décisionnel. C’est cette réalité qu’en 1920, lors de son 2e congrès, l’Internationale communiste va clairement caractériser : “L’attitude de la 3ème Internationale envers le parlementarisme n’est pas déterminée par une nouvelle doctrine, mais par la modification du rôle du Parlement même. A l’époque précédente, le Parlement en tant qu’instrument du capitalisme en voie de développement a, dans un certain sens, travaillé au progrès historique. Mais dans les conditions actuelles, à l’époque du déchaînement impérialiste, le Parlement est devenu tout à la fois un instrument de mensonge, de tromperie, de violence, et un exaspérant moulin à paroles... A l’heure actuelle, le Parlement ne peut être en aucun cas, pour les communistes, le théâtre d’une lutte pour des réformes et pour l’amélioration du sort de la classe ouvrière, comme ce fut le cas dans le passé. Le centre de gravité de la vie politique s’est déplacé en dehors du Parlement, et d’une manière définitive”.
Désormais, il est hors de question pour la bourgeoisie d’accorder des réformes réelles et durables des conditions de vie de la classe ouvrière. C’est l’inverse qu’elle impose au prolétariat : toujours plus de sacrifices, de misère et d’exploitation. Les révolutionnaires sont alors unanimes pour reconnaître que le capitalisme a atteint des limites historiques et qu’il est entré dans sa période de déclin, comme en a témoigné le déchaînement de la Première Guerre mondiale. L’alternative était désormais : socialisme ou barbarie. L’ère des réformes était définitivement close et les ouvriers n’avaient plus rien à conquérir sur le terrain des élections.
Néanmoins un débat central va se développer au cours des années 1920 au sein de l’Internationale communiste sur la possibilité, défendue par Lénine et le parti bolchevique, d’utiliser la “tactique” du “parlementarisme révolutionnaire”. Face à d’innombrables questions suscitées par l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, le poids du passé continuait à peser sur la classe ouvrière et ses organisations. La guerre impérialiste, la révolution prolétarienne en Russie, puis le reflux de la vague de luttes prolétariennes au niveau mondial dès 1920 ont conduit Lénine et ses camarades à penser que l’on peut détruire de l’intérieur le Parlement ou utiliser la tribune parlementaire de façon révolutionnaire. En fait cette “tactique” erronée va conduire la 3e Internationale vers toujours plus de compromis avec l’idéologie de la classe dominante. Par ailleurs, l’isolement de la révolution russe, l’impossibilité de son extension vers le reste de l’Europe avec l’écrasement de la révolution en Allemagne, vont entraîner les bolcheviks et l’Internationale, puis les partis communistes, vers un opportunisme débridé. C’est cet opportunisme qui allait les conduire à remettre en question les positions révolutionnaires des 1er et 2e Congrès de l’Internationale communiste pour s’enfoncer vers la dégénérescence lors des congrès suivants, jusqu’à la trahison et l’avènement du stalinisme qui fut le fer de lance de la contre-révolution triomphante.
C’est contre cet abandon des principes prolétariens que réagirent les fractions les plus à gauche dans les partis communistes (2). A commencer par la Gauche italienne avec Bordiga à sa tête qui, déjà avant 1918, préconisait le rejet de l’action électorale. Connue d’abord comme “Fraction communiste abstentionniste”, celle-ci s’est constituée formellement après le Congrès de Bologne en octobre 1919 et, dans une lettre envoyée de Naples à Moscou, elle affirmait qu’un véritable parti, qui devait adhérer à l’Internationale communiste, ne pouvait se créer que sur des bases antiparlementaristes. Les gauches allemande et hollandaise vont à leur tour développer la critique du parlementarisme. Anton Pannekoek dénonce clairement la possibilité d’utiliser le Parlement pour les révolutionnaires, car une telle tactique ne pouvait que les conduire à faire des compromis, des concessions à l’idéologie dominante. Elle ne visait qu’à insuffler un semblant de vie à ces institutions moribondes, à encourager la passivité des travailleurs alors que la révolution nécessite la participation active et consciente de l’ensemble du prolétariat.
Dans les années 1930, la Gauche italienne, à travers sa revue Bilan, montrera de façon concrète comment les luttes des prolétaires français et espagnols avaient été détournées vers le terrain électoral. Bilan affirmait à juste raison que c’est la “tactique” des fronts populaires en 1936 qui avait permis d’embrigader le prolétariat comme chair à canon dans la 2ème boucherie impérialiste mondiale. A la fin de cet effroyable holocauste, c’est la Gauche communiste de France qui publiait la revue Internationalisme (dont est issu le CCI) qui fera la dénonciation la plus claire de la “tactique” du parlementarisme révolutionnaire : “La politique du parlementarisme révolutionnaire a largement contribué à corrompre les partis de la 3ème Internationale et les fractions parlementaires ont servi de forteresses de l’opportunisme (…). La vérité est que le prolétariat ne peut utiliser pour sa lutte émancipatrice “le moyen de lutte politique” propre à la bourgeoisie et destiné à son asservissement. Le parlementarisme révolutionnaire en tant qu’activité réelle n’a, en fait, jamais existé pour la simple raison que l’action révolutionnaire du prolétariat quand elle se présente à lui, suppose sa mobilisation de classe sur un plan extra-capitaliste, et non la prise des positions à l’intérieur de la société capitaliste.” (3) Désormais, la non participation aux élections, est une frontière de classe entre organisations prolétariennes et organisations bourgeoises. Dans ces conditions, depuis plus de 80 ans, les élections sont utilisées, à l’échelle mondiale, par tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, pour dévoyer le mécontentement ouvrier sur un terrain stérile et crédibiliser le mythe de la “démocratie”. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si aujourd’hui, contrairement au 19e siècle, les Etats “démocratiques” mènent une lutte acharnée contre l’abstentionnisme et la désaffection des partis, car la participation des ouvriers aux élections est essentielle à la perpétuation de l’illusion démocratique.
Les élections ne sont qu’une mystification
Contrairement à la propagande indigeste voulant nous persuader que ce sont les urnes qui gouvernent, il faut réaffirmer que les élections sont une pure mascarade.
Certes, il peut y avoir des divergences au sein des différentes fractions qui composent l’Etat bourgeois sur la façon de défendre au mieux les intérêts du capital national mais, fondamentalement, la bourgeoisie organise et contrôle le carnaval électoral pour que le résultat soit conforme à ses besoins en tant que classe dominante. C’est pour cela que l’Etat capitaliste organise, manipule, utilise ses médias aux ordres. Ainsi, depuis la fin des années 1920 et jusqu’à aujourd’hui, quel que soit le résultat des élections, que ce soit la droite ou la gauche qui sorte victorieuse des urnes, c’est finalement toujours la même politique anti-ouvrière qui est menée.
Ces derniers mois, la focalisation orchestrée par la bourgeoisie autour des élections présidentielles de mai 2007 a réussi momentanément à capter l’attention des ouvriers et à les persuader qu’elles étaient un enjeu pour leur avenir et celui de leurs enfants. Non seulement la bourgeoisie plonge le prolétariat dans la paupérisation absolue, mais en plus elle l’humilie en lui donnant “des jeux et du cirque électoral”. Aujourd’hui, le prolétariat n’a pas le choix. Ou bien il se laisse entraîner sur le terrain électoral, sur le terrain des Etats bourgeois qui organisent son exploitation et son oppression, terrain où il ne peut être qu’atomisé et sans force pour résister aux attaques du capitalisme en crise. Ou bien, il développe ses luttes collectives, de façon solidaire et unie, pour défendre ses conditions de vie. Ce n’est que de cette façon qu’il pourra retrouver ce qui fait sa force en tant que classe révolutionnaire : son unité et sa capacité à lutter en dehors et contre les institutions bourgeoises (parlement et élections) en vue du renversement du capitalisme. D’ailleurs, face à l’aggravation des attaques et malgré ce bourrage de crane électoraliste, le prolétariat est en train de développer une réflexion en profondeur sur la signification du chômage massif, sur les attaques à répétition, sur le démantèlement des systèmes de retraite et de protection sociale. A terme, la politique anti-ouvrière de la bourgeoisie et la riposte prolétarienne ne peuvent que déboucher sur une prise de conscience croissante, au sein de la classe ouvrière, de la faillite historique du capitalisme. Le prolétariat n’a pas à participer à la fabrication de ses propres chaînes, mais à les briser ! Au renforcement de l’Etat capitaliste, les ouvriers doivent répondre par la volonté de sa destruction !
L’alternative qui se pose aujourd’hui est donc la même que celle dégagée par les gauches marxistes dans les années 1920 : électoralisme et mystification de la classe ouvrière ou développement de la conscience de classe et extension des luttes vers la révolution ! n
D. (d'après Internationalisme n° 331, avril 2007)
(1) Plate-forme du CCI.
(2) Le CCI est l’héritier de cette Gauche communiste et nos positions en sont le prolongement.
(3) Lire cet article d’Internationalisme n°36 de juillet 1948, reproduit dans la Revue Internationale n°36.
Rubrique:
La pire des attaques à nos conditions de vie (pour le moment), jusqu'où ? comment riposter ? (tract)
- 1079 reads
Voici un tract avec lequel notre section en Espagne dénonce la pire attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière, une attaque qui paraîtra pourtant “légère” en comparaison à celles qui vont venir. C’est aussi une analyse de la situation, qui essaie d’apporter des solutions aux dernières luttes.

En 1984, le gouvernement du PSOE (Parti socialiste, de gauche) imposa la première Réforme du travail ; il y a tout juste trois mois, le gouvernement actuel du PP (Parti populaire, de droite) a mis en place la plus grave des Réformes du travail connue jusqu’ici. En 1985, le gouvernement du PSOE fit la première Réforme des retraites ; en 2011, un autre gouvernement de ce même PSOE en imposa une autre. Pour quand la prochaine ? Depuis plus de 30 ans, les conditions de vie des travailleurs ont empiré graduellement, mais depuis 2010 cette dégradation a pris un rythme frénétique et, avec les nouvelles mesures gouvernementales du PP, elle a atteint des niveaux qui, malheureusement, sembleront bien bas lors des futures attaques. Il y a, par-dessus le marché, un acharnement répressif de la part de la police : violence contre les étudiants à Valence en février dernier, matraquage en règle des mineurs, usage de balles en caoutchouc utilisées, entre autres, contre des enfants. Par ailleurs, le Congrès est carrément protégé par la police face aux manifestations spontanées qui s’y déroulent depuis mercredi dernier et qui s’y sont renouvelées dimanche 15 juillet...
Nous, l’immense majorité, exploitée et opprimée, mais aussi indignée ; nous, travailleurs du public et du privé, chômeurs, étudiants, retraités, émigrés..., nous posons beaucoup de questions sur tout ce qui se passe. Nous devons tous, collectivement, partager ces questionnements dans les rues, sur les places, sur les lieux de travail, pour que nous commencions tous ensemble à trouver des réponses, à donner une riposte massive, forte et soutenue.
L’effondrement du capitalisme
Les gouvernements changent, mais la crise ne fait qu’empirer et les coupes sont de plus en plus féroces. On nous présente chaque sommet de l’UE, du G20, etc.., comme la “solution définitive”... qui, le jour suivant, apparaît comme un échec retentissant ! On nous dit que les coupes vont faire baisser la prime de risque, et ce qui arrive est tout le contraire. Après tant et tant de saignées contre nos conditions de vie, le FMI reconnaît qu’il faudra attendre… 2025 (!) pour retrouver les niveaux économiques de 2007. La crise suit un cours implacable et inexorable, faisant échouer sur son passage des millions de vies brisées.
Certes, il y a des pays qui vont mieux que d’autres, mais il faut regarder le monde dans son ensemble. Le problème ne se limite pas à l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, et ne peut même pas se réduire à la “crise de l’euro”. L’Allemagne est au bord de la récession et déjà, il s’y trouve 7 millions de mini-jobs (avec des salaires de 400 €) ; aux Etats-Unis, le chômage part en flèche à la même vitesse que les expulsions de domicile. En Chine, l’économie souffre d’une décélération depuis 7 mois, malgré une bulle immobilière insensée qui fait que, dans la seule ville de Pékin, il y a 2 millions d’appartements vides. Nous sommes en train de souffrir dans notre chair la crise mondiale et historique du système capitaliste dont font partie tous les Etats, quelle que soit l’idéologie officielle qu’ils professent –“communiste” en Chine ou à Cuba, “socialiste du 21ème siècle” en Équateur ou au Venezuela, “socialiste” en France, “démocrate” aux Etats-Unis, “libérale” en Espagne ou en Allemagne. Le capitalisme, après avoir créé le marché mondial, est devenu depuis presque un siècle un système réactionnaire, qui a plongé l’humanité dans la pire des barbaries (deux guerres mondiales, des guerres régionales innombrables, la destruction de l’environnement...) ; aujourd’hui, depuis 2007, après avoir bénéficié de moments de croissance économique artificielle à base de spéculation et de bulles financières en tout genre, il est en train de se crasher contre la pire des crises de son histoire, plongeant les États, les entreprises et les banques dans une insolvabilité sans issue. Le résultat d’une telle débâcle, c’est une catastrophe humanitaire gigantesque. Tandis que la famine et la misère ne font qu’augmenter en Afrique, en Asie et en Amérique latine, dans les pays “riches”, des millions de personnes perdent leur emploi, des centaines de milliers sont expulsées de leur domicile, la grande majorité n’arrive plus à boucler les fins de mois ; le renchérissement de services sociaux ultra-réduits rend l’existence très précaire, ainsi que la charge écrasante des impôts, directs et indirects.
L’Etat démocratique c’est la dictature de la classe capitaliste
Le capitalisme divise la société en deux pôles : le pôle minoritaire de la classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien ; et le pôle majoritaire des classes exploitées, qui produit tout et reçoit de moins en moins. La classe capitaliste, ce 1 % de la population comme le disait le mouvement Occupy aux États-Unis, apparaît de plus en plus corrompue, arrogante et insultante. Elle cumule les richesses avec un culot indécent, se montre insensible face aux souffrances de la majorité et son personnel politique impose partout des coupes et de l’austérité... Pourquoi, malgré les grands mouvements d’indignation sociale qui se sont déroulés en 2011 (Espagne, Grèce, Etats-Unis, Egypte, Chili etc..), continue-t-elle avec acharnement à appliquer des politiques contre les intérêts de la majorité ? Pourquoi notre lutte, malgré les précieuses expériences vécues, est si en dessous de ce qui serait nécessaire ?
Une première réponse se trouve dans la tromperie que représente l’Etat démocratique. Celui-ci se présente comme étant “l’émanation de tous les citoyens” mais, en vérité, il est l’organe exclusif et excluant de la classe capitaliste, il est à son service, et pour cela il possède deux mains : la main droite composée de la police, des prisons, des tribunaux, des lois, de la bureaucratie avec laquelle elle nous réprime et écrase toutes nos tentatives de révolte ; et la main gauche, avec son éventail de partis de toutes idéologies, avec ses syndicats apparemment indépendants, avec ses services de cohésion sociale qui prétendent nous protéger..., qui ne sont que des illusions pour nous tromper, nous diviser et nous démoraliser.
A quoi ont-ils servi, tous ces bulletins de vote émis tous les quatre ans ? Les gouvernements issus des urnes ont-ils réalisé une seule de leurs promesses ? Quelle que soit leur idéologie, qui ont-ils protégé ? Les électeurs ou le capital ?
À quoi ont servi les réformes et les changements innombrables qu’ils ont faits dans l’éducation, la sécurité sociale, l’économie, la politique, etc.. ? N’ont-t-ils pas été en vérité l’expression du “tout doit changer pour que tout continue pareil” ? Comme on le disait lors du mouvement du 15-Mai : “On l’appelle démocratie et ça ne l’est pas, c’est une dictature mais on ne le voit pas.”
Face à la misère mondiale, révolution mondiale contre la misère !
Le capitalisme mène à la misère généralisée. Mais ne voyons pas dans la misère que la misère ! Dans ses entrailles se trouve la principale classe exploitée, le prolétariat qui, par son travail associé – travail qui ne se limite pas à l’industrie et à l’agriculture mais qui comprend aussi l’éducation, la santé, les services, etc.. –, assure le fonctionnement de toute la société et qui, par là même, a la capacité tant de paralyser la machine capitaliste que d’ouvrir la voie à une société où la vie ne sera pas sacrifiée sur l’autel des profits capitalistes, où l’économie de la concurrence sera remplacée par la production solidaire pour la pleine satisfaction des besoins humains. En somme, une société qui dépasse le nœud de contradictions dans lesquelles le capitalisme tient l’humanité prisonnière.
Cette perspective, qui n’est pas un idéal mais le fruit de l’expérience historique et mondiale de plus de deux siècles de luttes du mouvement ouvrier, paraît cependant aujourd’hui difficile et lointaine. Nous en avons déjà mentionné une des causes : on nous berce avec l’illusion de l’Etat démocratique. Mais il y a d’autres causes plus profondes : la plupart des prolétaires ne se reconnaissent pas comme tels. Nous n’avons pas confiance en nous-mêmes en tant que force sociale autonome. Par ailleurs, et surtout, le mode de vie de cette société, basé sur la concurrence, sur la lutte de tous contre tous, nous plonge dans l’atomisation, dans le chacun pour soi, dans la division et l’affrontement entre nous.
La conscience de ces problèmes, le débat ouvert et fraternel sur ceux-ci, la récupération critique des expériences de plus de deux siècles de lutte, tout cela nous donne les moyens pour dépasser cette situation et nous rend capables de riposter. C’est le jour même (11 juillet) où Rajoy a annoncé les nouvelles mesures que quelques ripostes ont immédiatement commencé à poindre. Beaucoup de monde est allé à Madrid manifester sa solidarité avec les mineurs. Cette expérience d’unité et de solidarité s’est concrétisée les jours suivants dans des manifestations spontanées, appelées à travers les réseaux sociaux. C’était une initiative, hors syndicats, propre aux travailleurs du public ; comment la poursuivre en sachant qu’il s’agit d’une lutte longue et difficile ? Voici quelques propositions :
La lutte unitaire
Chômeurs, travailleurs du secteur public et du privé, intérimaires et fonctionnaires, retraités, étudiants, immigrés, ensemble, nous pouvons. Aucun secteur ne peut rester isolé et enfermé dans son coin. Face à une société de division et d’atomisation nous devons faire valoir la force de la solidarité.
Les assemblées générales et ouvertes
Le capital est fort si on laisse tout entre les mains des professionnels de la politique et de la représentation syndicale qui nous trahissent toujours. Il nous faut des assemblées pour réfléchir, discuter et décider ensemble. Pour que nous soyons tous responsables de ce que nous décidons ensemble, pour vivre et ressentir la satisfaction d’être unis, pour briser les barreaux de la solitude et de l’isolement et cultiver la confiance et l’empathie.
Chercher la solidarité internationale :
Défendre la nation fait de nous la chair à canon des guerres, de la xénophobie, du racisme ; défendre la nation nous divise, nous oppose aux ouvriers du monde entier, les seuls pourtant sur lesquels nous pouvons compter pour créer la force capable de faire reculer les attaques du capital.
Nous regrouper
Nous regrouper dans les lieux de travail, dans les quartiers, par Internet, dans des collectifs pour réfléchir à tout ce qui se passe, pour organiser des réunions et des débats qui impulsent et préparent les luttes. Il ne suffit pas de lutter ! Il faut lutter avec la conscience la plus claire de ce qui arrive, de quelles sont nos armes, de qui sont nos amis et nos ennemis !
Tout changement social est indissociable d’un changement individuel
Notre lutte ne peut pas se limiter à un simple changement de structures politiques et économiques, c’est un changement de système social et, par conséquent, de notre propre vie, de notre manière de voir les choses, de nos aspirations. Ce n’est qu’ainsi que nous développerons la force de déjouer les pièges innombrables que nous tend la classe dominante, de résister aux coups physiques et moraux qu’elle nous donne sans trêve. Nous devons développer un changement de mentalité qui nous ouvre à la solidarité, à la conscience collective, lesquelles sont plus que le ciment de notre union, mais aussi le pilier d’une société future libérée de ce monde de concurrence féroce et de mercantilisme extrême qui caractérise le capitalisme. n
CCI / 16.07.2012
Rubrique:
La situation en Syrie et au Mali révèle l'avenir dans le capitalisme
- 1314 reads
 Depuis plus d’un an et demi en Syrie, le pouvoir d’Assad bombarde, massacre, viole et torture, sous les yeux d’une “communauté internationale” qui se répand en lamentations hypocrites sur le sort d’une population syrienne soumise quotidiennement à toutes ces horreurs. De part et d’autre, les réunions internationales se multiplient, dénonçant les 16.000 morts de la répression syrienne, tout comme les appels à la paix assortis de menaces plus stériles les unes que les autres. Bernard Henry Lévi, ce “philosophe” représentant sans faille des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française et insatiable samouraï des plateaux télés et des salons parisiens depuis la guerre en ex-Yougoslavie, n’en peut plus d’appeler à l’intervention militaire en Syrie, à l’instar des États-Unis dont le doigt est sur la gâchette pour régler son compte au potentat syrien.
Depuis plus d’un an et demi en Syrie, le pouvoir d’Assad bombarde, massacre, viole et torture, sous les yeux d’une “communauté internationale” qui se répand en lamentations hypocrites sur le sort d’une population syrienne soumise quotidiennement à toutes ces horreurs. De part et d’autre, les réunions internationales se multiplient, dénonçant les 16.000 morts de la répression syrienne, tout comme les appels à la paix assortis de menaces plus stériles les unes que les autres. Bernard Henry Lévi, ce “philosophe” représentant sans faille des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française et insatiable samouraï des plateaux télés et des salons parisiens depuis la guerre en ex-Yougoslavie, n’en peut plus d’appeler à l’intervention militaire en Syrie, à l’instar des États-Unis dont le doigt est sur la gâchette pour régler son compte au potentat syrien.
Et, depuis six mois, le Mali est entré dans une situation de guerre qui n’offre elle aussi aucune perspective d’apaisement avant longtemps. Là encore, les dignes représentants de la bourgeoisie démocratique occidentale n’ont de cesse de s’offusquer et de s’inquiéter de l’enfer qui attend les habitants de cette région où les bandes armées peu ou prou islamistes sévissent sans vergogne. Mais qu’en est-il de ces velléités et de tout ce battage médiatique censé nous interpeller sur le sort de ces deux pays en particulier ? Rien ! Du vent et encore du vent !
Non seulement les grandes puissances ne se préoccupent au fond aucunement de la barbarie que vivent les populations vivant en Syrie ou au Mali, comme partout ailleurs, mais elles n’ont pour réelle problématique que de calculer les bénéfices possibles à tirer d’une intervention militaire et les risques qui en découleraient.
Ces deux situations sont une expression critique de l’impasse dans laquelle se trouve le monde capitaliste et de l’impuissance dans laquelle sont plongées les puissances occidentales.
Au Mali, une population prise au piège…
Au Mali, il s’agit d’un imbroglio qui est directement issu à la fois de la pourriture sociale qu’a laissé derrière lui le colonialisme français et de son incapacité à faire vivre un État malien suffisamment stable. L’explosion des différentes fractions qui sont apparues ces derniers mois en dit assez long sur l’état de déliquescence de toute cette région, bien au-delà du Mali proprement dit. De l’Aqmi au Mnla en passant par les divers groupes dissidents et opposants au régime de Bamako, tous plus “vrais croyants” les uns que les autres, il s’agit de cliques de bandits armés qui ne sont pas apparues hier par enchantement. On nous dit que le facteur déclenchant de cette nouvelle zone de chaos sahélienne a été le retour des touaregs anciennement enrôlés par Khadafi, c’est-à-dire de centaines d’hommes entraînés, aguerris, et traînant avec eux des armes lourdes.
Comme s’il ne fallait pas s’y attendre ! Comble de “surprise”, la Libye n’ayant pas de frontières communes avec le Mali, les touaregs ont dû franchir deux frontières : Libye-Algérie et Algérie-Mali. Et ils n’ont même pas été désarmés (!), venant grossir de façon significative les rangs et les forces d’une rébellion touarègue chronique, excitant de ce fait les appétits des petits truands locaux et régionaux.
Car le ver était depuis longtemps dans le fruit. Le Mali, avec l’ensemble du Sahel, fait en effet partie de ces endroits historiquement difficilement contrôlables du fait de l’existence d’une myriade de populations aux cultures différentes et parmi lesquelles les ex-puissances coloniales, en l’occurrence la France, ont pendant plus de 150 ans excité et entretenu les dissensions, selon l’adage : “diviser pour mieux régner”. Et si la situation actuelle est le produit de ce qu’on appelait la “Françafrique”, elle ne peut qu’être aggravée par la guerre larvée qui se mène entre les États-Unis et la France depuis vingt ans pour le contrôle du marché des matières premières africaines.
Après le Soudan, il n’est donc pas impossible que le Mali connaisse une partition en deux États. En attendant, une épidémie de choléra se développe à Goa, que les islamistes forcenés ont de surcroît miné aux alentours, prenant toute la population en otage. Mais, soyons rassurés, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à des sanctions contre les rebelles du nord du Mali dans une résolution adoptée à l’unanimité jeudi, tandis que la Cedeao refuse toute ingérence militaire occidentale dans le pays !
… comme en Syrie
Ville après ville, le pays est soumis à un bombardement d’artillerie intense et la population est piégée dans les maisons ou les caves, privée de nourriture et d’électricité durant des jours, voire des semaines. Les snipers de l’armée s’installent sur les toits, cueillant ceux qui sont assez fous pour tenter de trouver à manger pour leurs familles. Et lorsque la ville tombe au bout du compte, toutes les familles sont frappées de façon directe et personnelle, soit par les soldats de l’armée régulière, ou plus fréquemment – du fait des désertions massives des soldats dégoûtés de ce qu’ils ont été contraints de faire – par des bandes de vagues criminels nommés “Shabiha”, c’est-à-dire des “fantômes”. Les deux massacres les plus connus ont eu lieu à Houla et Mazraat al-Qubair, mais ils sont loin d’être les seuls exemples.
Avec l’arrogance la plus éhontée, les porte-parole du régime justifient ces bains de sang par l’existence de “groupes terroristes armés” qui auraient pris place dans les villes en question. Très souvent, ils accusent même les massacres les plus médiatisés de femmes et d’hommes comme étant du fait de ces groupes, agissant prétendument pour jeter le discrédit sur le gouvernement.
Devant les larges protestations qui ont surgi contre sa domination lors d’autres mouvements massifs à travers l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Bashar el-Assad a essayé de suivre les traces de son père : en 1982, Hafez el-Assad avait dû faire face à un autre soulèvement, conduit par les Frères musulmans et concentré sur Hama. Le régime avait envoyé l’armée et provoqué une atroce boucherie : le nombre de morts a été estimé entre 17.000 et 40.000. La révolte fut écrasée et la dynastie Assad a pu maintenir un contrôle plus ou moins contesté sur le pays pendant presque 30 ans.
Ce qui a débuté l’an dernier comme une révolte populaire non-armée contre le régime d’Assad s’est transformé en guerre locale entre les puissances impérialistes régionales et mondiales. L’Iran, allié principal de la Syrie dans la région, se tient fermement aux côtés d’Assad, et on sait que des Gardiens de la Révolution ou autres agents de la République islamique travaillent sur le terrain et sont complices de la campagne de terreur d’Assad. Ce dernier continue également de profiter de la protection de la Russie et de la Chine, qui s’activent au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour bloquer les résolutions condamnant son gouvernement et appelant à des sanctions. Même si la Russie a été contrainte, devant les atrocités commises, de modérer sa position, faisant ses premières critiques timides des massacres d’Assad, son soutien à une politique de “non-intervention” revient à renforcer son aide massive en armes envers la Syrie. Hillary Clinton a récemment accusé la Russie d’alimenter la Syrie en hélicoptères d’attaques – ce à quoi le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a répondu que les hélicoptères n’avaient qu’une destination “défensive” et que, de toute façon, l’Ouest armait les rebelles. Ce qui est également vrai.
Car dès que l’opposition s’est coalisée en force bourgeoise politique sérieuse autour de l’Armée libre de Syrie et du Conseil national syrien, il y a eu des acheminements d’armes depuis l’Arabie Saoudite et le Qatar.
Quant à la Turquie, alors qu'elle a longtemps manifest de bonnes relations avec le régime d'Assad, ces derniers mois ont vu son discours radicalement changer avec une condamnation de son inhumanité, offrant sa protection aux militaires dissidents et aux réfugiés fuyant le massacre.
Au niveau militaire, elle a amassé des forces considérables sur sa frontière syrienne et, dans le même discours accusant Moscou de soutenir la Syrie, Hillary Clinton a suggéré que l'arrivée massive de troupes syriennes autour d'Aleppo, proche de la frontière turque, "pourrait bien être une ligne rouge pour les Turcs en termes de défense de leurs intérêts nationaux stratégiques." De la part de l'Etat turc, il s'agit d'une politique de provocation évidente (1) destinée à lui assurer aux yeux des puissances occidentales un statut renforcé de puissance majeure au niveau régional.
La politique de terreur, loin de renforcer la main de fer d’Assad sur le pays, a fait bouillir le tout dans une perspective de conflit impérialiste imprévisible. Les divisions ethniques et religieuses à l’intérieur du pays ne cessent de s’accroître. Les Iraniens soutiennent la minorité Alawite, c’est-à-dire les Saoudiens, et sans aucun doute tout un tas de djihadistes hors de contrôle attirés par le conflit, afin d’imposer une sorte de régime sunnite. Les tensions montent aussi entre chrétiens et musulmans, et entre Kurdes et Arabes. Le tout dans un contexte où Israël fait pression sur les États-Unis pour attaquer l’Iran et menace de faire le boulot lui-même. Aussi, une escalade de la guerre en Syrie aurait pour effet de mettre encore plus en lumière la question de l’Iran, avec les conséquences encore plus dévastatrices qui s’ensuivraient.
Les répercussions sociales et politiques d’un nouveau théâtre de guerre s’ouvrant aux grandes puissances dans cette région syrienne ravagée seraient incalculables. Il en est de même au Mali où le risque d’embrasement de tout le Sahel est réel avec la création d’un immense foyer de conflits traversant l’Afrique d’Ouest en Est.
Nous ne pouvons donc pas prédire si les puissances occidentales interviendront dans la période à venir, que ce soit en Syrie ou au Mali, car la situation ne serait alors probablement pas contrôlable. Mais qu’elles le fassent ou non, les morts s’entassent et leurs grands discours “humanitaires” montrent ce qu’ils valent : mensonges, mépris des populations et calculs d’intérêts.
Wilma/7.07.2012
(1) La destruction d'un avion turc dans l'espace aérien libyen en est une preuve.
Géographique:
- Afrique [3]
- Moyen Orient [4]
Rubrique:
C'est quoi en fait l'impérialisme ? Dans quel contexte surgit-il ? quelle est son origine ?
- 20969 reads
Le texte que nous publions ci-dessous faisait figure d’introduction à une discussion du cercle de discussion Spartacus le 11 mars à Anvers.
Le cercle Spartacus se définit comme suit : " Spartacus est l’initiative de quelques jeunes qui veulent consciemment créer des moments de clarification politique en confrontant différents points de vue et visions. Nous voulons créer un endroit où l’on peut mener un débat libre sur des sujets engagés. Spartacus doit devenir selon nous un groupe engagé et militant et pas un ‘club de baratineurs’ académiste ou lieu de ‘formation’ scolaire. Car pour un meilleur monde, il faut lutter. Cependant, la question qui se pose est " Comment ? ". Le sens d’un groupe de discussion se reflète dans cette question, où la théorie et la pratique se joignent. En discutant, nous espérons développer notre propre conscience et celles des autres sur nos actes.(…) "
Le texte introductif développe très bien la question de l’impérialisme au cours de l’histoire, dès les sociétés antiques jusqu’à la société capitaliste, ce que nous avons souligné lors de cette soirée.
(https://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2012/03/10/inleiding-imperialisme/#more-1234 [5])
Ce qui selon notre point de vue manquait était l’insistance qui doit être mis sur le rôle que l’impérialisme va jouer dès que le capitalisme dépasse son sommet de développement. C’est surtout Rosa Luxemburg qui au début du 20ième siècle va lier la question de la crise de surproduction avec la tendance générale de la politique impérialiste appliquée par tous les États et pose ainsi les bases pour la combattre efficacement.
Comme l’écrivait Rosa Luxembourg, “L'impérialisme actuel est (…) la dernière étape de son processus historique d'expansion : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des états capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe. Dans cette phase finale, la catastrophe économique et politique constitue l'élément vital, le mode normal d'existence du capital, autant qu'elle l'avait été dans sa phase initiale, celle de l' " accumulation primitive ". (…) De même, dans la phase finale de l'impérialisme, l'expansion économique du capital est indissolublement liée à la série de conquêtes coloniales et de guerres mondiales que nous connaissons. (…) Ainsi l'impérialisme ramène la catastrophe, comme mode d'existence, de la périphérie de son champ d'action à son point de départ. (…)l'expansion capitaliste précipite aujourd'hui les peuples civilisés de l'Europe elle-même dans une suite de catastrophes dont le résultat final ne peut être que la ruine de la civilisation ou l'avènement de la production socialiste. A la lumière de cette conception, l'attitude du prolétariat à l'égard de l'impérialisme est celle d'une lutte générale contre la domination du capital..”( R. Luxemburg,Critique des critiques).
(Voir aussi : https://fr.internationalism.org/ri372/imperialisme.html#sdfootnote1sym [6])
Une grande partie de ce travail n'est pas sur l'impérialisme même parce que le terme impérialisme est souvent utilisé en vase clos et souvent à propos d’appareils d’États ou de politique étrangère de certains États. Toutefois, il est important de voir l'impérialisme comme un développement historique associé à d'autres développements qui font partie d’une certaine logique. Ce texte ne vise donc pas tellement à chercher à définir bêtement l'impérialisme mais surtout à mettre à nu cette "logique". De cette expérience, il m'est apparu clairement que chercher à définir l'impérialisme est un exercice qui porte peu de fruits pour une meilleure compréhension politique. Or, c'est bien cela que nous recherchons ?
Une quête de l'impérialisme.
Nous recherchons une définition de l'impérialisme qui nous donne une compréhension de quelque chose dont nous pouvons pointer ce qui en fait partie (par ex. Les guerres), mais pas quels sont les critères qui font en sorte que certains phénomènes historiques en font partie. Nous voulons avant tout que ces critères nous offrent une compréhension de ce qui est typique des conflits entre les États, à notre époque.
Une première tentative.
A première vue, définir ce qu'est l'impérialisme ne semble pas être si difficile. Nous pouvons faire référence à l'élément central dans impérialisme: "Imperium". Imperium renvoie à la possibilité de commander (en latin : imperare). Mais toutefois, le mot "Imperium" nous fait plutôt penser à un type spécifique d'État et l'exemple typique en Europe Occidentale est l'Empire romain (Latin : Imperium Romanum).
Mais un (ou plusieurs) Empire(s) ne semble pas suffire pour parler d'impérialisme. En effet, un "isme" se réfère à une propagation plus large, une tendance générale, une idéologie, une ère ou quelque chose de similaire (1).
Une seconde tentative : États et lutte.
Nous devons donc chercher une tendance générale qui est censée se trouver dans une période historique. Supposons un instant que l'impérialisme est une période où les États essayent de construire un empire mondial. Les États entrent alors en conflit. Dans une telle définition, l'impérialisme est de tous les temps. Des périodes historiques dans lesquelles de tels conflits permanents pour des territoires existaient sont nombreux. Nous pensons par exemple aux guerres entre l'Empire romain et les Sassanides (250-550 après JC), les Mayas et leurs peuples voisins (250-900 après JC), les Grecs et les Perses (400 av. J.-C. – 60 après JC), les Turcs et les arabes (av. 1000-1200 après JC) etc.
L’avidité de conquête semble fondamentale pour l'impérialisme. Pourtant, je dirais que ce ne sont pas des exemples d’impérialisme. Nous devons affiner pour en avoir une meilleure compréhension. Un exemple pour démontrer que de tels conflits ne relèvent pas de l’impérialisme: la guerre de Cent Ans (1337-1453) entre la maison de Valois (France) et la maison de Plantagenet (Angleterre) pour le trône du royaume Occidental des Francs tel qu'il a surgi après la division de l'empire carolingien (888 après JC). Ce combat impliquait deux appareils d’État développés qui convoitaient les mêmes zones. Les deux maisons possédaient déjà des territoires et si l’une obtenait la victoire sur l’autre, cela lui garantissait la domination sur l’Europe occidentale.
Mais je pense qu'une telle définition de l'impérialisme rend trop peu en évidence les développements des 300 dernières années qui ont donné naissance au terme impérialisme même. La base : l'impérialisme est une période historique dans laquelle les États entrent en conflit entre eux parce qu'ils tentent de conquérir des territoires les uns des autres. Mais nous devons ajouter deux autres hypothèses: 1) les États concernés ne sont pas en premier lieu intéressés dans un territoire aussi vaste que possible et 2) les zones pour lesquelles les États se battent ne font pas parties des territoires des États impérialistes, mais de territoires d’autres États, moins puissants (à condition que des États existent sur ce territoire). La Guerre de Cent ans dans ce sens n'est pas une guerre impérialiste : il s'agissait de territoires appartenant aux deux États qui étaient intéressés par un territoire aussi grand que possible. La raison pour cela réside dans l'utilité spécifique de ces territoires au cours de la guerre de Cent ans : plus de territoire signifiait plus de seigneurs tributaires qui à leur tour saignaient la pyramide de soumis. Il importait peu quel territoire l'on capturait: toutes les régions d'Europe connaissaient la même structure et leur conquête donnait tout simplement au roi plus de revenus. Peu importait si l'on pouvait acquérir le comté de Hollande, le Royaume de Bohême ou le comté de Navarre. Au Moyen Age, tous les territoires étaient similaires. L'impérialisme implique donc une troisième chose: 3) que les États aient un intérêt réel dans des caractéristiques économiques très spécifiques de la zone concernée. Il est de plus en plus évident que l'impérialisme est enraciné dans le capitalisme.
L'impérialisme et ses prédécesseurs.
Nous commençons avec l’État-Cité, comme il existait par exemple dans la Grèce classique, à la fin du Moyen-Âge Européen et le Moyen-Âge islamique. L’État-Cité s'est formé comme un lieu de rassemblement de commerçants dans un endroit sûr souvent créé par la présence militaire. Le commerce se faisait avec d'autres (proto-)villes et la campagne environnante. Les commerçants de la ville avaient souvent une relation symbiotique avec les militaires : ils leur offraient les biens et services dont ils avaient besoin et les militaires donnaient les biens et l'argent dont les commerçants à leur tour avaient besoin. Souvent on était militaire et marchand en même temps, ou encore les habitants de la ville étaient censés contribuer à la puissance militaire comme réservistes. L’État-Cité, puissance économique et militaire, était en mesure de soumettre tant militairement qu'économiquement la campagne environnante. L'utilité de cette domination réside dans les relations économiques inégales qui en résultent. Une campagne indépendante permettait à l'agriculteur de décider ce qu'il produisait et éventuellement avec qui il échangeait contre son prix. La soumission à une ville signifiait, dans le cas le moins grave, que l'agriculteur ne pouvait écouler son produit qu’uniquement dans la ville dominante. Cependant, existait également la situation où l'agriculteur était obligé de céder une partie de sa production (p. ex. en Mésopotamie antique) ou encore où il récupérait une partie de ses biens en devises de la ville (p. ex. Le Levant médiéval), ou encore où il devait céder la totalité de son produit et où sa famille devenait esclave de la ville (p. ex. en Grèce Antique).
Un exemple : la ville de Rome, dans les premiers siècles avant J.C. Elle était impliquée dans une guerre éternelle avec Carthage. Après une longue guerre, les Romains ont détruit Carthage mais ont conquis la campagne environnante (!) pour s’approprier l’abondante production de grain. Carthage ne pouvait plus appliquer des prix élevés sur le troc, la campagne répondait maintenant directement à Rome. Il en va de même pour beaucoup d'États-Cités, sous une forme ou une autre: l'assujettissement d'autres territoires plus faibles afin d’acquérir de ces territoires un plus grand bénéfice.
Comme dans l'impérialisme moderne il y avait souvent des alliances entre les États-Cités afin de défendre conjointement les intérêts individuels.
Dans le haut moyen-âge européen, la campagne était dominante et les villes soumises aux seigneurs ruraux qui les dominaient par leur importance économique et supériorité numérique. Les rois et les empereurs, qui étaient supérieurs aux seigneurs ruraux mais fortement dépendant d'eux, ont vu des opportunités dans les villes émergentes. Parce que les seigneurs organisaient eux-mêmes ce qui allait dans les caisses du roi, celui-ci commence bientôt à comprendre que les nouvelles villes offraient une occasion de consolider son propre pouvoir. Les villes émergentes et en expansion étaient exemptées des revendications des seigneurs locaux, étaient des refuges où les serfs en fuite pouvaient s'établir et étaient directement soumises et tributaires du roi ou de l'empereur. Un exemple d'un roi qui maîtrisait bien ce processus était, par exemple. Frédéric I, ou Barberousse. Ces villes devenaient ce que l'on appelait " villes Royales " ou " Villes de la Couronne ". Au travers des siècles, les villes et ses citoyens dépassaient par une croissance proto-capitaliste les seigneurs "appauvris". Nous utilisons ici des parenthèses parce que les seigneurs locaux ne produisent pas substantiellement plus ou moins (ils ont toujours été "pauvres"). La ville, mais surtout la campagne qui tombait sous l'influence de la ville, connaissaient une croissance beaucoup plus rapide. En Europe occidentale, par exemple en Hollande, la campagne fut capitalisée au XVe siècle (au lieu d’être féodalisée). La terre pouvait être vendue (chose inconcevable auparavant), et les agriculteurs incorporés comme travailleurs libres sur ces mêmes terres. Les propriétaires de la terre, vous l'aurez bien sûr deviné étaient: les citoyens des villes. Les États modernes, comme nous venons de le décrire avec des villes dominantes et un roi central ou une structure républicaine, ont connu la prospérité. La force et la portée des pays riches se sont accrues parce qu'il y avait croissance économique. C'est l'endroit où s'est créé ce que nous appelons "l'impérialisme".
Impérialisme
L'impérialisme est le processus par lequel des États nationaux ou pré-nationaux, par des moyens de soumission économique et militaire, rendent des régions économiquement plus faibles dépendantes d’un État dominant. Cela crée nécessairement un conflit entre ces États nationaux, car les régions économiquement plus faibles sont rares. Ce processus a commencé à se produire à partir du début du 16ème siècle dans les États européens, par exemple avec la Compagnie des Indes orientales dans la République des Sept Provinces des Pays-Bas-Unis. Toutefois, cela ne signifie pas que seuls les États européens sont impérialistes : c'est un processus, une logique de conflit entre États dans le cadre du capitalisme. Le but de conquérir ces régions économiquement plus faibles est double et les accents varient selon les circonstances: 1) réduire les coûts de production par des moyens de production moins chers ou 2) dominer le marché local pour écouler ses propres produits. On voit déjà surgir ces deux processus dans les relations entre la ville et la campagne, mais dans l'impérialisme, ils ont une nouvelle dimension. L'origine des deux se situe donc dans un (proto)-capitalisme. Qu’est-ce que j’entends par économiquement plus faible ? Je veux dire par là, essentiellement un manque de capital propre dans les limites d'une certaine région déterminée, où il devient impossible de développer soi-même une certaine puissance économique.
D'une part, cette zone reste militairement arriérée. La région se rend surtout intéressante par sa main d’œuvre moins coûteuse pour la production de produits à forte intensité de main-d'œuvre, surtout les matières premières rares. D’autre part, il y a aussi le potentiel d’écoulement des marchés que le capitalisme recherche dans les limites d'un territoire soumis. Par exemple, au XVII siècle, le Pendjab avait développé une proto-industrie où le lin était transformé en toutes sortes de produits. Par la conquête des anglais, avec un développement supérieur de leurs moyens de production, se développèrent rapidement des produits à base de lin meilleur marché à l’intérieur et pour le marché anglais. Quand celui-ci s’est avéré saturé et que le coût minimum du lin atteignait le fond, le lin a également été écoulé sur le marché du Pendjab (où là encore, un prix fort était demandé). Le résultat fut une famine dans le Pendjab, puisque pour le Pendjab, en raison de leurs produits coûteux, le marché en Grande-Bretagne était déjà devenu caduc. La destruction du marché local a été le coup de massue pour l'industrie des tisserands de lin. L'exemple provient d’Eric Hobsbawm.
Les marxistes à leur tour ont mis l’accent sur diverses composantes du processus, mais il existe une logique symbiotique entre les deux parties du processus. Une école récente de
Marxistes en sociologie/histoire, a essayé de réunir les deux en une seule description. Le sociologue Immanuel Wallerstein affirme qu’historiquement, les territoires étaient divisés en trois parties: le centre, les États semi-périphériques et les États périphériques. Les États centraux produisaient des biens et des services à forte valeur ajoutée, dont la production nécessitait un degré élevé de capital. Les États centraux essayaient activement de garder la compétitivité de leur capital sur leurs concurrents et la périphérie. Les États centraux ont une relation générale dominante sur les États périphériques. Les États périphériques vendent bon marché les matières premières nécessaires aux États centraux et importent de ces derniers les produits plus chers de haute qualité. Il en résulte un système de commerce mondial où l'impérialisme, la conquête d'autres États en vue d’importer et d’exporter forment une substance nécessaire dans la lutte concurrentielle de la bourgeoisie des centres.
Je pense avoir défini dans une certaine mesure l’impérialisme. Il y a encore suffisamment de place ici pour en discuter.
Pratique politique
Nous voulons nous positionner face à l'impérialisme. Mais à partir de quelles positions pouvons-nous choisir? Le court texte qui suit présente des idéologies qui ne sont pas élaborées mais plus une collection d'idées qui sont souvent combinées.
L'approche des conservateurs et libéraux. ans celle-ci, on suppose que la conquête des États n'a rien à voir avec une base matérielle de l'augmentation des profits, mais est considérée comme une partie nécessaire de la condition humaine. La guerre a été de tous les temps, les batailles entre les empires aussi. Un affaiblissement, une perte de volonté de se battre, une décadence, comme le conservateur historien Edward Gibbon l’appelle dans le cas de l'Empire romain, feront en sorte que les empires périssent. Il vaut mieux donc s’armer contre les autres groupes et territoires. Cela fait complètement abstraction de la nature historique de l'impérialisme !
Une forme particulière de cette approche conservatrice, est l'idée du "choc des civilisations" (Huntington). C'est l'idée que les empires se composent réellement de groupes culturellement homogènes qui devront combattre ensemble pour la vie et la mort. Mais ici aussi une base matérielle est niée. Le monde serait composé d’idéologies, de religions et de cultures qui pour des raisons encore obscures mais évidentes ne s’accordent pas les unes les autres une place au soleil.
L'approche sociale-démocrate . Ici, on préfère ne pas parler d’'impérialisme et on ne voit que les cas concrets d’exploitation dans les pays qui se trouvent à la périphérie. On essaie de remédier à ces cas d'exploitation par des accords internationaux ou par des interdits moraux. On part du fait qu’une entreprise (Nike) ou "un pays" (les mines de l'État chinois) exploite ses ouvriers, mais on ne tient pas compte du contexte plus large qui se trouve derrière. Au mieux, cela a à voir ou bien avec l'avarice des entreprises (sociaux-démocrates), la consommation excessive des Occidentaux (verts/consommation éthique), ou le fait que nos gouvernements nationaux interviennent peu dans la condamnation des violations du droit international (Chrétiens-démocrates). En aucun cas n’est vu le lien matériel.
L’approche socialiste nationale (trotskistes/staliniens) . Il est reconnu qu'il existe une base matérielle sous-jacente à l'impérialisme et la solution qui est proposée est un appel à soutenir activement les pays supposés " plus faibles " ou ayant une auréole " prolétarienne ". Par exemple : l’Anti-OTAN, Pour Chavez contre les États-Unis, etc.… Le problème ici est qu'à la base il est supposé que dans les conflits entre États, il y a quelque chose de "prolétarien". Cela n’est tout simplement pas le cas, et même si la classe ouvrière est activement impliquée dans un conflit (par exemple dans le cas où un fort sentiment anti-américanisme, qui est un nationalisme déguisé, est présent), il est naïf de croire que sa participation sert les intérêts de la classe ouvrière. Selon moi, un tas d’arguments contredisent l’idée que la classe ouvrière aurait un intérêt commun avec l’État qui la domine. Car, tous les États sont pris dans les mêmes restrictions bourgeoises. D’ailleurs, en se focalisant activement sur par exemple l’Anti-OTAN, on peut aussi devenir l’instrument de la bourgeoisie du Vénézuéla, Chine, Iran, etc.. En outre, dans certains conflits, il est difficile de savoir quel est le pays "le plus faible" parce que les nations sous-développées entre elles essaient aussi de grimper sur l’échelle du capitalisme. L'idée du " moindre impérialisme " que nous, socialistes, devrions prendre comme position lors d’un conflit me semble donc extrêmement dangereuse et insensée.
Une approche socialiste internationaliste. Dans cette approche, il est clair que tous les États fonctionnent à partir d'une logique qui leur est indiquée par les règles du capitalisme, et qui est inhérente à leur positionnement sur le terrain. Le remplacement d’un impérialisme par un autre, est dénué de sens parce que cela ne change en rien les règles du capitalisme international. La seule chose qu'on puisse faire, est de radicaliser la classe ouvrière et de lui expliquer la futilité du nationalisme dans ce jeu.
SP.L./11.03.2012
(1)Une comparaison pour clarifier cela. Ce n'est pas parce que nous pouvons découvrir quelqu'un au Moyen-Âge qui passe toute sa journée à accumuler l'argent acquis précédemment qu’on peut déjà parler de capitalisme. Pour parler de capitalisme, ce phénomène doit être généralisé et occuper une position dominante dans la société.
Vie du CCI:
Rubrique:
De quelle crise parlons-nous ? (cycle de discussion sur la crise, 1)
- 1428 reads
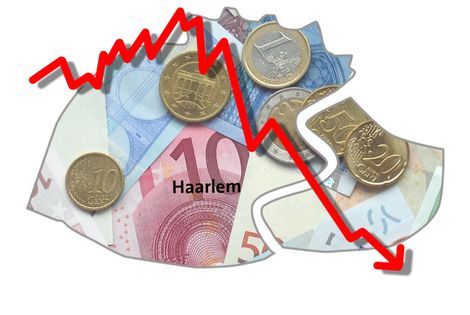
En avril et mai 2012, le CCI, ensemble avec ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
Dans la discussion l’accent a été mis sur la culture du débat et tous étaient invités à prendre part au débat. Nous soulignions que ce n’était pas une affaire d'experts car mêmes les plus grands experts économiques bourgeois n’avaient pas vu venir la crise. Et pourtant, ils dominent maintenant le débat dans les médias. A été posé le fait que pour nous il était grand temps que nous allions vers des arguments solides sur les causes des symptômes récurrents toujours plus graves de la crise et pourquoi cela ressemble de plus en plus à une crise du capitalisme en tant que système, aussi bien économiquement, socialement que politiquement. La question se pose : réforme ou renversement révolutionnaire?
Dans la contribution suivante, nous proposons la première introduction de ce cycle. La discussion qui a suivi a été très animée et traversée d’une participation enthousiaste de tous les participants.
Cette première discussion s’est centrée autour de quatre axes : la recherche d’une meilleure compréhension des définitions et concepts utilisés (argent et crédit, dette, marché, échange et valeurs d’usage, etc..); la crise historique du capitalisme (sa décadence) et la question de la surproduction ; le lien entre crise-guerre-reconstruction et le rôle de l'impérialisme, thèmes qui lançaient déjà les deux prochains tours de discussion.
Un recueil de textes a été créé au service des participants. Il peut aussi être envoyé sur simple demande.
Indéniablement, la crise se manifeste, et de manière particulièrement spectaculaire même, sur le plan financier : depuis la fin des années 1980, les banques ont reçu toute la latitude pour étendre leur politique de financement et de commercialisation de toutes sortes de produits financiers, de sorte qu’elles constituent aujourd’hui – même si c’est de manière virtuelle à travers les systèmes informatiques – un marché plus important que tous les secteurs non financiers réunis. En 2008, la totalité des transactions financières mondiales avait atteint la somme de 2.200.000 milliards de dollars, face à un Produit National Brut sur le plan mondial de 55.000 milliards. L’économie spéculative est en conséquence 40 fois plus importante que l’économie ‘réelle’. Or, durant ces dernières années, ces milliards ont été investis de manière croissante dans des placements totalement aberrants et autodestructeurs.
Durant ces 25 dernières années en effet, les transactions financières ne sont plus basées sur des valeurs réelles et intrinsèques, mais sont devenues un processus fonctionnant pleinement selon une logique propre. Le secteur financier a perdu tout contact avec la réalité économique, il n’est plus depuis longtemps au service de l’économie réelle, mais est basé sur de la plus-value irréelle, sur du vent. C’est bien là que se situe l’origine de l’accumulation hallucinante des dettes des gouvernements, des institutions financières, des entreprises et des particuliers.
Cette crise, est-elle à la base une crise hypothécaire ?
A la fin du 20e siècle, la bourgeoisie a donné le feu vert aux banques pour conclure des prêts hypothécaires plus importants que d’habitude à des taux de départ très bas. L’explosion du crédit hypothécaire a mené dans un grand nombre de pays à une hausse des prix immobiliers et des habitations. En offrant des prêts de plus en plus importants pour des prix fortement surévalués sur le marché immobilier, les banques sont arrivées à engranger sous la forme d’intérêts une partie de plus en plus importante du salaires des travailleurs.
A un moment donné, les taux ont toutefois été relevés pour contrer une inflation menaçante (la hausse du prix des habitations menait à une surchauffe sur le marché immobilier). Et soudain, une masse de familles ouvrières n’arrivaient plus à repayer leur crédit hypothécaire. Le phénomène des familles ouvrières liées pieds et poings à une hypothèque n’est cependant pas nouveau dans le capitalisme. Il l’a toujours accompagné et ne peut expliquer l’ampleur de la crise actuelle. Aujourd’hui, ces familles sont liées pieds et poings aux banques, avant, elles l’étaient au patron, comme on le sait à travers les rapports de Friedrich Engels : " ‘L’enchaînement du travailleur à sa propre maison’ existait déjà dans les années ’80 du 19e siècle. (Le fabriquant) Dolfuss et ses collègues essayaient de vendre aux travailleurs de petites maisons qu’ils devaient repayer en traites annuelles (...). De cette manière, les travailleurs avaient de lourdes charges hypothécaires sur le dos (...) et devenaient ensuite vraiment les esclaves de leurs patrons : ils étaient liés à leurs maisons, ils ne pouvaient pas s’en aller et ils devaient accepter sans rechigner n’importe quelles conditions de travail. " (Friederich Engels, 1887).
Mais aujourd’hui, le blocage ne touche pas le marché immobilier en soi, mais l’ensemble du mécanisme de marché, avec son caractère spéculatif exacerbé.
La crise s’explique-t-elle alors par une crise du crédit, une crise bancaire ?
Les prêts bancaires extravagants aux ménages et aux entreprises, qui ont déclenché la crise, n’avaient aucun caractère productif. Aucune valeur réelle n’était créée. Seuls les frais des marchandises et de services déjà existants ont augmenté à cause de cette politique des banques. D’une manière encore plus vulgaire, les assureurs ont vendu des polices avec de gigantesques frais cachés, ce qu’on appelle adéquatement des polices usuraires. D’une manière imagée, on pourrait dire que les banques et les assureurs ont gagné de l’argent en disposant des points de péage intermédiaires, pas en construisant de nouvelles routes.
Si ces banques ont réalisé des bénéfices, elles ont comme toutes les institutions partout dans le monde (fonds de pension, banques, sociétés immobilières) profité des bénéfices réalisés au moyen de prêts hypothécaires pourris, en particulier au niveau du marcher immobilier américain. Ces prêts hypothécaires pourris, ces investissements à hauts risques, ont été mélangé avec des investissements moins dangereux et proposés comme des produits boursiers par ces banques.
Et de par le fait que ces actions et obligations de ces banques et des compagnies d’assurance continuaient à monter, d’autres, qui voulaient également leur part du butin, commencèrent également à prendre plus de risques. Afin de participer à ce jeu de hasard, les banques (en tant que véritables entreprises d’utilité publique) reçurent l’autorisation de leurs Etats respectifs de réduire leurs réserves liquides au minimum. Les rentrées augmentaient en effet fortement. Ainsi, les fonds de pension aux Pays-Bas y gagnaient tellement que l’Etat a puisé deux fois dans leurs caisses dans les années ’90, parce qu’ils disposaient de tellement de réserves. La croissance exponentielle des bénéfices ne démontrait-elle pas que tout cela ne pouvait causer aucun souci.
Mais lorsqu’aux USA, la survaleur (virtuelle) disparut brusquement en fumée, les différentes institutions dans le reste du monde se réveillèrent avec la gueule de bois : Leurs placements dans des hypothèques pourries ne valaient du jour au lendemain pratiquement plus rien. Une fois de plus toutefois, ce phénomène n ‘est pas nouveau, nous l’avons déjà vu dans l’histoire, et il ne nous apprend rien sur les causes de l’actuelle crise. Un des phénomènes principaux de la Grande Dépression des années 1930 était la faillite d’un grand nombre de banques. A ce moment-là aussi, la confiance entre les banques descendit sous zéro (on se demandait avec angoisse : quelle banque a des crédits pourris et combien ?), ce qui fit que l’instillation de liquidités dans l’économie, la graisse indispensable au fonctionnement des mécanismes, s’arrêta presque complètement.
La cause de la crise doit-elle alors être trouvée auprès des spéculateurs, des fraudeurs ?
Ces dernières années, chaque effondrement boursier est effectivement allé de pair avec des cas de fraude. Et cela ne posait pas seulement la question des fraudeurs ! Ainsi, les magouilles de Madoff ont bien été contrôlées huit fois ces dernières seize années par toutes sortes d’organismes de contrôle, comme la Securities and Exchange Commission. Et malgré le fait que les contrôleurs avaient été informés sur des pratiques frauduleuses, ils n’ont jamais rien trouvé. Mais en décembre 2008, Bernard Madoff était brusquement un fraudeur. L’entreprise bancaire géante Lehman Brothers voyait s’évaporer 65 milliards de dollars. La même chose se passa en septembre 2011 avec Kweku Adoboli avec une " fraude " de 2,3 milliards de dollars auprès de la banque suisse UBS. En janvier 2008, Jérôme Kerviel provoqua une " fraude " de 4,82 milliards d’euros auprès de la banque française Société Générale.
Mais ici encore, la spéculation n’est pas un phénomène nouveau : " Un certain Sullivan se voit attribué au moment de son départ – pour une mission gouvernementale – vers une région d’Inde qui est éloignée des régions où l’on cultive l’opium, un contrat concernant l’opium. Sullivan vend son contrat pour £40.000 à un certain Binn. Binn vend ce contrat le même jour encore pour £60.000 et l’acheteur ultime et exécuteur du contrat déclara qu’il en tira encore malgré tout de substantiels bénéfices ". Et ce phénomène n’est par ailleurs pas non plus caractéristique pour la crise actuelle. Il existe depuis très longtemps dans le cadre du capitalisme. Marx a décrit à son époque l’activité destructrice du secteur financier et des spéculateurs comme " des chevaliers pillards du crédit ", une " classe parasitaire " : " le capital usuraire utilise le mode d’exploitation capitaliste, sans mettre en oeuvre le mode de production capitaliste ".
Bref, la spéculation accompagne toute l’histoire du capitalisme et ne peut donc fournir les fondements pour expliquer la crise actuelle.
S’agit-il enfin d’une crise de la dette souveraine des Etats ?
Lorsque les Etats ont décidé de sauver les banques du naufrage, on a vu la dette des Etats exploser. Suivant l’exemple " brillant " d’autres Etats de l’UE, le gouvernement grec a également injecté des capitaux importants dans les banques afin de les sauver de la faillite. Jusqu’à présent, les banques grecques ont reçu plus de 110 milliards de soutien financier sous diverses formes. Elles n’ont bien sûr jamais utilisé cet argent pour stimuler l’économie réelle. La dette de l’Etat grec avait bien augmenté jusqu’à des proportions inconsidérées. Sa dette correspondait déjà en 2008 à 125% du PIB et, à cause d’un déficit annuel de 12%, elle continuait à augmenter par bonds.
Mais à nouveau, la dette étatique n’est pas plus un phénomène nouveau au sein du capitalisme. Marx (Le Capital) en son temps expliquait déjà parfaitement en quoi consistait la dette d’Etat : " La dette de l’Etat implique que l’aliénation de l’Etat imprime sa marque sur l’ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui est véritablement la propriété collective des peuples modernes, est leur dette d’Etat (...). Les emprunts (par l’Etat) permettent aux gouvernements d’effectuer des dépenses extraordinaires sans que ceux qui paient des impôts le sentent immédiatement, mais ils rendent une augmentation des impôts dans le futur indispensable. D’autre part, ces augmentations d’impôts, causées par une accumulation de dettes successives, poussent les gouvernements dans le cas de nouvelles dépenses extraordinaires à souscrire continuellement de nouveaux emprunts ". Il s’agit là d’un cycle infernal de dettes, dont l’Etat ne peut d’aucune manière se dégager, une fois qu’il a été engagé. C’est comme toute dépendance, on s’enfonce de plus en plus. Plus la période de dépendance de l’Etat est longue, plus ce dernier a besoin de sa drogue pour se maintenir dans la concurrence économique internationale. Le phénomène n’est donc pas nouveau, mais existe déjà depuis les premiers agissements financiers au sein du mode de production capitaliste.
S’agit-il plus précisément d’une crise de la monnaie unique européenne, d’une crise de l’euro ?
Il existe sans doute un gouffre entre les économies de pays du Sud et des pays du Nord comme les Pays-Bas et l’Allemagne, mais ceci était évident en 2000 déjà. Un pays comme la Grèce n’est pas en état de supporter la concurrence avec des pays plus au Nord. Depuis le début, il était évident que la situation était intenable et que cela devait miner les fondements même de la monnaie unique européenne.
C’est en parfaite harmonie avec leurs intérêts économiques que les différentes bourgeoisies du Nord ont agi dans le passé en intégrant dans la zone euro des pays de la périphérie européenne, qui trichaient de manière évidente avec leurs statistiques budgétaires. Des règles fiscales contraignantes ont été mises de côté face à la promesse de nouveaux marchés protégés pour les entreprises de ces pays du Nord.
Et aujourd’hui encore, les politiciens noient le poisson en attaquant celui par qui le scandale arrive. Mais cela correspond bien sûr au rôle pour lequel ils sont élus et payés : mettre en place un rideau de fumée sur le fondement des événements qui provoquent la pression sur certains pays européens et exacerbent les tensions au sein de la zone euro, cacher qu’ils révèlent fondamentalement les contradictions fondamentales qui caractérisent le capitalisme et qui sont insolubles au sein du système.
Quels sont donc les fondements de la crise actuelle ?
Le capitalisme est la première forme de société dans l’histoire dont la crise n’est pas la conséquence d’une sous-production, d’une production de la pénurie, mais d’une surproduction, d’une abondance de marchandises. Avec les crises éclate une épidémie sociale qui aurait semblé absurde dans toutes les périodes précédentes, une épidémie de surproduction. C’est une crise du mode de production capitaliste basé sur le salariat.
Le capitalisme est marqué depuis sa naissance par une tare congénitale : il produit en abondance un poison que son organisme ne peut contrôler, la surproduction. Il produit plus de marchandises que son marché peut absorber. Pourquoi ? Prenons un exemple pour l’expliquer. Un travailleur travaille à la chaine ou derrière son ordinateur et reçoit à la fin du mois un salaire de 800 euro. En réalité, il ne produit pas l’équivalent de ces 800 euro, mais une valeur de, disons, 1600 euro. Il a donc produit une valeur qui ne lui est pas ristournée sous forme de salaire, en d’autres mots, il a produit de la plus-value. Que fait le capitaliste avec cette plus-value qu’il a volé des travailleurs (à condition bien sûr qu’il la réalise en vendant les marchandises sur le marché !) ? Il utilise une partie (peut-être 150 euro) pour sa consommation personnelle. Mais l’essentiel, les 650 euro restants, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, généralement pour l’achat d’un équipement plus moderne. Pourquoi le capitaliste agit-il de la sorte ? Parce qu’il y est contraint du point de vue économique. Le capitalisme est un système de concurrence, les produits doivent être vendus meilleur marché que ceux du voisin, du concurrent qui produit les mêmes produits. En conséquence, chaque patron doit non seulement réduire ses frais de production (les salaires) mais surtout et d’abord réinvestir la majeure partie du travail non payé des travailleurs dans des machines plus modernes pour accroître la productivité. S’il ne le fait pas, il ne peut pas moderniser sa production et il perdra des parts de marché à un concurrent qui, lui, a réussi à proposer des produits meilleur marché.
Le système capitaliste est caractérisé par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas complètement les travailleurs pour le travail effectivement réalisé et en imposant aux patrons de ne pas consommer eux-mêmes une grande partie des bénéfices qu’ils ont arrachés aux travailleurs, le système produit plus de valeur qu’il ne peut traiter en son sein. Les travailleurs et les capitalistes ne peuvent jamais ensemble consommer l’intégralité des marchandises produites. Le capitalisme doit donc vendre le surplus de marchandises en dehors de sa propre sphère de production, sur des marchés qui n’ont pas encore été conquis par les rapports de production capitalistes, et que nous appelons des marchés extra-capitalistes. S’il n’arrive plus à le faire, nous sommes alors confrontés à une crise de surproduction.
Voilà donc dans de grandes lignes les conclusions de Karl Marx dans ‘Le Capital’ et de Rosa Luxembourg dans ‘L’Accumulation du Capital’. Pour le formuler de manière encore plus concise, nous résumerons la théorie de la surproduction en quelques points :
- Le capital exploite ses ouvriers (ou autrement dit : leurs salaires ne recouvrent pas la valeur réelle qu’ils réalisent par leur travail).
- De cette manière, le capital peut vendre ses marchandises avec un profit, pour un prix qui comprend, outre le salaire des ouvriers et la plus-value, également le remboursement des moyens de productions. Mais à qui vend-il ?
- Bien sûr, les ouvriers achètent des marchandises... Pour un montant permis par leur salaire. Une bonne partie des marchandises restera donc à vendre autre part. La valeur de celles-ci est égale à la partie non payée du travail des ouvriers. Ce n’est que cette partie qui possède la caractéristique magique de réaliser du profit pour le capital.
- Les capitalistes ne consomment eux-mêmes qu’une partie des marchandises qui sont porteuses de la plus-value. S’il veut réaliser du profit, le capital ne peut acheter la totalité des marchandises pour lui-même. ce serait absurde, comme s’il sortait l’argent de sa poche de droite pour le fourrer dans sa poche de gauche. Ce n’est pas une manière de générer du profit.
- Pour accumuler, pour se développer, le capital doit donc trouver impérativement des acheteurs en dehors de la sphère des ouvriers et des capitalistes. Autrement dit, il doit trouver des marchés en dehors de son système, c’est une question cruciale s’il ne veut pas rester avec des marchandises invendues sur les bras qui étouffent le marché, s’il ne veut pas tomber dans une ‘crise de surproduction’ !
DS
Récent et en cours:
- Crise économique [8]
