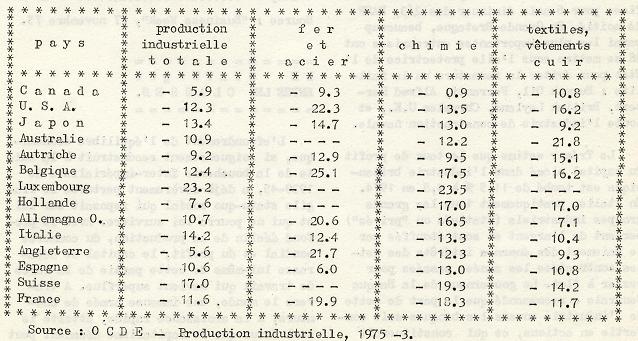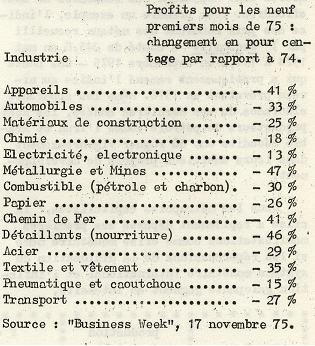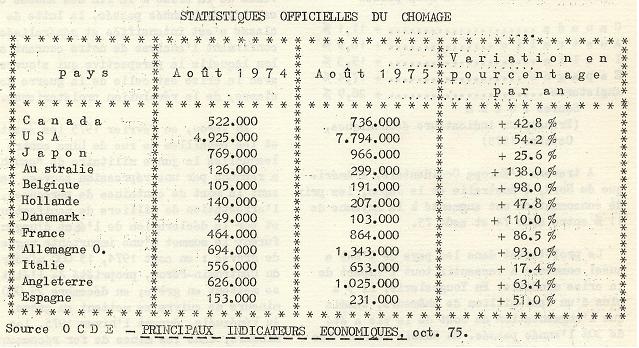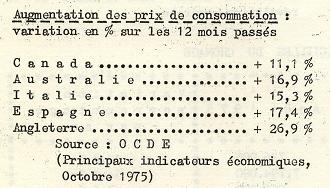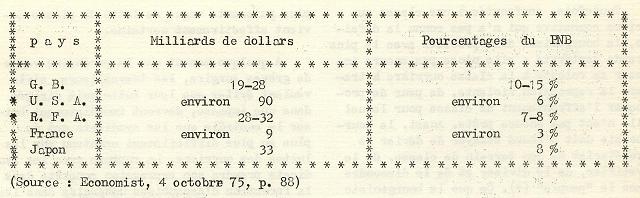Revue Internationale no 5 - 2e trimestre 1976
- 2636 reads
Présentation du 1er congrès du C.C.I.
- 2820 reads
Ce numéro de la Revue Internationale est entièrement consacré à la publication des documents du premier Congrès du Courant Communiste International. Nous publions ces documents dans le but de concrétiser publiquement ce que nous entendons par regroupement international des révolutionnaires, et d'encourager la réflexion des militants partout où ils se trouvent.
QUELLES EST LA FONCTION D'UNE ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ? SUR QUELLE BASE SE CONSTITUE-T-ELLE ? COMMENT ANALYSER LA PERIODE ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DE LUTTE ?
Voilà les questions qui préoccupent les révolutionnaires depuis le début de la lutte prolétarienne et qui étaient au cœur des discussions de ce premier Congrès du CCI.
En effet, ces questions cristallisent toute la difficulté des révolutionnaires dans notre période : d'une part pour définir les positions de classe à travers l'expérience de la lutte ouvrière dans l'histoire et d'autre part pour savoir comment agir et dans quel cadre organisationnel. Lorsqu’aujourd'hui, après plus de 50 ans de contre-révolution, la réapparition de la crise permanente du système fait surgir des éléments révolutionnaires, ces éléments ressentent inévitablement les effets de la rupture organique avec tous les courants et organisations que le mouvement ouvrier a fait naître par le passé. Aujourd'hui, il n'existe plus aucun lien vivant, organisationnel avec la Gauche Communiste des années 20, 30 et 40 qui a essayé de préserver et de faire avancer la théorie révolutionnaire pendant les années de défaite et de guerre mondiale. Ce lien organique étant rompu, la plupart des petits noyaux révolutionnaires qui se forment maintenant surgissent de façon isolés, éparpillés géographiquement; leur formation étant le plus souvent déterminée par des événements locaux et immédiats. Ils ont le pi plus grand mal à se situer dans un contexte politiquement et historiquement cohérent, à comprendre ce qu'ils représentent et les forces sociales qui les ont fait surgir. La rupture de 50 ans a créé tout un terrain propice à la confusion et jonché de difficultés : comment comprendre que les effets locaux et conjoncturels de la crise se rattachent à la crise mondiale, permanente du capitalisme depuis la première guerre mondiale
—comment comprendre que la lutte aujourd'hui n'est que la reprise et la continuation de la lutte historique du prolétariat ;
— comment œuvrer dans le sens d'un regroupement des révolutionnaires sur la base des positions de classe.
Le CCI est loin d'être la seule organisation à essayer de donner une réponse à ces questions; depuis la fin des années 60, il y a tout un bourgeonnement dans la classe qui fait naître des noyaux révolutionnaires un peu partout dans le monde comme expression d'un processus de prise de conscience. Mais si ces petits noyaux ne se situent pas rapidement sur un terrain de classe, s'ils ne situent pas leur activité dans un cadre international cohérent, ils risquent d'être vite épuisés dans la confusion et l'isolement, surtout dans notre période. Car aujourd1hui, c'est lentement que se fait le mûrissement de la lutte de classe, sous la poussée de la crise économique, contrairement à d'autres périodes où la guerre générale politisait immédiatement et internationalement le mouvement ouvrier. Dans ce contexte, les révolutionnaires doivent savoir travailler à longue haleine, regroupant leurs forces pour défendre une orientation politique d'ensemble, l’orientation de la lutte, ceci à travers et au delà des soubresauts, des flux et des reflux qui marquent cette lutte et des manifestations conjoncturelles de la crise. Dans le développement de cet effort, les révolutionnaires doivent avant tout se garder de deux écueils : l’immédiatisme et le modernisme,
L'immédiatisme est un danger particulier aujourd'hui quand la lutte de classe se développe par à-coups, en dent de scie, avec des moments de lutte intense suivis par des périodes d'accalmie provisoire, l'immédiatisme ne voit la lutte qu'au jour le jour et se perd dans une impatience activiste, typique de ceux qui viennent du gauchisme. Il voit ce développement de la montée des luttes de façon linéaire, mécaniste et il est entièrement déterminé par les flux et reflux des luttes locales, incapable de tracer une perspective globale. Tout le mouvement étudiant, le mouvement du "22 mars", le SDS allemand et américain, tout le "ras-le-bol" petit-bourgeois n'a rien laissé, sauf la démoralisation quand arrive inévitablement une retombée momentanée des luttes. Du grand triomphalisme des "campagnes" du moment, on tombe alors dans le pessimisme. Un activisme disproportionné par rapport à la réalité non seulement épuise les militants et fait la caricature du vrai travail révolutionnaire, mais encore il empêche les éléments révolutionnaires d’accomplir la tâche qui leur incombe, celle de la consolidation des acquis, du regroupement des forces sur la base d'une cohérence et d'une continuité politique.
Les révolutionnaires ne devraient pas se laisser emporter par l'impact immédiat des convulsions sociales. Il faut qu'ils puissent contribuer à une orientation générale sur l'évolution de la lutte à long terme, vers où va la lutte. Il faut surtout qu'ils comprennent que, après 50 ans de défaite?, la classe ouvrière ne sautera pas à pieds joints dans l'histoire. Il y aura inévitablement toute une période pendant laquelle les ouvriers auront à se débarrasser peu à peu des mystifications de la gauche du capital qui s’emploie de toutes ses forces à 1’embrigadé.
Le deuxième écueil ,1e "modernisme", est bien souvent le simple contre-pied d'un activisme fiévreux. Il correspond alors au creux de la vague, et amène au repli sur soi, à la théorisation de la démoralisation qui peut aller jusqu'à l'abandon de la conception du prolétariat comme classe révolutionnaire. Tel a été le cas d'Invariance et d'autres "modernistes" qui ont fui la réalité dans les hautes sphères de la "philosophie" marginaliste. C’est cette même fuite devant la réalité de la lutte longue et tourmentée de la classe ouvrière, qui dans de telles circonstances, produit des actes de terrorisme désespéré.
Pour la classe ouvrière, le manque de clarté sur ces deux écueils, ces deux aspects extrêmes, 1'immédiatisme et le modernisme, fait perdre énormément d'énergies révolutionnaires. La plupart des petits noyaux qui ont surgi depuis 1968 ce sont perdus. Au lieu d'éclairer le chemin de la classe, soit ils disparaissent, soit ils se transforment: en entraves au développement de la conscience. C'est pour éviter à des éléments révolutionnaires de se débattre seuls face aux confusions, pour éviter qu'on soit obligé à chaque fois de refaire les erreurs du passé, qu'il faut œuvrer dans le sens de la discussion et du regroupement international des révolutionnaires. Nous savons que les idées révolutionnaires surgissent du sol même de la lutte de classe, mais combien difficile est la voie vers la formation d'une organisation des révolutionnaires aujourd’hui. On n'est pas révolutionnaire parce qu'individuellement on a "des idées", mais parce que collectivement on travaille à remplir la tâche des révolutionnaires au sein de la classe. L'organisation des révolutionnaires, instrument de la réflexion et de l'activité collective internationale, requiers une volonté consciente de la part des militants. Le grand danger, c'est que nos efforts restent éparpillés, isolés dans une ville ou dans un pays, au point que les révolutionnaires soient incapables, aujourd'hui et demain d'assumer leur fonction. C'est pour cette raison que nous insistons tant sur la nécessité de regroupement.
Le CCI a aussi eu à lutter en son sein contre ces tendances activistes ou modernistes... il y a des éléments du PIC et de feu "Une Tendance Communiste" qui sont sortis de nos rangs en France. Il n'y a jamais de garanties "d'immunisation" absolues contre la con fusion et la pénétration des idées bourgeoises. Mais le CCI a fait tous les efforts pour surmonter ses faiblesses, pour orienter son travail sur la voie de la persévérance et de la continuité à long terme, contre le triomphalisme immédiatiste et le pessimisme des sceptiques. Dans ce sens, ce premier Congrès de notre Courant, cette année, couronne et affermit tout un travail patient et méthodique de sept ans vers la formation d'une organisation internationale des révolutionnaires autour d'une plateforme de classe.
Ceux de nos lecteurs qui nous suivent depuis un certain temps peuvent mieux se rendre compte dû chemin qu'a fait le CCI depuis les premières rencontres et discussions internationales et la proposition d'un réseau international de correspondance à travers les rapports des conférences internationales en France et en Angleterre publiés dans notre presse. L'année dernière sur l'initiative de Révolution Internationale, Internacionalismo (Venezuela), Internationalism (USA) World Révolution (G.B.), Rivoluzione Internazionale (Italie) et Accion Proletaria (Espagne) qui se réclament de la même orientation politique générale ont participé à une conférence internationale qui devait jeter les premières bases de la constitution d'une organisation internationale. Nous basions notre regrouperait sur l'analyse de la crise générale dans laquelle est plongé le capital mondial, débouchant inévitablement sur l'affrontement entre le Capital et le Prolétariat. Dans cette situation, les révolutionnaires ne peuvent aider le développement et la généralisation de la conscience qu'en s'organisant internationalement.
Quand le CCI a décidé de s'engager dans cette voie, (voir les travaux de la conférence 1975 publiés dans la revue internationale n°1), il y avait des critiques qui nous parvenaient de la part de certains groupes politiques. Pour le PIC en France, par exemple, le regroupement des révolutionnaires dans une organisation internationale unie n'était que "du vent" de notre part — il voyait la question d'intervention des révolutionnaires sans comprendre que l'intervention implique un cadre organisationnel international capable d'assumer un travail global, mais d'une façon immédiatiste et disproportionnée, Workers'Voice et Revolutionary Perspectives (Angleterre) étaient d'accord sur le fait que les révolutionnaires doivent se regrouper internationalement, mais ce n'était pas pour aujourd'hui. Il fallait d'autant plus attendre le mythique jour J, que la crise n'était pas encore d'actualité brûlante selon RP. Pour le Revolutionary Workers Group (USA), les questions d'organisation relevaient tout simplement d'une préoccupation de "bureaucrates" selon le modèle trotskyste.
Nous pensons que les événements qui ont eu lieu depuis la conférence de janvier 1975, confirment les analyses que nous avons élaborées alors, Sur le plan organisationnel, certaines constatations s'imposent : le PIC continue à s'agiter dans un vide sectaire, voyant les interventions du CCI dépasser de loin ses capacités isolées; RP et WR ont accompli un regroupement inachevé, limité sur le terrain purement local, en Angleterre, (Communist Workers Organisation) attribuant on ne sait quelles idées confuses au CCI, qu'ils taxent de "contre-révolutionnaires ". Ils se renferment jalousement dans leur isolement. Le RWG, incapable de s'intégrer à un travail cohérent et organisé a abouti à 1'autodissolution. Il est possible, comme le disent certains, que le fait que le CCI continue depuis 7 ans à se développer ne constitue pas une preuve en soi, mais il est encore plus vrai que disparaître dans la confusion n'apporte aucune contribution positive aux grands problèmes actuels du mouvement.
Le CCI ne tire aucun "orgueil" de petite chapelle de ses expériences et de ses polémiques, il s'agit de défendre et de concrétiser la nécessité du regroupement sur la base des positions révolutionnaires. C'est cette ORIENTATION que nous défendons et c'est pour œuvrer dans ce sens AVEC TOUTES LES FORCES REVOLUTIONNAIRES, pour encourager tous les révolutionnaires à partager ce souci, que nous pensons constituer une contribution effective au mouvement révolutionnaire.
En 1976, une année après la décision de constituer un Courant International organisé, le CCI a convoqué son premier Congrès pour faire un examen et un bilan du travail effectué et pour achever le travail de constitution du CCI. Le Congrès a constaté qu'en un an, le Courant a diffusé plus de 35 publications en 5 langues, a admis une nouvelle section en Belgique et a centralisé ses interventions et activités au niveau international.
La discussion au Congrès était centrée sur quatre thèmes principaux :
— Premièrement, l'adoption d'une plateforme politique internationale qui affirme les positions de classe0 On ne peut jamais trop insister sur le fait qu'une organisation révolutionnaire ne peut se constituer que sur la base des principes politiques cohérents; contre les tentatives de constitution de groupes "révolutionnaires" sur la base d'un pot-pourri de positions contingentes et contradictoires, le CCI défend la nécessité d'une cohérence historique, d'une plateforme basée sur les acquis des luttes passées.
Nous savons bien qu'une plateforme révolutionnaire n'est jamais achevée, d’autant plus que la classe est aujourd'hui en plein mouvement. Mais nous sommes convaincus que les positions de classe contenues dans cette plateforme tranchent par rapport aux enseignements du passé et que ces positions représentent par conséquent, le seul point de départ pour aller de l'avant à l,:avenir face à des problèmes nouveaux» La plateforme affirme les positions fondamentales du CCI mais elle ne présente pas une explication détaillée de tous ses aspects. Elle est conçue comme la base de l'action et de l'intervention dans la classe dans cette période de montée de luttes0
Cette plateforme que nous publions dans ce numéro 5 de la Revue Internationale, reprend les positions défendues dans les textes d'orientation de tous les Croupes qui maintenant constituent le CCI, mais c'est pour la première fois que nous avons une plateforme internationale de l'ensemble qui sera la base de toute adhésion au CCI dans n'importe quel pays.
Le deuxième axe du Congrès était la discussion sur le rôle et le fonctionnement d'une organisation révolutionnaire0 Tout d'abord, nous rejetons la conception léniniste selon laquelle le travail des révolutionnaires est de constituer des partis de masse, appelés à prendre le pouvoir. Nous rejetons également l'idée des "spontanéistes" qui nie toute fonction de l'organisation des révolutionnaires. L'organisation est forcément un organisme minoritaire dans la classe qui a pour seule fonction le développement et la généralisation de la conscience de classe.
Nous affirmons que le travail révolutionnaire ne peut se faire que dans un cadre international d'emblée. Contre la pratique de la II° Internationale qui concevait l'organisation internationale comme simple "chapeautage" de partis nationaux, nous pensons essentiel de créer un corps organisationnel uni à l'image de l'unité historique du prolétariat.
Notre travail reste une activité collective et centralisée sur le plan international. En ce sens, le Congres annuel constitue l'assemblée générale du CCI, le lieu de prise de décisions sur les perspectives générales pour l'ensemble du Courant.
Tous les points ci-dessus trouvent une formulation plus précise dans les statuts internes de l'organisation internationale :
— Le CCI a également voté un Manifeste, émanation du Congres, qui trace les grandes lignes de la lutte de classe depuis les 50 dernières années et met 1' accent sur la gravité de l'enjeu des affrontements qui se préparent. Ce document publié dans plusieurs langues dans toute notre presse locale présente la perspective du CCI face aux possibilités historiques qui s'ouvrent devant le prolétariat mondial.
— Sur la base des acquis du passé et de notre analyse de la période actuelle, le Congrès a fait l'examen plus précis de l'évolution de la crise dans la conjoncture présente et de la situation internationale en 1975-76.
Nous publions donc ces travaux et la plateforme en les soumettant à la réflexion et à la critique des militants engagés dans la lutte pour la révolution Communiste.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Plateforme du C.C.I.
- 2839 reads
Après la plus longue et profonde contre-révolution de son histoire, le prolétariat retrouve progressivement le chemin des combats de classe. Conséquence à la fois de la crise aigue du système qui se développe depuis le milieu des années 1960 et de l'apparition de nouvelles générations ouvrières qui subissent beaucoup moins que les précédentes le poids des défaites passées de la classe, ces combats sont d'ores et déjà les plus étendus qu'elle ait menés. Depuis le surgissement de 1968 en France, c'est de l'Italie à l'Argentine, de l'Angleterre à la Pologne, de la Suède à l'Egypte, de la Chine au Portugal, des Etats-Unis à l'Inde, du Japon à l'Espagne, que les luttes ouvrières sont redevenues un cauchemar pour la classe capitaliste.
La réapparition du prolétariat sur la scène historique vient condamner sans appel toutes les idéologies produites ou permises par la contre-révolution qu'il a dû subir et qui tendaient à lui nier sa nature de sujet de la révolution. Ce que redémontre magistralement l'actuelle reprise de la lutte de classe, c'est que le prolétariat est la classe révolutionnaire a notre époque et la seule.
Est révolutionnaire toute classe dont la domination sur la société est en accord avec l'instauration et l'extension, au détriment des anciens rapports de production devenus caducs, des nouveaux rapports de production rendus nécessaires par le degré de développement des forces productives. Au même titre que les modes de production qui l'ont précédé, le capitalisme correspond à une étape particulière du développement de la société. Forme progressive de celle-ci, à un moment de son histoire, il crée, par sa généralisation, les conditions de sa propre disparition. La classe ouvrière, par sa place spécifique dans le procès de production capitaliste, par sa nature de producteur collectif de l'essentiel de la richesse sociale, privé de toute propriété sur les moyens de production qu'il met en œuvre et donc n'ayant aucun intérêt qui l'attache au maintien de la société capitaliste, est la seule classe de la société qui puisse, tant objectivement que subjectivement, instaurer le nouveau mode de production qui doit succéder au capitalisme : le communisme. Le resurgissement actuel de la lutte prolétarienne indique, qu'à nouveau la perspective du communisme, de nécessité historique, est devenue également une possibilité.
Cependant, l'effort que doit faire le prolétariat pour se donner les moyens d'affronter victorieusement le capitalisme est encore immense. Produits et facteurs actifs de cet effort, les courants et éléments révolutionnaires qui sont apparus depuis le début de la reprise prolétarienne portent donc une énorme responsabilité dans le développement et l'issue de ces combats. Pour être à la hauteur de cette responsabilité ils doivent s'organiser autour des frontières de classe qui ont été tranchées de façon définitive par les expériences successives du prolétariat, et qui doivent guider toute activité et intervention en son sein.
C'est à travers l'expérience pratique et théorique de la classe que se dégagent les moyens et les buts de sa lutte historique pour le renversement du capitalisme et pour l'instauration du communisme. Depuis le début du capitalisme, l'activité du prolétariat est tendue vers un effort constant pour, à travers son expérience, prendre conscience de ses intérêts de classe et se dégager de l'emprise des idées de la classe dominante, des mystifications de l'idéologie bourgeoise. Cet effort du prolétariat est marqué par une continuité qui s'étend tout au long du mouvement ouvrier depuis les premières sociétés secrètes jusqu'aux fractions de gauche qui se sont dégagées de la III° Internationale. Malgré toutes les aberrations et toutes les manifestations de la pression de l’idéologie bourgeoise que pouvaient receler leurs positions et leur mode d'action, les différentes organisations qui se sont succédées constituent autant de maillons irremplaçables de la chaine de la continuité historique de la lutte prolétarienne, et le fait de succomber à la défaite ou à une dégénérescence interne, n'enlève rien à leur contribution fondamentale à cette lutte. Aussi, l'organisation des révolutionnaires qui se reconstitue aujourd'hui comme manifestation de la reprise générale du prolétariat après un demi-siècle de contre-révolution et de rupture dans le mouvement ouvrier, se doit absolument de renouer avec cette continuité historique afin que les combats présents et futurs de la classe puissent s'armer pleinement des leçons de son expérience passée, que toutes les défaites Partielles qui jalonnent son chemin ne restent pas vaines mais puissent constituer autant de promesses de sa victoire finale.
Le Courant Communiste International se revendique des apports successifs de la Ligue des Communistes, des Première, Deuxième et Troisième Internationales, des fractions de gauche qui se sont dégagées de cette dernière, en particulier des gauches Allemande - Hollandaise et Italienne. Ce sont ces apports-essentiels permettant d'intégrer l'ensemble des frontières de classe dans une vision cohérente et générale qui sont présentés dans la présente plateforme.
I - LA THEORIE DE LA REVOLUTION COMMUNISTE.
Le marxisme est l'acquis théorique fondamental de la lutte prolétarienne. C’est sur sa base que l’ensemble des acquis du prolétariat s'intègrent dans un tout cohérent.
En expliquant la marche de l'histoire par le développement de la lutte de classe, c'est-à-dire de la lutte basée sur la défense des intérêts économiques dans un cadre donné du développement des forces productives, et en reconnaissant dans le prolétariat la classe sujet de la révolution qui abolira le capitalisme, il est la seule conception du monde qui se place réellement du "point de vue de cette classe. Loin de constituer une spéculation abstraite sur le monde il est donc, et avant tout, une arme de combat de là classe. Et c'est parce que le prolétariat est la première et seule classe de l'histoire dont l'émancipation s'accompagne nécessairement de l'émancipation de toute l'humanité, dont la domination sur la société n'implique pas une nouvelle forme d'exploitation mais l'abolition de toute exploitation, que le marxisme est seul capable d'appréhender la réalité sociale de façon objective et scientifique, sans préjugés ni mystifications d'aucune sorte.
Par conséquent, bien qu'il ne soit pas un système ni un corps de doctrine fermé, mais au contraire une théorie en élaboration constante, en liaison directe et vivante avec la. Lutte de classe, et bien qu'il ait bénéficié des manifestations théoriques de la vie de la classe qui l'ont précédé, il constitue, depuis le moment où ses bases ont été jetées, le seul cadre. à partir et au sein duquel la théorie révolutionnaire peut se développera
II -LES CONDITIONS DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE.
Toute révolution sociale est l'acte par lequel la classe porteuse des nouveaux rapports de production établit sa domination politique sur la société La révolution prolétarienne n'échappe pas a cette définition mais ses conditions et son contenu diffèrent fondamentalement des révolutions du passé.
Celles-ci, parce qu'elles se trouvaient; à la charnière de deux modes de production dominés par la pénurie avaient pour fonction de substituer la domination d'une classe exploiteuse à celle d'une autre classe exploiteuse : ce fait s'exprimait par le remplacement d'une forme de propriété, par une autre forme de propriété, d'un type de privilèges par un autre type de privilèges.
La révolution prolétarienne, par contre, a pour but de remplacer des rapports de production basés sur l'abondance. C'est pour cela qu'elle signifie la fin de toute forme de propriété, de privilèges et d’exploitation.
Ces différences confèrent à la Révolution prolétarienne les caractéristiques suivantes, que la classe ouvrière-se doit, comme condition de son succès, de comprendre et de maîtriser :
a — Elle est la première forme de révolution à caractère mondial, qui ne puisse atteindre ses buts qu'en se généralisant à tous les pays, puisqu1avec la propriété privée elle doit abolir l'ensemble des cadres sectoriels, régionaux et nationaux liés à celle-ci. C’est la généralisation de la domination du capitalisme à l'échelle mondiale qui permet que cette nécessité soit aussi une possibilité.
b — La classe révolutionnaire, pour la première fois dans l'histoire, est en même temps aussi la classe exploitée de l'ancien système et, de ce fait, elle ne peut s'appuyer sur un quelconque pouvoir économique dans la conquête du pouvoir politique. Bien au contraire, à l'encontre de ce qui a prévalu dans le passé, la prise du pouvoir politique par le prolétariat précède nécessairement la période de transition pendant laquelle la domination des anciens rapports de production est détruite au bénéfice de celle des nouveaux.
c — Le fait que, pour la première fois, une classe de la société soit en même temps classe exploitée et classe révolutionnaire implique également que sa lutte comme classe exploitée ne peut à aucun moment être associée ou opposée à sa lutte comme classe révolutionnaire. Au contraire, comme le marxisme l'a, depuis le début affirmé contre les théories proudhoniennes et petites-bourgeoises, le développement de la lutte révolutionnaire est conditionné par 1' approfondissement et la généralisation de la lutte du prolétariat comme classe exploitée.
III - LA DECADENCE DU CAPITALISME
Pour que la Révolution Prolétarienne puisse passer du stade de simple souhait ou de simple potentialité et perspective historique au stade d'une possibilité concrète, il faut qu'elle soit devenue une nécessité objective pour le développement de l'humanité. C'est cette situation historique qui prévaut depuis la-première guerre mondiale : depuis cette date a pris fin la phase ascendante du mode de production capitaliste qui commence au 16ème siècle pour atteindre son apogée à la fin du 19ème. La nouvelle phase ouverte dès lors est celle de la décadence du capitalisme.
Comme pour toutes les sociétés du passé, la première phase du capitalisme traduisait le caractère historiquement nécessaire des rapports de production qu'il incarne, c'est-à-dire de leur nature indispensable pour l'épanouissement des forces productives de la société. La seconde, au contraire, traduit la transformation de ces rapports en une entrave de plus en plus lourde à ce même développement.
La décadence du capitalisme est le produit du développement des contradictions internes inhérentes à ce mode de production, et qu'on peut définir comme suit :
Bien que la marchandise ait existé dans la plupart des sociétés, l'économie capitaliste est la première qui soit basée fondamentalement sur la production marchandises. Aussi l'existence de marchés sans cesse croissants est-elle une des conditions essentielles du développement du capitalisme. En particulier, la réalisation de la plus-value produite par l'exploitation de la classe ouvrière est indispensable à l'accumulation du capital, moteur essentiel de la dynamique de celui-ci. Or, contrairement à ce que prétendent les adorateurs du capital, la production capitaliste ne crée pas automatiquement et à volonté les marchés nécessaires à sa croissance. Le capitalisme se développe dans un monde non capitaliste, et c'est dans ce monde qu'il trouve les débouchés qui permettent ce développement. Mais en généralisant ses rapports à l'ensemble de la planète et en unifiant le marché mondial, il a atteint un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19ème siècle. De plus la difficulté croissante pour le capital de- trouver des marchés où réaliser sa plus—value, accentue la pression à la baisse qu'exerce sur son taux de profit l'accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de- production et celle de là for-' ce de travail qui les met en œuvre. De tendancielle, cette baisse du taux, de profit devient de plus en plus effective, ce qui entrave d'autant le procès d'accumulation du capital, et donc le fonctionnement de l'ensemble des rouages du système.
Après avoir unifié et universalisé 1' échange marchand en faisant connaître un grand bond au développement de l'humanité, le capitalisme a donc mis à 1' ordre du jour la disparition des rapports de -production fondés sur l'échangée Mais tant que le prolétariat ne s'est pas donné les moyens d'imposer cette disparition, ces rapports de production se maintiennent et entraînent l'humanité dans des contradictions de plus en plus monstrueuses.
La cri.se [3] de surproduction, manifestation caractéristique des contradictions du mode de production capitaliste mais qui, dans le passé, constituait un palier entre chaque phase d'expansion du marché, battement de cœur d'un système en pleine santé, est devenue aujourd'hui permanente. C'est effectivement de façon permanente que sont sous-utilisées les capacités de l'appareil productif et que le capital est devenu incapable d'étendre sa domination ne serait-ce qu'au rythme de la croissance de la population humaine. La seule chose que ,1e capitalisme puisse aujourd'hui étendre dans le monde, c'est la misère humaine absolue, comme celle que connaissent les pays du tiers monde.
La concurrence entre les nations capitalistes, ne peut, dans ces conditions que devenir de plus en plus implacable. L'impérialisme, politique à laquelle est contrainte, pour survivre, toute nation quelle que soit sa taille, impose à l’humanité d'être plongée depuis 1914, dans le cycle infernal de crise-guerre-reconstruction-nouvelle crise, où une production d'armement chaque jour plus monstrueuse devient de plus en plus le seul terrain d'application de la science et d'utilisation des forces productives. Dans la décadence du capitalisme, l'humanité ne se survit que sur la base de destructions et d'une automutilation permanentes9
A la misère physiologique qui frappe les pays sous développés, fait écho dans les pays développés une déshumanisât ion extrême, jamais atteinte auparavant, des relations entre les membres de la société, et qui a pour' base l'absence totale de perspectives que le capitalisme offre à l'humanité, autres que celle de guerres de plus en plus meurtrières et d'une exploitation de plus en plus systématique, rationnelle et scientifique. Il en découle, comme pour toute société en décadence, un effondrement et une décomposition croissante des institutions sociales, de l'idéologie dominante, de l'ensemble des valeurs morales, des formes d'art et de toutes les autres manifestations culturelles du capitalisme. Le développement d'idéologies comme le fascisme ou le stalinisme marquent le triomphe croissant de la barbarie en l'absence du triomphe de l'alternative révolutionnaire.
IV - LE CAPITALISME D'ETAT
Dans toute période de décadence, face à l'exacerbation des contradictions du système, l’Etat garant de la cohésion du corps social et de la préservation des rapports de classe dominante, tend à se renforcer jusqu'à incorporer dans ses structures l’ensemble de la vie de la société. L’hypertrophie de l'administration impériale et monarchie absolue ont été les manifestations de ce phénomène dans la décadence de la société esclavagiste romaine et dans celle de la société féodale.
Dans la décadence capitaliste la tendance générale vers le capitalisme d'Etat est une des caractéristiques dominante de la vie sociale. Dans cette période, chaque capital national, privé de toute base pour un développement puissant, condamné à une concurrence impérialiste aigüe est contraint de s'organiser de la façon la plus efficace pour à l'extérieur, affronter économiquement et militairement ses rivaux et, à l'intérieur, faire face à une exacerbation croissante des contradictions sociales. La seule force de la société qui soit capable de prendre en charge l'accomplissement des tâches que cela impose est 1' Etat.
Effectivement, seul l'Etat :
- Peut prendre en main l'économie nationale de façon globale et centralisée et atténuer la concurrence interne qui l'affaiblit afin de renforcer sa capacité à affronter, comme un tout, la concurrence sur le marché mondial.
- mettre sur pied la puissance militaire nécessaire à la défense de ses intérêts face à 1'exacerbation des antagonismes internationaux.
- enfin, grâce, entre autres, aux forces de répression et à une bureaucratie de plus en plus pesantes; raffermir la cohésion interne de la société menacée de dislocation par la décomposition croissante de ses fondements économiques, imposer par une violence omniprésente le maintien d'une structure sociale de plus en plus inapte à régir spontanément les relations humaines et acceptée avec d'autant moins de facilité qu'elle devient, de plus en plus, une absurdité du point de vue de la survie même de la société.
Sur le plan économique, cette tendance jamais totalement achevée vers le capitalisme d'Etat, se traduit par le passage aux mains de l'Etat de tous les leviers de l'appareil productif Cela ne signifie pas que disparaissent la loi de la valeur, la concurrence où l'anarchie de la production, qui sont les caractéristiques fondamentales de l'économie capitaliste. Elles continuent de s'appliquer à l'échelle mondiale où les lois du marché continuent de régner et déterminent donc les conditions de la production à l'intérieur de chaque économie nationale aussi étatisée soit-elle. Dans ce cadre, si les lois de la valeur et de la concurrence semblent être "violées" c'est afin qu'elles puissent mieux s'appliquer. Si 1'anarchie de la production semble refluer face à la planification étatique, elle en ressurgit d'autant plus violemment à l'échelle mondiale particulièrement à l'occasion des crises aigues du système que le capitalisme d'Etat est incapable de prévenir. Loin de constituer une "rationalisation" du capitalisme, son étatisation n'est donc qu’une manifestation de son pourrissement.
Cette étatisation se fait, soit de façon graduelle, par fusion des capitaux "privés" et du capital d'Etat comme c'est plutôt le cas dans les pays les plus développés, soit par des sauts brusques sous forme de nationalisations massives et totales, en général là où le capital, privé est le plus faible.
Effectivement, si la tendance vers le capitalisme d'Etat se manifeste dans tous les pays du monde, elle s'accélère et éclate avec plus d'évidence quand, et où, les effets de la décadence se font sentir avec le plus de violence historiquement durant les périodes de crise ouverte ou de guerre, géographiquement dans les économies les plus faibles. Mais le capitalisme d'Etat n'est pas un phénomène spécifique des pays arriérés. Au contraire, bien que le degré d'étatisation formelle soit souvent plus élevé dans le capitalisme sous-développé, la prise en main véritable par l'Etat de la vie économique est généralement encore plus effective dans les pays les plus développés, du fait du haut degré de concentration du capital qui y règne.
Sur le plan politique et social, la tendance vers le capitalisme d'Etat se traduit par le fait que, sous les formes totalitaires les plus extrêmes comme le fascisme ou le stalinisme ou sous les formes qui se recouvrent du masque démocratique, l'appareil d'Etat, et essentiellement 1' exécutif, exerce un contrôle de plus en plus puissant, omniprésent et systématique sur tous les aspects de la vie sociale. A une échelle bien supérieure à celle de la décadence romaine ou féodale, l'Etat de la décadence capitaliste est devenu cette machine monstrueuse, froide et impersonnelle qui a fini par dévorer la substance même de la société civile.
V -LES PAYS DITS SOCIALISTES
En faisant passer le capital aux mains de l’Etat, le capitalisme d'Etat crée 1' illusion de la disparition de la propriété privée des moyens de production et de l'élimination de la classe bourgeoise, -La théorie stalinienne de la possibilité du "socialisme en un seul pays" ainsi que le mensonge des pays dits "communistes "socialistes", ou en voie de le devenir, trouvent leur fondements dans cette apparence mystificatrice.
Les changements provoqués par la tendance au capitalisme d'Etat ne se situent pas au niveau réel des rapports de production, mais au niveau juridique des formes de propriété. Ils n’éliminent pas le caractère réel de propriété privée des moyens de production, mais leur aspect juridique de propriété individuelle. Les travailleurs restent "prives" de toute emprise réelle sur leur utilisation, ils demeurent entièrement séparés d'eux. Les moyens de production ne sont "collectivisés" que pour la bureaucratie qui les possède et qui les gère collectivement.
La bureaucratie étatique qui assume la fonction économique spécifique d'extirpation du surtravail du prolétariat et d'accumulation du capital national constitue une classe. Mais ce n'est pas une nouvelle classe. Par sa fonction, elle n'est autre que la vieille bourgeoisie dans sa forme étatique. Au niveau de ses privilèges, ce qui la distingue, ce n'est pas l'importance de ceux-ci ,mais la façon dont elle les détient : au lieu de percevoir ses revenus sous forme de dividendes du fait de la possession individuelle de parts du capital, elle les perçoit du fait de la fonction de ses membres sous forme de "frais de fonction", de primes et de rémunérations fixes à apparence "salariale", dont le montant est souvent des dizaines ou des centaines de fois supérieur au revenu d'un ouvrier.
La centralisation et la planification de la production capitaliste par l'Etat et sa bureaucratie, loin d'être un pas vers l'élimination de l'exploitation n'est rien d'autre qu'un moyen pour tenter de la rendre plus efficace.
Sur le terrain économique, la Russie, même pendant le court laps de temps où le prolétariat y a détenu le pouvoir politique, n’a pu se désengager pleinement du capitalisme. Si la forme du capitalisme d'Etat y est apparue aussi tôt d'une façon aussi développée, c'est que la désorganisation économique causée par la défaite de la première guerre mondiale, puis par la guerre civile, y ont porté au plus haut degré les difficultés- de survie d'un capital national dans le cadre de la décadence capitaliste.
Le triomphe de la contre-révolution en Russie s'est fait sous le signe de la réorganisation de l'économie nationale avec les formes les plus achevées de capitalisme d'Etat, cyniquement représentées pour la circonstance comme "prolongements d'Octobre" et "construction du socialisme". L'exemple a été repris ailleurs : Chine, pays de l'Est, Cuba, Corée du Nord, Indochine, etc. Il n'y a cependant rien de prolétarien, encore moins de communiste, dans tous ces pays, où, sous le poids de ce qui restera comme un des plus grand mensonge de l’histoire, règne, sous ses formes les plus décadentes, la dictature du capital. Toute défense, même "critique" ou "conditionnelle" de ces pays est une activité absolument contre-révolutionnaire.
VI - LA LUTTE DU PROLETARIAT DANS LE CAPITALISME DECADENT»
Depuis ses débuts, la lutte du prolétariat pour l'a défense de ses intérêts propres porte en elle la perspective de la destruction du capital et de l'avènement de la société communiste.
Mais le prolétariat ne poursuit pas le but ultime de son combat par idéalisme, guidé par une inspiration divine. S'il est amené à s'attaquer à ses tâches communistes c'est que les conditions matérielles dans lesquelles se déroule sa lutte immédiate finissent par l'y contraindre, toute autre forme de combat aboutissant à un désastre.
Tant que la bourgeoisie parvient, grâce à l'expansion gigantesque de ses richesses dans le monde entier au cours de la phase ascendante du capitalisme, à accorder de véritables réformes de la condition prolétarienne, la lutte ouvrière ne peut trouver les conditions objectives nécessaires à la réalisation de son assaut révolutionnaire.
Malgré la volonté révolutionnaire, communiste, affirmée dès la révolution bourgeoise par les tendances les plus radicales du prolétariat, le combat ouvrier se trouve, au cours de cette période historique, cantonné aux luttes pour des réformes.
Apprendre à s'organiser pour arracher des réformes politiques et économiques à travers le parlementarisme et le syndicalisme devient à la fin du 19ème siècle un des axes essentiel de l'activité prolétarienne. On trouve ainsi dans des organisations authentiquement ouvrières, côte à côte, des éléments "réformistes " (ceux pour qui toute lutte ouvrière doit uniquement être une lutte pour des réformes) et les révolutionnaires (ceux pour qui les luttes pour des réformes ne peuvent constituer qu'une étape, un moment du processus qui mène aux luttes révolutionnaires).
Ainsi, pouvait-on voir également dans cette période le prolétariat appuyer certaines fractions de la bourgeoisie contre d'autres, plus réactionnaires, dans le but d'imposer des aménagements de la société en sa faveur, ce qui correspond objectivement à l'accélération du développement des forces productives»
L'ensemble de ces conditions se transforme radicalement dans le capitalisme décadent. Le monde est devenu trop étroit pour contenir le nombre de capitaux nationaux existants. Dans chaque nation, le capital est contraint d'augmenter sa productivité, c'est-à-dire l'exploitation des travailleurs;, jusqu'aux limites les plus extrêmes.
L'organisation de l'exploitation du prolétariat cesse d'être une affaire entre patrons d'entreprises et ouvriers, pour devenir celle de l'Etat et de mille rouages nouveaux crées pour l'encadrer, gérer, vider en permanence de tout danger révolutionnaire, la soumettre à une répression aussi systématique qu'insidieuse.
L'inflation, devenue un phénomène permanent depuis la première guerre mondiale, ronge toute "augmentation de salaires". La durée de temps de travail stagne ou ne diminue que pour compenser des augmentations du temps de transport ou pour empêcher la totale destruction nerveuse des travailleurs soumis à des rythmes de vie et de travail sans cesse croissants.
La lutte pour des réformes est devenue une utopie grossière. Contre le capital, la classe ouvrière ne peut mener en fin de compte qu'une lutte à mort. Elle n'a plus d'autres alternative qu'accepter d' être atomisée en une somme de millions d'individus écrasés et encadrés, ou bien se battre en affrontant l'Etat lui-même, en généralisant des luttes de la façon la plus étendue, en refusant de se laisser enfermer dans le cadre purement économique ou dans le localisme de l'usine ou de la profession, en se donnant comme forme d'organisation les embryons de ses organes de pouvoir : les conseils ouvriers .
Dans ces nouvelles conditions historiques, beaucoup des anciennes armes du prolétariat sont devenues inopérantes. Les courants politiques qui en préconisent l'usage ne le font que pour mieux T'enchaîner à l'exploitation, pour mieux briser toute volonté de combat.
La distinction faite dans le mouvement ouvrier du 19ème siècle entre programme maximum et programme minimum a perdu tout son sens. Il n'y a plus de programme minimum possible. Le prolétariat ne peut développer ses luttes qu'en les inscrivant dans la perspective d'un programme maximum : la révolution communiste.
VII - LES SYNDICATS : ORGANES DU PROLETARIAT HIER, INSTRUMENT DU CAPITAL AUJOURD' HUI.
Au 19ème siècle, dans la période de plus grande prospérité du capitalisme, la classe ouvrière s'est donné, souvent au prix de luttes acharnées et sanglantes des organisations permanentes et professionnelles destinées à assurer la défense de ses intérêts économiques : les syndicats. Ces organes ont assumé un rôle fondamental dans la lutte pour des réformes et pour les améliorations substantielles des conditions de vie des travailleurs que le système pouvait encore accorder. Ils ont également constitué des lieux de regroupement de la classe, de développement de sa solidarité et de sa conscience, dans lesquels les révolutionnaires intervenaient activement pour en faire " des écoles du communisme". Donc, bien que l’existence de ces organes ait été liée de façon indissoluble à celle du salariat et que, dès cette période, ils se soient souvent déjà bureaucratisés de façon importante, ils n'en constituaient pas moins d'authentiques organes de la classe dans la mesure où l'abolition du salariat n'était pas à l'ordre du jour.
En entrant dans sa phase de décadence, le capitalisme cesse d'être en mesure d’accorder des réformes et des améliorations en faveur de la classe ouvrière. Ayant perdu toute possibilité d'exercer leur fonction initiale de défenseurs efficaces des intérêts prolétariens et confrontés à une situation historique où seule l'abolition du salariat, et donc leur propre disparition, est à l'ordre du jour, les syndicats sont devenus, comme condition de leur propre survie, d'authentiques défenseurs du capitalisme, des agences de l'Etat bourgeois in milieu ouvrier — évolution qui a été fortement favorisée par leur bureaucratisation antérieure et par la tendance inexorable de l'Etat de la période de décadence à absorber toutes les structures de la société.
La fonction anti-ouvrière des syndicats s'est manifestée pour la première fois de façon décisive au cours de la première guerre mondiale où, aux côtés des partis sociaux-démocrates, ils ont participé, à la mobilisation des ouvriers dans la boucherie impérialiste. Dans la vague révolutionnaire qui a suivi la guerre, les syndicats ont tout fait pour entraver les tentatives du prolétariat de détruire le capitalisme. Depuis lors, ils ont été maintenus en vie, non par la classe ouvrière, mais par l'Etat capitaliste pour le compte duquel ils remplissent des fonctions très importantes :
— participation active aux tentatives de l'Etat capitaliste de rationaliser l'économie, réglementation de la vente de la force de travail, et intensification de l'exploitation ;
— sabotage de la lutte de classe de l'intérieur, soit en détournant les grèves et les révoltes vers des impasses catégorielles, soit en affrontant les mouvements autonomes par la répression ouverte.
Du fait que les syndicats ont perdu leur caractère prolétarien, ils ne peuvent pas être reconquis par la classe ouvrière, ni constituer un terrain pour 1'activité des minorités révolutionnaires. Depuis plus d'un demi-siècle les ouvriers, ont éprouvé de moins en moins d'intérêt à participer à l'activité de ces organisations devenues corps et âme des organes de l’Etat capitaliste. Leurs ce, luttes de résistance contre la dégradation de leurs conditions de vie ont tendu à prendre la forme de "grèves sauvages" en dehors.... et contre les syndicats dirigées par les assemblées générales de grévistes et, dans les cas où elles se sont généralisées, coordonnées par des dû comités de délégués élus et révocables par les assemblées, ces luttes se sont immédiatement situées sur un terrain politique, dans la mesure où elles ont dû se confronter à l'Etat sous la forme de ses représentants dans l'entreprise : Leu les syndicats. Seule la généralisation et la radicalisation de ces luttes peuvent permettre à la classe de passer à un assaut ouvert et frontal contre l'Etat capitaliste. La destruction de l’Etat bourgeois implique nécessairement la destruction des syndicats.
Le caractère anti-prolétarien des anciens syndicats ne leur est pas conféré par leur mode d'organisation propre, par profession ou branche industrielle, m par l'existence de "mauvais chefs", mais bien par l'impossibilité, dans le renvoi de actuelle, de maintenir en vie des organes permanents de défense véritable des intérêts économiques du prolétariat. Par conséquent, le caractère capitaliste de ces organes s'étend à toutes les "nouvelles" organisations qui se donnent des fonctions similaires et ceci quel que soient leur modèle organisatif et les intentions qu’elles proclament. Il en est ainsi des "syndicats révolutionnaires" ou des "shop stewards"' comme de 1’ensemble des organes (comités ou noyaux ouvriers, commissions ouvrières) qui peuvent subsister à l'issue d'une lutte, même opposée aux syndicats, et qui tentent de reconstituer un "pôle authentique" de défense des intérêts immédiats des travailleurs. Sur cette base, ces organisations ne peuvent pas échapper à 1'engrenage de l'intégration effective dans l'appareil d' tes Etat bourgeois, même à tire d'organes non officiels ou illégaux.
Toutes les politiques "d'utilisation", de "rénovation" ou de "reconquête" d'organisations à caractère syndical, en ce qu'elles conduisent à revigorer des institutions capitalistes souvent déjà désertées par les travailleurs, sont foncièrement favorables à la survie du capitalisme. Apres plus d’un demi-siècle d'expérience jamais démentie du rôle anti-ouvrier de ces organisations, les courants qui préconisent encore de telles politiques se trouvent sur le terrain de la contre-révolution.
VII - LA MYSTIFICATION PARLEMENTAIRE ET ELECTORALE.
Dans la période d'apogée du système capitaliste, le parlement constituait la forme la plus appropriée de l'organisation de la vie politique de la bourgeoisie. Institution spécifiquement bourgeoise, il n'a donc jamais été un terrain de prédilection pour l'action de la classe ouvrière et le fait pour celle-ci de participer à ses activités ou aux campagnes électorales recelait des dangers très importants que les révolutionnaires du siècle dernier n'ont jamais manqué de dénoncer. Cependant, dans une période où la Révolution n'était pas à l'ordre du jour et où le prolétariat pouvait arracher des réformes à son avantage à l'intérieur du système, une telle participation lui permettait à la fois de faire pression en faveur de ces réformes, d' utiliser les campagnes électorales comme moyen de propagande et d'agitation autour du programme prolétarien et d’employer le Parlement comme tribune de dénonciation de l'ignominie de la politique bourgeoise . C'est pour cela que la lutte pour le suffrage universel a constitué, tout au long du 19ème siècle, dans un grand nombre de pays, une des occasions majeures de mobilisation du prolétariat.
Avec l'entrée du système dans sa phase de décadence, le Parlement cesse d'être un organe de réformes. Comme le dit l’Internationale Communiste (2°Congrès) : "le centre de gravité de la vie politique est sorti complètement et définitivement du Parlement". La seule fonction qu'il puisse assumer, et qui explique son maintien en vie, est "une fonction de mystification. Dès lors, prend fin toute possibilité, pour le prolétariat de l'utiliser de quelque façon que ce soit. En effet, il ne peut conquérir des réformes devenues impossibles à travers un organe qui a perdu toute fonction politique effective» A l'heure où sa tâche fondamentale réside dans la destruction de l'ensemble des institutions étatiques bourgeoises et donc du Parlement, où il se doit d'établir sa propre dictature sur les ruines du suffrage universel et autres vestiges de la société bourgeoise, sa participation aux institutions parlementaires et électorales aboutit, quelles que soient les intentions affirmées par ceux qui la préconisent, à insuffler un semblant de vie à ces institutions moribondes .
La participation électorale et parlementaire ne comporte actuellement aucun des avantages qu'elle pouvait avoir au siècle dernier. Par contre, elle cumule tous les inconvénients et dangers, et principalement celui de maintenir vivaces les illusions sur la possibilité d'un "passage pacifique ou progressif au socialisme" à travers la conquête d'une majorité parlementaire par les partis dits "ouvriers",
La politique de "destruction de l'intérieur" du Parlement à laquelle seraient sensés participer les élus "révolutionnaires" s'est révélée, de façon catégorique, n'aboutir qu'à la corruption des organisations politiques qui l'ont pratiquée et à leur absorption par le capitalisme.
Enfin, l'utilisation des élections et des parlements comme instruments d'agitation et de propagande, dans la mesure où elle est essentiellement affaire de spécialistes, où elle privilégie le jeu des partis politiques au détriment de l'activité propre des masses, tendra préserver les schémas politiques de la société bourgeoise et à encourager la passivité des travailleurs. Si un tel inconvénient était acceptable quand le Révolution n'était pas immédiatement possible, il devient une entrave décisive à l'heure où la seule tâche qui soit historiquement à l'ordre du jour pour le prolétariat est justement celle du renversement du vieil ordre social et l'instauration de la société communiste qui exigent la participation active et consciente de l'ensemble de la classe.
Si, à l'origine, les tactiques de "parlementarisme révolutionnaire" étaient, avant tout, la manifestation du poids du passé au sein de la classe et de ses organisations, elles, se sont; avérées, après une pratique aux résultats désastreux pour la classe, une politique foncièrement contre-révolutionnaire. Les courants qui la préconisent, au même titre que ceux qui présentent le Parlement comme instrument de la transformation socialiste, de la société, se situent aujourd'hui, de façon irréversible dans le camp de la bourgeoisie»
IX - LE FRONTISME, STRATEGIE DE DEVOTEMENT DU PROLETARIAT
Dans la décadence capitaliste, quand seule la Révolution Prolétarienne constitue un pas en avant de l'Histoire, il ne peut exister aucune tâche commune, même momentanée, entre la classe révolutionnaire et une quelconque fraction de la classe dominante, aussi "progressiste", "démocratique" ou "populaire" qu' elle puisse se prétendre. Contrairement à la phase ascendante du capitalisme, sa période de décadence ne permet effectivement à aucune fraction de la bourgeoisie de jouer un rôle progressiste. En particulier, la démocratie bourgeoise qui, contre les vestiges des structures héritées de la féodalité, constituait, au siècle dernier, une forme politique progressive, a perdu, à l'heure de la décadence, tout contenu politique réel. Elle ne subsiste que comme paravent trompeur au renforcement du totalitarisme étatique et les fractions de la bourgeoisie qui s'en réclament sont aussi réactionnaires que toutes.les autres, De fait, depuis la première guerre mondiale, la "démocratie" s'est révélée comme un des pires opiums pour le prolétariat. C'est en son nom, qu'après cette guerre, a été écrasée la révolution dans plusieurs pays d'Europe, c'est en son nom et contre le "fascisme", qu'ont été mobilisés des dizaines de millions de prolétaires dans la seconde guerre impérialiste. C'est encore en son nom, qu'aujourd'hui, le capital tente de dévoyer les luttes prolétariennes dans les alliances "contre le fascisme", "contre la réaction", "contre la répression", "contre le totalitarisme", etc. coproduit spécifique d'une période où le prolétariat a déjà été écrasé, le fascisme n'est absolument pas à l'ordre du jour à l’heure actuelle et toute propagande sur le "danger fasciste" est parfaitement mystificatrice. D'autre part, il ne détient pas le monopole de la répression, et si les courants politiques démocratiques ou de gauche l'identifient avec celle-ci, c'est qu'ils tentent de masquer qu'ils sont eux-mêmes des utilisateurs décidés de cette même répression a tel point que c'est à eux que revient l'essentiel de l'écrasement des mouvements révolutionnaires de la classe.
Au même titre que les "fronts populaires" et "antifascistes", les tactiques de "front unique" se sont révélées de redoutables moyens de détournement de la lutte prolétarienne. Ces tactiques, qui commandent aux organisations révolutionnaires de proposer des alliances aux partis dits "ouvriers" afin de les "mettre au pied du mur" et de les démasquer, ne reviennent, en fin de compte, qu'à maintenir des illusions sur la véritable nature bourgeoise de ces partis et à retarder la rupture des ouvriers avec eux,
L’"autonomie" du prolétariat face à toutes les autres classes de la société est la condition première de l'épanouissement de sa lutte vers le but révolutionnaire. Toutes les alliances, et particulièrement celles avec des fractions de la bourgeoisie, ne peuvent aboutir qu'à son désarmement devant son ennemi en lui faisant abandonner le seul terrain où il puisse tremper ses forces : son terrain de classe. Tout courant politique qui tente de lui faire quitter ce terrain appartient au camp, de la bourgeoisie.
X - LE MYTHE CONTRE-REVOLUTLONNAIRE DE LA " LIBERATION NATIONALE"
La libération nationale et la constitution de nouvelles nations n'a jamais été une tâche propre du prolétariat, Si, au siècle dernier, les révolutionnaires ont été amenés à appuyer de telles politiques, ce n'est donc.pas avec des illusions sur leur caractère exclusivement bourgeois ni au nom du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes". Un tel appui reposait sur le fait que, dans la phase ascendante du capitalisme, la nation représentait le cadre approprié au développement du capitalisme et toute nouvelle édification de ce cadre, en éliminant les vestiges contraignants des rapports sociaux précapitalistes, constituait un pas en avant dans le sens d' une croissance des forces productives au niveau mondial et donc dans le sens de la maturation des conditions matériel les du socialisme.
Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, et au même titre que l'ensemble des rapports de production capitalistes, la nation devient un cadre trop étroit pour le développement des forces productives. Aujourd'hui, la constitution juridique d’un nouveau pays ne permet aucun réel pas en avant dans un tel développement que les pays les plus anciens et les plus puissants sont eux-mêmes incapables d'assumer. Dans un monde désormais divisé et partagé entre blocs impérialistes, toute lutte de "libération nationale", loin de constituer un quelconque mouvement progressif, se résume en fait à un moment de l'affrontement constant entre bloc rivaux dans lesquels les prolétaires: et paysans enrôlés, volontairement ou de force, ne participent que comme chair à canon,
De telles luttes "n'affaiblissent" aucunement 1'Impérialisme puisqu'elles ne remettent pas en cause sa base : les rapports de production capitalistes. Si elles affaiblissent un bloc impérialiste c'est pour mieux en renforcer un autre et, la nation ainsi constitué devient elle-même impérialiste puisqu'à l’heure de la décadence, aucun pays, grand ou petit, ne peut s'épargner une telle politique.
Si, dans le monde actuel, une "libération nationale réussie" n'a d'autre signification que le changement de puissance de tutelle pour le pays concerné, elle se traduit la plupart du temps, pour les travailleurs, en particulier dans les nouveaux pays "socialistes", par une intensification, une systématisation, une militarisation de l'exploitation par le capital étatisé qui, manifestation de la barbarie actuelle du système, transforme la nation "libérée" en véritable camp de concentration. Loin d'être, comme le prétendent certains, un tremplin pour la lutte de classe du prolétariat du tiers-monde, ces luttes, par les mystifications "patriotiques" qu'elles colportent et l'embrigadement derrière le capital national qu'elles impliquent, agissent toujours comme frein et dévoiement de la lutte prolétarienne souvent acharnée dans ces pays. L’histoire a amplement montré depuis plus d'un demi-siècle et contrairement aux affirmations de l'Internationale Communiste, que les luttes de "libération nationale" n'impulsent pas plus le combat de classe des prolétaires des pays avancés que celui des prolétaires des pays sous-développés. Les uns comme les autres n'ont rien à attendre de ces luttes ni aucun "camp à choisir". Dans ces affrontements le "seul" mot d'ordre des révolutionnaires ne peut être, contre la version moderne de la "défense nationale" que représente "l'indépendance nationale" que celui qui fut déjà adopté par eux dans la première guerre mondiale : "défaitisme révolutionnaire : transformation de la guerre impérialiste en guerre civile". Toute position de "soutien inconditionnel" ou "critique" à ces luttes est aussi criminelle que celle des "social-chauvins" de la première guerre mondiale et donc parfaitement incompatible avec une activité communiste.
XI - L’AUTOGESTION AUTO-EXPLOITATION DU PROLETARIAT
Si la nation est devenue un cadre trop étroit pour les forces productives actuelles, ceci est encore plus vrai pour 1' entreprise qui n'a jamais connu d'autonomie véritable par rapport aux lois générales du capitalisme et dont la dépendance par rapport à celles-ci et à l'Etat ne peut aller qu'en s'accentuant dans la décadence capitaliste. C'est pour cela que "l'autogestion", c'est-à-dire la gestion des entreprises par les ouvriers au sein d'une société qui reste capitaliste, si elle était déjà une utopie petite-bourgeoise au siècle dernier quand elle était préconisée par les courants proudhoniens, est aujourd'hui une pure mystification capitaliste.
— arme économique du capital, elle a pour finalité de faire accepter par les travailleurs le poids des difficultés des entreprises frappées par la crise en leur faisant organiser les modalités de leur propre exploitation,,
— arme politique de la contre-révolution, elle a pour fonction :
- de diviser la classe ouvrière en l'enfermant et l'isolant usine par usine, quartier par quartier, secteur par secteur ;
- d'attacher les travailleurs aux préoccupations de l'économie capitaliste qu'ils ont au contraire pour tâche de détruire ;
- de détourner le prolétariat de la première tâche qui conditionne son émancipation ; la destruction de 1'appareil politique du capital et l'instauration de sa propre dictature au niveau mondial.
C'est effectivement à ce seul niveau que le prolétariat pourra .prendre en charge la gestion de la production, mais alors, il ne le fera pas dans le cadre des lois capitalistes mais en détruisant celles-ci.
Tous les courants politiques qui, même au nom de "1'expérience, prolétarienne" ou de "l'établissement" de nouveaux rapports entre travailleurs", défendent 1' autogestion, se font en fait les défenseurs objectifs des rapports de production capitalistes.
XII - LES LUTTES "PARCELLAIRES", IMPASSE RE ACTIONNAIRE.
La décadence du capitalisme a accentué la. Décomposition de toutes ses valeurs morales et "une dégradation profonde de tous les rapports humains9
Cependant, s'il est vrai.que la Révolution Prolétarienne engendrera de nouveaux rapports dans tous les domaines de la vie, il est erroné de croire que l'on peut y contribuer en organisant des luttes spécifiques sur des problèmes parcellaires tels le racisme, la condition féminine, la pollution, la sexualité et autres aspects de la vie quotidienne.
La lutte contre les fondements économiques du système contient la lutte contre les aspects superstructures de la société capitaliste, mais la réciproque est fausse.
Par leur contenu même, les luttes "parcellaires", loin de renforcer la nécessaire autonomie de la classe ouvrière, tendent au contraire à la diluer dans la confusion de catégories particulières ou invertébrées (races, sexes, jeunes, etc.) totalement impuissantes devant 1'Histoire. C’est pourquoi elles constituent un authentique instrument de la contre-révolution que les gouvernements bourgeois ont appris à utiliser efficacement.
XIII - LA NATURE CONTRE-REVOLUTIONNAIRE DES PARTIS "OUVRIERS"
L'ensemble des partis ou organisations qui aujourd'hui défendent, même conditionnellement ou de façon critique, certains Etats ou certaines fractions de la bourgeoisie contre d'autres, que ce soit -au nom du "socialisme", "de la démocratie, de l’antifascisme, de "l’indépendance nationale", du "front unique" ou du "moindre mal", qui participent, de quelque façon que ce soit, au jeu bourgeois, des élections, à l'activité anti ouvrière du syndicalisme ou aux mystifications autogestionnaires, sont des agents du capitale. Il en est ainsi, en particulier des partis "socialistes" et "communistes".
Les premiers ont perdu toute substance; prolétarienne en s'engageant dans la "défense nationale" au cours de la première guerre mondiale et se sont illustrés après celle-ci comme bourreaux du prolétariat révolutionnaire.
Les seconds sont, à leur tour, passés dans le camp du capital, en reniant l'internationalisme qui avait justement été à l'origine de leur rupture avec les partis socialistes, A travers, "le socialisme en un seul pays" d'abord et qui marque ce passage définitif à l'ennemi de classe puis la participation aux efforts d'armement de leur bourgeoisie, aux "fronts populaires", à la "résistance" durant la seconde guerre mondiale et à la "reconstruction nationale" après, celle-ci y ces partis se sont confirmes de plus en plus comme de fidèle serviteurs du capital national, et comme la pure incarnation de la contre-révolution.
L'ensemble des courants maoïstes, trotskistes ou anarchistes qui, soit sont directement issus de ces partis bourgeois, soit défendent un certain nombre de leurs, positions (défense des pays dits "socialistes" et alliances "antifascistes"…) appartiennent au même camp qu’eux : celui du capital. Le fait qu'ils aient moins d'influence ou qu'ils utilisent un langage plus radical, n’enlève rien au fond bourgeois de leur programme mais en fait d'utiles rabatteurs ou suppléants de ces partis.
XIV - LA PREMIERE GRANDE VAGUE REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT MONDIAL
En ponctuant l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, la première guerre mondiale indique que l.es conditions objectives de la révolution prolétarienne sont mûres.
La vague révolutionnaire qui, en réponse à la guerre et à ses séquelles, surgit, et, se répand en. Russie et; en Europe, marque de son empreinte les deux Amériques et se répercute comme un écho jusqu’en Chine, constitue donc la première tentative du prolétariat mondial d’accomplir sa tâche historique de destruction du capitalisme. Au plus fort de sa lutte entre 1917 et 1923, le prolétariat se saisit du pouvoir en Russie, se lance-dans des insurrections de masses en Allemagne et secoue, jusque dans ses fondements l'Italie, la. Hongrie et l'Autriche. Bien que moins puissamment, il ne s’en manifeste pas moins et de façon acharnée, dans le reste du monde, comme par exemple en Espagne, en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Finalement, l'échec tragique de cette vague révolutionnaire est ponctuée, en 1927, par l'écrasement de l'insurrection prolétarienne en Chine, à Shanghai et à. Canton, qui vient conclure une longue série de combats et de défaites de la classe au niveau international. C’est pour cela que la Révolution d'Octobre 17 en Russie ne peut se comprendre que comme une des manifestations de cet immense mouvement de la classe, et non, comme une "révolution bourgeoise", "capitaliste d'Etat", "double", ou encore "permanente", imposant au prolétariat l’accomplissement de tâches "démocratiques" à la place d'une bourgeoisie incapable de les assumer.
C'est également à l'intérieur de cette vague révolutionnaire que s'inscrit la création, en 1919, de la Troisième Internationale (Internationale .Communiste) qui rompt organisâtionnellement et politiquement avec les partis de la Seconde dont la participation à la Guerre impérialiste a signé le passage dans le camp de la bourgeoisie. Le parti bolchevik, partie intégrante de la Gauche Révolutionnaire qui s'est dégagée de la 2° Internationale, par ses positions politiques, claires condensées dans les mots d'ordre "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile !" "Destruction de l'Etat bourgeois!" et '"Tout le Pouvoir aux Soviets !" ainsi que par sa participation décisive à: la création de la Troisième Internationale, apporte une contribution fondamentale au processus révolutionnaire et constitue, à ce moment, une authentique
Toutefois, si la dégénérescence tant de la révolution en Russie que de la 3ème Internationale a été essentiellement la conséquence de l'écrasement des tentatives révolutionnaires dans d’autres pays et de 1'épuisement général de la vague révolutionnaire, il faut également prendre considération le rôle joué parle parti Bolchevik, parce que pièce maîtresse de l'Internationale Communiste du fait de la faiblesse des autres partis, dans ce processus de dégénérescence et dans les échecs internationaux du prolétariat. Avec, pour exemples, l’écrasement du soulèvement de Kronstadt, la mise en avant contre la gauche de la 3ème Internationale, des politiques de "conquête des syndicats", de "parlementarisme" révolutionnaire" et de "front unique", son influence et sa responsabilité dans la liquidation de la vague révolutionnaire ont été à la mesure de celles qu'il avait assumées dans le développement de cette vague.
En Russie même la contre-révolution ne venait pas seulement "de l'extérieur" mais aussi "de l'intérieur" et en particulier des structures de l'Etat mises en place par le Parti Bolchevik devenu parti étatique. Ce qui, pendant Octobre 1917, ne constituait que des erreurs graves mais s'expliquant aussi bien par l'immaturité du prolétariat en Russie que par celle du mouvement ouvrier mondial face au changement de période, devait, dès lors, servir de paravent et justification idéologique de la contre-révolution, et agir comme facteur emportant de celle-ci. Cependant, le déclin de la vague révolutionnaire du premier après-guerre comme de la révolution en Russie, la dégénérescence de la 3° Internationale comme du parti bolchevick et le rôle contre-révolutionnaire, finalement joué pair ce dernier à partie d'un certain moment, ne peuvent être compris qu'en considérant cette vague révolutionnaire et la 3° Internationale, y induis leur composante en Russie; comme d'authentiques manifestations du mouvement prolétarien, toute autre interprétation constituant un facteur considérable de confusion et interdisant aux courants qui la défendent un réel accomplissement de tâches révolutionnaires.
Même si, et d’autant plus qu'il ne subsiste aucun "acquis matériel" de ces expériences de la classe, ce n'est qu'à partir de cette compréhension de leur nature qu'on peut et doit dégager leurs acquis théoriques réels, d'une importance considérable. En particulier, seul exemple historique de prise de pouvoir politique par le prolétariat (hormis la tentative éphémère et désespérée de la Commune en 1871 et les expériences avortées de Bavière et de Hongrie en 1919), la Révolution d'Octobre 17 a apporté des enseignements précieux dans la compréhension de deux problèmes cruciaux de la lutte prolétarienne : le contenu de la Révolution et la nature de l'Organisation des révolutionnaires.
XV -LA DICTATURE DU PROLETARIAT
La prise du pouvoir politique par le prolétariat à l’échelle mondiale, condition préliminaire et première étape de la transformation révolutionnaire de la société capitaliste, signifie, en premier lieu, la destruction de fond en comble de l^FP5£Giï^d^Êtat_boûrgêôïs7
En effet, comme c'est sur celui-ci que la bourgeoisie assoit la perpétuation de sa domination sur la société, de ses privilèges, de l'exploitation des autres classes et,: particulièrement de la classe ouvrière, cet organe est nécessairement adapté à cette fonction.et ne peut convenir à cette dernière classe qui n'a aucune privilège ni exploitation à préserver. En d'autres termes, il n'existe pas de "voie pacifique vers le "socialisme" : à la violence de classe minoritaire et exploiteuse exercée ouvertement ou hypocritement, mais de façon de plus en plus systématique par la bourgeoisie, le prolétariat ne peut qu'opposer sa propre violence révolutionnaire de classe.
Levier de la transformation économique de la société, la dictature du prolétariat, c'est-à-dire l'exercice exclusif du pouvoir, politique par celui-ci, aura pour tâche fondamentale d'exproprierez classe exploiteuse en socialisant ses moyens de production et d’étendre progressivement au secteur socialisé à l'ensemble des activités productives. Fort de son pouvoir politique, le prolétariat devra s'attaquer à l'économie politique bourgeoise en menant une politique économique dans le sens de l'abolition du salariat et de la production marchande, dans celui de la satisfaction des besoins de l'Humanité.
Pendant cette période de transition du capitalisme au Communisme, il subsiste des classes et couches sociales non-exploiteuses autres que le prolétariat et qui assoient leur existence sur le secteur non socialisé de l'économie. De ce fait, la lutte de classe se maintien comme manifestation d'intérêts économiques contradictoires au sein de la société. Celle-ci fait donc surgir un Etat destiné à empêcher que ces conflits ne conduisent à son déchirement. Mais avec la disparition progressive de ces classes sociales par l'intégration de leurs membres dans le secteur socialisé, donc avec l'abolition de toute classe sociale, l’Etat lui-même sera appelé à disparaître.
La forme revêtue par la dictature du prolétariat sera celle des Conseils Ouvriers, assemblées unitaires et centralisées à l'échelle de la classe, avec délégués élus et révocables, permettant l'exercice effectif, collectif et indivisible du pouvoir par l'ensemble de celle-ci. Ces conseils devront avoir le monopole du contrôlé des armes comme garant du pouvoir politique exclusif de la classe ouvrière.
C'est la classe ouvrière dans son ensemble qui seule peut exercer le pouvoir dans le sens de la transformation communiste de la société, contrairement aux autres classes révolutionnaires du passé, elle ne peut donc déléguer son pouvoir à une quelconque institution ou minorité y compris là minorité des révolutionnaires elle-même. Ceux-ci agissent au sein des Conseils, mais leur organisation ne peut se substituer à l'organisation unitaire de la classe dans l'accomplissement de la tâche historique de celle-ci.
De même, l'expérience de la révolution russe a fait apparaître la complexité et .la-gravité du problème posé par les rapports entre la classe et l'Etat de la période de transition. Dans la période qui vient, le prolétariat et les révolutionnaires ne pourront pas esquiver ce problème, mais se devront d'y consacrer tous les efforts nécessaires pour le résoudre.
La dictature du prolétariat implique l'absolue soustraction de celui-ci à toute soumission, en tant que classe, à des forces extérieures ainsi qu'à tout établissement de rapports de violence en son sein. Dans 1a période de transition, le prolétariat est la seule classe révolutionnaire de la société. Sa conscience et sa cohésion, ainsi que son action autonome, sont les garanties essentielles de l'issue communiste de sa dictature.
XVI - L'ORGANISATION DES REVOLUTIONNAIRES,
a— Organisation et conscience de.la classe
Toute classe luttant contre l'ordre social de son époque, ne peut le faire efficacement qu’en donnant à sa lutte une forme organisée et consciente. Ceci était déjà valable, quel que puisse être le degré d'imperfection et d'aliénation de leurs formes d'organisation et de conscience, pour les couches comme la paysannerie ou celle des esclaves qui ne portaient pas en elles le devenir socialo Mais cette nécessité s’applique encore plus aux classes historiques porteuses des nouveaux rapports de production rendus nécessaires par l'évolution de la société. Le prolétariat est, parmi celles-ci, la seule classe qui ne dispose, dans l'ancienne société d'aucun pouvoir économique, ne prélude à sa future domination. De ce fait, l’organisation et la conscience sont des facteurs encore bien plus décisifs de sa lutte,,
La forme d'organisation que se donne la classe dans sa lutte révolutionnaire et pour l'exercice de son pouvoir politique est celle des Conseils Ouvriers. Mais si c'est l'en semble de la classe qui est le sujet de la Révolution et qui se regroupe donc dans ces organes au moment de celle-ci, cela n’en signifie pas pour autant que le processus de sa prise de conscience soit simultané et homogène.
La conscience de la classe se forge à travers ses luttes, elle se fraye un chemin difficile à travers ses succès et ses défaites. Elle doit faire face aux divisions et aux différences catégorielles ou nationales qui constituent le cadre "naturel" de la société que le capitalisme a intérêt à maintenir au sein de la classe.
b — Les révolutionnaires et leur fonction
Les révolutionnaires sont les éléments de la classe qui, à travers ce Processus hétérogène, se hissent les premiers à une "intelligence nette des conditions de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien" (Manifeste Communiste) et, comme dans la société capitaliste, "les idées dominantes sont les idées de la classe dominante", ils constituent forcement une minorité de la classe.
Sécrétion de la classe, manifestation du processus de sa prise de conscience, les révolutionnaires ne peuvent exister comme tels qu'en s'organisant et devenant accomplir cette tâche et de façon indissociable, l'organisation des révolutionnaires :
- participe à toutes les luttes de la classe dans lesquelles ses membres se distinguent comme les éléments les plus déterminés et combatifs.
- y intervient en mettant toujours au premier plan les intérêts généraux de la classe et les buts finaux du mouvement.
- pour cette intervention, et comme partie intégrante de celle-ci, elle se consacre de façon permanente au travail de réflexion et d'élaboration théorique, travail qui seul permet que son activité générale s'appuie sur toute l'expérience passée de.la classe et sur ses perspectives d'avenir ainsi dégagées.
c — Les rapports entre la classe et l'organisation des révolutionnaires.
Si l'organisation générale de la classe et l'organisation des révolutionnaires participent d'un même mouvement, ce n’en sont pas moins deux choses distinctes.
La première, l'organisation des Conseils, regroupe1' ensemble de la classe : le seul critère d'appartenances est d’être un travailleur.
La seconde, par contre, ne regroupe que des éléments révolutionnaires de la classe. Le critère d'appartenance est, non plus sociologique, mais politique : l'accord sur le programme et l'engagement de le défendre. En ce sens, peuvent faire partie de l'avant-garde de la classe des individus qui n'en font pas partie sociologiquement mais qui, rompant avec leur classe d'origine, font leurs les intérêts historiques du prolétariat.
Cependant, si la classe et l'organisation de son avant-garde sont deux choses bien distinctes, elles ne sont pas pour cela séparées, extérieures l’une à l’autre ou même opposées comme le prétendent d'une part les courants "léninistes" et, d'autre part, les courants conseillistes-ouvriéristes.
Ce que ces deux conceptions veulent ignorer, c'est que, loin de s'affronter, ou de s'opposer, ces deux éléments -la classe et les révolutionnaires- sont en fait complémentaires dans un rapport de tout et de partie du tout. Entre la première et les seconds, il ne peut jamais exister de rapports de force puisque "les communistes n'ont point d'intérêt qui les séparent du prolétariat en général" (Manifeste Communiste).
Comme partie de la classe, les révolutionnaires ne peuvent, à aucun moment, se substituer à celle-ci, ni dans ses luttes au sein du capitalisme ni, à plus forte raison, dans le renversement de celui-ci ou dans l'exercice du pouvoir. Contrairement à ce qui prévalait pour les autres classes historiques, l'œuvre que doit mener à bien le prolétariat ne se suffit pas de la conscience d'une minorité aussi éclairée soit-elle, mais exige la participation constante et une activité créatrice de tout instant de la classe dans son ensemble.
La conscience généralisée est la seule garantie de victoire de la Révolution prolétarienne et, comme elle est essentiellement le fruit de l'expérience pratique, l'activité de l’ensemble de la classe est irremplaçable. En particulier, l'usage que la classe doit nécessairement faire de la violence ne peut-être une activité séparée du mouvement général de la classe. En ce sens, le terrorisme individuel ou de groupes isolés, est absolument étranger aux méthodes de la classe et constitue au mieux une manifestation de désespoir petit-bourgeois quand il n'est pas simplement une méthode cynique de lutte de fractions de la bourgeoisie entre elles.
L'auto-organisation des luttes de la classe et l'exercice du pouvoir par elle-même n'est pas une des voies vers le communisme, qu'on pourrait mettre en balance avec d'autres, C'EST L'UNIQUE VOIE.
d — L’autonomie de la classe ouvrière
Cependant, le concept d'"autonomie de la classe" tel qu'il est compris par les courants ouvriéristes et anarchistes, et qu'ils opposent aux conceptions substitutionnistes, acquiert chez eux, un sens réactionnaire et petit-bourgeois. Outre que "l'autonomie" se réduit bien souvent chez eux à leur propre autonomie de petite secte prétendant représenter la classe ouvrière au même titre que les courants substitutionnistes qu'ils dénoncent, leur conception comporte deux aspects principaux :
- le rejet de la part des travailleurs des partis et organisations politiques quels qu'ils soient
- L'autonomie de chaque fraction de la classe ouvrière (usines, quartiers, régions, nations, etc.) par rapport aux autres : le Fédéralisme.
Actuellement de telles notions sont, dans le meilleur des cas, une réaction primaire contre le bureaucratisme stalinien et le développement du totalitarisme étatique et, dans le pire, l'expression politique de l'isolement et de la division propre à la petite bourgeoisie. Mais dans les deux cas, elles traduisent l'incompréhension totale de trois aspects fondamentaux de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
- l'importance et la priorité des tâches politiques de la classe (destruction de l'Etat capitaliste, dictature mondiale du prolétariat) ;
- l'importance et le caractère indispensable de l'organisation des révolutionnaires au sein de la classe ;
- le caractère unitaire, centralisé et mondial de la lutte révolutionnaire de la classe.
Pour nous, marxistes, l'autonomie de la classe signifie son indépendance par rapport aux autres classes de la société. Cette autonomie constitue une CONDITION INDISPENSABLE pour l'action révolutionnaire de la classe dans la mesure où le prolétariat est aujourd'hui la seule classe révolutionnaire. Elle se manifeste tant sur le plan organisationnel (organisation des Conseils) que sur les plans politiques et programmatiques et donc, contrairement à ce que pensent les courants ouvriéristes, on étroite liaison avec son avant-garde communiste.
e — L’organisation des révolutionnaires dans les différents moments de la lutte de classe.
Si l'organisation générale de la classe et l'organisation de révolutionnaires sont deux choses différentes quand à leur fonction, elles le sont également quand aux circonstances de leur apparition, Les Conseils n'apparaissent que dans les périodes d’affrontements révolutionnaires, quand toutes les luttes de la classe tendent vers la prise du pouvoir. Par contre, l'effort de prise de conscience de la classe existe constamment depuis ses origines et existera jusqu'à sa disparition dans la société communiste. C'est en ce sens qu'il existe en toutes périodes des minorités révolutionnaires comme expression de cet effort constant. Mais l'ampleur, l'influence, le type d'activité et le mode d'organisation de ces minorités sont étroitement liés aux conditions de la lutte de classe.
Dans les périodes d'activité intense de la classe, ces minorités ont une influence directe sur le cours pratique de cette activité. On peut alors parler de parti pour désigner l'organisation de cette avant-garde. Par contre, dans les périodes de recul, ou de creux de la lutte de classe, les révolutionnaires n’ont plus une influence directe sur le cours immédiat de l'Histoire. Seules peuvent subsister des organisations à la taille beaucoup plus redite dont la fonction ne errait plus être d’influencer le mouvement immédiat, mais d'y résister, ce qui les conduit à lutter à contre-courant d’une classe paralysée et entraînée par la bourgeoisie sur son terrain (collaboration de classe, "union sacrée", "résistance", "antifascisme", etc.). Leur tache essentielle consiste alors, en tirant les leçons des expériences antérieures, à préparer le cadre théorique et programmatique du futur parti prolétarien qui devra nécessairement ressurgir dans la prochaine montée de la classe. D’une certaine façon, ces groupes et fractions qui, au moment du recul de la lutte se sont dégagés du parti en dégénérescence ou lui ont survécu, ont pour rôle de constituer le pont politique et organisationnel jusqu'à son prochain resurgissement.
f — Le mode d’organisation des révolutionnaires.
La nature nécessairement mondiale et centralisée de la Révolution Prolétarienne confère au parti de la classe ouvrière ce même ce même caractère mondial et centralisé, et les fractions ou groupes qui travaillent à sa reconstitution tendent nécessairement vers une centralisation mondiale. Celle-ci se concrétise par l'existence d'organes centraux investis de responsabilité politiques entre chacun des congrès devant lesquels ils sont responsables.
La structure que se donne l'organisation des révolutionnaires doit tenir compte de deux nécessités fondamentales :
- permettre le plein développement de la conscience révolutionnaire en son sein et donc de la discussion la plus large et approfondie de toutes les questions et désaccords qui surgissent dans une organisation non monolithique.
- assurer, en même temps, sa cohésion et son unité d’action en particulier par l'application, par toutes les parties de l'organisation, des décisions adoptées majoritairement.
De même, les rapports qui se nouent entre les différentes parties et différents militants de l'organisation porte nécessairement les stigmates de la société capitaliste et, ne peuvent donc constituer un îlot de rapports communistes au sein de celle-ci. Néanmoins, ils ne peuvent être en contradiction flagrante avec le but poursuivi par les révolutionnaires et ils s'appuient nécessairement sur une solidarité et une confiance mutuelle qui sont une des marques de l'appartenance de l'organisation à la classe porteuse du communisme.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Le capital mondial : crise, lutte de classe et perspectives pour 1976.
- 2986 reads
L’EQUILIBRE ECONOMIQUE
Le fragile équilibre économique du capital mondial a été irrémédiablement brisé l’année passée. Le Tiers-monde a sombré encore plus dans l'appauvrissement et le déclin tandis que les prix des matières premières dont dépendent ces économies se sont effondrés. Pour prendre un exemple, l’indice des prix mondiaux des métaux recueilli par l’"Economist" a chuté de 245,8 en mai 1974 à 111,8 en septembre 1975 -une chute qui a pratiquement ramené l'indice au niveau prévalant en 1970. Même les apparents eldorados de ces dernières années, les Etats producteurs de pétrole comme 1!Iran et Arabie Saoudite ont dû rogner vigoureusement dans 1eurs à ambitieux projets de développement.
Dans les métropoles capitalistes, la crise a rapidement dépassé ses premières manifestations comme crise monétaire même si les répercutions de la dislocation du système monétaire international et l’inflation galopante gagnent en intensité.
Maintenant, la crise se manifeste dans le procès de production des valeurs matérielles lui-même. Le jugement selon lequel nous sommes pleinement et clairement dans une crise générale de surproduction est aujourd'hui incontestable.
Aux U.S.A, 31?S des capacités de production restent inactives aujourd' hui 5 au Japon, plus d'un cinquième de la capacité industrielle reste inemployé. Avec une capacité de production annuelle de douze millions de voitures, l'industrie automobile européenne ne va pas produire plus de huit millions de véhicules en 1975.
Le tableau qui suit montre l'ampleur de l'affaissement de la production industrielle, qui a été sans précédent depuis la crise des années 1930.
Production - variation en pourcentage du second quart de 1974 au second quart de 1975.
Le déclin de la production est maintenant ressenti dons le bloc de l’Est également, où les planificateurs russes ont dû admettre en décembre que la production a seulement augmenté de 4$ au lieu des 6,5$ prévus. Ce dernier chiffre étant lui même un objectif qui avait été, deux ans auparavant, sérieusement révisé en baisse quand les bureaucrates ont découvert qu’ils devaient "planifier" les effets destructeurs d'une crise qui rend risible toute tentative de planification capitaliste.
Le fléchissement de la croissance du commerce mondial, qui a suivi le "boom" inflationniste de 72-73, a produit eh 75 la première diminution en volume du commerce mondial depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les profits, qui sont 1'indice le plus précis de la santé de l'économie capitaliste, ont chuté de manière encore plus catastrophique eue la production et le commerce mondial, An Japon, lès bénéfices des sociétés ont chuté de 47 $ durant les six premiers mois de 1975. Les sommes substantielles mises en épargne, pendant les années du "boom" sont maintenant incorporées dans les bilans, les profits ont en fait diminué de 70 $ environ. Un quart des compagnies répertoriées à la bourse de Tokyo ont fonctionné à perte cette année. En Allemagne, les grands trusts chimiques qui avaient lancé le "miracle économique" ont vu leurs énormes bénéfices se dissoudre: Bayer a vu ses bénéfices pour 6 mois diminuer des 2/3, BASF de moitié. En Grande-Bretagne, beaucoup parmi les plus importantes entreprises ont dû se mettre sous l'aile protectrice de 1' Etat pour éviter la fermeture ou la faillite : Burmah Oil, Ferranti, Alfred Herbert, British Leyland, Chrysler U.K., et toute l'industrie de construction navale.
Le Trésor estime que le taux de profit du capital placé dans l'industrie britanniques est tombé de 11,5 $ à 4,5 en 1974. En Italie, pratiquement tous les grands groupes industriels (étatisés ou "privés") perdent de l'argent et sont étouffés par le paiement des énormes intérêts des dettes contractées les années passées pour rester à flot. Le gouverneur de la Banque Centrale a recommandé que la part de dette de l'industrie envers les banques soit convertie en actions, ce qui constituerait de fait une nationalisation car les grandes banques sont propriété de l'Etat. De son côté> la Fédération des patrons, la Confindustria, a demandé d'urgence un moratoire d’un ou deux ans sur le paiement des intérêts comme étant le seul moyen de sauver 1’économie italienne.
Aux Etats-Unis, qui furent les architectes de l'équilibre économique provisoire établi après la IIème Guerre Mondiale aussi bien que les principaux bénéficiaires du repartage du marché mondial affecté par le carnage impérialiste, les profits dans toutes les industries de base se sont écroulés comme un château de cartes sous l'impact de la crise.
LE STATU-QUO ENTRE LES CLASSES.
L'effondrement de l'équilibre économique, si soigneusement reconstruit à la suite de la boucherie inter-impérialiste de 1939-45, a déjà sévèrement perturbé le fragile statuquo social qui reposait sur lui et qui ne pourra lui survivre. Avec le profond déclin de la production, du commerce mondial et du profit, le capital se débarrasse lui-même de cette partie de la force de travail qui devient superflue. A travers le monde, une immense armée de chômeurs, à la croissance rapide, atteste le seul futur que le capitalisme décadent peut la misère de plus offrir au prolétariat en plus profonde.
La croissance massive du chômage les années passées a déjà sonné comme un avertissement aux oreilles de la bourgeoisie dont les représentants les plus intelligents voient dans cette masse de prolétaires amers un des éléments qui menace de s'unir dans l'armée de la révolution mondiale.
Les statistiques officielles ne donnent en fait qu'une pâle indication de 1' extension du chômage dans les nations capitalistes dominantes. Aux USA, comme 1'attestent même des politiciens et économistes bourgeois, un calcul plus précis du nombre de chômeurs montrerait que ce sont plus de 10 millions de travailleurs qui sont privés par la crise de leur moyen d'existence. Une étude de la Banque d'Angleterre qui essaie d'unifier les calculs en ajustant les différences dans les méthodes de calcul utilisées par différents gouvernements, montre qu'en France il y avait déjà 1.150.000 chômeurs en avril (Financial Times, 20 juin 1975), un nombre qui a certainement dû s'accroître depuis. En Allemagne, le chiffre officiel ne tient pas compte des 300.000 travailleurs immigrés expulsés depuis mars 74 et du million de travailleurs inemployés à temps partiel. Les statistiques japonaises sur le chômage ignorent les travailleurs saisonniers qui ont été licenciés, ne tiennent pas compte-du chômage partiel ces travailleurs qui ont été contraints de quitter "volontairement" leur travail ou de "prendre des vacances" imposées qui cachent les fermetures temporaires. Une estimation plus réaliste du nombre de chômeurs véritable au Japon devrait au moins se situer vers 2 millions. Sur la base d'estimations raisonnables et précises des gens sans travail en Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Australie et Japon, il y a aujourd'hui au moins une masse grandissante de 21 millions de chômeurs.
La croissance énorme du nombre de chômeurs est seulement l'un des signes de la détérioration du niveau de vie de la classe ouvrière. D'un côté une part croissante du prolétariat doit faire face à la perspective d'être jetée sur le pavé par la bourgeoisie qui cherche à licencier les ouvriers en rapport avec la contraction des marchés avec l'espoir de rétablir un taux de profit plus élevé en extorquant encore plus de plus-value d'un plus petit nombre d'ouvriers. De l'autre côté, ces travailleurs qui n'ont pas été expulsés du procès dé production et que la crise condamne à une intensification incessante de l'exploitation dans les usines, ont vu leur salaire réel sévèrement amputé par la prodigieuse augmentation des prix des biens de consommation. Dans beaucoup de pays, en dépit de la croissance du chômage, les prix de consommation (alimentation, loyer, vêtement) augmentent encore plus vite qu'en 1974 :
A travers l'Europe Occidentale, 1'Amérique du Nord, l'Australie et le Japon, les prix de consommation ont augmenté à la moyenne de 11% entre août 74 et août 75.
Le prolétariat dans les pays de l'Est a aussi commencé à ressentir tout l'impact de la crise mondiale. En Yougoslavie, il y a plus d'un demi-million de chômeurs, tandis que l'augmentation du coût de la vie a été de 30fi l'année passée. En Russie et dans les autres pays de l'Est, même si le chômage peut être caché, rien ne peut dissimuler aux travailleurs l'augmentation palpable du taux d'exploitation qu'imposent 1eurs patrons capitalistes. De plus, le prolétariat est soumis à une augmentation dévastatrice et continuelle des prix des produits de consommation alors qu'au même moment il y a une pénurie massive et grandissante des produits de première nécessité. En décembre, les travailleurs polonais se sont vu annoncer "qu’une politique flexible des prix" remplacera le blocage des prix sur les produits d'alimentation de base. Quelques prix d'alimentation sont gelés depuis l'insurrection ouvrière de 1970 - 71, mais le seul résultat de ce blocage des prix est depuis longtemps de produire une pénurie accrue pour ces produits. L'effet de la planification capitaliste en Pologne, qui a permis l'exportation de quelques rares produits d'alimentation à l'étranger, peut se voir aussi dans le problème du logement où il y a maintenant une liste d'attente pour les appartements de plus d'un million et demi de familles. En décembre aussi, la Hongrie a annoncé la troisième augmentation importante des prix cette année sur un grand nombre de produits d'alimentation et de consommation.
Sous la poussée de la crise mondiale qui s'approfondie, avec la paupérisation grandissante du prolétariat qui en découle, le statuquo entre les classes qui a déjà commencé à se fissurer avec la venue de la crise à la fin des années 60, est brisé. L'année passée, la lutte de classe s'est intensifiée et généralisée, confirmant l'analyse de notre courant selon laquelle la perspective qui s'ouvre avec la crise est celle de la guerre de cl asse, de la révolution prolétarienne.
Au Pérou, en février 1975 les émeutes et les batailles de rue de Lima contre lesquelles la junte militaire de "gauche" a répondu par une répression sauvage causant la mort de centaines de personnes, l'arrestation de milliers de manifestants, et par la déclaration de l'état d'urgence furent» le sommet d'une importante vague de grèves : en août 1974, 15 000 mineurs du Centromin-Pérou, propriété de l'état se mettent en grève; en décembre 25 000 mineurs de cuivre se mettent en grève. Au Venezuela, durant l'hiver 1975, les mineurs, dans les mines de fer récemment nationalisées, lancent une grève dure. En Argentine, des dizaines de milliers de travailleurs sont en grève de Villa construction à Cordoba, de Rosario à Buenos Air es f du printemps à l'été. La vague d'occupation d'usines et la défense armée des quartiers ouvriers face à la répression brutale de l'armée et de la police, marquent la combativité grandissante du prolétariat en réponse à la crise.
En Chine, l'année 1975 a vu une vague de luttes ouvrières en réponse aux mesures d'austérité; l'Etat a réagi en envoyant des troupes dans les régions concernées pour briser les grèves et restaurer la production. En Septembre on a annoncé que 10 000 soldats ont été envoyés à Hengchow pour restaurer la production dans treize usinés. La très large utilisation de l'armée dans les mines de charbon, les centres sidérurgiques et de nombreuses autres industries donne une indication de l'étendue de la réponse du prolétariat chinois contre, à la fois, la détérioration de son niveau de vie et celle des conditions de travail que l'Etat veut lui imposer.
En Europe de l'Est, 1975 a aussi apporté de nouvelles évidences de la résistance prolétarienne aux attaques de la crise du capital mondial. Les grèves le ralentissement du travail, les actions de protestation et les sabotages ont augmenté partout. En Pologne, l'Etat a réagi en novembre, de lourdes amendes contre l'absentéisme ont été introduites et toute une série d'autres mesures disciplinaires sont annoncées comme prochaines. Avec en mémoire l'insurrection de1970 encore présente dans leurs pensées, les leaders politiques et les syndicats officiels ont fait une tournée des usines pour convaincre les travailleurs que les "conquêtes" des années passées peuvent être misés en danger par une "agitation stérile".
En Europe de l'Ouest, 1975 a amené une dramatique poussée de l'importance et de 1'intensité des grèves, terminant ainsi l'accalmie relative dé 1973-74 qui avait succédé à la vague de grèves débutant en 68. L'hiver dernier, des centaines de milliers d'ouvriers espagnols ont entrepris des grèves massives En janvier et février, la vague de grèves s'étend de Pampelune à Barcelone dans le nord, à travers la région de Madrid, vers 1'Andalousie au sud. En mars, les faubourgs industriels, de Bilbao sont le théâtre de grèves très dures, tandis qu'en avril, la vague culmine un moment avec la grève des 3000 ouvriers de la Casa Renault à Valladolid
En Italie, la fin du mois d'avril voit une grève sauvage des conducteurs du réseau de transports de Milan (ATM) qui était dirigée aussi bien contre les syndicats que contre les employeurs. En France, pendant le: printemps, la classe ouvrière a répondu aux licenciements et à la fermeture des usines dans l'industrie automobile, la sidérurgie, métallurgie, les journaux, les transports et les services publics par une vague de grèves que les syndicats ont provisoirement réussi à contenir mais avec de plus en de difficultés. En avril, plus de 50 usines étaient occupées tandis que le nombre de grévistes s'élevait à 100 000 par jour.
Aux Etats-Unis, l'été dernier, une grève sauvage des mineurs de charbon de la Virginie de l'Ouest, dirigée contre la collusion des syndicats et des propriétaires, s'est étendue en quelques jours, jusqu'à englober 80 000 des 125 000 mineurs de charbon du pays. Les efforts combinés des syndicats, des patrons, des cours de justice et de la police ont été nécessaire pour mettre fin à la grève qui a duré un mois et qui a complètement paralysé l’industrie du charbon.
Les années écoulées, la lutte de classe a continué à se développer, se répandant de pays en pays, touchant de plus en plus de secteurs industriels et incluant un nombre grandissant de travailleurs. Cependant, en dépit de leur extension et de leur intensité, qui témoigne de la combativité d'une génération de travailleurs qui n'a pas connue la défaite, ces luttes ont seulement ouvert une brèche mais n'ont pas encore brise les remparts corporatistes nationaux, et syndicaux, qui constituent les derniers bastions du capital contre la tempête prolétarienne menaçante. Une accalmie s'est momentanément installée sur le champ de bataille de classe pendant laquelle le prolétariat assimile les leçons de sa lutte récente et la bourgeoisie se prépare à affronter la classe ouvrière. Le calme avant le nouveau soulèvement qui germe déjà profondément dans le tréfonds de la société bourgeoise en déclin coïncide avec les bavardages concernant une reprise économique.
LA REPRISE : REALITE OU MYTHE?
Le prestigieux Economist de Londres a signalé une augmentation de la production commençant le printemps dernier au Japon, et cet été aux Etats-Unis et en Allemagne de l'Ouest, comme le signe annonciateur d’une reprise, ceci après la pire dépression depuis celle des années 30 :
"Les six plus importantes nations industrielles : USA, France, Japon, RFA, Grande-Bretagne et Italie, représentant environ à elles toutes 80% de la production industrielle. Après qu'elles se soient rencontrées au sommet de Rambouillet, chacune voit des hirondelles dans son ciel, et espère qu'elles sont le signal du printemps qui s'annonce. (15 nov. 75, p.
Ainsi l’Economist prévoit d'une manière très optimiste une élévation de leur PNB à toutes les six pour 1976, dans le cas des Etats-Unis et du Japon, une croissance solide de 6 $. Les cercles dirigeants aux USA parlent d'une manière encore plus confiante ; plus de doutes à ce sujet : la reprise des 11 affaires est vigoureuse, plus vigoureuse même que les optimistes ne l'attendaient" (borness Week, 3 nov.1975, p. 19).
Une partie non négligeable de la bourgeoisie partage le point de vue du premier ministre français Chirac, disant "on commence à voir le bout du tunnel".
Les marxistes n'ont jamais affirmé que dans une crise généralisée de surproduction, qui avec les périodes de guerre impérialiste et de reconstruction nationale constitue le cycle barbare du capitalisme décadent, la production baisse constamment, suivant une ligne droite descendante. Une crise sera toujours ponctuée par de faibles et courts sursauts de la production ou même par une augmentation conjoncturelle pour un capital particulier (national). Cependant, seule la bourgeoisie peut confondre une telle pause dans le déclin de la production avec les signes d'une reprise. Le prolétariat a appris une cruelle leçon selon laquelle à une époque de capitalisme décadent, la seule "reprise" qu'après une crise générale de surproduction la société bourgeoise peut avoir se situe après le carnage d'une nouvelle guerre mondiale.
Tandis que l'Etat capitaliste a assumé de manière croissante l'ensemble de chaque économie nationale depuis la crise mondiale des années 30 sans éliminer l'anarchie de la production qui est le stigmate du système capitaliste, la tendance générale vers le capitalisme d'Etat a rendu possible le tassement de la crise. Mène si l'appareil du capitalisme d'Etat a permis d'éviter un effondrement total de la production par le recours au programme inflationniste, le produit inéducable de l'inflation avec ses déficits budgétaires massifs, représente par la suite un affaiblissement de la compétitivité du capital national sur le marché mondial et une tendance prononcée vers une hyperinflation. Une telle situation nécessitera alors une déflation énergique pour éviter un effondrement de l'économie, qui produirait rapidement une crise de liquidités, une avalanche de banqueroutes et une nouvelle chute de la production. De plus, de là manière que la déflation, d'une part produit un effondrement industriel, d'autre part ne fait que ralentir, sans l'arrêter l'inflation galopante, les programmes inflationnistes ne font que ralentir le déclin de la production sans pouvoir renverser la tendance, et de plus produit un boom de l'inflation. Bieri avant que la déflation puisse arrêter l'inflation galopante, elle produirait un effondrement général du système à travers l'asphyxie. Bien avant que la relance puisse éliminer la sous-utilisassions, des capacités industrielles, elle produirait l'hyperinflation et donc l’écroulement de la production. L'économie mondiale est aujourd'hui condamnée à osciller entre des poussées d'inflation et de dépression de plus' en plus dures quelque soit le plan que l'Etat capitaliste adopte.
La reprise, dont la bourgeoisie elle-même essaie de se convaincre de la réalité est condamnée à être morte née. Les signes d'une reprise apparente sont dus à deux facteurs :
- D’abord, une halte temporaire d'une sévère politique de déstockage que l'industrie a entreprise depuis plus d'une année pour, faire face aux marchés sur saturés; et l'élan qui en découle dans la production quand l'industrie recomposées stocks dégarnis.
- Ensuite, la diminution des taxes et 1' accroissement, des dépenses publiques que les différents Etats leadeurs du capitalisme ont entrepris dans un effort désespéré pour soutenir la production et éviter un chômage encore plus important (avec le soulèvement social qui en serait le résultat inévitable).
Aucun de ces facteurs ne fournit les bases pour une reprise réelle. La reconstitution des stocks sera rapidement achevée dès que ceux-ci se heurteront aux réalités du marché mondial rétréci, et sans un nouvel élan, une nouvelle période de liquidation des stocks devra commencer. Le déficit budgétaire sans précédent qui a été nécessaire pour financer les différents programmes de relance, a déjà atteint le point où il provoque une forte-inflation sans pour autant, diminuer rapidement.
Estimation des déficits budgétaires pour l'année fiscale en cours :
Dans les pays capitalistes dominants, 1'année qui vient va se caractériser par un effort systématique pour réduire le déficit budgétaire en rognant sur les dépenses publiques et en faisant un nouveau saut dans la déflation. Ainsi la "reprise" va-t-elle nécessairement entrer en collision avec la diminution des dépenses publiques. Quand aucun accroissement effectif de la demande globale n'est concevable, quand les industries du monde entier amputent leurs dépenses, quand les "économies planifiées" planifient toutes la baisse de leur croissance industrielle, la nature erronée de la reprise pour laquelle est fait un si grand battage, devient évidente.
LA REPONSE DE LA BOURGEOISIE A LA CRISE.
Pour être compétitive sur un marché mondial saturé, chaque fraction nationale du capital doit essayer de réduire le prix de ses marchandises afin d'affronter ses concurrents sur le marché. Cependant, face à la chute du profit, elle doit réduire ses investissements dans de nouveaux outillages ou de nouvelles machines qui permettraient d'élever la productivité du travail et de vendre moins cher que ses concurrents. De plus, les coûts de production liés au capital constant qui est utilisé, sont relativement rigides et résistants à toute diminution si le coût des matières premières (capital circulant) tend à baisser quelque peu, le fardeau de l'outillage et des machines inoccupées (capital fixe) croix à un taux de plus en plus élevé. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel chaque capital national pout essayer de rendre sa production plus compétitive : en faisant supporter au prolétariat le poids de la crise.
L'assaut massif contre la classe ouvrière que mène actuellement la bourgeoisie prend deux formes. D'abord, celle d'une détérioration des conditions de travail du prolétariat de manière à élever le taux de profit sans faire aucun nouvel investissement dans le capital constant : réduction massive de la force de travail d'un côté, intensification du travail et allongement des horaires pour les travailleurs qui restent, de l'autre ([1] [4]). Ensuite, une forte réduction du niveau de vie du prolétariat, une attaque directe contre les salaires des ouvriers. Les salaires qui représentent l'équivalent du coût de production et de reproduction de la force de travail (et rendent aussi possible pour un ouvrier de fonder une famille, une nouvelle génération de prolétaires) sont dans les conditions prédominantes de capitalisme d'Etat "payé" de deux façons. Une partie est directement payée au travailleur par son employeur sous la forme de sa paye ; la deuxième partie est donnée au travailleur à la fois par son employeur et par l'Etat sous forme de "services sociaux". Les mesures d'austérité draconiennes (blocage des salaires, politique des revenus, diminution des services sociaux) que la bourgeoisie essaye maintenant d'imposer partout, ont pour objet l'amputation impitoyable des salaires des ouvriers sous ces deux formes.
Toutefois, confrontée à une classe ouvrière combative qui n'a pas connu la défaite, la bourgeoisie doit procéder avec la plus grande dextérité, elle n'ose pas encore imposer sa volonté à la classe ouvrière à travers la répression violente, de peur de provoquer l'affrontement de classe pour lequel elle n'est pas encore prête. Aussi, la bourgeoisie doit d’abord essayer de dévier le prolétariat de son terrain de classe, de le mystifier, de le diviser et de le dissoudre dans le "peuple" ([2] [5]). Ce que la bourgeoisie doit imposer à tout prix, c’est l’unité nationale. Ceci signifie que la gauche va être amenée à "gérer" la crise, à imposer des mesures d'austérité à la classe ouvrière, à convaincre les ouvriers que l'Etat est "leur" Etat et qu'ils doivent faire les sacrifices nécessaires dans son intérêt. Nous allons voir apparaître une floraison d'idéologies nationalistes antifascistes, anti-impérialistes; au niveau le plus élevé de l'appareil d'Etat capitaliste. Toute "opposition à l'Etat sera décrite comme aidant objectivement le toujours menaçant "danger fasciste" que le "peuple démocratique" doit écraser avec son "Etat populaire". La fraction consciente de .la clause, les militants ouvriers et les révolutionnaires seront dénoncés par tous les organes de propagande comme des "agents, fascistes" et des "instruments de la réaction". Avant que chaque fraction nationale de la bourgeoisie puisse espérer atténuer les effets dévastateurs de la crise mondiale et essayer de rafistoler 1'équilibre économique chancelant, elle doit d'abord restaurer 1'équilibre entre les classes. C'est cela qui constitue l'objectif politique du capitalisme d'Etat. La crise économique du capital agonisant a aujourd'hui poussé a un point crucial la profonde crise politique de la classe dirigeante.
LA LUTTE DE CLASSE
A cause de la nature convulsive de la crise qui échappe même au tentaculaire Etat capitaliste et à cause des sacrifices grandissants que l'Etat doit demander, la possibilité de restaurer, ne serait-ce que le plus ténu des statu quo social, s'évanouit, et l'éclatement d'une nouvelle et encore plus puissante vague de lutte de classe devient effectivement certaine.
A quelque moment que la prochain vague de grèves surgira, les travailleurs, s’ils veulent éviter que leur lutte soit, dirigée dans une impasse, devront immédiatement briser le contrôle que les syndicats ont de plus en plus difficilement maintenu sur les luttes des ouvriers. La rupture avec les syndicats prendra son expression concrète dans la formation d'Assemblées Générales dans les usines, qui auront le contrôle de la lutte et dans la création do Comités de Grève élus et révocables. Cependant, il est clair que même la grève la plus militante, et la plus combative, si elle veut éviter d'être isolée et finalement écrasée, doit dépasser rapidement le caractère corporatiste et local.que la structure même du système capitaliste essaie de lui imprimer dès sa naissance. Ce qui est nécessaire, c'est la GENERALISATION de la lutte : son extension aux autres usines, aux autres branches d'industrie et aux autres villes. Ce processus s'accompagnera de la constitution de Comité de Coordination, consistant en délégués des différentes usines, qui seront les embryons à partir desquels les Conseils Ouvriers prendront forme.
L'expérience des soixante années passées a amplement démontré que mené les vagues de grèves de masse les plus généralisées dans lesquelles les ouvriers ont occupé les usines dans les principales villes industrielles (Allemagne 18-19, Italie 20, Espagne 36) sont condamnées à la défaite si la POLITISATION de 1a lutte, 1'attaque de l’Etat bourgeois n’apparaît pas. Tant qu'ils n'auront pas complètement détruit l'Etat bourgeois? Les travailleurs ne pourront être vraiment les maîtres du procès de production. C'est avec, la politisation de la lutte que les Conseils Ouvriers les organes politico-militaires et non simplement économiques du prolétariat, font leur apparition.
Même dans la première petite apparition d'un mouvement ouvrier autonome, lorsque les luttes commencent a briser le cadre étroit des syndicats et à se généraliser, la gauche de 1'appareil politique du capital vient aussi au devant pour appeler à la nécessité de la "politisation" de la lutte qui germer quand 20 000 travailleurs défilent dons les rues, manifestant contre le chômage, les licenciements, les heures supplémentaires obligatoires, comme l'ont fait les ouvriers de Lisbonne en février 75; quand les travailleurs occupent leurs lieux de travail, dénoncent les syndicats et envoient les délégués dans d'autres usines pour coordonner la lutte, comme l'ont fait les travailleurs de la TAE au Portugal, il y a un peu plus d'un an, la gauche terrifiée par ce qui n'était que le début d'une lutte de classe réelle, soutient des grèves et des arrêts de travail officiels pour monter la haine du prolétariat envers le fascisme" et sa confiance dans l'Etat "démocratique". Quand la gauche préconise la transformation de la lutte économique en lutte politique, c'est pour défendre en vérité la transformation de la lutte du prolétariat en lutte pour la défense de l'Etat capitaliste et la préservation de l'ordre bourgeois! La lutte pour des salaires plus élevés, contre les licenciements, etc., est indiscutablement une lutte pour les travailleurs, la base et le sol réel sur lesquels: une lutte révolutionnaire se développe. Les grèves antifascistes et démocratiques, défendues par la gauche, ne sont sans conteste que des grèves contre la classe ouvrière des grèves dirigées à la fois contre les intérêts de classe historiques et immédiats du prolétariat. Dans leurs appels aux grèves antifascistes et démocratiques, les staliniens, maoïstes, trotskystes, anarchistes et socialistes de gauche se révèlent une fois de plus les héritiers directs et légitimes de la social-démocratie d'août 1914 : des instruments enthousiastes et les agents actifs de l'ordre bourgeois chancelant, les bourreaux du prolétariat.
Confrontée à un mouvement de classe autonome qu'elle ne peut simplement ignorer, la bourgeoisie dans un premier temps ne peut agir que d'une seule façon : essayer de détourner à tous prix le prolétariat d'une attaque directe contre l'Etat capitaliste. Toute concession économique peut être faite et sera faite, tant que l'appareil d'Etat bourgeois reste intact, que les usines continueront de tourner, même à perte, elles peuvent mène être "données" aux ouvriers un réseau de "Conseils" d'usine sera toléré ou même encouragé; les augmentations salariales seront accordées et en même temps le gouvernement évoluera de plus en plus à gauche comme le caméléon prenant la couleur rouge pour se protéger quand il est en danger.
Si face à une vague montante de grèves, la bourgeoisie semble céder dévouant toute son énergie à la défense de son appareil d’Etat, sa stratégie est d'attendre que la rage du prolétariat s'épuise d'elle-même et se consume à travers les frustrations et les responsabilités de la gestion des usines, dans la société capitaliste, et ensuite d'agir pour rétablir son autorité et son contrôle direct dans la production elle-même. Cependant, la combativité des travailleurs n'est pais le seul facteur qui affectera la réponse de la bourgeoisie à la vague de grèves de masse qui arrive. La profondeur même de la crise enlève à la bourgeoisie toute marge de manœuvre réelle : si d'un côté des concessions doivent être faites, de l'autre la nature catastrophique de la crise exige qu'elles soient vite retirées. L'Etat capitaliste devra agir promptement pour restaurer l'ordre dans les usines et gagner la "bataille de la production" de peur que les ressources du capital mondial ne soient complètement épuisées et sa compétitivité sur le marché mondial définitivement atteinte.
Dans son effort pour restaurer la production sur une base rentable et imposer sa volonté au prolétariat après qu'une vague de grèves se soit temporairement calmé, la bourgeoisie peut avoir recours soit à la mystification, soit à la répression violente. La plus extrême prudence face à-une classe ouvrière pas encore vaincue doit dicter le choix des mystifications utilisées par la bourgeoisie : organes de "démocratie populaire" autogestion, comités de base, etc.. Toutefois, la nature des sacrifices que 1'Etat capitaliste doit imposer et la forte combativité des ouvriers face à la crise sont telles que même les mystifications gauchistes que maintenant la bourgeoisie trouve plus concrètes, perdent vite leur pouvoir d'influence et de mobilisation sur la classe. Donc, si la tentative de restauration de 1'équilibre économique en mettant les fusils dans les reins des prolétaires détruirait complètement les derniers lambeaux du statu quo social et précipiterait la guerre de classe à outrance, 1’incapacité de la bourgeoisie à restaurer le statu quo social à travers la mystification détruira entièrement toute possibilité de rafistoler même temporairement l'équilibre économique. Tel est le dilemme auquel la bourgeoisie se trouve confrontée à l'aube d'une nouvelle offensive prolétarienne.
LE RAPPORT DE FORCE INTERNATIONAL.
La crise, qui a d'une manière si dévastatrice brisé le statuquo économique et social du capital mondial a aussi sévèrement disloqué l'équilibre international. Face à la faillite d'une économie, chaque fraction nationale du capital est confrontée à la nécessité de rogner dans ses importations et d'encourager les exportations. En d'autres termes "exporter ou mourir" ! Déjà, dans le cadre d’un marché mondial sursaturé, chaque capital national peut seulement améliorer sa balance commerciale aux dépens de celle de ses rivaux car il est, évident que tous les pays ne peuvent importer moins et exporter plus au même moment. La manifestation concrète de la rupture de 1’équilibre international provisoirement établi après la IIème guerre mondiale réside dans la tendance prononcée vers les guerres commerciales, l'autarcie, le nationalisme économique, le protectionnisme et le dumping qui deviennent partie intégrante de la vie quotidienne du capital depuis la. fin.des années 60. A cela on doit ajouter la tendance très significative aux affrontements inter-impérialistes localisés qui se déplacent des pays delà périphérie du monde capitaliste (Indochine, Cachemire, Bengale) vexe les centres vitaux (Moyen-Orient, bassin méditerranéen, régions d'Afrique situées sur les principaux axes de commerce liant l'Europe à l'Asie et aux Amériques).
A mesure que la crise s'approfondit, ces dernières années que le commerce devient plus difficile, et les conflits localisés encore plus féroces, la nécessité d’imposer une nouvelle re division du marché mondial, 1a nécessité de l'élimination violente des concurrents s'imposera avec une logique implacable à chacun des blocs impérialistes. Depuis plus de soixante ans, le marxisme insiste sur le fait qu'en dernière instance, la bourgeoisie a seulement une réponse à la crise : la guerre mondiale impérialiste. Il n’est pas question ici d'une théorie sur la conspiration de généraux bellicistes, mais de la reconnaissance de la tendance inéluctable à laquelle la société bourgeoise pourrissante dans son ensemble, pacifiste ou chauvine, devra se plier :
"Dans la phase décadente de l'impérialisme, le capitalisme peut seulement diriger les contradictions de son système dans une direction : la guerre. Quel que soit le chemin qu'il suive, quels que soient les moyens qu'il essaie d'utiliser pour surmonter la crise, le capitalisme est irrésistiblement poussé vers sa destinée de guerre. L'humanité: peut échapper à. un tel aboutissement au travers de la révolution prolétarienne" (Mitchell, "Bilan" 1934).
Cependant, relativement en dehors du fait que la crise n’a pas encore atteint une acuité qui contraindrait la bourgeoisie à entreprendre une nouvelle guerre impérialiste, il y a une raison beaucoup plus déterminante pour laquelle nous insistons aujourd'hui sur le fait que ce n'est pas la guerre impérialiste mondiale mais la guerre de classe, la révolution prolétarienne qui est à l'ordre du jour. Pour lancer une guerre mondiale, le capital, doit avoir un prolétariat suffisamment écrasé et mystifié pour que celui-ci puisse accepter les sacrifices ultimes dans l'intérêt de la "défense nationale". Aujourd'hui, c’est un prolétariat militant et combatif qui affronte la bourgeoisie et lui barre le chemin vers la guerre. Avant que le capital puisse imposer sa "solution" à la crise, il devra d'abord battre et écraser le prolétariat. Ou la présente crise se terminera par la solution bourgeoise de la guerre mondiale ou la solution prolétarienne de la révolution communiste sera décidée par l'aboutissement de la bataille de classe décisive qui sera allée de l'avant.
Bien que la guerre mondiale ne soit pas maintenant a l'ordre du jour et bien que la bourgeoisie soit occupée par la lutte de classe, avec l’approfondissement inexorable de la crise, les antagonismes inter-impérialistes se font de plus en plus aigus. Pour avoir une idée claire du moyen par lequel les tensions internationales se feront plus aiguës dans les années qui viennent, nous devons considérer à la fois l'équilibre interne dans les blocs russes et américains, et l'équilibre entre ces deux blocs impérialistes.
Certains faits semblent récemment indiquer la désintégration des deux blocs impérialistes, la destruction de leur unité et de leur cohésion. La tendance aux guerres commerciales, la montée du nationalisme économique et même la tendance générale du capital à se centraliser dans les mains de chaque Etat national, tout cela semble être annonciateur de la dissolution des grands blocs impérialistes. Bien sur, des faits tels que la décision de la province canadienne du Sashatchewan de nationaliser 1’industrie de la potasse à capitaux américains, les limitations du Canada sur l'exportation de pétrole vers les Etats-Unis, la nationalisation par le Venezuela des gisements de pétrole et de fer (là aussi, le capital était surtout américain) et le recours de la Grande-Bretagne au contrôle des importations attestent du nationalisme véritable et des tendances à l'autarcie parmi les pays qui constituent le bloc américain. Des tendances similaires sont apparentes dans les relations des Etats roumains et indochinois avec la Russie.
De telles tendances qui devraient si elles étaient dominantes, mener à l'éclatement des blocs, sont cependant contrecarrées par la tendance beaucoup plus forte et profonde vers le renforcement de chaque bloc impérialiste sur la base d'un accroissement de la domination indiscutable d'un Etat capitaliste à l’échelle d'un continent : USA et Russie. Ainsi, à l'intérieur de chaque bloc, toutes les puissances plus faibles, malgré leurs efforts pour continuer une politique nationale agressive, sont contraintes par leur faiblesse sur le marché mondial s'adapter leur politique aux besoins du pouvoir impérialiste dominant. Finalement, le nationalisme économique et les tendances autarciques des petits pays sont condamnés à n’être guère plus qu'un rideau de fumée idéologique utilisé pour obtenir le soutien populaire aux mesures d'austérité extrêmement dures que l'étau du capital russe ou américain impose aux pays dominés.
Le capital russe et le capital américain ont tous deux répondu aux premiers assauts de la crise en en exportant les pires effets sur leurs satellites plus faibles. Ainsi la fameuse "crise du pétrole" provoquée par 1'argumentation des prix qui a accompagné la guerre du Yom Kippour fut un écran de fumée cachant la réalité d'un transfert massif de richesses de l'Europe de l'Ouest et du Japon vers les Etats-Unis par le biais de l'Iran et des producteurs arabes. Dépendant militairement et financièrement des USA, incapables d'avoir une activité indépendante au Moyen-Orient, l'Europe et le Japon ont du accepter un arrangement par lequel des milliards de dollars affluèrent dans les trésoreries de l'OPEP et furent ensuite "administrés" par Wall Street ou utilisés pour acheter a l'Amérique du matériel militaire, des biens d’équipement, des produits agricoles, ceci améliorant la balance commerciale américaine, En plus de ce considérable transfert de richesses aux USA, les produits européens ou japonais sont devenus moins compétitifs sur le marché mondial car leurs prix ont au répercuter la forte augmentation du prix du pétrole vis-à-vis duquel leur économie est totalement dépendante. Le capital américain a été le bénéficiaire de ce "handicap" supplémentaire auquel ses concurrents ont été soumis.
L'étendue du bouleversement qu'a subi 1'équilibre à l'intérieur du bloc occidental, reflétant ainsi le rôle dominant dû plus en plus grand et de moins en moins contestable des USA se voit dans la comparaison des balances commerciales les pays de ce bloc. Les USA, d'un déficit commercial de 5,3 milliards de dollars en 1974 sont parvenus à un surplus commercial de 11 milliard de dollars en 75. La plus grande partie des 15 milliards d'exportation en plus en 1975 par rapport à 74, qui ont seulement pu atténuer les effets de la crise aux Etats-Unis, proviennent directement ou indirectement et à leurs dépens des pays clients des USA. L! acceptation britannique à la conférence de Rambouillet du dictât américain sur le contrôle dés importations, la soumission de la France aux USA à propos du rôle de l’or, la tolérance de l’Allemagne de l'Ouest qui a une monnaie surévaluée à une période de baisse des exportations et l'acquiescement de Tokyo aux "recommandations" américaines concernant les investissements 'étrangers au Japon, tout cela indique le caractère insoutenable de la théorie de l'effritement des blocs.
A l'intérieur du bloc de l’Est, l'équilibre s'est aussi modifié; reflétant la domination incontestable de la Russie sur ses "partenaires". Durant les deux années passées, 1' URSS a imposé des augmentations successives des prix du pétrole et d'autres matières premières aux Etats dépendants, demandant récemment qu'ils fournissent en plus des capitaux pour des projets éléphantesques d'investissements en Sibérie.
La totale impuissance des Etats les plus faibles à résister à la demande des capitalismes d'Etat dominant le monde est aujourd'hui manifeste. Et même si un pays, réussit vraiment à assurer son "indépendance" et à rompre avec un bloc impérialiste, il est condamné par la structure même du capitalisme décadent à tomber immédiatement sous la domination du bloc impérialiste rival. Ceci a été le destin de l’Egypte qui s’est elle-même dégagée de l’hégémonie de Moscou pour ,tomber finalement sous sa domination de Washington, Ainsi, ce qui est en cause ici, ce n'est d'aucune façon l'effritement des blocs impérialistes, mais plutôt la manifestation d'une rivalité inter-impérialiste plus dure entre les blocs.
Cependant, le fait que la Russie et les USA aient accru leur contrôle sur leurs blocs respectifs ces deux dernières années a seulement rendu momentanément possible l'atténuation des pires effets de la crise. Quelques soient les espoirs que l'URSS et les USA ont mis sur leurs blocs pour absorber une masse toujours plus grande de leurs marchandises; leur perspective de succès sur le plan de l'exportation, sont excessivement faibles. Les plus petits pays du bloc américain, déjà paralysés par la crise, ne seront pas capables de continuer à absorber les marchandises américaines au niveau actuel dans 1'année qui vient. En 1976, quand la demande effective en Europe va décliner et que la tentative d’éviter une faillite économique totale conduit à des efforts frénétiques pour limiter les importations, la balance commerciale des Etats-Unis va gravement se détériorer. De manière similaire, les planificateurs russes qui essaient désespérément d’augmenter leur commerce extérieur de 13,6% cette année la majeure partie vers leurs "alliés" européens devront aussi lutter contre la contraction de la demande, et dans ce domaine comme dans bien d'autres, ils ne parviendront sûrement pas à atteindre leur but.
De la même manière que dans les deux années passées, le statu quo à l'intérieur de chaque bloc a basculé en faveur du pouvoir impérialiste dominant, l’équilibre entre les blocs a aussi basculé en faveur des américains aux dépend du bloc russe! Ce n'est pas dans des zones d’une importance relativement faible comme le Viêt-Nam, mais dans des zones qui, par leur proximité des centres industriels du capital mondial et par leur richesse en matières premières, par leur marché et leur situation stratégique dominant les voies du commerce mondial, sont vitales pour les blocs impérialistes, que la rupture dramatique de l'équilibre des puissances peut être clairement vue.
Les gains significatifs que l’impérialisme russe a réalisés au Moyen-Orient durant les années 60 ont été réduits durant ces deux dernières années. La contre-attaque de l'impérialisme américain dans cette région cruciale a déjà ramené l'Egypte et le Soudan dans l'orbite occidentale. Pendant l'année passée, un solide axe Téhéran-Djeddah-Amman-le Caire-Washington a été bâti, ce qui avec son client israélien assure la domination américaine au Moyen-Orient. Les énormes ventes d'armes à l'Iran, la livraison d'un nouvel équipement militaire à Israël, le projet d'une industrie arabe d'armement liée au bloc américain qui a été entrepris par l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les émirats arabes unis constituent des moments significatifs de la construction militaire en cours que les USA ont entrepris avec succès dans cette région. Les fruits de cette politique belliqueuse sont déjà apparents avec la fin de la rébellion du Dhofar soutenu par l'Urss contre le sultan pro-occidental d'Oman, qui a été écrasée avec l'aide des troupes iraniennes et l'armement sophistiqué Anglo-américain.
En réponse à ce basculement de l'équilibre international en faveur du bloc américain, l'impérialisme russe a lancé une offensive réfléchie pour expulser les USA d’un certain nombre de positions près des centres nerveux du capital mondial. En Yougoslavie, les "kominformistes" pro-russes et anti-titistes et les groupes nationalistes croates ont considérablement accru leurs activités ces derniers mois. Une initiative russe en Yougoslavie, avec ses facilités navales dans la mer Adriatique et sa proximité de l'Italie, prend forme. Le bloc américain a pris des mesures pour contrecarrer la poussée russe dans les Balkans avec le projet du régime grec d'un pacte des Balkans qui serait basé sur les régimes albanais, yougoslaves, grecs et turcs, tous antirusses, et qui cherchera à miner l'influence russe en Roumanie.
L'impérialisme russe essaie aussi de récupérer le terrain perdu au Moyen-Orient par son intervention au Liban. L'aide militaire est acheminée pari l'Irak- une des places forte qui reste à Moscou dans la péninsule arabique, pour les FORCES UNIES d’Ibrahim Koleilat qui sont engagées dans une lutte sanglante pour le contrôle de cette région importante du littoral méditerranéen. Les Etats-Unis en même temps qu'ils soutiennent les forces phalangistes, essaient au travers de la Ligue Arabe, de l'Egypte, de la Syrie, et de l'OLP de restaurer le statu quo au Liban. Si cela échoue, et dans l'éventualité d'un effondrement complet de l'Etat libanais pro-occidental, les Etats-Unis pourraient intervenir pour conserver les positions stratégiques, ou bien au travers d’une invasion israélienne, ou bien par la partition du Liban d'où un Etat chrétien totalement dépendant du bloc américain pourrait émerger.
Les impérialismes russe et américain s’affrontent autour de la corne de 'Afrique et du détroit vital de Bab-el-Mahdeb qui contrôle l'accès à la mer Rouge et par lequel le commerce entre l'Europe et l'Asie passera avec la réouverture du canal de Suez. Tandis que les russes essaient désespérément de briser la domination américaine sur cette région au travers de leur soutien au front de libération de l'Erythrée et par l'importante implantation militaire en Somalie, quand la lutte dans cette région dû monde va s'intensifier, les américains peuvent réagir de trois façons:
1- Soutenir le régime militaire en Ethiopie s'il apparaît capable de contrôler la situation et d'être un chien de gardé loya1 de l'impérialisme américain.
2- Créer un état Afar dépendant à partir de la province éthiopienne de Wollo et du territoire français des Afar et des Issas pour surveiller l'importante route du commerce.
3- En trouvant un terrain d'entente avec l'aile "modérée" du FLE et avec les arrières arabes "amis" l'Egypte et le Soudan, pour soutenir la création d'un Etat érythréen qui garantirait la domination américaine sur la région.
De l'autre côté de l'Afrique, le Maroc et l'Algérie sont au bord de la guerre pour le phosphate de l'ancienne et riche colonie espagnole du Sahara. Tandis que les troupes marocaines assurent leur contrôle sur la région, le Front Polisario soutenu par l'Algérie a lancé une guerre de guérilla contre l'armée du roi Hassan, au même moment l’Algérie a massé le gros de ses troupes à la frontière saharienne, et l'Algérie et la Lybie ont de manière répétée averti que l'annexion du Sahara Occidental par le Maroc serait inacceptable pour eux. Derrière le Maroc et l'Algérie, se cachent les des grands blocs impérialistes, dont les aides et les armements seuls peuvent rendre une guerre possible. Derrière la question des matières premières, c'est la situation stratégique de l'ancienne colonie espagnole qui est du plus grand intérêt pour les USA et la Russie. Les Etats-Unis espèrent faire échec aux ambitions navales de la Russie dans l'Atlantique grâce à l’incorporation du Sahara au Maroc, son "ami" de l'autre côté, un Sahara Indépendant" qui "dépendrait du soutien de l'Algérie et de la Russie, fournirait à la Russie sa première bise sur l'Océan Atlantique.
Les besoins de la Russie pour une telle base deviennent visibles quand sa flotte de guerre traverse l'Atlantique vers l'Angola où une puissante force d'intervention américaine est concentrée. C'est en Angola que la boucherie inter-impérialiste atteint, actuellement son sommet : les "fronts de libération" rivaux, largement équipés avec les plus modernes instruments de mort par leurs maîtres américains et russes ont transformé le pays en véritable boucherie. En Angola, 1' URSS, au travers du MPLA et d’un corps expéditionnaire cubain, les USA avec le FNLA, 1'UNITA et des contingents de troupes sud africaines, se battent pour l'Angola riche en matières premières (pétrole, fer, diamants, etc..) pour le contrôle du transport du cuivre et de l'uranium provenant du Zaïre et de la Zambie qui passe par les ports angolais et pour la domination des joutes commerciales qui lien l'Europe à l'Afrique du Sud et traversent l'Atlantique sud entre l'Europe et l’Amérique du Sud.
La Chine, une puissance impérialiste mineure essayant vainement de construire seule un bloc, est condamnée par sa faiblesse à chercher le soutien de l'un des deux blocs impérialistes. Si pour l'instant la Chine est l'alliée des USA contre la Russie et essaie énergiquement de contrecarrer la poussée expansionniste de Moscou en Asie du Sud et en Extrême-Orient, un renversement d'alliance dicté par les circonstances n'est pas à exclure.
LA GUERRE DE CLASSES
L’effondrement de l'économie du statu quo social et de l'équilibre international du capital mondial face à la crise générale de surproduction a amené l'ordre bourgeois déclinant au bord d'une guerre de classe généralisée. Aujourd'hui, le Portugal et 1’Espagne sont devenues les arènes décisives où le prolétariat et la bourgeoisie mesurent leurs forces et se préparent pour les luttes gigantesques qui vont venir ; c'est sur la base des leçons tirées des événements qui se déroulent maintenant dans la péninsule ibérique que la classe ouvrière et son avant-garde communiste s'armera pour la lutte violente qui s'annonce pour la destruction de l'Etat capitaliste et l'établissement de la dictature des Conseils Ouvriers.
Au Portugal, face à une vague de grèves de masse, la bourgeoisie a réussi à détourner la classe ouvrière d'un assaut direct contre l'Etat capitaliste grâce aux mystifications nationalistes, démocratiques et antifascistes qui ont accompagné le mouvement de gouvernements successifs vers la gauche entre 1974 et 75. Cependant, le cinquième gouvernement, dans lequel les staliniens et le COPCON ont joué le rôle principal, a complètement échoué dans "la bataille de la production", pour restaurer l'ordre et la discipline dans les usines et pour imposer les sacrifices nécessaires au prolétariat. Toutefois, la fragmentation et la dramatisation momentanée que les mystifications de la démocratie, de l'unité nationale et de l'antifascisme ont amené dans la classe, ont suffi pour produire un creux momentané dans la lutte de classe et c'est a ce creux que le sixième gouvernement correspondait. La combinaison de l'effondrement économique qui menace et d'une classe ouvrière pas encore défaite, va toutefois- bientôt relancer une nouvelle vague de grèves. Face à une bourgeoisie qui évolue toujours plus à gauche, en réponse à un nouveau surgissement de la classe, il est impératif que les révolutionnaires dénoncent sans merci les programmes de démocratie populaire, d'autogestion, de comités de base, et de quartiers par lesquels la bourgeoisie essaiera de contenir la poussée violente du prolétariat et de créer ainsi les bases de sa contre-attaque à venir.
Maintenant, encore plus que le Portugal, c'est l’Espagne qui est devenue le banc d'essai des oppositions de classe. Pays industriel avancé qui par son histoire de militantisme prolétarien et sa proximité de la France et de l'Italie, peut allumer la flamme révolutionnaire en Europe, l'Espagne est devenue l'objet de préoccupation de la bourgeoisie qui tente désespérément de mettre en place son arsenal de mystifications avant 1'explosion de la poudrière. La vague de grèves qui vient quasiment de paralyser Madrid indique l'ampleur de l'explosion à laquelle le capital aura bientôt à faire face.
La préparation des révolutionnaires pour l'intervention dans la lutte de leur classe dans cette bataille cruciale demande une compréhension complète de là marche vers la gauche que la bourgeoisie espagnole, sous les exhortations de ses maîtres européens et américains, entreprend maintenant. C'est sur les champs de bataille de la classe que les analyses, les perspectives et l'orientation pratique pour la lutte qui émergeront à ce Congrès du Courant Communiste International seront vérifiées dans l'année qui vient.
Mc Intosh, décembre 1975- janvier 1976
[1] [6] Au milieu d'une crise, le capitalisme décadent a recours aux méthodes barbares d'extraction de la plus-value qui caractérise son enfance : la plus-value absolue. C'est la seule caractéristique de sa jeunesse que le capital, dans les affres de l'agonie, peut reprendre.
[2] [7] Le mot le plus odieux du vocabulaire bourgeois!
Conscience et organisation:
Récent et en cours:
- Crise économique [8]
- Luttes de classe [9]
Thèses sur la situation internationale.
- 2625 reads
1 — La crise, qui a commencé à toucher, depuis 1965, les pays développés et dont le cours s'est brutalement accéléré depuis fin 1973, n’est ni une crise de civilisation, ni une crise monétaire, ni même une crise de matières premières, ou de "restructuration" mais la crise du système capitaliste mondial.
2 — L'extension du chômage qui accompagne la baisse généralisée de la production mondiale et dont l'ampleur est comparable à 1929, la multiplication des famines et des épidémies dans certains pays du tiers monde, les "crises" agricoles jusque dans les pays les plus développés sont les symptômes les plus clairs que la maladie actuelle qui ébranle le capital mondial à un rythme accru n'est pas une simple "dépression" momentanée, conjoncturelle ou cyclique mais la convulsion d'un système à l'agonie.
3 — Cette seconde crise ouverte du système capitaliste confirme avec éclat la thèse défendue par les révolutionnaires depuis presque 60 ans. A là suite de 1' Internationale communiste, que la période ouverte par la première guerre mondiale est la phase de déclin d'un mode de production parvenu au terme de sa trajectoire historique. Dans cette phase, la crise mondiale est le reflet de l'état de décomposition d'un système entré en décadence.
4 — Les tentatives répétées du capitalisme avec la fin de la période de reconstruction qui a suivi les destructions du second conflit impérialiste, d' échapper à la crise ouverte en rejetant les premiers symptômes dans les zones arriérées et en cherchant dans les guerres locales, en particulier dans la guerre du Vietnam, un exutoire à ses propres contradictions, se soldent aujourd'hui par un cuisant échec. Par un effet de boomerang, elles n'ont fait qu'accentuer en retour les effets destructeurs du choc de la crise.
5 — Contrairement à 1929, où un krach généralisé signifiait le début de la phase de crise ouverte, la crise actuelle se caractérise non plus par un effondrement-brutal mais par un étalement prolongé dans le temps. La bourgeoisie, poussée par son propre instinct de conservation de classe a tiré les leçons de la précédente crise en accélérant le phénomène tendanciel de prise en charge par l'Etat de l'ensemble de l'économie. L'injection de capital fictif, sous forme d'une inflation généralisée, dans les cellules nécrosées du capital, a permis et permet encore de freiner la chute du système jusqu'à un effondrement final.
6 — Néanmoins, la mise en place de ces paliers successifs dans la descente au fond de la crise n'a fait qu'amplifier en sur face ce que le capitalisme tentait de conjurer dans le temps. Aujourd'hui, quels que soient l'hémisphère, le continent, la nation, la crise a jeté sa chape de plomb sur l'ensemble du monde. Les divers "miracles économiques" avec leurs régulières et rapides courbes de croissances ne sont plus que des fantômes qui hantent la mémoire de la classe dirigeante. La tâche sombre du tiers monde en crise permanente dans les années de reconstruction a fini par envahir l'ensemble de la scène économique mondiale.
6 bis — L'économie mondiale -malgré l'extension de l'appareil du capitalisme d' Etat dans chacune de ses cellules nationales- est condamnée désormais à subir les oscillations dé plus en plus rapprochées de l'hyperinflation et de la déflation brutale. Cette courbe sinusoïdale dans l'utilisation de plus en plus frénétique de capital-monnaie ne fait que traduire 1'asphyxie progressive qui gagne l'économie mondiale sous la double forme de la surproduction et de déficits budgétaires de plus en plus massifs et dont la conjonction ne peut qu'entrainer à la longue l'effondrement brutal.
7 — Les pays du bloc russe, les multiples et pittoresques variétés de "socialisme" qui, aux dires de la "gauche" et des gauchistes, ne pouvaient connaitre les affres de la crise grâce à leur planification prétendument "scientifique", "socialiste" ont en 1975 plongé eux aussi dans la crise. Ce retard dans la crise qui s'explique par les mécanismes mis en place, les manipulations permanentes exercées par le "capital idéal : l'Etat" met ces pays brutalement et à l'improviste dans une situation de moindre résistance au choc d'une crise amplifiée par la masse des pays atteints.
8 — La crise des pays de l'Est est la confirmation éclatante de la thèse marxiste selon laquelle le capitalisme entré en décadence est dans l'incapacité de se résoudre ses contradictions. Le "capitalisme d'Etat" n'est pas une "solution" à la crise, comme le soutiennent et les staliniens et les tenants des théories conseillistes qui y voient du "socialisme d'Etat". L'échec de cette "solution" prive aujourd'hui la bourgeoisie d'une de ses mystifications les plus puissantes.
9 — Les révolutionnaires ne peuvent que dénoncer avec la plus grande énergie les mystifications de "reprise" mises aujourd'hui en avant par la bourgeoisie, que ce soit sous forme de "plans de relance" ou de nationalisations. Leur propagande au sein de leur classe doit être axée sur le fait que dans le cadre du système capitaliste décadent les soi-disant "solutions" ne sont que des replâtrages qui signifient attaque de son niveau de vie et aggravation constante de ses conditions d'existence.
10 — Aujourd'hui, comme il y a 50 ans, la seule alternative est : guerre ou révolution. Sur un marché hyper saturé, où chaque capital national a besoin pour survivre d'exporter ses propres marchandises au détriment des autres capitaux qui le concurrencent, il ne peut y avoir d'autre "solution" que celle de la force. La projection brutale du prolétariat dans la réalité de la crise dont l'issue ne peut être que son utilisation comme chair à canon d'un troisième conflit impérialiste qui pourrait bien signifier pour l'humanité une chute irrémédiable dans la barbarie comme l'ont montré les 2 guerres précédentes, met à l'ordre du jour la nécessité de la révolution communiste permettant à l'humanité de passer du règne de la nécessité dans le règne de la liberté.
11 — Contrairement à l'entre-deux-guerres, la tendance actuelle n'est pas à la guerre impérialiste. Le prolétariat a manifesté depuis la fin de la période de reconstruction une combativité décuplée par l’approfondissement de la crise. Seul un écrasement brutal du prolétariat ou des défaites répétées pourraient inverser la tendance actuelle à la révolution en tendance à la guerre impérialiste. Aujourd' hui, la coïncidence de la crise avec un essor des luttes prolétariennes met à l’ordre du jour la révolution prolétarienne, dans les conditions telles que Marx les avaient envisagées et non pas au sortir d'une guerre impérialiste comme ce fut le cas de la vague révolutionnaire passée, dont le déclenchement pouvait signifier la disparition du mouvement prolétarien.
12 — Comme l'ont montré les deux grands conflits impérialistes, pour la bourgeoisie il ne peut y avoir d'autre perspective que celle de la guerre. Si la guerre impérialiste, dont les destructions généralisées à l'ensemble de la planète, entraînent une régression des forces productives, ne saurait être un remède au déclin du capitalisme qu'elle accélère chaque fois plus, pour le capital elle est son unique sortie de secours. En aucun cas elle ne peut résoudre le problème de la crise : elle est la continuation de la crise avec d'autres moyens.
13 — Si le cours actuel n'est pas celui de la guerre, c'est néanmoins par le biais des "luttes de libération nationale" ou des guerres locales que le capital teste et perfectionne tout son arsenal de mort dans le cadre de ses préparatifs permanents à l'éventuel d'un troisième conflit mondial.
14 — La fin de la guerre du Vietnam ne marque pas le début d'une ère de "paix armée" entre les deux blocs que viendrait sanctionner des conférences d'Helsinki. L'industrie d'armements' est le seul secteur de l'économie qui dans la crise actuelle connaît un développement rapide et fiévreux. L'année 75 a été celle du plus formidable programme d'armement qu'ait connu l'humanité loin d'établir, comme le prétendent d'attardés descendants de Kautsky, l'ère d'un condominium russo-américain, elle marque 1'accélération d'une course aux armements, dont la seule limite est la combativité- accrue du prolétariat.
15 — Si les deux blocs impérialistes continuent à jauger leurs forces dans les zones marginales du capitalisme, c'est aujourd'hui à proximité des zones vitales du système que se déplacent les conflits inter-impérialistes. Le Bassin méditerranéen, où la Russie et les USA s'affrontent au travers de la guerre civile, tend à devenir "la poudrière du monde capitaliste". Le développement de la guerre en Angola, les incidents de frontière entre l'Inde et la Chine d'une part, entre celle-ci et la Russie d'autre part, sont le signe que pour des raisons à la fois stratégiques et économiques les deux grands impérialismes concentrent leurs forces dans une périphérie toujours plus proche des pôles industrialisés du capital.
16 — La multiplication de guerres locales entre pays d'un même bloc (Grèce et Turquie) ou l'apparente "indépendance nationale" accordée aux pays de l'Asie du Sud-est par les deux grandes puissances impérialistes ne signifient pas un affaiblissement des blocs constitués autour de l'URSS et des USA. De tels phénomènes montrent que chaque camp a renforcé sa mainmise politique dans sa zone d'influence au point de ne plus avoir besoin de recourir à des interventions militaires directes. L'apparent développement des forces centrifuges qui s'exercent au sein de chaque bloc et qui trouvent leur origine dans les tentatives désespérées de chaque bourgeoisie nationale de trouver un moyen de résoudre seule "sa" propre crise, n'est qu'une résistance anachronique à la force centripète qui pousse chaque capital national dans le giron de son bloc impérialiste respectif. Aujourd'hui le mot d'ordre de chaque bourgeoisie ne peut plus être "chacun pour soi" comme dans la période de reconstruction, mais "coulons tous ensemble". L'effrontément d'un seul pays industrialisé pouvant entraîner la chute de tous les autres et la nécessité de renforcer les blocs dans la perspective d'une guerre mondiale imposent de plus en plus une discipline de fer au sein de chaque camp.
17 — Dans le jeu des forces des grandes puissances impérialistes qui avancent leurs .pions respectifs sur l'échiquier mondial, ce sont les Etats-Unis qui ont marqué le plus de points aux dépens de la Russie qui a du en partie se replier sur son "glacis" dont elle a renforcé la cohésion et la discipline, même si la politique extérieure reste axée sur la recherche fébrile de nouveaux points d'appui stratégiques. La Chine comme troisième puissance impérialiste, joue un rôle identique à celui de la Russie d'avant 14 : cherchant à se constituer des zones d'influence en Asie et en Afrique, sa faiblesse économique l'empêche de pouvoir mener par ses propres forces une politique d'expansion. Comme la Russie tzariste elle est destinée à fournir le gros de la chair à canon au profit d'un bloc dans un troisième conflit impérialiste. Si actuellement elle s'est alliée avec les USA contre la Russie, l'histoire de ces cinquante années montre qu'un renversement d'alliance est toujours possible.
18 — La thèse répandue par les gauchistes de l'affaiblissement de l'impérialisme US sous les coups des "luttes de libération nationale" est un pur instrument de mystification et une tentative d'embrigader les prolétaires dans le camp russe. Son corollaire de l’"effritement des blocs" quand il n'est pas une apologie voilée du nationalisme sous la forme de 1'"indépendance nationale" est une dangereuse sous-estimation, des préparatifs de guerre du capital menant soit à l'attentisme soit au pacifisme.
19 — Face à la reprise de la lutte de classe du prolétariat dont le développement est .une menace mortelle pour le capital, celui-ci ne peut que globalement renforcer ses préparatifs et sa cohésion pour ne plus former qu'un seul bloc dans la perspective du surgissement dé la révolution prolétarienne. Face à la bourgeoisie qui est amenée à prendre les mesures les plus extrêmes pour sortir d'une crise dont le prolongement signifierait son propre arrêt de mort, le prolétariat ne peut qu' être amené à comprendre l'immensité de la lutte sans merci qu'il devra mener contre son ennemi mortel
20 — Le krach de 1929 pouvait faire croire aux révolutionnaires dans le passé que la crise constituait un facteur de démoralisation du prolétariat ouvrant le cours fatal vers la guerre. Au contraire, la crise actuelle est une véritable école de combat du prolétariat, dont les craintes se dissolvent dans le feu de la lutte de classe. Dans la période actuelle, l'approfondissement de La crise sous les coups répétés de la lutte de classe internationale ne peut qu'accélérer le cours de celle-ci, renforçant, en cohésion et en force les rangs prolétariens, condition même de son passage à un stade qualitativement supérieur au niveau de sa conscience et son" organisation. Le géant endormi par cinquante ans de contre-révolution a ressurgi sur la scène historique, avec de nouvelles forces, galvanisé par la crise. De l'Espagne à l'Argentine, de l'Angleterre à la Pologne, quel que soit le nom que se donne le système qui l'exploite, le prolétariat est de nouveau le spectre qui hante le monde.
21 — Alors qu'aux explosions ouvrières de 68-71 en Europe avait succédé un certain reflux des luttes, l'année 1975 a marqué une nouvelle étape dans la lutte de classe du prolétariat, sous la forme d'une résistance farouche aux assauts du capital (chômage massif, diminution rapide de l'ancien niveau de "vie") une fois le premier effet de stupeur dissipé. Le cours de la lutte de classe est aujourd'hui à un tournant décisif. L'irruption de la lutte de classe encore lente et sporadique, de quantitative et ponctuelle, tend à se hisser de .plus en plus à un stade qualitativement supérieur en gagnant en extension et en profondeur ce qu’elle a perdu en masse momentanément. Alors que le renouveau des luttes ouvrières se faisait jusqu'ici dans les pays où la tradition de lutte de classe. était plus solidement enracinée, leur extension à l'ensemble du monde est le signe avant-coureur de leur généralisation en masse.et donc l'embryon de la formation des l'armée mondiale du prolétariat.
22— C'est néanmoins vers l'Espagne, compte tenu .de l'intensité et de la radicalité des luttes menées par la classe ouvrière de ce pays, que se concentre aujourd'hui l'attention des révolutionnaires. Alors qu'en 36 l'Espagne s'était vite transformée en un banc d'essai pour la seconde guerre mondiale impérialiste, elle est appelée dans la période actuelle à jouer un rôle décisif au niveau international pour les deux forces en présence : bourgeoisie et prolétariat. Véritable laboratoire du combat titanesque auquel se préparent les deux classes antagonistes, les révolutionnaires devront tirer toutes les leçons des événements cruciaux appelés à s'y dérouler et dont le poids pèsera lourd dans le surgissement ou l'étouffement de la révolution mondiale.
23 — Cependant en raison :
- du caractère encore graduel et relativement lent du rythme de la crise;
- du poids de 50 ans de contre-révolution, où le prolétariat a connu les plus sanglantes défaites de son histoire, perdant jusqu’a son instinct le plus élémentaire de classe; la reprise des luttes se manifeste encore sur le terrain économique de la résistance au capital. Même lorsque ces luttes se hissent au niveau de la grève de masse posant immédiatement le problème de leur affrontement à l'Etat, elles prennent une forme saccadée, suivant un tracé irrégulier, une apathie apparente suivant souvent de grandes irruptions prolétariennes. Le prolétariat ne semble pas encore prendre pleinement conscience de la richesse des enseignements contenus dans ces luttes qu'il a menées, même si ses expériences généralisées sont partout les mêmes. Malgré l'apparition sporadique de noyaux politiques au sein du prolétariat, là où la lutte de classe connaît son plus haut degré de développement, la classe n'a pas pu et ne peut encore prendre spontanément conscience de la nécessité de passer du terrain économique au terrain politique de l'offensive généralisée contre le capital, de la lutte parcellaire à la lutte globale qui s'accompagne nécessairement de l'apparition de l'organisation unitaire, économique et politique, de l'ensemble de la classe : les conseils ouvriers.
24 — Dans le monde entier les leçons qui commencent déjà à se graver dans le cœur et le cerveau de la classe sont partout les mêmes, du pays le plus arriéré au plus développé. :
- résistance acharnée aux effets de la crise par la généralisation de la lutte de classe;
- autonomie de la classe par l'affrontement avec .les syndicats, bras armé du capital au sein de l'usine;
- nécessité de la lutte directe politique par l'affrontement violent avec l'Etat..
25 — L'apparition et le développement dans le feu de la lutte, d'assemblées ouvrières rassemblant l'ensemble des travail leurs d'une ou de plusieurs usines sur un objectif revendicatif donné, expriment les balbutiements de la classe révolutionnaire cherchant à tâtons la voie de son autonomie Dans la conjoncture actuelle, où le niveau de la lutte de classe demeure encore relativement modeste, ces organisations ne peuvent être autre chose que des embryons de l'organisation unitaire de la classe. En tant que tels, en l'absence d'une lutte permanente de la classe, ils sont amenés soit à disparaître avec la retombée de la lutte, soit à se transformer en syndicats et donc en de nouveaux instruments de mystifications.
26 — La paralysie croissante et chronique ce l'appareil politique du capital qui si manifeste aujourd'hui dans les pays dent l'économie est à mi-chemin entre 1' arriération et le développement industriel, comme au Portugal et en Argentine, ust la préfiguration de l'Etat de décomposition avancée tant économiquement que socialement qui est appelé à devenir le mode d’existence de l'ensemble du capitalisme, avec l'accélération de la crise et de la lutte de classe. Gomme l'ont montre les révolutions passées, la révolution prolétarienne est la conjonction de l’impossibilité pour la bourgeoisie de gouverner désormais de manière stable et le refus croissant des ouvriers de vivre comme auparavant.
27 — Face au prolétariat dont l'audace et la combativité n'ont cessé de s1affirmer toujours plus, la bourgeoisie a de moins en moins la capacité et la cohésion suffisantes pour écraser le prolétariat et l'embrigader dans une troisième guerre impérialiste. Sa ligne d'action est aujourd’hui d'éviter toute lutte frontale avec son ennemi mortel, laquelle ne pourrait que précipiter le cours de la lutte de classe vers la révolution. La mystification, c'est-à-dire toute la stratégie de dévoiement, de division, de démoralisation du prolétariat, est la seule arme réelle dont dispose et use la bourgeoisie aujourd'hui. Plus encore que tout l'arsenal répressif, de guerre civile déjà mis au point, les diverses mystifications utilisées par le capital pour empêcher, ou du moins freiner la prise de conscience révolutionnaire du prolétariat, sont dans la période actuelle l'arme la plus efficace et la plus dangereuse de son arsenal. Néanmoins, la bourgeoisie est parfaitement consciente qu'au bout du compte l'affrontement direct est inévitable, les mystifications mises en place n'ayant d'autres sens que de gagner du temps pour affronter le prolétariat dans les conditions les plus favorables pour elle.
28 — Seule force apte à détourner les ouvriers de leur terrain de classe, les partis de gauche, dont la venue au pouvoir est inéluctable et nécessaire pour le capital, constituent la seule solution de rechange aux partis classiques incapables toujours plus d'exercer un contrôle quelconque sur la classe ouvrière. Leur capacité d'apparaître vis-à-vis des ouvriers comme "leurs partis", leur confère un rôle de tout premier plan pour inciter la classe à se sacrifier sur l'autel de la défense de "son gouvernement populaire", de " son économie socialiste". Même là où l'instabilité ou l'archaïsme de l'appareil politique du capital, ou bien une défaite locale du prolétariat ont amené le remplacement de la gauche par la droite, parce que les solutions politiques de la bourgeoisie ne peuvent être que globales, la nécessité de la "solution" de gauche s'impose face à un prolétariat qui ne peut être battu ou du moins paralysé que globalement et universellement.
29 — Néanmoins, aux solutions classiques des partis de gauche, dont la capacité de mystification a commencé à s'user au bout de cinquante ans de contre-révolution, devront se substituer de plus en plus des fractions plus "radicales" dans leur fonction de dévoreurs de la classe ouvrière. Ils constituent l'ultime carte de mystification que la bourgeoisie met soigneusement en réserve au moment où l'affrontement global prolétariat-bourgeoisie de vient inévitable. Cependant, la gauche et les gauchistes, comme n'importe quelle fraction du capital, ne peuvent résoudre la crise; leur venue ne peut que freiner mais non empêcher la conflagration finale entre les deux classes.
30 — Aujourd'hui comme hier, l'arme utilisée par la gauche face au prolétariat, qui conserve encore des illusions léguées par cinquante ans de contre-révolution qu'il a dû traverser, est celle du frontisme. Toutes les variétés d'antifascisme, d'anti stalinisme sont autant de manœuvres systématiques du capital pour faire lâcher au prolétariat sa propre boussole de classe. Les révolutionnaires doivent mettre en garde le prolétariat contre toutes les illusions de type démocratique qui, comme par le passé, ne pourraient le mener qu'à un nouveau massacre, et dénoncer sans relâche tous les partis qui se font les propagandistes de tous les "anti" démocratiques,
31 — Ni le "fasciste" ni la "dictature" ne peuvent être aujourd'hui à l'ordre du jour, la bourgeoisie renforçant à l'est comme à l'ouest son arsenal démocratique face au prolétariat, ce thème ne peut p prendre dans la période actuelle toute la place qu'il tenait en période de contre-révolution. Enfermer le prolétariat dans le cadre de l'usine par l'autogestion, ou laisser croire aux ouvriers que la "solution" à la crise se trouve dans 1'"indépendance nationale" contre les "multinationales" ou "l'impérialisme" deviennent aujourd'hui les mystifications majeures utilisées par le capital pour empêcher toute autonomie de classe, toute prise de conscience généralisée en tentant d'atomiser, de dissoudre les intérêts de la classe dans ceux de "la nation toute entière"0
32 — C'est donc une "intelligence" de la situation, aiguisée par l'enjeu de la bataille, qui est sa propre existence en tant que classe, qui a permis à la bourgeoisie de manœuvrer cette année encore de main de maître, pour éviter tout affrontement direct avec le prolétariat. Même si la bourgeoisie sur le plan local (Portugal, Espagne) n'a pas su manœuvrer avec toute l'habilité recuise, globalement elle a réussi à affronter les réactions prolétariennes à la crise et la crise elle-même par de multiples plans d'ensemble, sans subir aucun recul, même si déjà le prolétariat commence à se libérer de plus en plus des illusions ou des mystifications qui lui sont imposées par la classe, dominante,
33 — Les révolutionnaires ne peuvent que mettre en garde le prolétariat contre toute sous-estimation des forces et capacités de manœuvrer son ennemi de classe. Plus que par le passé, face à une bourgeoisie forte de plus d'un siècle et demi d'expériences dont elle a su tirer les leçons, la cohésion, l'organisation du prolétariat au niveau mondial sont une impérieuse nécessitée Les révolutionnaires doivent, par leur participation active dans toutes les luttes que mène le prolétariat contre le capital, montrer qu'aujourd’hui face à un adversaire aguerri- le moindre recul pourrait avait des répercussions catastrophiques, s'il n'est pas à même de tirer les leçons de ses luttes par le développement de son organisation autonome de classe,,
34 — Le CCI invite tous les groupes ou individus révolutionnaires à se regrouper dans une même organisation de combat, à concentrer et non à disperser leurs forces. Les révolutionnaires, plus que par le passé, alors que l'alternative est le triomphe du communisme ou la chute irrémédiable dans la. Barbarie par un 3° holocauste mondial, doivent prendre conscience des lourdes responsabilités historiques qui pèsent sur leurs épaules. Le moindre retard dans leur organisation ou le refus de s'organiser ne pourrait être qu'un abandon de leurs tâches au sein de la classe d'intervention de manière organisée comme la fraction la plus décidée du mouvement de lutte de classe du prolétariat mondial. Si les révolutionnaires n'arrivaient pas à être à la hauteur des tâches pour lesquelles la classe les a sécrétées, ils ne pourraient que porter une lourde responsabilité en cas de défaite de leur propre classe. Dans les formidables batailles qui se préparent, l'intervention organisée et décidée des révolutionnaires aura un poids qui au moment décisif peut faire pencher la balance des forces dans le sens de la victoire du prolétariat mondial sur le capital mondial.
Conscience et organisation:
Récent et en cours:
- Crise économique [8]
- Luttes de classe [9]
Les statuts des organisations internationales du prolétariat.
- 3222 reads
PRESENTATION
Au premier Congrès du Courant Communiste International, outre la plate-forme, ont été adoptés des statuts qui viennent sceller et cimenter l'existence de l'organisation unie. Nous publions ici un article basé sur le rapport introductif à la discussion sur les statuts et qui tente de dégager les grandes lignes qui ont présidé à la rédaction des actuels statuts de l'organisation.
Si, en filigrane des statuts que se sont données les différentes organisations politiques de la classe, on peut lire les principes généraux, programmatiques, qui président à leur constitution, on y décèle bien plus encore, les conditions particulières dans lesquelles elles sont affirmées. Alors que le programme du prolétariat, même s'il n'est pas 'Invariant", comme le prétendent certains, et s'il bénéficie des apports successifs de l'expérience de la classe, n'est pas quelque chose de circonstanciel, qu'on peut remettre en cause à chaque détour de la lutte, la façon dont les révolutionnaires s'organisent pour défendre ce programme est éminemment liée, tant aux conditions pratiques que ceux-ci affrontent, qu'au moment historique où se situe leur activité. Loin de constituer de simples règles neutres et intemporelles, les statuts sont donc un reflet signifiant de la vie même de l'organisation politique, et qui change de forme quand les conditions de cette vie se transforment. A travers les statuts des quatre principales organisations principales que s'est données le prolétariat (Ligue des communistes, première, deuxième et troisième Internationales), c'est l'évolution et la maturation mêmes du mouvement de la classe qu'on peut suivre.
LA LIGUE DES COMMUNISTES (1847)
Des statuts de la Ligue des Communistes on peut dégager trois caractéristiques essentielles :
— l'affirmation du principe d'unité internationale du prolétariat ;
— une forte insistance sur les problèmes de clandestinité ;
— les vestiges du communisme utopique.
1° L'AFFIRMATION DU PRINCIPE D'UNITE INTERNATIONALE DU PROLETARIAT
En tête des statuts de la Ligue se trouve sa célèbre devise : "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !". Dès les premiers balbutiements de la classe, l'internationalisme apparaît d'emblée comme une des pierres de touche de son programme. De même l'organisation que se donnent ses éléments les plus conscients, les communistes, est unitaire au niveau international et ses statuts s'adressent non pas à des sections territoriales particulières (régionales ou nationales), mais à l'ensemble des membres de l'organisation.
Cependant, dans l'existence des statuts uniques, régissant l'activité de chaque membre à l'échelle internationale, on ne doit pas seulement voir, dans le cas de la Ligue, une manifestation puissante de son internationalisme. En fait, la Ligue est avant tout une société secrète comme il en existe tant d'autres à l'époque. Elle regroupe essentiellement des ouvriers et des artisans allemands, pour la plupart émigrés à Bruxelles, Londres et Paris et ne comporte pas, par conséquent, des sections nationales effectives, liées à. la vie politique du prolétariat des différents pays. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la Ligue ne regroupe qu'une petite partie des forces vives du prolétariat de l'époque : les courants proudhoniens et blanquistes, pour ne parler que de ceux-ci, très influents en France, n1en font pas partie. La Ligue reste une petite organisation dont les membres sont souvent liés par les vestiges des vieilles relations de compagnonnage. Il faut d' ailleurs noter que les "tours" d'apprentissage de la profession, que les ouvriers de l'époque ont l'habitude de faire, jouent un rôle important dans la diffusion des idées de la Ligue et dans le développement de son organisation.
Concernant le champ d'application territorial des statuts de la Ligue, il faut enfin, remarquer que c'est sur cette base territoriale qu’elle est clairement organisée : les commîmes de la Ligue existent, par localités et sont regroupées en secteurs géographiques et non pas sur une base professionnelle ou d'activité industrielle. C'est là une caractéristique d'une organisation de type parti en opposition à celles de type syndical. D'emblée, la Ligue a donc compris la nécessité pour la classe d'organisations de ce premier type mais cela ne correspond pas encore au degré de maturation de celle-ci à l'époque.
2° L'INSISTANCE SUR LES PROBLEMES DE CLANDESTINITE
Dans l'Europe de 1847 marquée de sceau du "Congrès de Vienne" symbole de la réaction féodale, les libertés bourgeoises sont encore fort peu développées et le programme de la Ligue la contraint à l'illégalité. Cela explique en bonne parie les dispositions prévues dans les statuts pour assurer sa clandestinité :
— "garder le silence sur l'existence de toute affaire de la Ligue". (Art. 2, point f)
— "être admis à l'unanimité dans une commune". (Art. 2, point g)
— "les membres portent des noms d'emprunt". (Art, 4)
— "Les diverses communes ne se connaissent "pas entre elles, et n'échangent pas de "correspondance entre elles". (Art, 8)
Cependant, si les conditions policières de cette période expliquent la nécessité d'un certain nombre de mesures, il faut également voir dans celles-ci la manifestation du caractère de société secrète de la Ligue hérité des différentes sectes conspiratives qui l'ont précédée et dont elle est issue (Société des Saisons, Ligue des Justes, etc.). Ici encore, l'immaturité du prolétariat de l'époque est transcrite dans les dispositions organisationnelles de la Ligue. Mais elle l'est encore plus dans :
3° LES VESTIGES DU COMMUNISME UTOPIQUE
Les statuts de la Ligue portent la marque des origines de celle-ci dans les sociétés secrètes, tant du point de vue d'une certaine verbosité que du rituel qui marque l'admission d'un nouveau membre : "Tous les membres sont égaux et frères, et se doivent donc aider en toute circonstance" (art. 3).
Où retrouve là l'ancienne devise de la Ligue des Justes d'où est issue la Ligue des Communistes : "Tous les hommes sont frères" mais, par ailleurs, l'idée de la nécessaire solidarité entre les membres de 1'organisation n'est pas un vestige d'une époque révolue. Au contraire, contre les déformations subies dans les partis de la IIème et IIIème Internationales où l’arrivisme, le carriérisme et le jeu des rivalités professionnelles ont été une des manifestations de la dégénérescence, nous avons jugé nécessaire d'écrire dans la plateforme du CCI : " (les rapports entre militants de l'organisation).. ne peuvent être en contradiction flagrante avec le but poursuivi par les révolutionnaires et ils s'appuient nécessairement sur une solidarité et une confiance mutuelle qui sont une des marques de l'appartenance de l'organisation à la classe porteuse du communisme".
Dans les statuts de la Ligue on trouve aussi :
"(les adhérents doivent) faire profession de communisme" (art. 2, point c) et, dans l'article 50, la description du rituel qui doit accompagner toute admission : " Le président de la commune donne lecture au candidat des articles 1 à 49, les explique, met particulièrement en évidence dans une brève allocution les obligations dont se charge celui qui entre dans la Ligue, et lui pose ensuite la question : "Veux-tu, dans ces conditions, entrer dans cette Ligue ?" ..."
Là encore, on trouve donc des restes des origines sectaires de la Ligue. Cependant, ces dispositions contiennent une autre idée fondamentale et qui, elle, ne porte pas la marque de l'époque : celle du nécessaire engagement des membres de l'organisation, laquelle ne peut être composée de dilettantes. Rappelons que c'est sur ce problème que s'est faite la scission entre bolcheviks et menchéviks en 1903.
La Ligue constituait une étape importante dans le développement du prolétariat. Elle lui a légué des acquis fondamentaux, en particulier son "Manifeste" qui est probablement le texte le plus important du mouvement ouvrier. Mais elle n'a pu réellement constituer le regroupement des forces vives du prolétariat mondial, tâche que l'AIT allait assumer dans la période suivante.
2° - L'ASSOCIATION INTERNATIONALE Ces TRAVAILLEURS (1864)
Les statuts de l’AIT ont joué un rôle politique fondamental dans le développement et l'activité dé l'organisation. A travers leur évolution, les discussions à leur sujet, la façon dont ils ont été appliqués, c’est toute une étape fondamentale de la vie de la classe qu'on retrouve de façon condensée.
La forme de ces Statuts appelle un certain nombre de remarques préliminaires.
En premier lieu, les "considérants" constituent le véritable programme de l'AIT, Les statuts et la plateforme de l’organisation sont confondus. Ceci était également valable pour les statuts de la Ligue des Communistes dont le premier article indiquait:
"Le but de la Ligue est le renversement de la bourgeoisie, la domination du prolétariat, l'abolition de la vieille société bourgeoise fondée sur les antagonismes de classe, et l'instauration d'une société nouvelle, sans classes et sans propriété privée".
La possibilité d'insérer le programme de l'organisation dans |les statuts existe au début du mouvement ouvrier quand ce programme se résume à quelques principes généraux sur le but à atteindre. Pais au fur et à mesure que se développe l'expérience de la classe, et que se précise ce programme, non pas tant sur le but ultime, qui a été défini dès les débuts du mouvement ouvrier, mais sur les moyens de l'atteindre, il devient de plus en plus difficile de l'intégrer dans les statuts. Les considérants des statuts de l'AIT sont déjà plus développés que l'article premier de ceux de la Ligue mais en quelques points ils établissent l'essentiel du programme prolétarien de cette époque: auto-émancipation du prolétariat, abolition des classes, base économique de l'exploitation et de l'oppression des travailleurs, nécessité de moyens politiques pour abolir celles-ci, nécessité de la solidarité, de l'action et de l'organisation à l'échelle internationale. Ces considérants constituent donc les bases de l'unification des éléments les plus avancés de la classe de cette époque,
Deuxième remarque qu’on peut faire sur ces statuts, c'est de signaler le reste de verbalisme qu'ils contiennent encore:
"La base de leur conduite envers tous les hommes (doit être) la vérité, la justice, la morale..." "Pas de droits sans devoirs, pas de devoirs sans droits". Dans une lettre du 29 novembre 1864? Marx, le rédacteur de ces statuts, s'en explique:
"Par politesse pour les français et les italiens qui emploient toujours de grandes phrases, j'ai dû accueillir dans le préambule des statuts quelques figures de style inutiles".
En fait l'Internationale regroupait toute une série de courants de la classe : proudhoniens, Pierre-Leroux, marxistes, Owenistes et même Mazziniens et, d'une façon atténuée, cela se reflétait dans ses propres statuts qui devaient pouvoir satisfaire ces courants hétéroclites.
La troisième remarque porte sur le caractère hybride de l'AIT, à la fois parti politique et organisation générale de la classe (ou tendant à l'Être) regroupant aussi bien des organisations professionnelles (sociétés ouvrières, de secours mutuel,..) que des groupes politiques (comme la trop célèbre "Alliance de la Démocratie Socialiste" de Bakounine). C'est là une manifestation du caractère immature de la classe de cette période. Ce n'est que progressivement que la question s'est clarifiée sans jamais, toutefois, être résolue. On peut suivre cette clarification à travers l'évolution des statuts et des règlements spéciaux adoptés par les Congrès successifs. Par exemple l'article 3 des statuts se transforme entre 1864 (constitution) et 1866 (1er Congrès). La phrases "(le Congrès) sera composé de représentants de toutes les sociétés ouvrières qui auront adhéré" est devenue "Tous les ans aura lieu un Congrès ouvrier général composé de délégués de£ branches de l'Association". On voit donc l'AIT, de rassemblement de sociétés ouvrières, se structurer en branches sections, etc.
En fait, les statuts ainsi que les amendements et compléments qui leur ont été apportés, ont été eux-mêmes un instrument de clarification et de lutte contre les tendances confusionnistes et fédéralistes. On peut citer le cas des règlements spéciaux adoptés au Congrès de Genève en 1866 et dont l'article 5 stipules "Partout où les circonstances le permettront, des conseils centraux groupant un certain nombre de sections seront établis".
Ainsi, les règles de fonctionnement se font un outil actif et dynamique du processus de centralisation de 1’Internationale. La nécessité de cet effort de centralisation est mise en relief, à contrario, par la façon dont les statuts ont été traduits par les sections françaises :
-"Le conseil central fonctionne comme agence internationale" devient "établira des relations" (art.6)
-"Sous une direction commune" devient "dans un môme esprit" (art.6)
-"Conseil Central International" devient "Conseil central" (art.7)
-"Organes nationaux centraux" devient "organe spécial" (art.7)
-"Les sociétés ouvrières qui adhèrent à l'Association Internationale continueront à garder intacte leur organisation existante" devient "n'en continueront pas moins d'exister sur les bases qui leur sont particulières" (art.10)
Cette lutte contre les courants petit-bourgeois trouvera sa conclusion au Congrès de La Haye en 1872 qui adoptera l'article 7a des statuts : "Dans sa lutte contre le pouvoir collectif des classes possédantes, le prolétariat ne peut agir comme classe qu’en se constituant lui-même en parti politique distinct, opposé à tous les anciens partis formés par les classes possédantes. Cette constitution du prolétariat en parti politique est indispensable pour assurer le triomphe de la révolution sociale et de son but suprême l’abolition des classes. La coalition des forces ouvrières, déjà obtenue par la lutte économique, doit aussi servir de levier aux mains de cette classe dans sa lutte contre le pouvoir politique de ses exploiteurs".
Ainsi, le dernier Congrès de l'AIT jetait des bases claires pour la poursuite de la lutte du prolétariat :
- nécessité de l'activité politique de la classe et non seulement économique.
- nécessité de la constitution d'un parti politique distinct des multiples "sociétés ouvrières" et autres organes exclusivement économiques.
Cet effort de clarification de l’AIT devait trouver son terme a ce Congrès par le départ des anarchistes regroupés autour de "l'Alliance" de Bakounine et devenus inassimilables. Ce terme était marqué par le fait que l'Internationale en revenait, du point de vue programmatique, aux positions de la Ligue. Mais, alors que celle-ci était encore en bonne partie une secte, ne regroupant qu'une toute petite minorité d'éléments de la classe et sans influence majeur sur celle-ci, l'Internationale avait dépassé les sectes et regroupé les forces vives du prolétariat mondial autour d'un certain nombre de points fondamentaux dont le moindre n'était pas 1'Internationalisme.
A la différence de la Ligue, l’AIT était donc une véritable organisation internationale ayant une activité et un impact effectifs au sein de la classe, C'est pour cela, qu’à l’opposé de la Ligue dont les statuts s’adressaient directement aux membres de Inorganisation, que 1’Internationale s’est structurée en sections nationales puisque c'est d’abord dans ce cadre national que le prolétariat est confronté à la bourgeoisie et à son Etat.
Cependant, cela n'affaiblissait pas le caractère puissamment centralisé de l'organisation dans laquelle le Conseil Général de Londres a joué un rôle fondamental tant dans la lutte contre les tendances confusionnistes et sectaires ([1] [10]) que dans les prises de position face aux événements fondamentaux de la vie politique. On se souvient par exemple que les deux textes sur la guerre -franco-prussienne de 1870 et celui sur la Commune de 1871, œuvres de Marx, ont été publiés comme adresses du Conseil Général et donc prises de positions officielles de l'Internationale,
L'AIT est morte en 1876, comme résultat du reflux du mouvement ouvrier après l’écrasement de la Commune, mais aussi comme manifestation du fait, qu'après une série de convulsions économiques et politiques de 1847 à 1871, le capitalisme. A connu après cette date, la période de plus grande prospérité et stabilité de toute son histoire.
3° - L'INTERNATIONALE SOCIALISTE (1889)
Au moment de la fondation de la IIème Internationale, le capitalisme est donc à son apogée; ce qui se répercute immédiatement tant dans le programme de la IIème Internationale que dans son mode d'organisation. Ainsi, on lit à l'ordre du jour du 1er Congrès :
1- Législation internationale du travail, Réglementation légale de la journée de travail. Travail de jour, de nuit, des jours fériés, des adultes et des enfants,
2- Surveillance des ateliers de la grande et petite industrie, ainsi que de l'industrie domestique,
3- Voies et moyens pour obtenir ces revendications,
4- Abolition des armées permanentes et armement du peuple.
On peut donc constater que les préoccupations des partis qui composent l'Internationale sont tournées vers l'obtention de réformes dans le cadre du système.
Sur le plan organisationnel, le moins que l'on puisse dire c'est que cette Internationale ne ressemblait pas du tout à la précédente. En effet pendant plus de dix ans, elle n’a existé que par ses Congrès. Jusqu’en 1900 il n'a existé aucun organe permanent chargé de faire exécuter les décisions de ceux-ci. La préparation et l’organisation des Congrès étaient laissées aux partis des pays dans lesquels ils devaient se tenir. Ce n’est qu'au Congrès de Paris, en 1900 que le principe de la création d'un "Comité permanent international" est retenu et que celui-ci se constitue fin 1900 sous le nom de Bureau Socialiste International (BSI). Celui-ci est composé de deux délégués par pays et nomme un secrétariat permanent.
Jusqu’en 1905 le BSI reste relativement effacé. Et ce n’est qu'en 1907 au Congrès de Stuttgart que sont adoptés statuts et règlements pour les Congrès et le BSI. Mais, môme au moment critique du début de la 1ère guerre mondiale, le BSI réuni le 29 juillet ne prend aucune décision et se rallie à la solution proposée par Jaurès :
"Le BSI formulera la protestation contre la guerre, le Congrès souverain décidera".
Ce Congrès de l'Internationale ne devait jamais se réunir car celle-ci mourut dans la tourmente de la guerre ses principaux partis étant passés à la "défense nationale" et à "l'union sacrée" avec la "bourgeoisie de leurs pays respectifs.
Jusqu'au bout, l'Internationale Socialiste était donc restée une fédération de partis nationaux? C’est ce que traduit la forme du BSI qui n'est pas l'expression collective d'un corps unitaire mais la somme des délégués mandatés par les partis nationaux. Comment expliquer ce relâchement considérable par rapport à la centralisation de l'AIT? Essentiellement par les conditions historiques de la lutte prolétarienne de cette époque. L’éloignement de la perspective de la révolution, qui au milieu du 19ème siècle, au milieu de différents soubresauts du capitalisme, avait paru imminente, la nécessité par suite, de consacrer l'essentiel des luttes à l'obtention de réformes, avait conduit le prolétariat à développer son organisation sur le plan national qui-était celui dans lequel il pouvait obtenir ces réformes.
La IIème Internationale constitue l'étape du mouvement ouvrier où celui-ci se développe en grands partis de masse devenant des forces effectives sur le terrain politique des différents pays. Mais les conditions de prospérité capitaliste, dans laquelle elle a vécu, ont favorisé chez elle le développement de l'opportunisme et un relâchement de 1’Internationalisme qui devaient lui coûter la vie en 1914.
Par ailleurs, l'Internationale Socialiste a parachevé l'œuvre entreprise par l'AIT, de clarification de la distinction entre l'organisation générale de la classe et l'organisation des révolutionnaires.
Bien qu'elle ait été bien souvent à l'origine des syndicats (surtout en Allemagne), la IIème Internationale prend progressivement ses distances avec le mouvement syndical du point de vue organisationnels après une série de débats, la séparation organique est consommée en 1902 par la création d'un "Secrétariat International des Organisations Syndicales". Même si on ne peut assimiler complètement les syndicats à l'organisation générale de la classe et les partis de la IIème Internationale à la minorité révolutionnaire, telles qu'elles sont apparues dans la période suivante, la distinction entre syndicats et partis politiques.
4° - L'INTERNATIONALE COMMUNISTE (1919)
Dans les 30 années qui séparent la fondation de la IIème Internationale et celle de la IIIème, des événements d'une importance considérable pour le mouvement ouvrier sont intervenus. De système à l'apogée, le capitalisme est devenu un système en décadence ouvrant ainsi "l'ère des guerres et des révolutions". La première grande manifestation de cette décadence, la guerre impérialiste de I914-18 a, en même temps, signé la mort de l'Internationale Socialiste et permis l'éclosion de l'Internationale Communiste dont la fonction n'est plus d'organiser la lutte pour des réformes, mais de préparer le prolétariat à la révolution. Tant du point de vue programmatique qu'organisationnel, la IIIème Internationale s'oppose à la seconde. Plus de distinction entre "programme minimum et programme maximum": "L'Internationale se donne pour but la lutte armée pour le renversement de la bourgeoisie internationale, et la création de la république Internationale des Soviets, première "étape" dans la voie de la suppression complète de tout régime gouvernemental". (Préambule des statuts de l'IC, 1920). Et pour cela, l'organisation de l'avant-garde de la classe ne peut être que mondiale et centralisée.
Cependant, si l'IC a rompu fondamentalement avec la seconde, elle ne s'est pas entièrement dégagée d'elle, Ainsi elle conserve, en leur donnant un sens qui se veut "révolutionnaire", les vieilles tactiques syndicales et parlementaires et, plus tard, frontistes. De même, sur le plan organisationnel, elle conserve un certain nombre de vestiges de 1'époque antérieure. Ainsi l'article 4 des statuts, indiques "L'instance suprême de l'IC n'est autre que le Congrès Mondial de tous les partis et organisations affiliées", ce qui laisse encore une possibilité d'ambiguïté sur l'aspect de l'Internationale comme somme de partis. Par ailleurs, autre vestige de la IIème Internationale, les articles 14, 15 et 16 des statuts de l'IC prévoient des relations spéciales avec les syndicats, le mouvement de la jeunesse et le mouvement des femmes.
Cependant, le caractère "fortement centralisé" de l'organisation est bien souligné :
Article 5: "Le Congrès international élit un comité exécutif de l'Internationale Communiste, qui devient l'instance suprême de l'I.C. durant les intervalles qui séparent les sessions du Congrès mondial.
Article 9 : "Le Comité Exécutif de l'IC a le droit d'exiger des partis affiliés que soient exclus tels groupes ou tels individus qui auraient enfreint la discipline prolétarienne. Il peut exiger l’exclusion des partis qui auraient violé les décisions du Congrès mondial".
Article 11 : " Les organes de la presse de tous les partis et organisations affilié à l'I.C. doivent publier tous les documents officiels de l'I.C. et de son Comité Exécutif".
Cette centralisation est l'expression directe des tâches du prolétariat à cette époque. La révolution mondiale implique qu’autant le prolétariat que son avant-garde doivent s'unifier à l'échelle mondiale. Comme dans la première Internationale, les éléments qui se .revendiquent d'une plus grande "autonomie" des sections (comme en France), sont en fait ceux qui véhiculent le plus d'idéologie bourgeoise. Et c'est la gauche italienne qui, par la bouche de Bordiga, propose la création d'un parti mondial. Donc, si c'est en partie à travers cette centralisation qu'ont été véhiculés un certain nombre de germes de la dégénérescence ultérieure, il ne faut pas perdre de vue que la centralisation est, dans la période actuelle, une condition indispensable pour l'organisation des révolutionnaires .
5° LES STATUTS DU CCI.
a) Leur forme:
Comme on l'a vu an début de ce texte, les statuts des différentes organisations politiques de la classe ont été, en même temps qu'instruments de la lutte politique, des miroirs fidèles des conditions dans lesquelles celle-ci devait lutter. Et en particulier, ils portaient en eux les faiblesses et l'immaturité du prolétariat des différentes époques. Les statuts du CCI n'échappent pas à la règle. Ils sont un produit de leur époque, et c'est parce que le mouvement général de la classe a progressivement surmonté son immaturité qu'ils peuvent aujourd’hui, à leur tour, dépasser les faiblesses des statuts que nous avons passé en revue.
Par exemple, dans les statuts du C.C.I., il n'est plus fait référence à l'idée que "tous les hommes sont frères" ou qu'il n'y a "pas de devoir sans droit". Ils établissent, contrairement à l'A.I.T. ou aux débuts de la seconde Internationale, une distinction nette entre la classe et les révolutionnaires. N'ayant plus pour tache d’unifier les différentes sectes et de clarifier progressivement le programme prolétarien, ils ne sont pas des statuts-programme comme l'étaient ceux de l'A.I.T. Ils ont également abandonné toute conception fédéraliste comme celle de la seconde Internationale. Enfin, ils ne prévoient pas 1'existence d'organisation syndicale annexe, d'organisât ion de jeunes ou de femmes comme ceux de la troisième Internationale.
Compte tenu de toute l'expérience du mouvement ouvrier et des tâches que le CCI doit assumer dans la période actuelle, les caractéristiques essentielles de ces statuts sont une forte insistance sur le caractère unifié et centralisé mondialement de l'organisation mais qui n'exclut pas le maintien de l'existence de sections par pays comme manifestation du fait que c'est à ce niveau que, dans les luttes qui viennent, le prolétariat sera d'abord confronté à la bourgeoisie et que les révolutionnaires seront appelés à agir. C'est pour cela que ces statuts s'adressent à des sections de pays et non à des individus.
Par ailleurs, compte-tenu de l'expérience delà dégénérescence de la troisième Internationale, où les mesures administratives ont été l'instrument utilisé contre les fractions révolutionnaires, il était utile d'insérer dans les présents statuts des points précisant les conditions dans lesquelles peuvent et doivent s'exprimer les divergences au sein de l’organisation.
Par conséquent, les statuts, se. .-subdivisant en un certain nombre de parties qu'on peut identifier de la façon suivante :
-Préambule indiquant la signification du Courant et faisant référence à la base programmatique de celui-ci : la plateforme à laquelle il n’a pas pour fonction de se substituer ;
-L'unité du courant ;
-Le Congrès comme expression de cette unité ;
-Le rôle centralisateur de l'organe exécutif ;
-La façon centralisée de concevoir les rapports avec l'extérieur, les finances, et les publications ;
-La vie de 1'organisation ;
b) Leur signification:
L'adoption par le C.C.I. revêt une importance considérable à l'heure où s'approfondit inexorablement la crise du capitalisme et le mouvement de la classe. Elle est la manifestation du fait que les révolutionnaires se sont dotés d'un instrument fondamental de leur activité : leur organisation mondiale. II faut à ce propos signaler le fait que pour la première fois de l'histoire du mouvement ouvrier, l'organisation internationale né vient pas chapeauter des sections nationales existant au préalable, mais au contraire que ces sections sont le résultat de l'activité du Courant International lequel s'est constitué pratiquement d'emblée à cette échelle,,
Contrairement au passé, la constitution effective de l'organisation mondiale intervient avant que le prolétariat ne se soit lancé dans ses combats décisifs : en 1919 l'Internationale est fondée alors que le plus fort du mouvement est déjà passé. Certains groupes révolutionnaires sont d'accord avec nous sur le caractère nécessairement mondial de l'organisation des révolutionnaires, mais prétendent en même temps que le moment n'est pas encore venu et qu'il faut attendre ces combats décisifs, la création d'une organisation mondiale aujourd'hui étant "volontariste". Cette temporisation n'est en fait qu'une manifestation de leur localisme, de leur jalousie de petite chapelle et cet "après" qu'ils proposent risque de vouloir dire "trop tard", Les révolutionnaires ne doivent pas faire vertu des faiblesses du passé.
L'organisation des révolutionnaires qui se reconstitue difficilement aujourd’hui après.la rupture organique du lien avec les fractions communistes, conséquence d'un demi-siècle de contre-révolution, porte encore de graves faiblesses qui ne pourront être surmontées qu'à travers toute une expérience longue et difficile. Par contre, le fait que, dès maintenant, la classe puisse se doter d'une organisation mondiale de ses éléments révolutionnaires est un élément extrêmement positif qui vient en partie compenser ces autres faiblesses et pèsera certainement d'un poids très lourd sur l'issue des combats gigantesques qui se préparent.
C
G
[1] [11] "L’histoire de l’Internationale a été une lutte continuelle du Conseil Général contre les sectes et les tentatives d'amateurs qui tentaient sans cesse de se maintenir contre le mouvement réel de la classe ouvrière au sein de l’Internationale elle-même" (Marx, lettre à Bolte, 23 novembre 1871)