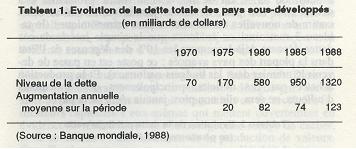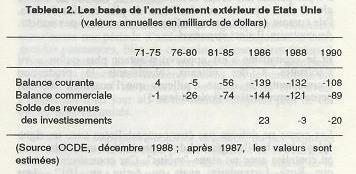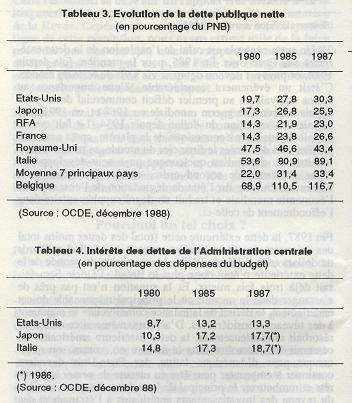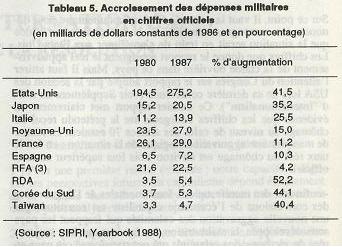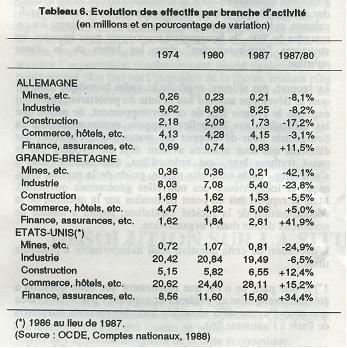Revue Internationale no 59 - 4e trimestre 1989
- 2712 reads
Editorial : Chine, Pologne, Moyen-Orient, grèves en URSS et aux Etats-Unis
- 2705 reads
CONVULSIONS CAPITALISTES ET LUTTES OUVRIERES
En quelques mois, le monde a été le théâtre de toute une série d'événements particulièrement significatifs des enjeux réels de la période historique actuelle : les événements de Chine au printemps, les grèves ouvrières en URSS durant l'été, la situation au Moyen Orient, marquée par des faits d'apparence "pacifique" comme la nouvelle orientation de la politique de l'Iran, mais aussi par des événements sanglants et menaçants comme la destruction systématique de Beyrouth et les gesticulations belliqueuses de la flotte française au large du Liban. Enfin, le dernier événement qui ait fait la "une" des journaux, la constitution en Pologne, pour la première fois dans un pays à régime stalinien, d'un gouvernement dirigé par une formation politique qui n'est ni le parti "communiste", ni même une de ses marionnettes (comme le "parti paysan" où autres), rend compte de la situation inédite dans laquelle se trouvent ces pays.
Pour les commentateurs bourgeois, ces différents événements trouvent en général une explication spécifique, sans lien aucun avec celle des autres. Et quand ils s'emploient à dégager ce qui les relie entre eux, à établir un cadre général dans lequel ils s'insèrent, c'est pour les mettre au service des campagnes démocratiques qui se déchaînent à l'heure actuelle. C'est ainsi qu'on peut lire et entendre que :
- "les convulsions qui ont secoué la Chine sont liées au problème de la succession du vieillard autocrate Deng Xiaoping" ;
- "les grèves des ouvriers en URSS s'expliquent par les difficultés économiques spécifiques auxquelles ils se confrontent" ;
- "le nouveau cours de la politique iranienne est la conséquence de la disparition du fou paranoïaque Khomeiny" ;
- "les affrontements sanglants du Liban et l'expédition militaire française ont pour cause les appétits excessifs de Assad, le "Bismarck" du Moyen Orient" ;
- "on ne peut comprendre la situation actuelle en Pologne qu'en partant des spécificités de ce pays"...
"Mais tous ces événements ont un point commun : ils participent de la lutte universelle entre la "Démocratie" et le totalitarisme", entre les défenseurs des "Droits de l'Homme" et ceux qui les bafouent."
Face à la vision du monde des bourgeois qui ne dépasse pas le bout de leur nez et surtout face aux mensonges qu'ils répètent à satiété en espérant que les prolétaires en feront leur vérité, c'est le rôle des révolutionnaires de mettre en avant les véritables enjeux que les événements récents traduisent, de dégager le cadre réel dans lequel ils se situent.
A la racine de la situation internationale actuelle se trouve l'effondrement irréversible des bases matérielles de l'ensemble de la société, la crise mondiale insurmontable de l'économie capitaliste. La bourgeoisie a eu beau saluer ces deux dernières années comme celles de la "reprise" et même de la "sortie de la crise", elle a bien pu s'extasier sur les taux de croissance "d'un niveau inconnu depuis les années 60", elle ne peut rien contre des faits qui restent toujours aussi têtus : les "performances" récentes de l'économie mondiale (en fait de l'économie des pays les plus avancés) ont été payées par une nouvelle fuite en avant dans l'endettement généralisé qui augure de futures convulsions encore plus dramatiques et brutales que les précédentes ([1] [1]). Et, déjà, le retour d'une inflation galopante dans la plupart des pays et notamment dans la Grande Bretagne de Madame Thatcher, modèle de "vertu économique" commence à semer l'inquiétude... Toutes les déclarations euphoriques de la bourgeoisie n'auront pas plus d'effet que les incantations des hommes préhistoriques pour faire pleuvoir : le capitalisme est dans une impasse. Depuis qu'il est entré dans sa période de décadence au début du siècle, la seule perspective qu'il sache offrir à l'humanité, dans une telle situation de crise ouverte, est celle d'une fuite en avant dans la guerre dont l'aboutissement est la guerre impérialiste généralisée.
LIBAN ET IRAN : LA GUERRE HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN...
C'est bien ce que viennent confirmer les derniers événements du Liban. Ce pays, qui autrefois était appelé la "Suisse du Moyen Orient", n'a pas connu de répit depuis plus de 15 ans. Sa capitale, qui a bénéficié de la sollicitude de nombreux "libérateurs" et "protecteurs" (Syriens, Israéliens, Américains, Français, Anglais, Italiens...) est en passe d'être rayée de la carte. Véritable Carthage des temps modernes, elle fait l'objet aujourd'hui d'une destruction systématique, méticuleuse, qui, au moyen de centaines de milliers d'obus par semaine, la transforme en un champ de ruines et condamne ses habitants rescapés à vivre comme des rats. Contrairement au passé, ce ne sont plus à l'heure actuelle les deux grandes puissances qui 's'y affrontent : l'URSS qui, pendant un temps, s'était trouvée derrière la Syrie, a dû ravaler ses ambitions face au déploiement de force du bloc occidental de 1982. Cependant, dans le monde actuel, les antagonismes entre les deux blocs impérialistes, s'ils déterminent, en dernière instance, la physionomie générale des affrontements guerriers, ne sont pas les seuls à occuper le terrain militaire. Avec l'aggravation catastrophique de la crise capitaliste, les revendications particulières des petites puissances tendent à s'exacerber, surtout lorsqu'elles constatent qu'elles sont les victimes d'un marché de dupes, comme c'est le cas de la Syrie aujourd'hui. Après 83, ce pays avait échangé, avec le bloc américain, son retrait de l'alliance avec l'URSS contre une partie du Liban. Il s'était même converti en "gendarme" de sa zone d'occupation contre l'OLP et les groupuscules pro-iraniens. Mais en 88, estimant qu'il n'avait plus à craindre le retour dans la région d'un bloc russe de plus en plus pris à la gorge, le bloc américain a décidé qu'il n'avait plus besoin de respecter les clauses du marché. En téléguidant l'offensive du général chrétien Aoun, il a entrepris de faire revenir la Syrie à l'intérieur de ses frontières, ou au moins de réduire ses prétentions, afin de confier le contrôle du Liban à des alliés plus fiables, les milices chrétiennes et Israël, tout en mettant au pas les milices musulmanes. Le résultat en est ce massacre dont les populations civiles des deux côtés sont les premières victimes. Et dans cette affaire, on assiste une nouvelle fois à un judicieux partage des tâches entre les différents pays du bloc occidental : les Etats-Unis feignant de ne pas prendre parti entre les deux camps belligérants afin de ramasser la mise quand la situation sera mûre, alors que la France s'implique directement sur le terrain en envoyant un porte-avions et 6 autres navires de guerre dont personne n'arrive à croire, même en faisant beaucoup d'efforts, qu'ils sont investis d'une "mission humanitaire , comme le raconte Mitterrand. Au Liban, comme partout ailleurs, les croisades sur les "droits de l'homme" et la "liberté" ne sont que le cache-sexe des calculs impérialistes les plus sordides.
Le Liban constitue à l'heure actuelle un concentré de la barbarie dont est capable le capitalisme moribond. Il fait la preuve que toutes les paroles de paix qui ont été prononcées depuis un an ne sont que... des paroles. Même si un certain nombre de conflits ont été mis en sourdine ces derniers temps, il n'existe pour le monde aucune perspective de paix réelle. Bien au contraire.
C'est de cette façon que nous devons comprendre l'évolution récente de la situation en Iran. La nouvelle orientation du gouvernement de ce pays, qui désormais est prêt à coopérer avec le "Grand Satan" américain, n'a pas pour cause fondamentale la disparition de Khomeiny. Elle résulte essentiellement de la formidable pression que ce même "Grand Satan" a exercée pendant des années, en compagnie de la totalité de ses alliés les plus proches, pour remettre au pas ce pays après qu'il ait tenté de se soustraire au contrôle du bloc américain. Il y a deux ans à peine, celui-ci, en envoyant dans le Golfe persique la plus formidable armada qu'on ai vue depuis la seconde guerre mondiale, tout en intensifiant son soutien à l'Irak en guerre avec l'Iran depuis 8 ans, avait clairement signifié à ce dernier que "les choses avaient assez duré". Le résultat ne s'était pas fait attendre bien longtemps : l'an dernier, l'Iran acceptait de signer un armistice avec l'Irak et d'entamer des négociations de paix avec ce pays. C'était un premier succès de l'offensive du bloc occidental, mais jugé encore insuffisant par ce dernier. Il fallait en plus que la direction du pays passe aux mains de forces politiques capables de comprendre où se trouvait son "véritable intérêt" et de museler les cliques religieuses fanatiques et complètement archaïques qui l'avaient conduit dans cette situation. Les déclarations "Rushdicides" de l'hiver dernier traduisaient une dernière tentative de ces cliques, regroupées autour de Khomeiny, pour reprendre le contrôle d'une situation qui tendait à leur échapper, mais la mort du descendant du Prophète a sonné le glas de leurs ambitions. En fait, celui-ci constituait, par l'autorité qu'il conservait encore, le dernier verrou bloquant l'évolution de la situation, comme le cas s'était déjà présenté en Espagne, au début des années 70, où la survie de Franco était le dernier obstacle à un processus de "démocratisation" ardemment souhaité par la bourgeoisie nationale et par celle du bloc américain. La rapidité avec laquelle évolue aujourd'hui la situation politique en Iran, où le nouveau président Rafsandjani s'est entouré d'un gouvernement de "techniciens" excluant tous les anciens "politiques" (à part lui), fait la preuve que la situation était "mûre" depuis longtemps, que les forces sérieuses de la bourgeoisie nationale étaient pressées d'en finir avec un régime dont le bilan se solde par la ruine totale de l'économie. Cette bourgeoisie risque vite de déchanter : au milieu de la catastrophe actuelle de l'économie mondiale, il n'y a aucune place pour le "rétablissement" d'un pays sous-développé, et de plus détruit et saigné par huit ans de guerre. En revanche, pour les grandes puissances du bloc occidental, le bilan est nettement plus positif : ce bloc a réussi à faire un nouveau pas dans le développement de sa stratégie d'encerclement de l'URSS, un pas qui vient s'ajouter à celui qu'il avait accompli en obtenant le retrait d'Afghanistan des troupes de ce pays. Cependant, la "Pax Americana" qui est en passe de se rétablir, au prix d'incroyables massacres, dans cette partie du monde n'augure nullement une "pacification" définitive. En refermant de plus en plus son étau sur l'URSS, le bloc occidental ne fait que reporter à un niveau supérieur les antagonismes insurmontables entre les deux blocs impérialistes.
Par ailleurs, les différents conflits du Moyen-Orient ont mis en relief une des caractéristiques générales de la période actuelle : la décomposition avancée, le véritable pourrissement sur pieds qui affecte aujourd'hui la société bourgeoise du fait de la perpétuation et de l'aggravation continuelle de la crise depuis plus de vingt ans. Plus encore que l'Iran, le Liban témoigne de ce phénomène, avec la loi de ses bandes armées rivales, avec l'éternisation d'une guerre qui n'a jamais été déclarée, avec les attentats terroristes quotidiens et avec ses "preneurs d'otages". Les guerres entre factions de la bourgeoisie n'ont jamais été des jeux de fillettes, mais cette classe s'était par le passé donné des règles pour "organiser" ses déchirements et ses massacres. Aujourd'hui, preuve de cette décomposition de l'ensemble de la société, même ces règles sont quotidiennement bafouées.
Mais la barbarie et la décomposition sociales actuelles ne se limitent pas aux guerres et aux moyens qu'elles emploient aujourd'hui. C'est dans ce cadre qu'il faut également comprendre les événements du printemps en Chine et ceux de l'été en Pologne.
CHINE ET POLOGNE : LES CONVULSIONS DES REGIMES STALINIENS
Ces deux séries d'événements, en apparence diamétralement opposés, révèlent une même situation de crise profonde, un même phénomène de décomposition qui affecte les régimes dits "communistes".
En Chine, la terreur qui s'est abattue sur le pays parle d'elle-même. Les massacres de juin, les arrestations en masse, les exécutions en série, la délation et l'intimidation quotidiennes rendent compte, non pas d'une quelconque force du régime, mais de son extrême fragilité, des convulsions qui menacent de le disloquer. De cette faiblesse nous avions eu une illustration flagrante lors de la venue de Gorbatchev à Pékin, le 15 mai, lorsque les manifestations étudiantes avaient, fait incroyable, contraint les autorités à chambouler complètement le programme de la visite de l'inventeur de la "Perestroïka". En fait, les déchirements au sein de l'appareil du parti, entre la clique des "conservateurs" et celle des "réformateurs" qui a utilisé les étudiants comme masse de manoeuvre, ne relevaient pas uniquement de la lutte pour la succession de Deng Xiaoping. Ils révélaient aussi, et fondamentalement, le niveau de la crise politique qui secoue cet appareil.
Les convulsions de ce type ne sont pas nouvelles dans ce pays. Par exemple, la prétendue "Révolution culturelle" avait correspondu à une période de troubles et d'affrontements sanglants. Cependant, durant une dizaine d'années, après l'élimination de la "bande des quatre" et sous la direction de Deng Xiaoping, la situation a donné l'impression de s'être quelque peu stabilisée. En particulier, l'ouverture vers l'Occident et la "libéralisation" de l'économie chinoise avaient permis une petite modernisation de certains secteurs créant l’illusion d'un développement enfin "pacifique" de la Chine. Les convulsions qui ont secoué ce pays au printemps dernier sont venues mettre un terme à ces illusions. Derrière la façade de la "stabilité", les conflits s'étaient en réalité aiguisés au sein du parti entre les "conservateurs" qui estimaient qu'il y avait déjà trop de "libéralisation" et les réformateurs" qui considéraient qu'il fallait poursuivre le mouvement sur le plan économique et même l'élargir, éventuellement, au plan politique. Les deux derniers secrétaires généraux du parti, Hu Yaobang et Zhao Zyiang, étaient partisans de cette deuxième ligne. Le premier a été chassé de son poste en 86 après le lâchage de Deng Xiaoping, qui pourtant l'avait sacré. Le second, qui était le principal instigateur des manifestations étudiantes du printemps, sur lesquelles il comptait pour imposer sa ligne et sa clique, a connu le même sort après la terrible répression de juin. C'en était fini du mythe de la "démocratisation de la Chine" sous l'égide du nouveau "timonier" Deng. Ce fut d'ailleurs l'occasion, pour certains "spécialistes", de rappeler qu'en réalité, toute la carrière de cet individu s'était faite comme organisateur de la répression et en utilisant la plus grande brutalité contre ses adversaires. Ce qu'il est nécessaire de préciser, c'est que tous les dirigeants chinois ont fait ce type de carrière. La force brute, la terreur, la répression, les massacres, constituent la méthode de gouvernement presque exclusive d'un régime qui, sans de tels moyens, s'effondrerait au milieu de ses contradictions. Et lorsque, de temps en temps, un ancien boucher, un tortionnaire recyclé, embouche les trompettes de la "Démocratie", en faisant baver la petite bourgeoisie intellectuelle du pays et les bonnes âmes médiatiques du monde entier, ses fanfaronnades sont vite ravalées : soit il est assez intelligent (comme Deng Xiaoping) pour changer à temps de registre, soit il passe à la trappe.
En Chine, avec les événements du printemps et leur sinistre épilogue, c'est de façon évidente que s'est exprimée une nouvelle fois la situation de crise aiguë qui affecte le régime de ce pays. Mais ce type de situation n'est pas réservé à la Chine. Il ne résulte pas seulement de son arriération économique considérable. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Pologne démontre de façon claire que c'est l'ensemble des régimes de type stalinien qui subit aujourd'hui les rigueurs d'une telle crise.
Dans ce pays, la constitution d'un gouvernement dirigé par Solidarnosc, c'est-à-dire par une formation qui n'est ni le parti stalinien, ni même directement contrôlée par celui-ci (et qui se trouvait, il y a peu de temps encore, dans la clandestinité), ne constitue pas seulement une première historique pour les pays du glacis soviétique. Cet événement est également significatif du niveau de la crise économique et politique qui frappe ces pays. En effet, il ne s'agit pas là d'une décision prévue et pré-paiée délibérément par la bourgeoisie afin de renforcer son appareil politique, mais le résultat de l'affaiblissement de celui-ci qui ne peut que contribuer à l'affaiblir encore. En fait, ces événements traduisent de la part de la bourgeoisie une perte de contrôle de la situation politique. Ils appartiennent à un processus de dérapage dont les étapes et les résultats n'ont été voulus par aucun des partenaires de la "table ronde" du début 89. En particulier, ni l'ensemble de la bourgeoisie, ni aucune de ses forces en particulier, n'a pu maîtriser le jeu électoral et "semi-démocratique" élaboré au cours de ces négociations. Déjà, au lendemain des élections de juin, il est apparu clairement que leur résultat, la défaite cuisante du parti stalinien et le "triomphe" de Solidarnosc, embarrassait autant le second que le premier. Aujourd'hui, la situation qui s'est instaurée rend bien compte de la gravité réelle de la crise et présage clairement des futures convulsions.
En effet, nous avons à l'heure actuelle en Pologne un gouvernement dirigé par un membre de Solidarnosc, dont les postes clés (surtout pour un régime dont le contrôle sur la société repose essentiellement sur la force) de l'Intérieur et de la Défense sont entre les mains de deux membres du POUP (en fait les précédents titulaires), c'est-à-dire le parti qui, il y a encore quelques mois, maintenait Solidarnosc dans l'illégalité et qui avait fait emprisonner ses dirigeants il y a quelques années. Même si tout ce beau monde témoigne d'une même et indéfectible solidarité anti-ouvrière (sur ce point on peut lui faire confiance), la "cohabitation" entre les représentants de ces deux formations dont les programmes politiques et économiques sont antinomiques, risque d'être tout sauf harmonieuse. Concrètement, les mesures économiques décidées par une équipe qui ne jure que par le "libéralisme" et "l'économie de marché" ont toutes les chances de rencontrer une résistance décidée de la part d'un parti dont le programme et la raison d'être même ne peuvent s'accommoder d'une telle perspective. Et cette résistance, ce n'est pas seulement au sein du gouvernement qu'elle va se manifester. Elle proviendra principalement de tout l'appareil du parti, de ces centaines de milliers de fonctionnaires de la "Nomenklatura" dont le pouvoir, les privilèges et les prébendes sont liés à la "gestion" (si toutefois ce terme a encore un sens quand on voit la désorganisation actuelle) administrative de 1’économie. En Pologne, comme dans la plupart des autres pays de l'Est, on a pu déjà constater, en de multiples circonstances, la difficulté d application de ce type de réformes, alors qu'elles étaient plus timides que celles prévues par les "experts" de Solidarnosc et qu'elles étaient décidées par la direction du parti. Aujourd'hui si on voit très bien que la gestion d'un gouvernement inspiré par ces experts signifie pour les ouvriers une nouvelle aggravation de leurs conditions d'existence, on ne voit vraiment pas, en revanche, comment elle pourrait parvenir à un autre résultat qu'une désorganisation encore plus grande de l'économie.
Mais les difficultés de ce nouveau gouvernement ne s'arrêtent pas là. Celui-ci sera confronté en permanence au gouvernement "bis", constitué autour de Jaruzelski et composé pour l'essentiel de membres du POUP. En réalité, c'est à ce dernier qu'obéira l'ensemble de l'appareil administratif et économique existant qui, lui aussi, se confond avec le POUP. Ainsi, dès sa constitution, le gouvernement Mazowiecki, salué comme une "victoire de la Démocratie" par les campagnes médiatiques occidentales, n'a d'autre perspective que le développement d'un chaos économique et politique encore plus grand que celui qui règne à l'heure actuelle.
La création en 1980 du syndicat indépendant Solidarnosc, destinée à canaliser, dévoyer et défaire la formidable combativité ouvrière qui s'était exprimée durant l'été avait, en même temps, engendré déjà une situation de crise politique qui ne s'était résolue qu'avec le coup de force et la répression de décembre 81. La mise hors-la-loi du syndicat, une fois qu'il eût achevé son travail de sabotage, montrait que les régimes de type stalinien ne peuvent supporter sans dommages l'existence en leur sein d'un "corps étranger", d'une formation qui ne soit pas directement sous leur contrôle. La constitution aujourd'hui d'un gouvernement dirigé par ce même syndicat (le fait, unique dans l'histoire, que ce soit un syndicat qui se trouve à la tête d'un gouvernement en dit long, par lui-même, sur le degré d'aberration de la situation qui s'est créée en Pologne) ne peut donc qu'entraîner, à une échelle encore plus vaste, ce type de contradictions et de convulsions. En ce sens, la "solution" de décembre 81, l'emploi de la force, une répression féroce, n'est nullement à exclure. Le ministre de l'intérieur de l'état de guerre, Kiszczak, est d'ailleurs toujours à son poste...
Les convulsions qui secouent à l'heure actuelle la Pologne, même si elles prennent dans ce pays une forme caricaturale, ne doivent pas être considérées comme spécifiques à ce pays. En fait, c'est l'ensemble des pays à régime stalinien qui se trouve dans une impasse. La crise mondiale du capitalisme se répercute avec une brutalité toute particulière sur leur économie qui est, non seulement arriérée, mais aussi incapable de s'adapter d'une quelconque façon à l'exacerbation de la concurrence entre les capitaux. La tentative d'introduire dans cette économie des normes "classiques" de gestion capitaliste, afin d'améliorer sa compétitivité, ne réussit qu'à provoquer une pagaille plus grande encore, comme le démontre en URSS, l'échec, complet et cuisant de la "Perestroïka". Cette pagaille se développe également sur le plan politique, lorsque sont introduits des essais de "démocratisation" destinés à défouler et canaliser quelque peu l'énorme mécontentement qui existe depuis des décennies dans la population et qui va croissant. La situation en Pologne l'illustre bien, mais celle qui se développe en URSS en constitue une autre manifestation : par exemple, l'explosion actuelle des nationalismes, que le relâchement de l'emprise du pouvoir central a favorisé, constitue une menace grandissante pour ce pays. De même, c'est la cohésion de l'ensemble du bloc de l'Est qui est aujourd'hui affectée : les déclarations hystériques des partis "frères" d'Allemagne de l'Est et de Tchécoslovaquie contre les "assassins du marxisme" et les "révisionnistes' qui sévissent en Pologne et en Hongrie ne sont pas du cinéma ; elles rendent compte des clivages qui sont en train de se développer entre ces différents pays.
La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est donc nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un "redressement" de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents.
Ainsi la plupart des événements qui se sont déroulés cet été nous renvoient l'image d'un monde qui, de toutes parts, s'enfonce dans la barbarie : affrontements militaires, massacres, répressions, convulsions économiques et politiques. Cependant, dans le même moment, s'est exprimé de façon extrêmement significative la seule force qui puisse offrir un autre avenir à la société : le prolétariat. Et c'est justement en URSS qu'il s'est manifesté de façon massive.
URSS : LA CLASSE OUVRIERE AFFIRME SA LUTTE
Les luttes prolétariennes qui, à partir de la mi-juillet et durant plusieurs semaines, ont paralysé la plupart des mines du Kouzbass, du Donbass et du grand nord sibérien, mobilisant plus de 500 000 ouvriers, revêtent une importance historique considérable. De très loin, elles constituent le mouvement le plus massif du prolétariat en URSS depuis la période révolutionnaire de 1917. Mais surtout, dans la mesure même où elles ont été menées par le prolétariat qui avait subit le plus durement et profondément la terrible contre-révolution, longue de quatre décennies, qui s'était déchaînée à l'échelle mondiale à la fin des années 20, elles sont une confirmation lumineuse du cours historique actuel : la perspective ouverte par la crise aiguë du capitalisme n'est pas celle d'une nouvelle guerre mondiale mais celle des affrontements de classe.
Ces luttes n'ont pas eu l'ampleur de celles de Pologne en 1980, m même de beaucoup de celles qui se sont développées dans les pays centraux du capitalisme depuis 1968. Cependant, pour- un pays comme 1’URSS, où pendant plus d'un demi-siècle, face à des conditions de vie intenables, les ouvriers ne pouvaient, à de rares exceptions près, que se taire, la rage au ventre, elles ouvrent une nouvelle perspective pour le prolétariat de ce pays. Elles font la preuve que même dans la métropole du "socialisme réel", face à la répression mais aussi face à tous les poisons du nationalisme et des campagnes démocratiques, les ouvriers peuvent s'exprimer sur leur terrain de classe.
Elles ont aussi fait la preuve, comme ce fut déjà le cas en Pologne en 80, de ce dont est capable le prolétariat lorsque, ne sont pas présentes les forces classiques d'encadrement de ses luttes, les syndicats. L'extension rapide du mouvement d'un centre minier à l'autre avec l'envoi de délégations massives, la prise en charge collective du combat par les assemblées générales, l'organisation de meetings et de manifestations de masse dans la rue, dépassant la séparation en entreprises, l'élection de comités de grève par les assemblées et responsables devant elles, voilà les formes élémentaires de lutte que se donne spontanément la classe dès lors que le terrain n'est pas occupé, ou qu'il l'est faiblement, par les professionnels du sabotage.
Face à l'ampleur et à la dynamique du mouvement, et pour éviter son extension à d'autres secteurs, les autorités n'ont eu d'autre remède que d'accepter, sur le moment, les revendications mises en avant par les ouvriers. Il est clair cependant que la plupart de ces revendications ne seront jamais réellement satisfaites : la catastrophe économique dans laquelle s'enfonce l'URSS ne le permet absolument pas. Les seules revendications qui risquent de ne pas être remises en cause sont justement celles qui révèlent les limites du mouvement : "l'autonomie" des entreprises permettant à celles-ci de fixer le prix du charbon et de vendre sur le marché intérieur et mondial ce qui n'aura pas été prélevé par l'Etat. De la même façon que, en 1980, la constitution d'un syndicat "libre" en Pologne était un piège qui s'est rapidement refermé sur la classe ouvrière, cet "acquis", la fixation des prix du charbon par les entreprises, va très vite se transformer en un moyen de renforcer l'exploitation des mineurs et de provoquer des divisions entre eux et les autres secteurs du prolétariat qui devront payer plus cher le charbon cour se chauffer. Ainsi, les combats considérables des ouvriers des mines en URSS constituent aussi, au même titre que ceux de Pologne en 80, une illustration de la faiblesse politique du prolétariat des pays de l'Est Dans cette partie du monde, malgré tout le courage et toute la combativité qu'elle est amenée à manifester face à des attaques d'une ampleur sans précédent, la classe ouvrière est encore extrêmement vulnérable face aux mystifications bourgeoises syndicalistes, démocratiques, nationalistes et même religieuses (si on prend le cas de la Pologne). Enfermés pendant des décennies dans le silence par la terreur policière, les ouvriers de ces pays manquent cruellement d'expérience face à ces mystifications et ces pièges. De ce fait, les convulsions politiques qui régulièrement secouent ces pays, et qui les secoueront de plus en plus, sont la plupart du temps retournées contre leurs luttes, comme on a pu le voir en Pologne où l'interdiction de Solidarnosc entre 81 et 89 a servi à lui redorer un blason terni par ses nombreuses interventions comme "pompier social". C'est ainsi également que les revendications "politiques" des mineurs en URSS (démission des cadres locaux du parti, nouvelle constitution, etc.), ont pu être utilisées par la politique actuelle de Gorbatchev.
C'est pour ces raisons que les luttes qui se sont déroulées cet été en URSS constituent un appel à l'ensemble du prolétariat mondial, et particulièrement à celui des métropoles du capitalisme, là où sont concentrés ses bataillons les plus puissants et expérimentés. Ces luttes témoignent de la profondeur, de la force et de l'importance des combats actuels de la classe. En même temps, elles mettent en évidence toute la responsabilité du prolétariat de ces métropoles : seul son affrontement contre les pièges les plus sophistiqués que peut semer sur son chemin la bourgeoisie la plus forte et expérimentée du monde, seule la dénonciation par et dans la lutte de ces pièges permettra aux ouvriers des pays de l'Est de combattre victorieusement ces mêmes pièges. Les combats ouvriers qui se sont déroulés cet été aux Etats-Unis, dans la première puissance mondiale, au même moment que ceux qui secouaient la deuxième puissance, combats qui ont mobilisé plus de cent mille ouvriers dans les hôpitaux, les télécommunications et l'électricité, font la preuve que ce prolétariat des pays centraux poursuit son chemin sur cette voie. De même, la très forte combativité ouvrière qui s'est exprimée pendant plusieurs mois en Grande-Bretagne, notamment dans les transports et dans les docks, en se heurtant au sabotage syndical mis en place par la bourgeoisie la plus forte du monde sur le plan politique, constitue une autre étape de ce chemin.
FM, 7/9/89.
[1] [2] Sur la question de la crise économique voir la résolution sur la situation internationale du 8ème congrès du CCI ainsi que sa présentation.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [3]
Questions théoriques:
- Guerre [4]
Le 8eme congres international du CCI : les enjeux du congres
- 2415 reads
Le Courant Communiste International vient de tenir son 8ème congrès. Outre la présence de délégations des dix sections du CCI, des délégués du Grupo Proletario Internacionalista (GPI) du Mexique et de Communist Intemationalist (CI) d'Inde ont participé aux travaux du congrès. A travers leur participation active et enthousiaste, c'est de la périphérie du capitalisme, là où la lutte du prolétariat est la plus difficile, là où les conditions d'une activité militante communiste sont les plus défavorables, qu'est venu un souffle nouveau d'énergie et de confiance qui a animé toutes nos discussions et donné le ton au congrès. La délégation du GPI était mandatée pour poser l'adhésion des militants du groupe à notre organisation, adhésion que le congrès a discuté et accepté dès son ouverture. Nous y reviendrons plus loin. Ce congrès s'est tenu au moment où l'histoire s'accélère considérablement.
Le capitalisme conduit l'humanité à la catastrophe. Les conditions d'existence de l'immense majorité des êtres humains sont chaque jour plus dramatiques, les émeutes et les révoltes de la faim se multiplient, l'espérance de vie diminue pour des milliards d'hommes, les catastrophes de tout ordre causent des milliers de victimes, et les guerres des millions.
La situation de la classe ouvrière dans le monde, y compris dans les pays riches et développés de l'hémisphère nord, se dégrade constamment elle aussi, le chômage croît, les salaires baissent, les conditions de travail et de vie empirent. La classe ouvrière ne reste pas passive face à cela et, en essayant de résister pas à pas aux attaques économiques qui lui sont portées, elle développe ses luttes, son expérience et sa conscience. La dynamique de développement des luttes ouvrières s'est trouvée confirmée encore dernièrement par les grèves massives qui ont eu lieu cet été en Grande-Bretagne et en URSS. A 1’Ouest comme à l'Est, le prolétariat international lutte contre le capital.
Les enjeux sont clairs : le capitalisme nous mène à la chute encore plus brutale dans la catastrophe économique et dans la 3ème guerre mondiale. Seule la résistance du prolétariat, le développement de ses luttes, empêchent aujourd'hui, et peuvent empêcher demain, le déchaînement de l'holocauste généralisé et dégager pour l'humanité la perspective révolutionnaire du communisme.
Nous n'allons pas entrer ici dans les débats que nous avons menés au congrès sur la situation internationale. Nous renvoyons le lecteur à la résolution adoptée par le congrès et à sa présentation publiées dans ce numéro de la Revue Internationale. Disons simplement que le congrès devait confirmer la validité de nos orientations précédentes et leur accélération sur les trois volets de la situation internationale : crise économique, conflits inter-impérialistes, et lutte des classes. Il a permis de réaffirmer la validité et l'actualité de l'existence d'un cours historique vers des affrontements de classes : les dernières années n'ont pas vu la remise en cause de cette perspective ; le prolétariat, malgré ses faiblesses et ses difficultés, n'a pas subi de défaite majeure provoquant le renversement de ce cours historique et le cours à la guerre mondiale reste barrée pour le capitalisme. Plus précisément, le congrès devait confirmer la réalité et la continuation de la vague de luttes ouvrières qui se développe depuis 1983 au niveau international face aux mensonges et à la propagande de la bourgeoisie, face aux doutes, aux hésitations, au manque de confiance, et au scepticisme régnant actuellement parmi les groupes du milieu politique prolétarien.
Le GPI et CI se sont constitués autour, et sur nos analyses générales de la période actuelle, et en particulier, sur la reconnaissance du cours historique vers des affrontements de classes. Les interventions du délégué d'Inde et des nouveaux militants du CCI au Mexique se sont donc intégrées tout à fait dans la réaffirmation et la manifestation par l'ensemble du congrès de notre confiance dans la lutte du prolétariat, dans ses luttes actuelles. Là résidait un des enjeux du congrès. La résolution adoptée répond clairement à cet enjeu. Comme on peut le voir à sa lecture, le congrès a su aller plus loin encore dans la clarification des différentes caractéristiques de la période présente, et il a décidé d'ouvrir une discussion sur le phénomène de la décomposition sociale.
LA DEFENSE ET LE RENFORCEMENT DE L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE.
C'est dans le cadre de cette compréhension générale des enjeux historiques actuels que les organisations révolutionnaires qui sont à la fois le produit et aussi partie prenante des combats menés par le prolétariat mondial, doivent se mobiliser, se préparer et participer à la lutte historique de leur classe. Le rôle qui leur échoit est essentiel : sur la base de la compréhension la plus claire possible de la situation actuelle et de ses perspectives, il leur revient d'assumer dès aujourd'hui le combat politique d'avant-garde dans les luttes ouvrières.
Pour cela, les perspectives d'activités pour notre organisation que le congrès a dégagées, forment un tout avec l'analyse et la compréhension de la période historique actuelle. Après avoir tiré un bilan positif du travail militant accompli depuis le 7ème congrès, la résolution adoptée sur les activités réaffirme notre orientation précédente :
"Les activités du CCI pour les deux ans qui viennent doivent se mener en continuité avec les tâches entreprises depuis la reprise des combats de classe en 1983, tracées lors des deux précédents congrès de 1985 et 1987, suivant les priorités de l'intervention dans les luttes ouvrières, de la participation à leur orientation, et un engagement militant plus important, à long terme, face aux perspectives :
- de nouvelles intégrations issues de la vague actuelle de la lutte de classe, en premier lieu la constitution d'une nouvelle section territoriale, un des principaux enjeux à court terme pour le CCI ;
- d'un rôle déplus en plus important de l'organisation dans le processus des luttes ouvrières vers leur unification (...).
Les expériences les plus récentes de l'organisation ont permis en particulier de mettre en évidence plusieurs leçons qui doivent être pleinement intégrées dans les perspectives d'activités:
- la nécessité de mener le combat pour la tenue des assemblées générales ouvertes, qui se donnent dès le début l'objectif de l'élargissement de la lutte, de son extension géographique ;
- la nécessité de revendications unitaires, contre les surenchères démagogiques et les particularismes corporatistes ;
- la nécessité de ne pas être naïfs face à l'action de la bourgeoisie sur le terrain, pour pouvoir faire échec aux manoeuvres de confiscation de la lutte par les syndicats et les coordinations telles qu'elles se développent aujourd'hui ;
- la nécessité d'être au premier rang de l'intervention dans la constitution et l'action des comités de lutte (...)".
Dans la période actuelle, l'intervention dans les luttes ouvrières détermine tous les plans de l'activité d'une organisation révolutionnaire. Pour pouvoir mener à bien les tâches d'intervention, les révolutionnaires doivent pouvoir se doter d'organisations politiques centralisées solides. De tout temps, la question de 1’organisation politique et sa défense a été une question politique centrale. Les organisations communistes subissent la pression de l'idéologie bourgeoise, et aussi celle de la petite-bourgeoisie qui se manifeste par l'individualisme, le localisme, l'immédiatisme, etc., contre l'activité des organisations communistes. Cette pression devient encore plus forte sur les groupes communistes d'aujourd'hui par les effets de la décomposition sociale qui touche la société capitaliste. Comme le souligne la résolution sur les activités adoptée :
"La décomposition de la société bourgeoise, son pourrissement sur pied en l'absence d'une perspective d'issue immédiate exerce sa pression sur le prolétariat et ses organisations politiques (...)."
Cette pression accrue sur les groupes communistes rend la question de la défense de l'organisation révolutionnaire encore plus cruciale. C'est là le second volet de notre discussion au congrès sur les activités. La résolution réaffirme que, face à ce danger, "la force principale du CCI réside dans son caractère international, uni et centralisé". Dans ce sens, le congrès a engagé l'ensemble de l'organisation, des sections et des camarades à renforcer le tissu organisationnel, le travail collectif, à développer la centralisation internationale, à développer la rigueur dans le fonctionnement et l'implication militante. Il s'agit là de contrecarrer les effets particuliers d'aujourd'hui de la décomposition sur les groupes politiques révolutionnaires tels que le localisme, l'individualisme, voir les pratiques manoeuvrières et destructrices.
LA CONSTITUTION DE "REVOLUCION MUNDIAL" COMME NOUVELLE SECTION DU CCI.
Confiance dans la lutte du prolétariat, confiance dans le rôle et l'intervention des révolutionnaires, confiance dans le CCI : tels étaient les enjeux du congrès, avons-nous dit. La présence d'une délégation de CI, la demande d'intégration des camarades du Mexique, leurs interventions durant les débats, étaient l'illustration de leur propre confiance sur ces trois plans, situant les camarades dans la dynamique même du congrès. Au delà des textes, documents et résolutions adoptés, la manifestation la plus concrète de cette confiance par le congrès, fut l'adoption de la résolution d'intégration des camarades du GPI dans le CCI et la constitution d'une nouvelle section au Mexique. En voici les principaux extraits :
1- Produit du développement de la lutte de classe, le Grupo Proletario Internacionalista est un groupe communiste qui s'est constitué -avec la participation active du CCI- sur la base des positions politiques principielles du CCI et de ses orientations générales, en particulier celle de l'intervention dans la lutte des classes. (...)
2- Le 1er congrès du GPI a vu la ratification par tous ses militants (...) des positions politiques de classe développées par le groupe. En étroite relation avec le CCI, il a ouvert un processus de réappropriation et de clarification politiques, et dégagé les lignes principales pour l'établissement d'une présence politique conséquente du groupe au Mexique.
3- Un an plus tard, le 2ème congrès du GPI - ainsi que le CCI
- a tiré un bilan positif de ce processus de clarification politique. Le groupe a su en effet :
- prendre connaissance, se confronter et prendre position sur les différents courants et groupes du milieu politique prolétarien ;
- défendre les positions programmatiques, théoriques et politiques du CCI ;
- développer les mêmes orientations d intervention dans les luttes ouvrières et le milieu politique prolétarien que le CCI ;
- assumer une présence politique tant au niveau local qu'international ;
- avoir une vie politique interne vivante, intense et fructueuse.
4- C'est avec succès que le 2ème congrès du GPI a affronté et dépassé les faiblesses conseillistes du groupe qui s'étaient exprimées dans le processus de clarification politique :
- au plan théorique, par l'adoption unanime d'une position correcte sur la question de la conscience de classe et du parti ;
- au plan politique, par la demande unanime d'ouverture d'un processus d'intégration dans le CCI de ses militants que le (CCI) a accueillie favorablement.
5- Sept mois plus tard, le Sème congrès du CCI tire un bilan positif de ce processus d'intégration. C'est à l'unanimité que les camarades du GPI se sont prononcés en accord avec la Plate-forme du CCI et ses statuts après des débats approfondis. Par ailleurs, le GPI a maintenu les tâches d'une véritable section du CCI depuis l'ouverture de ce processus par une correspondance régulière et fréquente, des prises de position dans les débats du CCI, l'intervention dans la lutte de classes, la publication régulière de Revolucion Mundial
6- Le 8ème congrès du CCI (...), conscient des difficultés d'intégration pour l'organisation d'un ensemble de militants dans un pays relativement isolé, estime donc que le processus de rapprochement et d'intégration des camarades du GPI avec le CCI touche à son terme. En conséquence, le congrès se prononce pour l'intégration des militants du GPI dans l'organisation et leur constitution en section du CCI au Mexique."
Après la décision du congrès, la délégation, comme le précisait son mandat fixé par le GPI, a déclaré dissout ce dernier. A partir de ce moment, bien évidemment, les délégués sont intervenus dans le congrès comme délégués de la nouvelle section au Mexique, Revolucion Mundial, comme membres à part entière du CCI. Par le haut niveau de clarté politique qui s'est exprimé dans la préparation au congrès et dans la participation énergique et importante de sa délégation, la constitution de la section manifeste un renforcement considérable du CCI au niveau politique et au niveau de sa présence consolidée sur le continent américain.
UN RENFORCEMENT DU MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN.
Cette dynamique de clarification politique, vers l'engagement militant, de regroupement, en particulier avec le CCI, n'est pas le seul fait des camarades de RM. A l'issue du congrès, le délégué de CI, groupe avec lequel nous sommes en étroit contact depuis plusieurs années, a posé sa candidature à notre organisation, candidature que nous avons acceptée. Cette intégration et la publication de Communist Internationalist comme organe du CQ en Inde signifie la perspective d'une présence politique, d'une douzième section de notre organisation, dans un pays et sur un continent, l'Asie, où les forces révolutionnaires sont pratiquement inexistantes, et où le prolétariat, malgré une grande combativité comme en Inde justement, est peu concentré et a peu d'expérience historique et politique. A vrai dire, ce processus de rapprochement et d'intégration au CCI n'est pas propre aux pays de la périphérie. Nous constatons, et nous y participons aussi, un renouveau des contacts et une dynamique vers l'engagement militant en Europe même, là où le CCI, et les principaux groupes et courants communistes, sont déjà présents.
Soyons clairs : même si ces intégrations et cette dynamique au renforcement militant nous enthousiasment, il ne s'agit pas pour nous de faire ici du triomphalisme. Nous sommes bien trop conscients des enjeux historiques, des difficultés du prolétariat et des faiblesses des forces révolutionnaires.
Pour le CCI qui, depuis sa fondation, a toujours revendiqué et travaillé afin d'assumer les tâches d'un véritable pôle international de référence et de regroupement politiques, ces nouvelles adhésions sont un succès. Elles sont la confirmation de la justesse de ses positions politiques, valables aussi bien dans les pays développés que de la périphérie, sur tous les continents, et de l'orientation de son intervention en direction du milieu politique prolétarien. Mais aussi, et nous en sommes extrêmement conscients, elles nous posent des responsabilités accrues : d'une part, réussir complètement ces intégrations et, d'autre part, une plus grande responsabilité militante encore face au prolétariat mondial.
Le surgissement d'éléments et de groupes politiques dans les pays de la périphérie (Inde, Amérique Latine), l'apparition d'une nouvelle génération de militants, sont le produit de la période historique, le produit des luttes ouvrières d'aujourd'hui. C est d'ailleurs, nous l'avons vu, essentiellement sur la reconnaissance plus ou moins claire du cours historique vers des affrontements de classes, de la réalité de la vague de luttes actuelles que ces éléments et groupes se constituent.
La question du cours historique est la question centrale qui "sépare" les groupes du milieu politique prolétarien. Au delà des différences programmatiques existantes, c'est elle qui détermine aujourd'hui la dynamique dans laquelle se situent les différents courants et groupes : soit vers l'intervention dans les luttes, dans le milieu révolutionnaire, vers la discussion et la confrontation politiques, et, à son terme, le regroupement ; soit le scepticisme devant les luttes, le refus et la peur de l'intervention, le repli sectaire, la dispersion, le découragement et la sclérose.
La reconnaissance du développement des luttes ouvrières, et la volonté d'intervention des révolutionnaires en leur sein, est à la base de la capacité des groupes révolutionnaires à faire face aux responsabilités qui sont les leurs : dans les luttes ouvrières elles-mêmes bien sûr ; mais aussi face aux éléments et groupes qui surgissent de par le monde; face à la nécessité de développer des organisations centralisées et militantes pouvant jouer un rôle de référence et de regroupement.
Le renforcement du CCI représente, à notre avis, un renforcement de tout le milieu politique prolétarien. Ce sont les premiers regroupements, réels et significatifs, depuis une décennie, en fait depuis la constitution de la section du CCI en Suède. Ils marquent un coup d'arrêt à la multiplication des scissions, à la dispersion et à la perte de forces militantes. Pour tous les groupes politiques prolétariens, pour tous les éléments révolutionnaires qui surgissent, ce doit être un élément de confiance dans la situation actuelle et d'appel au sérieux et à la responsabilité militante.
L'HISTOIRE ACCELERE SUR TOUS LES PLANS.
Par la réaffirmation de sa confiance dans les luttes ouvrières actuelles, sa conviction dans leur développement au cours de la période qui vient, par la réaffirmation de l'orientation vers l'intervention dans ces luttes, par le renforcement encore du cadre centralisé et international du CCI en vue de sa défense, par l'intégration de nouveaux camarades et la constitution d'une nouvelle section "Revolucion Mundial" et la publication de Communist Intemationalist, nous pouvons d'ores et déjà tirer un bilan positif du 8ème congrès du CCI, véritable congrès "mondial avec la participation de camarades d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
L'histoire s'accélère.
C'est dans ce cadre historique que le congrès a réussi à se situer. Le 8ème congrès du CCI aura été à la fois un produit de cette accélération de l'histoire, et n'en doutons pas, un moment et un facteur de celle-ci.
"Dans les épreuves de l'histoire, les tâches du prolétariat moderne sont aussi gigantesques que ses erreurs. Il n'existe pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer les voies sur lesquelles il doit s'engager. Il n'a d'autre maître que l'expérience historique. Le chemin de croix de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait tirer enseignement de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l'autocritique, une autocritique impitoyable, cruelle, allant jusqu'au bout des choses, c'est l'air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre."
Rosa Luxemburg. La crise de la social-démocratie.
"Ce n'est qu'en période révolutionnaire, où les fondements sociaux et quand les murailles de la société de classes se lézardent et se disjoignent continuellement, que toute action politique de classe entamée par le prolétariat peut, en quelques heures, arracher à leur immobilité des couches de la classe ouvrière, jusque là inertes."
Rosa Luxemburg, Grève de masses, parti et syndicats, 1906.
Conscience et organisation:
8ème Congrès du CCI : la situation internationale
- 2950 reads
PRESENTATION DE LA RESOLUTION
Nous publions dans ce numéro la résolution sur la situation internationale adoptée par le 8ème Congrès du CCI. Cette résolution se base sur un rapport très détaillé dont la longueur ne nous permet pas de le publier dans ce numéro de la Revue. Cependant, compte tenu du caractère synthétique de cette résolution, nous avons estimé utile de la faire précéder par des extraits, non du rapport lui-même, mais de la présentation qui en a été faite au Congrès-même, extraits que nous avons accompagnés d'un certain nombre de données prélevées dans le rapport.
Habituellement, le rapport pour un congrès tend compte de l'évolution de la situation depuis le congrès précédent. En particulier, il examine dans quelle mesure les perspectives qui avaient été dégagées deux ans auparavant se sont vérifiées. Pour sa part, le présent rapport ne se contente pas de prendre en compte les deux dernières années. Il se propose de faire un bilan pour l'ensemble des années 80, celles que nous avons appelées "les années de vérité".
Pourquoi un tel choix ?
Parce qu'au début de la décennie, nous avions annoncé que celle-ci allait représenter tout un tournant dans l'évolution de la situation internationale. Un tournant entre :
- une période où la bourgeoisie avait encore tenté de masquer à la classe ouvrière -et à elle-même- la gravité des convulsions de son système ;
- et une période où ces convulsions allaient atteindre un tel niveau, qu'elle ne pourrait plus cacher comme auparavant l'impasse où se trouve le capitalisme, une période où cette impasse s'afficherait toujours plus aux yeux de l'ensemble de la société.
Cette différence entre ces deux périodes devait évidemment se répercuter sur tous les aspects de la situation mondiale. Elle devait en particulier souligner le niveau des enjeux présents des combats de la classe ouvrière.
Pour le présent Congrès, qui est le dernier congrès des années 80, il était donc important de vérifier la validité de cette orientation générale que nous avions adoptée il y a dix ans. Il importait notamment de mettre en évidence qu'à aucun moment cette orientation n'avait été démentie, en particulier face aux doutes et fluctuations qui peuvent exister dans l'ensemble du milieu politique prolétarien et qui tendent à sous-estimer les enjeux de la période présente, et particulièrement l'importance des combats de la classe ouvrière.
Quels sont les points qu'il convient de souligner particulièrement pour ce Congrès ?
SUR LA CRISE ECONOMIQUE
Il est indispensable que le congrès parvienne à une pleine clarté sur ce sujet. En particulier, avant même de dégager les perspectives catastrophiques de l'évolution du capitalisme dans les années qui viennent, il importe de mettre en évidence toute la gravité de la crise telle qu'elle s'est déjà manifestée jusqu'à présent.
Pourquoi est-il nécessaire de faire un tel bilan ?
1°) Pour une première raison évidente : notre capacité à dégager les perspectives futures du capitalisme dépend étroitement de la validité du cadre d'analyse que nous nous sommes donné pour analyser la situation passée.
2e) Parce que, et c'est également une évidence, de l'évaluation correcte de la gravité actuelle de la crise dépend, pour une large part, notre capacité à nous prononcer sur les réels enjeux et potentialités des luttes présentes de la classe ouvrière, notamment face aux sous-estimations qui existent dans le milieu politique.
3°) Parce qu'il a pu exister, dans l'organisation, des tendances à sous-estimer la gravité réelle de l'effondrement de l'économie capitaliste en se basant de façon unilatérale sur l'évolution des indicateurs fournis habituellement par la bourgeoisie tels que le "Produit National Brut" ou le volume du marché mondial.
Une telle erreur peut être très dangereuse. Elle pourrait nous conduire à nous enfermer dans une vision similaire à celle de Vercesi ([1] [6]), à la fin des années 30, qui prétendait que le capitalisme avait désormais surmonté sa crise. Cette vision se basait sur l'accroissement des chiffres bruts de la production sans se préoccuper DE QUOI était faite cette production (en réalité, principalement des armements) ni se demander QUI allait la payer.
C'est justement pour cette raison que le rapport, de même que la résolution, base son appréciation de l'aggravation considérable de la crise capitaliste tout au long des années 80, non pas tant sur ces chiffres (qui eux semblent indiquer une "croissance", en particulier ces dernières années) mais sur toute une série d'autres éléments qui, pris ensemble, sont beaucoup plus significatifs. Il s'agit des éléments suivants :
- l'accroissement vertigineux de l'endettement des pays sous-développés, mais aussi de la première puissance mondiale de même que des administrations publiques de tous les pays ;
- la progression continue des dépenses d'armement, mais également de l'ensemble des secteurs improductifs tels que, par exemple, le secteur bancaire, et cela au détriment des secteurs productifs (production de biens de consommation et de moyens de production) ;
- l'accélération du processus de désertification industrielle qui fait disparaître des pans entiers de l'appareil productif et jette dans le chômage des millions d'ouvriers ;
- l'énorme aggravation du chômage tout au long des années 80 et, plus généralement, le développement considérable de la lunpénisation absolue au sein de la classe ouvrière des pays es plus avancés ;
Sur ce point, il vaut la peine de faire un commentaire pour dénoncer les campagnes actuelles de la bourgeoisie sur l'idée que la situation serait en train de s'améliorer aux Etats-Unis. Les chiffres que donne le rapport soulignent le réel appauvrissement de la classe ouvrière dans ce pays. Mais il faut attirer l'attention du Congrès sur le rapport adopté par la section des USA lors de sa dernière conférence (voir Supplément au n°64 d’Internationalism). Ce dernier rapport met clairement en évidence que les chiffres bourgeois sur le prétendu recul du chômage au niveau de celui des années 70 essaient en réalité de masquer une aggravation tragique de la situation : en fait le taux réel du chômage est environ trois fois supérieur au taux officiel.
- enfin une des manifestations fondamentales de l'aggravation des convulsions de l'économie capitaliste est constituée par une nouvelle aggravation des calamités qui frappent les pays sous-développés, la malnutrition, les famines qui font toujours plus de victimes, des calamités qui ont transformé ces pays en un véritable enfer pour des milliards d'êtres humains.
En quoi faut-il considérer ces différents phénomènes comme des manifestations très significatives de l'effondrement de l'économie capitaliste ?
Pour ce qui concerne l'endettement généralisé, nous avons là une expression claire des causes profondes de la crise capitaliste : la saturation générale des marchés. Faute de réels débouchés solvables, à travers lesquels pourrait se réaliser la plus-value produite, la production est écoulée en grande partie sur des marchés fictifs.
On peut prendre trois exemples :
1°) Pendant les années 70, on a assisté à une augmentation sensible des importations des pays sous-développés. Les marchandises achetées provenaient principalement des pays avancés, ce quia permis de relancer momentanément la production dans ces pays. Mais comment étaient payés ces achats ? Par des emprunts contractés par les pays sous-développés acheteurs auprès de leurs fournisseurs (voir tableau 1). Si les pays acheteurs payaient réellement leurs dettes, alors on pourrait considérer que ces marchandises ont été réellement vendues, que la valeur qu'elles contenaient a été effectivement réalisée. Mais nous savons tous que ces dettes ne seront jamais remboursées ([2] [7]). Cela signifie que, globalement, ces produits ont été vendus non pas contre un paiement réel, mais contre des promesses de paiement, des promesses qui ne seront jamais tenues. Nous disons globalement, parce que, pour leur part, les capitalistes qui ont effectué ces ventes peuvent avoir été payés. Mais cela ne change pas le fond du problème. Ce que ces capitalistes ont encaissé avait été avancé par des banques ou des Etats qui, eux, ne seront jamais remboursés. C'est bien là que réside la signification profonde de toutes les négociations actuelles (désignées par le terme de "plan Brady") visant à réduire de façon significative l'endettement d'un certain nombre de pays sous-développés, à commencer par le Mexique (pour éviter que ces pays ne se déclarent ouvertement en faillite et cessent tout remboursement). Ce "moratoire" sur une partie des dettes veut dire qu'il est officiellement prévu, dès à présent, que les banques ou les pays prêteurs ne récupéreront pas la totalité de leur mise.
2°) Un autre exemple est celui de l'explosion de la dette extérieure des Etats-Unis. En 1985, pour la première fois depuis 1914, ce pays est devenu débiteur vis à vis du reste du monde. C'était un événement considérable, d'une importance au moins équivalente au premier déficit commercial de ce pays depuis la première guerre mondiale en 1968 et, en 1971, à la première dévaluation du dollar depuis 1934. Le fait que la première puissance économique de la planète, après avoir été pendant des décennies le financier du monde, se retrouve dans un situation digne d'un quelconque pays sous-développé ou d'une puissance de second ordre, comme par exemple la France, en dit long sur l'état de dégradation de l'ensemble de l'économie mondiale et traduit un degré supplémentaire dans l'effondrement de celle-ci.
Fin 1987, la dette extérieure nette (total des dettes moins total des créances) des Etats-Unis se montait déjà à 368 milliards de dollars (soit 8,1% du PNB). Le champion du monde de la dette extérieure n'était donc plus le Brésil : l'Oncle Sam faisait déjà trois fois mieux. Et la situation n'est pas près de s'arranger dans la mesure où le principal responsable de cet endettement, le déficit de la balance commerciale se maintient à des niveaux considérables. D'ailleurs, même si ce déficit se résorbait miraculeusement, la dette extérieure américaine ne cesserait de s'accroître dans la mesure où, comme un quelconque pays d'Amérique latine, les Etats-Unis devraient continuer à emprunter pour être en mesure de verser les intérêts et rembourser le principal de leur dette. De plus, le solde du revenu des investissements américains à l'étranger et des investissements étrangers aux Etats Unis, qui était encore positif de 20,4 milliards de dollars en 1987, ce qui limitait les conséquences financières du déficit de la balance commerciale, est devenu négatif en 1988 et poursuivra son effondrement dans les années suivantes (voir le tableau 2).
Sur la base de ces projections, la dette extérieure des Etats-Unis est donc destinée à s'accroître de façon très importante dans l'avenir : elle devrait atteindre 1000 milliards de dollars en 1992 et 1400 milliards de dollars en 1997. Ainsi, au même titre que la dette des pays sous-développés, la dette américaine n'a pas la moindre perspective de remboursement.
3°) Le dernier exemple est celui des déficits budgétaires, de l'accumulation des dettes de tous les Etats à un niveau astronomique (voir les tableaux 3 et 4). Nous avons déjà mis en évidence, lors des précédents congrès, que ce sont en grande partie ces déficits, et particulièrement le déficit fédéral des Etals-Unis, qui ont permis une relance timide de la production à partir de 83. C'est de nouveau le même problème. Ces dettes, elles non plus, ne seront jamais remboursées, sinon contre de nouvelles dettes encore plus astronomiques (le tableau 3 met ainsi en évidence que le simple intérêt de ces dettes dépasse déjà largement les 10% des dépenses de l'Etat dans la plupart des pays avancés : ce poste est en passe de devenir le premier dans les budgets nationaux). Et la production achetée par ces déficits, principalement des armements d'ailleurs, ne sera, elle non plus, jamais réellement payée.
En fin de compte, pendant des années, une bonne partie de la production mondiale n'a pas été vendue mais tout simplement donnée. Cette production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est donc pas une production de valeur, c'est-à-dire la seule chose qui intéresse le capitalisme. Elle n'a pas permis une réelle accumulation de capital. Le capital global s'est reproduit sur des bases de plus en plus étroites. Pris comme un tout, le capitalisme ne s est donc pas enrichi. Au contraire, il s'est appauvri.
Et le capitalisme s'est appauvri d'autant plus qu'on a vu s'accroître à des niveaux ahurissants la production d'armements, de même d'ailleurs que l'ensemble des dépenses improductives (voir tableau 5).
Les armes ne doivent pas être comptabilisées avec un signe "plus" dans le bilan général de la production mondiale, mais au contraire avec un signe "moins". Car contrairement à ce que Rosa Luxemburg avait pu écrire en 1912, dans "L'accumulation du capital", et à ce qu'affirmait Vercesi à la fin des années 30, le militarisme n'est nullement un champ d'accumulation pour le capital. Les armes peuvent enrichir les marchands de canons mais nullement le capitalisme comme un tout puisqu’elles ne peuvent pas s'incorporer dans un nouveau cycle de production. Au mieux, quand elles ne servent pas, elles constituent une stérilisation de capital. Et quand elles servent, elles aboutissent à une destruction de capital.
Ainsi, pour se faire une idée véritable de l'évolution de l'économie mondiale, pour rendre compte de la valeur réellement produite, il faudrait retrancher des chiffres officiels sensés représenter la production (indicateurs du PNB par exemple) les chiffres de l'endettement de la période considérée, de même que les chiffres correspondant aux dépenses d'armement et à l'ensemble des dépenses improductives. Pour ce qui concerne les Etats-Unis, par exemple, sur la période 1980-87, le seul accroissement de l'endettement de l'Etat est plus élevé que la croissance du PNB : 2,7% du PNB pour l'accroissement de l'endettement contre 2,4% de croissance du PNB en moyenne annuelle. Ainsi, pour la décennie qui s'achève, la seule prise en compte des déficits budgétaires nous indique déjà une régression de la première économie mondiale. Régression qui est bien plus importante dans la réalité, du fait :
l°) des autres endettements (extérieur, entreprises, particuliers, administrations locales, etc.) ;
2°) des énormes dépenses improductives.
En fin de compte, même si nous ne disposons pas des chiffres exacts permettant de calculer au niveau mondial le réel déclin de la production capitaliste, on peut conclure du simple exemple précédent, la réalité de cet appauvrissement global de la société que nous évoquions.
Un appauvrissement considérable au cours des années 80.
C'est uniquement dans ce cadre - et non pas en faisant de la stagnation ou du recul du PNB la manifestation par excellence de la crise capitaliste - que Ton peut comprendre la signification réelle des "taux de croissance exceptionnels" dont s'est félicitée la bourgeoisie ces deux dernières années. En réalité, si l'on retranchait de ces formidables "taux de croissance" affichés par la bourgeoisie tout ce qui est stérilisation de capital et endettement nous aurions une croissance nettement négative. Face à un marché mondial de plus en plus saturé, une progression des chiffres de la production ne peut correspondre qu'à une nouvelle progression des dettes. Une progression encore plus considérable que les précédentes. ,
C'est donc en constatant la réalité d'un réel appauvrissement de l'ensemble de la société capitaliste, une destruction réelle de capital tout au long des années 80, que l'on peut comprendre les autres phénomènes qui sont analysés dans le rapport.
Ainsi la désertification industrielle constitue une illustration flagrante de cette destruction de capital. Le tableau 6 nous donne une idée chiffrée de ce phénomène qui, de façon concrète, se traduit par le dynamitage ou la mise à la casse d'usines à peine construites, par les paysages de désolation, de terrains vagues sordides et de ruines, dans lesquels se sont transformées certaines zones industrielles, et surtout par les licenciements massifs d'ouvriers. Par exemple, ce tableau nous indique qu'aux Etats-Unis, entre 1980 et 1986, les effectifs ont diminué de 1,35 millions dans l'industrie alors qu'ils augmentaient de 3,71 millions dans le secteur du commerce-hôtels-restaurants et de 3,99 millions dans le secteur finances-assurances-affaires. La prétendue "diminution du chômage", dont la bourgeoisie de ce pays fait aujourd'hui ses choux gras, n'a nullement permis une amélioration des capacités productives réelles de l'économie américaine : en quoi la "reconversion" d'un ouvrier qualifié de la métallurgie en vendeur de "hot dogs" est-elle positive pour l'économie capitaliste, sans parler du travailleur lui-même ?
De même, la progression du chômage réel, la paupérisation absolue de la classe ouvrière et la plongée des pays sous-développés dans le dénuement le plus total (dont l'article de la Revue Internationale n°57, "Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme", nous donne un tableau impressionnant) sont les manifestations de cet appauvrissement global du capitalisme, de l'impasse historique de ce système ([3] [8]), un appauvrissement que la classe dominante fait payer aux exploités et aux masses misérables.
C'est pour cela que la prétendue "croissance" dont se vante la bourgeoisie depuis 83 a été accompagnée d'attaques sans précédent contre la classe ouvrière. Ces attaques ne sont évidemment pas l'expression d'une "méchanceté" délibérée de la bourgeoisie, mais bien la manifestation de l'effondrement considérable qu'a connu l'économie capitaliste au cours de ces années. Un effondrement dont les tricheries bourgeoises avec les lois du capitalisme, le renforcement des politiques de capitalisme d'Etat à l'échelle des blocs, la fuite en avant dans l'endettement, ont permis qu'il n'apparaisse de façon trop évidente sous la forme d'une récession ouverte.
Une remarque sur cette question de la "récession". Dans un souci de plus grande clarté, la résolution désigne par "récession ouverte" le phénomène de stagnation ou de recul des indicateurs capitalistes eux-mêmes qui mettent ouvertement en évidence la réalité de ce que la bourgeoisie essaye de cacher, et de se cacher : l'effondrement de la production de valeurs. Cet effondrement, pour sa part, et comme l'établit le rapport, se poursuit même dans les moments qualifiés de "reprise" par la bourgeoisie. C'est ce dernier phénomène que la résolution désigne par le terme de "récession".
En conclusion de cette partie sur la crise économique, il faut souligner une nouvelle fois très clairement l'aggravation considérable de la crise du capitalisme, et des attaques contre la classe ouvrière, tout au long des années 80, confirmant sans aucune ambiguïté la validité de la perspective que nous avions tracée il y a dix ans. De même, il faut souligner que cette situation ne pourra que s'aggraver à une échelle encore bien plus considérable dans la période qui vient, du fait de l'impasse totale dans laquelle se trouve le capitalisme aujourd'hui.
SUR LES CONFLITS IMPERIALISTES
Sur cette question, qui n'a pas soulevé de débats importants, la présentation sera très brève et va se résumer à la réaffirmation lapidaire de quelques idées de base :
1°) C'est uniquement en s'appuyant fermement sur le cadre du marxisme que l'on peut comprendre l'évolution réelle des conflits impérialistes : au delà de toutes les campagnes idéologiques, l'aggravation de la crise du capitalisme ne peut conduire qu'à une intensification des antagonismes réels entre les blocs impérialistes.
2°) Manifestation de cette intensification, l'offensive du bloc US, par les succès qu'elle a remportés, permet d'expliquer l'évolution récente de la diplomatie de l'URSS et le désengagement de cette puissance d'un certain nombre de positions qu'elle ne pouvait plus tenir.
3°) Cette évolution diplomatique ne signifie donc nullement que s'ouvre une période d'atténuation des antagonismes entre grandes puissances, bien au contraire, ni que soient éteints, à l'heure actuelle, les conflits qui ont ravagé de nombreux points de la planète ces dernières années. En de nombreux endroits la guerre et les massacres se poursuivent et peuvent s'intensifier d'un jour à l'autre, semant toujours plus de cadavres et de calamités.
4°) Dans les campagnes pacifistes actuelles, un des éléments déterminants est la nécessité pour l'ensemble de la bourgeoisie de masquer à la classe ouvrière les véritables enjeux de la période présente à un moment où se développent ses luttes.
L'EVOLUTION DE LA LUTTE DE CLASSE
Ce que se propose de faire essentiellement la présentation, c'est d'expliciter le bilan global de la lutte de classe au cours des années 80.
Pour donner les grandes lignes d'un tel bilan, pour rendre compte du chemin parcouru, il est nécessaire de voir brièvement où en était le prolétariat au début de la décennie.
Le début des années 80 est marqué par le contraste entre, d'une part, l'affaiblissement de la lutte du prolétariat des grandes concentrations ouvrières des pays avancés du bloc de l'Ouest, en particulier d'Europe occidentale, faisant suite aux grands combats de la seconde vague de luttes en 1978-79 et, d'autre part, les formidables affrontements de Pologne de l'été 80, qui constituent le point culminant de cette vague. Cet affaiblissement de la lutte des bataillons décisifs du prolétariat mondial est dû en grande partie à la politique de la gauche dans l'opposition mise en place par la bourgeoisie dès le début de cette deuxième vague de luttes. Cette nouvelle carte bourgeoise a surpris la classe ouvrière et a, en quelque sorte, brisé son élan. C est pour cela que les combats de Pologne se déroulent dans un contexte général défavorable, dans une situation d'isolement international. C'est une situation qui évidemment facilite d'autant leur dévoiement sur les terrains du syndicalisme, des mystifications démocratiques et nationalistes ; qui facilite par conséquent la brutale répression de décembre 81. En retour, la défaite cruelle subie par le prolétariat en Pologne ne peut qu'aggraver pour un temps la démoralisation, la démobilisation et le désarroi du prolétariat des autres pays. Elle permet en particulier de redorer de façon très sensible le blason du syndicalisme à l'Est et à l'Ouest. C'est pour cela que nous avons parlé de défaite et de recul de la classe ouvrière," non seulement sur le plan de sa combativité, mais aussi sur le plan idéologique.
Cependant, ce recul est de courte durée. Dès l'automne 83, se développe une 3ème vague de luttes, une vague particulièrement puissante qui met en évidence la combativité intacte du prolétariat, et qui se distingue par le caractère massif et simultané des luttes.
Face à cette vague de luttes ouvrières, la bourgeoisie déploie en beaucoup d'endroits une stratégie de dispersion des attaques destinée à émietter les luttes, stratégie accompagnée d'une politique d'immobilisation menée par les syndicats là où ils sont les plus déconsidérés. Mais dès le printemps 86, les combats généralisés du secteur public, en Belgique, de même que la grève des chemins de fer de décembre en France, mettent en évidence les limites d'une telle stratégie du fait même de l'aggravation considérable de la situation économique qui contraint la bourgeoisie à mener des attaques de plus en plus frontales. La question essentielle que posent désormais, et pour toute une période historique, ces expériences de la classe et le caractère même des attaques capitalistes, est celle de l'unification des luttes. C'est-à-dire une forme de mobilisation qui ne se contente pas de la simple extension mais où la classe prendra en main directement celle-ci à travers ses assemblées générales en vue de constituer un front uni face à la bourgeoisie. ([4] [9])
Face à ces nécessités et potentialités de la lutte, il est évident que la bourgeoisie ne reste pas inactive. Elle déploie d'une manière encore plus systématique qu'auparavant les armes classiques de la gauche dans l'opposition :
- la radicalisation des syndicats classiques,
- la mise en avant du syndicalisme de base,
- la politique consistant pour ces organes à prendre les devants afin de mouiller la poudre.
Mais de plus, elle utilise, notamment là où le syndicalisme est le plus déconsidéré, des armes nouvelles telles les coordinations, qui complètent où précèdent le travail du syndicalisme. Enfin, elle utilise en de nombreux pays le poison du corporatisme visant notamment à enfermer les ouvriers dans un faux choix entre "l'élargissement avec les syndicats" et le repliement "auto-organisé" sur le métier.
Cet ensemble de manoeuvres a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats. Cela ne veut pas dire que soit remise en cause la dynamique des luttes ouvrières dans la mesure même où la radicalisation des manoeuvres bourgeoises est, au même titre que toutes les campagnes médiatiques actuelles, pacifistes et autres, un signe du développement des potentialités vers de nouveaux combats de bien plus grande envergure et beaucoup plus conscients.
En ce sens, le bilan global qu'il faut tirer des années 80 est celui, non pas d'une quelconque stagnation de la lutte de classe, mais bien d'une avancée décisive. Cette avancée, elle s'exprime notamment dans le contraste existant entre le début des années 80, qui voit un renforcement momentané du syndicalisme, et la fin de cette période où, comme le disent les camarades de WR, "la bourgeoisie manoeuvre pour imposer des structures "anti-syndicales" dans les luttes de la classe ouvrière".
Le rapport, par ailleurs, explicite le cadre historique dans lequel se développe aujourd'hui la lutte du prolétariat, cadre qui explique le rythme lent de ce développement, de même que les difficultés sur lesquelles s'appuie systématiquement la bourgeoisie pour développer ses manoeuvres. Plusieurs des éléments qui sont avancés avaient déjà été évoqués par le passé (rythme lent -qui aujourd'hui, évidemment, tend à s'accélérer- de la crise elle-même, poids de la rupture organique et inexpérience des nouvelles générations ouvrières). Mais le rapport fait un point particulier sur la question de la décomposition de la société capitaliste, lequel a suscité de nombreux débats dans l'organisation.
L'évocation de cette question était indispensable à plusieurs titres :
1°) D'une part, ce n'est que récemment que cette question a été clairement mise en évidence et explicitée par le CCI (bien que nous l'ayons déjà identifiée lors des attentats terroristes de Paris à l'automne 86).
2°) Il importait d'examiner dans quelle mesure un phénomène qui affecte les organisations révolutionnaires (et qui est particulièrement souligné dans le rapport d'activités) pèse également sur la classe dont ces organisations constituent l'avant garde.
La présentation ne reviendra pas sur ce qui est dit dans le rapport. Nous nous bornerons à mettre en avant les points suivants :
1°) Depuis déjà longtemps, le CCI a mis en évidence le fait que les conditions objectives dans lesquelles se développent aujourd'hui les luttes ouvrières (l'enfoncement du capitalisme dans sa crise économique qui touche simultanément tous les pays) sont bien plus favorables au succès de la révolution que celles qui se trouvaient à l'origine de la première vague révolutionnaire (la 1ère guerre impérialiste).
2°) De même, nous avons montré en quoi les conditions subjectives étaient également plus favorables dans la mesure où il n'existe pas aujourd'hui de grands partis ouvriers, comme les partis socialiste, dont la trahison au cours même de la période décisive pourrait, à l'image du passé, désarçonner le prolétariat.
3°) En même temps, nous avons également mis en évidence les difficultés spécifiques et les entraves que rencontre la vague historique actuelle des combats de classe : le poids de la rupture organique, la méfiance vis à vis du politique, le poids du conseillisme (voir en particulier la résolution sur la situation internationale adoptée par le 6ème congrès du CCI).
Il importait donc de mettre en évidence, en simple cohérence avec ce que nous disons sur les difficultés que rencontre l'organisation, que le phénomène de décomposition pèse à l'heure actuelle et pour toute une période d'un poids considérable, qu'il constitue un danger très important auquel la classe doit s'affronter pour s'en protéger et se donner les moyens de le retourner contre le capitalisme.
En prenant conscience de la gravité de cette réalité, il ne s'agit évidemment pas de dire que tous les aspects de la décomposition constituent un obstacle à la prise de conscience du prolétariat. Les éléments objectifs qui mettent clairement en évidence la barbarie totale dans laquelle s'enfonce la société constituent un facteur de dégoût pour ce système et contribuent donc à la prise de conscience du prolétariat. De même, dans la décomposition idéologique, des éléments comme la corruption de la classe bourgeoise ou l'effondrement des piliers classiques de sa domination son également des facteurs de prise de conscience de la faillite du capitalisme. En revanche, tous les éléments de la pourriture idéologique qui pèsent sur l'organisation révolutionnaire pèsent également d'un poids encore plus fort sur l'ensemble de la classe, rendant plus difficile le développement de la conscience et des combats du prolétariat.
De même ce constat ne doit être nullement une source de démoralisation ou de scepticisme.
l°) Tout au long des années 80, c'est malgré ce poids négatif de la décomposition, systématiquement exploité par la bourgeoisie, que le prolétariat a été en mesure de développer ses luttes face aux conséquences de l'aggravation de la crise, laquelle s'est confirmée une nouvelle fois comme la "meilleure alliée de la classe ouvrière" (comme nous l'avons souvent dit).
2°) Le poids de la décomposition constitue un défi qui doit être relevé par la classe ouvrière. C'est aussi dans sa lutte contre cette influence, notamment en renforçant, dans l'action collective, son unité et sa solidarité de classe, que le prolétariat forgera ses armes en vue du renversement du capitalisme.
3°) Dans ce combat contre le poids de la décomposition, les révolutionnaires ont un rôle fondamental à jouer. De la même façon que le constat de ce poids dans nos propres rangs n'est pas fait pour nous démoraliser, mais au contraire pour nous mobiliser, pour renforcer notre vigilance et notre détermination, le constat de cette difficulté que rencontre la classe ouvrière est un facteur de plus grande détermination, conviction et vigilance dans notre intervention au sein de la classe.
Pour conclure cette présentation, nous dirons donc que la discussion sur la situation internationale doit faire ressortir dans nos rangs, non seulement la plus grande clarté, mais aussi :
- la plus grande confiance dans la validité des analyses sur lesquelles s'est formé et développé le CCI, et tout particulièrement la confiance dans le développement du combat de classe vers des affrontements de plus en plus profonds et généralisés, vers une période révolutionnaire ;
- la plus grande détermination à nous montrer à la hauteur des responsabilités que le prolétariat nous a confiées.
RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
1) L'accélération de l'histoire tout au long des années 1980 a mis en relief les contradictions insurmontables du capitalisme. Les années 1980 sont des années de vérité. Vérité de l'approfondissement de la crise économique. Vérité de l'aggravation des tensions impérialistes. Vérité du développement de la lutte de classe.
Face à cette clarification de l'histoire la classe dominante n'a plus que des mensonges à offrir : "croissance", "paix" et "calme social".
LA CRISE ECONOMIQUE
2) Le niveau de vie de la classe ouvrière a subi, durant cette décennie, sa plus forte attaque depuis la guerre :
- développement massif du chômage et de l'emploi précaire ;
- attaques contre les salaires et diminution du pouvoir d'achat;
- amputation du salaire social ;
Tandis que le prolétariat des pays industriels subissait une paupérisation croissante, la majorité de la population mondiale s'est retrouvée à la merci de la famine et du rationnement.
3) La bourgeoisie, contre l'évidence subie dans leur chair par les exploités du monde entier, chante la "croissance" retrouvée de son économie. Cette "croissance" est un mythe.
Cette soi-disant "croissance" de la production a été financée par un recours effréné au crédit et à coups de déficits commerciaux et budgétaires gigantesques des USA, de manière purement artificielle. Ces crédits ne seront jamais remboursés.
Cet endettement a, pour l'essentiel, financé la production d'armement, c'est-à-dire que c'est du capital détruit. Alors que des pans entiers de 1 industrie ont été démantelés, les secteurs à forte croissance sont ceux, donc, de l'armement et de manière générale les secteurs improductif (services : publicité, banques, etc.), ou de pur gaspillage (marché de la drogue).
La classe dominante n'a pu maintenir son illusion d'activité économique que par une destruction de capital. La fausse "croissance" des capitalistes est une vraie récession.
4) Pour parvenir à ce "résultat", les gouvernements ont dû avoir recours aux mesures capitalistes d'Etat à un niveau jamais atteint jusqu'à présent : endettement record, économie de guerre, falsification des données économiques, manipulations monétaires.
Le rôle de l'Etat, contrairement à l'illusion selon laquelle les privatisations représentent un démantèlement du capitalisme d'Etat, s'est renforcé.
Imposée par les USA, la "coopération" internationale s'est développée entre les puissances occidentales participant du renforcement du bloc impérialiste.
5) De son coté, la "perestroïka" constitue la reconnaissance au sein du bloc de l'Est de la faillite de l'économie. Les méthodes capitalistes d'Etat à la russe : l'emprise totale de l'Etat sur l'économie et l'omniprésence de l'économie de guerre, ont eu pour seul résultat une anarchie bureaucratique croissante de la production et un gaspillage gigantesque de richesses. L'URSS et son bloc se sont enfoncés dans le sous-développement économique. La nouvelle politique économique de Gorbatchev n'y changera rien.
A l'Est comme à l'Ouest, la crise capitaliste s'accélère tandis que les attaques contre la classe ouvrière vont en s'intensifiant.
6) Aucune mesure de capitalisme d'Etat ne peut permettre une réelle relance de l'économie, ni même toutes utilisées en semble. Elles sont une gigantesque tricherie par rapport aux lois économiques. Elles ne sont pas un remède, mais un facteur aggravant de la maladie. Leur utilisation massive est le symptôme le plus évident de celle-ci.
En conséquence, le marché mondial a été fragilisé : fluctuation croissante des monnaies, spéculation effrénée, crise boursière, etc., sans que l'économie capitaliste sorte de la récession dans laquelle elle a plongé au début des années 1980.
Le poids de la dette s'est terriblement accru. A la fin des années 1980, les USA, la première puissance mondiale, sont devenus le pays le plus endetté du monde. L'inflation n'a jamais disparu : elle a continué de galoper aux portes des pays industrialisés, et sous la pression inflationniste de l'endettement, elle connaît aujourd'hui une accélération irréversible au coeur du capitalisme développé.
7) Avec la fin des années 1980, les politiques capitalistes d'Etat montrent leur impuissance. Malgré toutes les mesures prises, la courbe de croissance officielle descend irrésistible ment et annonce la récession ouverte à venir et l'indice des prix remonte lentement. L'inflation artificiellement masquée est prête à faire un retour en force au coeur du monde industriel.
Durant cette décennie, la classe dominante a fait une politique de fuite en avant. Cette politique, même employée de plus en plus massivement, montre ses limites. Elle sera de moins en moins efficace immédiatement et les traites sur l'avenir qui ont été tirées, devront être payées. Les années à venir seront des années de plongée encore accélérée dans la crise économique, où l'inflation va se conjuguer toujours plus avec la récession. Malgré le renforcement international du contrôle des Etats, la fragilité du marché mondial va s'accroître et les convulsions vont s'accentuer sur les marchés (financiers, monétaires, boursiers, matières premières) tandis que les faillites vont se développer dans les banques, l'industrie et le commerce.
Les attaques contre le niveau et les conditions de vie du prolétariat et de l'humanité ne pourront donc que s'accentuer à un degré dramatique.
LES TENSIONS INTER-IMPERIALISTES
8) Les années 1980 se sont ouvertes sous les auspices de la chute du régime du Shah en Iran, ayant eu pour conséquence le démantèlement du dispositif militaire occidental au sud de l'URSS, et l'invasion de l'Afghanistan par les troupes de l'Armée rouge.
Cette situation a déterminé le bloc américain, aiguillonné par la crise économique, a lancer une offensive impérialiste de grande envergure visant à consolider son bloc, mettre au pas les petits impérialismes récalcitrants (Iran, Libye, Syrie), à expulser l'influence russe de la périphérie du capitalisme et à l'étouffer dans les limites étroites de son glacis en imposant un quasi-blocus.
Cette offensive vise en dernière instance à retirer à l'URSS son statut de puissance mondiale.
9) Face à cette pression, incapable de soutenir les enchères de la course aux armements et de moderniser ses armes périmées au niveau requis par ces enchères de la course aux armements, incapable d'obtenir une quelconque adhésion de son prolétariat à son effort de guerre comme l'ont montré les événements de Pologne et l'impopularité croissante de l'aventure afghane, l'URSS a dû reculer.
La bourgeoisie russe a su mettre à profit ce recul pour lancer, sous la houlette de Gorbatchev, une offensive diplomatique et idéologique de grande envergure sur le thème de la paix et du désarmement.
Les USA, face au mécontentement croissant du prolétariat au sein de leur bloc ne pouvaient apparaître comme la seule puissance belliciste et ont entonné à leur tour la rengaine de la paix.
10) Commencées sous les diatribes guerrières de la bourgeoisie, les années 1980 se terminent sous le martèlement des campagnes idéologiques sur la paix.
La paix dans le capitalisme en crise est un mensonge. Les paroles de paix de la bourgeoisie servent à camoufler les antagonismes inter-impérialistes et les préparatifs guerriers qui vont en s'intensifiant, à cacher à la classe ouvrière les véritables enjeux historiques, guerre ou révolution, pour empêcher les ouvriers de prendre conscience du lien entre l'austérité et les préparatifs guerriers et endormir la classe dans un faux sentiment de sécurité.
Les traités sur le désarmement n'ont aucune valeur. Les armes mises au rencard ne constituent qu'une infime partie de l'arsenal de mort de chaque bloc et sont, pour l'essentiel, périmées. Et, la tricherie et le secret étant la règle, rien n est réellement vérifiable.
L'offensive occidentale se poursuit tandis que l'URSS essaie de mettre à profit la situation pour rattraper son retard technologique et moderniser son armement et pour se recréer une virginité politique mystificatrice.
La guerre continue en Afghanistan, la flotte occidentale est toujours massée dans le golfe, les armes parlent toujours au Liban, etc. Les budgets de l'armée continuent de grossir, alimentés si besoin est de manière discrète. De nouvelles armes toujours plus destructrices sont mises en chantier pour les 20 ans à venir. Non seulement rien n'a fondamentalement changé malgré tous les discours somnifères, mais encore la spirale guerrière est allée en s'accélérant.
A l'Ouest, les propositions américaines de réductions des troupes en Europe ne sont que l'expression de la pression du chef de bloc sur les puissances européennes pour qu'elles contribuent plus à l'effort de guerre global. Ce processus est déjà en cours avec la formation d'armées "communes", la proposition d'un avion de chasse européen, le renouveau des missiles Lance, le projet Euclide, etc. Derrière la fameuse Europe 1992, il y a une Europe armée jusqu'aux dents pour faire face à l'autre bloc.
Le recul présent du bloc russe est porteur des surenchères militaires de demain. La perspective est au développement des tensions impérialistes, au renforcement de la militarisation de la société et à une décomposition à la "libanaise" particulièrement dans les pays les plus touchés par les conflits inter impérialistes et les pays les moins industrialisés, comme aujourd'hui l'Afghanistan. Ce processus peut connaître, à long terme, de tels développements en Europe si le développement international de la lutte de classe n'est pas suffisant pour y faire obstacle.
11) Alors que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour imposer sa "solution" : la guerre impérialiste généralisée, et que a lutte de classe n'est pas encore suffisamment développée pour permettre la mise en avant de sa perspective révolutionnaire, le capitalisme est entraîné dans une dynamique de décomposition, de pourrissement sur pied qui se manifeste sur tous les plans de son existence :
- dégradation des relations internationales entre Etats manifestée par le développement du terrorisme ;
- catastrophes technologiques et soi-disant naturelles à répétition ;
- destruction de la sphère écologique ;
- famines, épidémies, expressions de la paupérisation absolue qui se généralise ;
- explosion des "nationalités" ;
- vie de la société marquée par le développement de la criminalité, de la délinquance, des suicides, de la folie, de l'atomisation individuelle ;
- décomposition idéologique marquée entre autre par le développement du mysticisme, du nihilisme, de l'idéologie du "chacun-pour-soi", etc..
LA LUTTE DE CLASSE
12) La grève de masse en Pologne a éclairé les années 1980 et posé les enjeux de la lutte de classe pour la période. Le dévoiement de la stratégie bourgeoise de la gauche dans l'opposition en Europe occidentale, le sabotage syndical et la répression par l'armée des ouvriers en Pologne ont déterminé un recul bref mais difficile pour la classe ouvrière au début de la décennie.
La bourgeoisie occidentale a profité de cette situation pour lancer des attaques économiques redoublées (développement brutal du chômage), tout en accentuant sa répression et en menant des campagnes médiatiques sur la guerre destinées à accentuer le recul en démoralisant et terrorisant, et à habituer les ouvriers à l'idée de la guerre.
Cependant, les années 1980 ont, avant tout, été des années de développement de la lutte de classe. A partir de 1983, le prolétariat, sous la pression des mesures d austérité qui tombent en cascade, retrouve internationalement le chemin de la lutte. Face aux attaques massives la combativité du prolétariat se manifeste avec ampleur dans des grèves massives sur tous les continents, et surtout en Europe occidentale, au coeur du capitalisme, là où se trouvent concentrés les bataillons les plus expérimentés de la classe ouvrière mondiale. Ainsi des luttes ouvrières ont éclaté d'un continent à l'autre : Afrique du sud, Corée, Brésil, Mexique, etc...et, en Europe : Belgique 1983, mineurs de Grande-Bretagne 1984, Danemark 1985, Belgique 1986, cheminots en France 1986, Espagne 1987, RFA 1987, enseignants en Italie 1987, hospitaliers en France en 1988, etc.
Cette vérité de la lutte de classe n'est pas celle de la bourgeoisie. De toutes ses forces elle tente de la cacher. La chute statistique des journées de grève par rapport aux années 1970 qui a alimenté les campagnes idéologiques de démoralisation de la classe ouvrière ne rend pas compte du développement qualitatif de la lutte. Depuis 1983, les grèves courtes et massives sont de plus en plus nombreuses, et malgré le black-out sur l'information auquel elles sont soumises la réalité du développement de la combativité ouvrière s'impose peu à peu à tous.
13) La vague de lutte de classe qui se développe depuis 1983 pose la perspective de l'unification des luttes. Dans ce processus, elle se caractérise par :
- des luttes massives et souvent spontanées, liées à un mécontentement général qui touche tous les secteurs,
- une tendance à la simultanéité croissante des luttes,
- une tendance à l'extension comme seule manière d'imposer un rapport de force à la classe dominante soudée derrière son Etat,
- la croissante prise en main des luttes par les ouvriers pour réaliser cette extension contre le sabotage syndical,
- le surgissement des comités de lutte.
Cette vague de lutte traduit non seulement le mécontentement grandissant de la classe ouvrière, sa combativité intacte, sa volonté de lutter mais aussi le développement et l'approfondissement de sa conscience. Ce processus de maturation se concrétise sur tous les aspects de la situation à laquelle se confronte le prolétariat : guerre, décomposition sociale, impasse du capitalisme, etc., mais il se concrétise plus particulièrement sur deux points essentiels, puisqu'ils déterminent le rapport du prolétariat à l'Etat :
- la méfiance par rapport aux syndicats va en se développant, ce qui se traduit internationalement par des confrontations répétées avec les forces d'encadrement et par la tendance à la désyndicalisation ;
- le rejet des partis politiques de la bourgeoisie s'intensifie, comme le concrétisent par exemple les luttes continues pendant les campagnes électorales et l'abstention grandissante aux élections.
14) Loin de la minimisation des médias étatiques, les convulsions sociales sont une préoccupation centrale et permanente de la classe dominante, à l'ouest comme à l'est. Première ment, parce qu'elles interfèrent avec toutes les autres questions à un niveau immédiat, deuxièmement la lutte ouvrière porte en germe la remise en cause radicale de l'état de choses existant.
De même que la préoccupation de la classe dominante s'exprime dans les pays centraux par un développement sans précédent de la stratégie de la gauche dans l'opposition, elle se manifeste aussi :
- dans la volonté des dirigeants américains du bloc occidental de remplacer les "dictatures" caricaturales dans les pays sous leur contrôle par des "démocraties" plus adaptées à faire face à l'instabilité sociale en incluant une "gauche" capable de saboter les luttes ouvrières de l'intérieur (les leçons de l'Iran ont été tirées) ;
- dans celle de l'équipe Gorbatchev qui fait de même dans son bloc au nom de la " glastnost" (là ce sont les leçons de la Pologne).
15) Face au mécontentement de la classe ouvrière, la bourgeoisie n'a rien à offrir sinon toujours plus d'austérité et de répression. Face à la vérité des luttes ouvrières, la bourgeoisie n'a que le mensonge pour pouvoir manoeuvrer.
La crise rend la bourgeoisie intelligente. Face à la perte de crédibilité de son appareil politico-syndical d'encadrement de la classe ouvrière, elle a du utiliser celui-ci de manière plus subtile :
* d'abord, en faisant manoeuvrer sa "gauche" en étroite connivence avec l'ensemble des moyens de l'appareil d'Etat : "droite" repoussoir pour renforcer la crédibilité de la "gauche", médias aux ordres, forces de répression, etc. La politique de gauche dans l'opposition s'est renforcée dans tous les pays, malgré les vicissitudes électorales ;
* ensuite, en adaptant ses organes d'encadrement pour entraver et saboter les luttes ouvrières de l'intérieur :
- radicalisation des syndicats classiques,
- utilisation accrue des groupes gauchistes,
- développement du syndicalisme de base,
- développement de structures en dehors du syndicat, qui prétendent représenter la lutte : coordinations.
16) Cette capacité de manoeuvre de la bourgeoisie est parvenue jusqu'à présent à entraver le processus d'extension et d'unification dont est porteuse la vague présente de lutte de classe. Face à la dynamique vers des luttes massives et d'extension des mouvements, la classe dominante encourage tous les facteurs de division et d'isolement : corporatisme, régionalisme, nationalisme. Face à cette même dynamique la bourgeoisie est prête à lancer des actions préventives afin de pousser la classe ouvrière à lutter dans des conditions défavorables. Dans chaque lutte les ouvriers sont obligés de se confronter à la coalition de l'ensemble des forces de la bourgeoisie.
Cependant, malgré les difficultés qu'elle rencontre, la dynamique de lutte de la classe ouvrière n'est pas brisée. Au contraire, elle se développe. La classe ouvrière a un potentiel de combativité, non seulement intact, mais qui va en se renforçant. Sous l'aiguillon douloureux des mesures d'austérité qui ne peuvent aller qu'en s'intensifiant la classe ouvrière est poussée à la lutte et à la confrontation avec les forces de la bourgeoisie. La perspective est à un développement de la lutte de classe. C'est pourquoi les armes de la bourgeoisie, parce que celles-ci vont être utilisées de plus en plus fréquemment sont destinées à se dévoiler.
17) L'apprentissage que fait le prolétariat de la capacité manoeuvrière de la bourgeoisie est un facteur nécessaire de sa prise de conscience, de son renforcement face à l'ennemi qu'il confronte.
La dynamique de la situation le pousse à imposer sa force par l'extension réelle de ses luttes, c'est-à-dire l'extension géographique contre la division organisée par la bourgeoisie, contre l'enfermement sectoriel, corporatiste ou régionaliste, contre les propositions de fausse extension des syndicalistes et des gauchistes.
Pour mener à bien cet élargissement nécessaire de son combat, la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même et, avant tout, sur ses assemblées générales. Celles-ci doivent être ouvertes à tous les ouvriers et assumer souverainement, par elles-mêmes, la conduite de la lutte, c'est-à-dire en priorité son extension géographique. De ce fait, les assemblées générales souveraines doivent rejeter tout ce qui tend à les étouffer (leur fermeture aux autres ouvriers) et à les déposséder de la lutte (les organes de centralisation prématurée que la bourgeoisie, aujourd'hui, ne se prive pas de susciter et de manipuler, ou pire ceux qu'elle parachute de l'extérieur : coordinations, comités de grève syndicaux, etc.). De cette dynamique dépend l'unification future des luttes.
Le manque d'expérience politique de la génération prolétarienne actuelle, dû à près d'un demi-siècle de contre-révolution, pèse lourdement. Elle est encore renforcée par :
- la méfiance et le rejet de tout ce qui est politique, expression de décennies d'écœurement des manoeuvres politicardes bourgeoises des partis prétendument ouvriers ;
- le poids de la décomposition idéologique environnante sur laquelle s'appuient et s'appuieront de plus en plus les manoeuvres bourgeoises visant à renforcer l'atomisation, le "chacun pour soi", et à saper la confiance croissante de la classe ouvrière en sa propre force et en l'avenir que porte son combat.
De la capacité de la classe ouvrière dans la période présente de renforcer, dans l'action collective, son unité et sa solidarité de classe, de tirer les leçons de ses luttes, de développer son expérience politique dépend sa capacité à surmonter ses faiblesses et à confronter demain l'Etat du capital pour le mettre à bas et ouvrir les portes de l'avenir.
Dans le processus vers l'unification, dans le combat politique pour l'extension contre les manoeuvres syndicales, les révolutionnaires ont un rôle d'avant-garde, déterminant et indispensable à remplir. Ils sont partie intégrante de sa lutte. De leur intervention dépend la capacité de la classe à traduire sa combativité sur le plan du mûrissement de sa conscience. De leur intervention dépend l'issue future.
18) Le prolétariat est au coeur de la situation internationale. Si les années 1980 sont des années de vérité, cette vérité c'est d'abord celle de la classe ouvrière. Vérité d'un système capitaliste qui entraîne l'humanité à sa perte, par la décomposition barbare déjà à l'oeuvre maintenant, et dont la guerre apocalyptique que la bourgeoisie prépare avec toujours plus de folie est l'aboutissement extrême.
Les années 1980 ont posé les enjeux et ses responsabilités au prolétariat : socialisme ou barbarie, guerre ou révolution ! De sa capacité à y répondre dans les années à venir, par la mise en avant de sa perspective révolutionnaire, par et dans sa lutte, dépend l'avenir de l'humanité.
[1] [10] Vercesi était le principal animateur de la Fraction de gauche du Parti communiste d'Italie. Sa contribution politique et théorique dans celle-ci, et dans l'ensemble du mouvement ouvrier, est considérable. Mais à la fin des années 30, il a développé une théorie aberrante sur l'économie de guerre comme solution à la crise qui a désarmé et désarticulé la Fraction face à la seconde guerre mondiale.
[2] [11] D'ailleurs, les "experts" bourgeois eux-mêmes le disent clairement : "Pratiquement plus personne ne pense aujourd'hui que la dette puisse être remboursée, mais les pays occidentaux insistent pour élaborer un mécanisme qui permettrait de dissimuler ce fait et d'éviter des termes aussi durs que cessation de paiement et banqueroute." (W.Pfaff, "International Herald Tribune" du 30-1-89). Ce que l'auteur oublie de préciser, ce sont les causes profondes d'une telle "pudeur". En réalité, pour la bourgeoisie des grandes puissances occidentales, proclamer officiellement la faillite complète de ses débiteurs, c'est reconnaître la faillite de son système financier et, au delà, de l'ensemble de l'économie capitaliste. En fin de compte, la classe dominante ressemble un peu à ces personnages de dessins animés qui continuent de courir alors qu'ils se trouvent déjà au dessus d'un précipice et qui n'y tombent qu'au moment où ils en prennent conscience.
[3] [12] Les famines et la paupérisation absolue de la classe ouvrière, telles que nous les avons vécues ces dernières années, ne sont pas des phénomènes nouveaux dans l'histoire du capitalisme. Mais au delà de l'ampleur qu'elles prennent aujourd'hui (et qui n'est comparable qu'aux situations vécues lors des guerres mondiales), il importe de distinguer ce qui relevait de l'introduction du mode de production capitaliste dans la société (qui s'est faite effectivement "dans la boue et le sang", suivant les termes de Marx, en s'appuyant sur la création d'une armée de miséreux et de mendiants, sur les "workhouses", le travail de nuit des enfants, l'extraction de la plus value absolue...) de ce qui relève de l'agonie de ce mode de production. De même que le chômage ne représente plus aujourd'hui une "armée industrielle de réserve", mais traduit l'incapacité du système capitaliste de poursuivre ce qui constituait une de ses tâches historiques - développer le salariat, le retour des famines et de la paupérisation absolue (après une période où elle avait été remplacée par la paupérisation relative) signe la faillite historique totale de ce système.
[4] [13] Cette analyse est développée dans les rapports et résolutions des précédents congrès publiés dans la Revue Internationale n°35, 44 et 51.
PRE
Vie du CCI:
Questions théoriques:
- Guerre [4]
- Le cours historique [15]
- L'économie [16]
Il y a 50 ans : les véritables causes de la 2eme guerre mondiale
- 24500 reads
Le texte que nous publions ci-dessous est une partie du Rapport sur la situation internationale présenté et débattu à la Conférence de la Gauche communiste de France (GCF) qui s'est tenue en juillet 1945 à Paris. Aujourd'hui, quand la bourgeoisie mondiale commémore avec enthousiasme les hauts faits de la victoire de la "démocratie" contre le fascisme hitlérien qui, selon elle, était la seule raison de la 2ème guerre mondiale de 1939-45, il est nécessaire de rappeler à la classe ouvrière, non seulement la vraie nature impérialiste de cette boucherie sanglante qui a fait 50 millions de victimes et a laissé en ruines fumantes tant de pays d'Europe et d'Asie, mais aussi ce qui s'annonçait être la "paix" capitaliste qui allait suivre.
Tel était l'objectif que cette petite minorité de révolutionnaires qu'était la GCF s'était donnée dans cette conférence, en démontrant, contre tous les laquais de la bourgeoisie allant des PS-PC jusqu'aux groupes trotskystes, que, dans le capitalisme dans sa période impérialiste, la "paix" n'est qu'un intervalle entre les guerres, quelle que soit l'étiquette sous laquelle ces guerres se camouflent.
De 1945 à aujourd'hui, les innombrables conflits armés localisés, qui ont déjà fait au moins autant de victimes que la guerre mondiale de 1939-45, la crise économique mondiale qui dure depuis vingt ans, la course effarante aux armements, ont amplement confirmé ces analyses, et plus que jamais reste valable la perspective : lutte de classe du prolétariat débouchant sur la révolution communiste comme seule alternative à la course vers une 3ème guerre mondiale qui mettrait en question la survie même de l'humanité.
RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
GAUCHE COMMUNISTE DE FRANCE (juillet 1945, extraits)
I. GUERRE ET PAIX
Guerre et paix sont deux moments d'une même société : la société capitaliste. Elles ne se présentent pas comme des oppositions historiques s'excluant Tune l'autre. Au contraire, guerre et paix en régime capitaliste représentent des moments complémentaires indispensables l'un à l'autre, des phases successives d'un même régime économique, des aspects particuliers et complémentaires d'un phénomène unique.
A l'époque du capitalisme ascendant les guerres (nationales, coloniales et de conquêtes impérialistes) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, d'élargissement et de l'expansion du système économique capitaliste. La production capitaliste trouvait dans la guerre la continuation de sa politique économique par d'autres moyens. Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d'une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste.
A l'époque du capitalisme décadent, la guerre au même titre que la paix exprime cette décadence et concourt puissamment à l'accélérer.
Il serait erroné de voir dans la guerre un phénomène propre négatif par définition, destructeur et entrave du développement de la société, en opposition à la paix, qui, elle, sera présentée comme le cours normal positif du développement continu de la production et de la société. Ce serait introduire un concept moral dans uni cours objectif, économiquement déterminé.
La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement, qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines.
Il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et partant une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix), dans les deux phases respectives. Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de consommation, dans la seconde phase la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique - période ascendante -, l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre -période de décadence.
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de plus-value, mais cela signifie que la guerre prenant un caractère de permanence est devenue le mode de vie du capitalisme décadent.
Dans la mesure où l'alternative guerre paix n'est pas simplement destinée à tromper le prolétariat, à endormir sa vigilance et à lui faire quitter son terrain de classe, cette alternative n'exprime que le fond apparent, contingent, momentané, servant au regroupement des différentes constellations en vue de la guerre. Dans un monde où les zones d'influences, les marchés d'écoulement des produits, les sources de matières premières et les pays de l'exploitation forcenée de la main d'oeuvre sont définitivement partagés entre les grandes puissances impérialistes, les besoins vitaux des jeunes impéria-lismes les moins favorisés se heurtent violemment aux intérêts des vieux impérialismes les plus favorisés et s'expriment dans une politique belliqueuse et agressive pour obtenir par la force un nouveau partage du monde. Le bloc impérialiste de la "Paix" ne signifie nullement une politique basée sur un concept moral plus humain, mais simplement la volonté des impérialismes repus et favorisés, de défendre par la force leurs privilèges acquis dans les brigandages antérieurs. La "paix" pour eux ne signifie nullement une économie se développant pacifiquement, qui ne peut exister en régime capitaliste, mais la préparation méthodique à l'inévitable compétition armée et l'écrasement impitoyable au moment propice des impérialismes concurrents et antagoniques.
La profonde aversion des masses travailleuses pour la guerre est d'autant plus exploitée qu'elle offre un magnifique terrain de mobilisation pour la guerre contre l'impérialisme adverse... fauteur de guerres.
Entre les deux guerres, la démagogie de la "paix" a servi aux impérialismes anglo-américano-russe de camouflage à leur préparation à la guerre, qu'ils savaient inévitable et à leur préparation idéologique des masses.
La mobilisation pour la paix est du charlatanisme conscient de tous les laquais du capitalisme et dans le meilleur des cas un songe creux, une phrase vide et impuissante, des petits bourgeois se lamentant. Elle désarme le prolétariat en faisant miroiter devant lui l'illusion dangereuse entre toutes d'un capitalisme pacifique.
La lutte contre la guerre ne peut être efficace et avoir un sens qu'en liaison indissoluble avec la lutte de classe du prolétariat, avec la lutte révolutionnaire pour la destruction du régime capitaliste.
A l'alternative mensongère de guerre-paix le prolétariat oppose la seule alternative que pose l'histoire : GUERRE
IMPERIALISTE ou REVOLUTION PROLETARIENNE.
II. LA GUERRE IMPERIALISTE
Le bureau international de la Gauche communiste a commis, l'erreur à la veille de la guerre, de ne voir en celle-ci avant tout qu'une expression directe de la lutte de classe, une guerre de la bourgeoisie contre le prolétariat. Il prétendait nier complètement ou partiellement l'existence des antagonismes inter impérialistes s'exacerbant et déterminant la conflagration mondiale. Partant d'une vérité indéniable de l'inexistence de nouveaux débouchés à conquérir, qui de ce fait rend la guerre inopérante en tant que moyen de résoudre la crise de surproduction, le bureau international aboutissait à la conclusion simpliste et erronée d'après laquelle la guerre impérialiste ne serait plus le produit du capitalisme divisé en Etats antagoniques luttant chacun pour l'hégémonie mondiale. Le capitalisme sera présenté comme un tout unifié et solidaire et ne recourant à la guerre impérialiste que dans le but de massacrer le prolétariat et d'entraver la montée de la révolution.
L'erreur fondamentale dans l'analyse de la nature de la guerre impérialiste se doublait d'une deuxième erreur dans l'appréciation des rapports de forces des classes en présence au moment du déclenchement de la guerre impérialiste.
L'ère des guerres et des révolutions ne signifie pas qu'au développement du cours de la révolution réponde un développement du cours de la guerre. Ces deux cours ayant leur source dans une même situation historique de crise permanente du régime capitaliste, sont toutefois d'essences différentes n'ayant pas des rapports de réciprocité directe. Si le dé roulement de la guerre devient un facteur direct précipitant les convulsions révolutionnaires, il n'en est pas de même en ce qui concerne le cours de la révolution qui n'est jamais un facteur de la guerre impérialiste.
La guerre impérialiste ne se développe pas en réponse au flux de la révolution, mais c'est exactement le contraire qui est vrai, c'est le reflux de la révolution qui suit la défaite de la lutte révolutionnaire, c'est l'évincement momentané de la menace de la révolution qui permet à la société capitaliste d'évoluer vers le déclenchement de la guerre engendrée par les contradictions et les déchirements internes du système capitaliste.
La fausse analyse de la guerre impérialiste devait amener fatalement à présenter le moment du déclenchement de la guerre comme la réponse au flux de la révolution, à confondre et à intervertir les deux moments, à donner une appréciation erronée des rapports de forces existants entre les classes.
L'absence de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés où puisse se réaliser la plus-value incluse dans les produits au cours du procès de la production, ouvre la crise permanente du système capitaliste. La réduction du marché extérieur a pour conséquence une restriction du marché intérieur. La crise | économique va en s’amplifiant.
A l'époque impérialiste l'élimination achevée des producteurs isolés et groupes de petits et moyens producteurs par la victoire et le monopole des grandes concentrations du capital, les syndicats et les trusts, trouve son corollaire sur le plan international par l'élimination et la complète subordination des petits Etats à quelques grandes puissances impérialistes dominant le monde. Mais de même que l'élimination des petits producteurs capitalistes ne fait pas disparaître la concurrence qui, de petites luttes éparpillées en surface qu'elle était» se creuse en profondeur et se manifeste en des luttes géantes dans la mesure même de la concentration du capital, de même l'élimination des petits Etats et leur vassalisation par les 4 ou 5 Etats impérialistes monstres, ne signifie pas atténuation des antagonismes inter impérialistes.
Au contraire ces antagonismes ne font que se concentrer et ce qu'ils perdent en surface, en nombre, ils le gagnent en intensité et dont les chocs et les explosions ébranlent jusqu'aux fondements de la société capitaliste.
Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du i marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre Etats. La lutte économique exaspérée entre Etats ne peut finalement se résoudre que par la j force militaire. La guerre devient le seul moyen non pas de solution à la crise internationale, mais le seul moyen par le quel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des Etats impérialistes rivaux.
Les solutions momentanées des impérialismes isolés, par des |victoires militaires et économiques, ont pour conséquence non seulement l'aggravation des situations des pays impérialistes adverses, mais encore une aggravation de la crise mondiale et la destruction des masses de valeurs accumulées par des dizaines et des centaines d'années de travail social. La société capitaliste à l'époque impérialiste ressemble à un bâtiment dont les matériaux nécessaires pour la construction des étages supérieurs sont extraits de la bâtisse des étages inférieurs et des fondations. Plus frénétique est la construction en hauteur, plus fragile est rendue la base soutenant tout l'édifice. Plus est imposante en apparence, la puissance au sommet, plus l'édifice est, en réalité, branlant et chancelant. Le capitalisme, forcé qu'il est de creuser sous ses propres fondations, travaille avec rage à l'effondrement de l'économie mondiale, précipitant la société humaine vers la catastrophe et l'abîme.
"Une formation sociale ne périt pas avant que soient développées toutes les forces productives auxquelles elle ouvre un champ libre" disait Marx, mais cela ne signifie pas qu'ayant épuisé cette mission, la formation sociale disparaît, s'évanouit d'elle-même. Pour cela, il faut qu'une nouvelle formation sociale correspondant à l'état des forces productives et à même de leur ouvrir des champs nouveaux pour leur développement, renne la direction de la société. En cela elle se heurte à 'ancienne formation sociale, qu'elle ne peut remplacer qu'en la vainquant par la lutte et la violence révolutionnaires. Et si, se survivant, l'ancienne formation, restée maîtresse des destinées de la société, continue à agir et à guider la société non plus vers l'ouverture des champs libres au développement des forces productives, mais d'après sa nouvelle nature désormais réactionnaire, elle oeuvre vers leur destruction.
Chaque jour de survivance du capitalisme se solde pour la société par une nouvelle destruction. Chaque acte du capitalisme décadent est un moment de cette destruction.
Prise dans ce sens historique, la guerre à l'époque impérialiste, présente l'expression la plus haute en même temps que la plus adéquate du capitalisme décadent, de sa crise permanente et de son mode de vie économique : la destruction.
Aucun mystère n'enveloppe la nature de la guerre impérialiste. Historiquement, elle est la matérialisation de la phase décadente et de destruction de la société capitaliste se manifestant par la croissance des contradictions et l'exaspération des antagonismes inter-impérialistes qui servent de base concrète et de cause immédiate au déchaînement de la guerre.
La production de guerre n'a pas pour objectif la solution d'un problème économique. A l'origine, elle est le fruit d'une nécessité de l'Etat capitaliste de se défendre contre les classes dépossédées et de maintenir par la force leur exploitation, d'une part, et d'assurer par la force ses positions économiques et de les élargir, aux dépens des autres Etats impérialistes.
Plus les marchés de réalisation de la plus-value se rétrécissent, plus la lutte entre impérialistes devient acerbe, plus l'antagonisme inter-impérialiste s'exacerbe, et plus l'Etat est amené à renforcer son appareil offensif et défensif. La crise permanente pose l'inéluctabilité, l'inévitabilité du règlement des différends impérialistes par la lutte armée. La guerre et la menace de guerre sont les aspects latents ou manifestes d'une situation de guerre permanente dans la société. La guerre moderne est essentiellement une guerre de matériel. En vue de la guerre une mobilisation monstrueuse de toutes les ressources techniques et économiques des pays est nécessaire. La production de guerre devient aussi l'axe de la production industrielle et le principal champ économique de la société.
Mais la masse des produits représente-t-elle un accroissement de la richesse sociale ? A cette question, il faut répondre catégoriquement par la négative, la production de guerre, toutes les valeurs qu'elle matérialise, est destinée à sortir de la production, à ne pas se retrouver dans la reprise du procès de la production et à être détruite. Après chaque cycle de production, la société n'enregistre pas un accroissement de son patrimoine social, mais un rétrécissement, un appauvrissement dans la totalité.
Qui paie la production de guerre ? Autrement dit, qui réalise la production de guerre ?
En premier lieu, la production de guerre est réalisée aux dépens des masses travailleuses dont l'Etat par diverses opérations financières : impôts, emprunts, conversions, inflation et autres mesures, draine des valeurs avec lesquelles il constitue un pouvoir d'achat supplémentaire et nouveau. Mais toute cette masse ne peut réaliser qu'une partie de la production de guerre. La plus grande partie reste non réalisée et attendant sa réalisation au travers de la guerre, c'est-à-dire au travers du brigandage exercé sur l'impérialisme vaincu. Ainsi s'opère en quelque sorte une réalisation forcée.
L'impérialisme vainqueur présente la note de sa production de guerre, sous l'appellation de "réparations" et se taille la livre de chair sur l'impérialisme vaincu à qui il impose sa loi. Mais la valeur contenue dans la production de guerre de l'impérialisme vaincu, comme d autres petits Etats capitalistes, est complètement et irrémédiablement perdue. Au total, si on fait le bilan de l'ensemble de l'opération pour l'économie mondiale prise comme un tout, le bilan sera catastrophique, quoique certains secteurs et certains impérialismes isolément se trouvent enrichis.
L'échange des marchandises au travers duquel la plus-value parvenait à se réaliser, ne fonctionne que partiellement avec la disparition du marché extra-capitaliste et tend à être supplanté par "l'échange" forcé, de brigandage sur les pays vaincus et plus faibles, par les capitalistes les plus forts, au travers des guerres impérialistes. En cela réside un aspect nouveau de la guerre impérialiste.
III. LA TRANSFORMATION DE LA GUERRE IMPERIALISTE EN GUERRE CIVILE
Comme nous l'avons dit plus haut, c'est l'arrêt de la lutte de classes, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la déviation de ses luttes, que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, en vidant ces luttes de leur contenu révolutionnaire et les engageant sur les rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de l'éclatement de la guerre impérialiste.
Ceci doit être compris non d'un point de vue étroit et limité d'un secteur national isolé, mais internationalement.
Ainsi la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constatés en 1913 eh Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masses, gloire et fierté de la 2ème Internationale, n'étaient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier miné et pourri par l'opportunisme régnant en maître, devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de guerre.
La réalité ne se traduit pas dans la photographie chronologique des événements. Pour la comprendre, il faut saisir le mouvement sous-jacent, interne, les modifications profondes qui se sont produites avant qu'elles n'apparaissent à la surface et soient enregistrées par des dates. On commettrait une grave erreur en voulant rester fidèle à l'ordre chronologique de l'histoire, et présenter la guerre de 1914 comme la cause de l'effondrement de la 2ème Internationale, quand en réalité l'éclatement de la guerre fut directement conditionné par la dégénérescence opportuniste préalable du mouvement ouvrier international. Les fanfaronnades de la phrase internationaliste
se faisaient d'autant plus extérieurement, qu'intérieurement triomphait et dominait la tendance nationaliste. La guerre de 1914 n'a fait que mettre en évidence, au grand jour, l'embourgeoisement des partis de la 2ème Internationale, la substitution à leur programme révolutionnaire initial, par l'idéologie de l'ennemi de classe, leur rattachement aux intérêts de leur bourgeoisie nationale.
Ce processus interne de la destruction de la conscience de classe a manifesté son achèvement ouvertement dans l'éclatement de la guerre de 1914 qu'il a conditionnée.
L'éclatement de la 2ème guerre mondiale était soumis aux mêmes conditions.
On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerres impérialistes.
La première s'achève avec l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après 1917 et consignée dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, dans la défaite de la Gauche exclue de l'IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme au travers de la théorie et la pratique du "socialisme en un seul pays".
La deuxième étape est celle de l'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue l'alternative historique du capitalisme-socialisme : l'Allemagne, par l'écrasement physique du prolétariat et l'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l'IC et la faillite de l'opposition de gauche de Trotski qui, incapable de regrouper les énergies révolutionnaires, s'engage par la coalition et la fusion avec des groupements et des courants opportunistes de la gauche socialiste, s'oriente vers des pratiques de bluff et d'aventurisme en proclamant la formation de la 4ème Internationale.
La troisième étape fut celle du dévoiement total du mouvement ouvrier des pays démocratiques. Sous le masque de défense des "libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a en réalité cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de leur bourgeoisie nationale, de leur patrie capitaliste. L'anti-fascisme était la plate-forme, l'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres du prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale.
Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif, la destruction de la conscience de classe par l'empoisonnement des masses par l'idéologie "anti-fasciste", l'adhésion des masses à la future guerre impérialiste au travers de leur mobilisation dans les "fronts populaires", les grèves dénaturées et déviées de 1936, de la guerre "antifasciste" espagnole, la victoire définitive du capitalisme d'Etat en Russie se manifestant entre autre par la répression féroce et le massacre physique de toute velléité de réaction révolutionnaire, son adhésion à la SDN ; son intégration dans un bloc impérialiste et l'instauration de l'économie de guerre en vue de la guerre impérialiste se précipitant. Cette période enregistre également la liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et des communistes de gauche surgis par la crise de TIC et qui, au travers de l'idéologie "anti-fasciste" à la "défense de l'Etat ouvrier" en Russie, sont happés dans l'engrenage du capitalisme et définitivement perdus en tant qu'expression de la vie de la classe. Jamais l'histoire n'a encore enregistré un pareil divorce entre la classe et les groupes qui expriment ses intérêts et sa mission. L'avant-garde se trouve dans un état d'absolu isolement et réduit quantitativement à de petits îlots négligeables.
L'immense vague de la révolution jaillie à la fin de la première guerre impérialiste a jeté le capitalisme international dans une telle crainte, qu'il a fallu cette longue période de désarticulation des bases du prolétariat, pour que la condition soit requise pour le déchaînement de la nouvelle guerre impérialiste mondiale.
La guerre impérialiste ne résout aucune des contradictions du régime qui la engendrée. Mais cette manifestation pouvant s'épanouir grâce à l'effacement "momentané" du prolétariat luttant pour le socialisme, provoque le plus grand déséquilibre de la société, et accule l'humanité à l'abîme. Conditionnée par l'effacement de la lutte de classe, la guerre devient au cours de son déroulement un facteur puissant de réveil de la conscience de classe et de la combativité révolutionnaire des masses. Ainsi se manifeste le cours dialectique et contradictoire de l'histoire.
Les ruines accumulées, les destructions multipliées, les cadavres s'entassant par millions, la misère et la famine se développant et s'amplifiant chaque jour, tout pose devant le prolétariat et les couches travailleuses le dilemme aigu et direct de mourir ou de se révolter. Les mensonges patriotiques et la fumée chauvine se dissipent et font apparaître devant les masses l'atrocité et l'inutilité de la boucherie impérialiste. La guerre devient un puissant moteur accélérant la reprise de la lutte de classe et transformant rapidement celle-ci en guerre civile de classe.
Au cours de la troisième année de la guerre, commencent à se manifester les premiers symptômes d'un processus de désintégration du prolétariat de la guerre. Processus encore profondément souterrain, difficilement décelable et encore moins mesurable. Contrairement aux russophiles et anglophiles, les amis platoniques de la révolution, et en premier lieu les trotskystes, qui cachaient leur chauvinisme sous l'argument que la démocratie offrait plus de possibilité à l'éclosion d'un mouvement révolutionnaire du prolétariat et voyaient dans la victoire des impérialismes démocratiques, la condition de la révolution, nous placions, nous, le centre de la fermentation révolutionnaire dans les pays de l'Europe et plus précisément en Italie et en Allemagne, où le prolétariat a subi moins la destruction de sa conscience que la destruction physique, et n'a adhéré à la guerre que sous la pression de la violence.
A la faveur de la guerre, la puissance du gendarme allemand s'épuisait. Les auspices économiques extrêmement fragiles de ces impérialistes qui n'ont pas pu supporter dans le passé les convulsions sociales, devaient être ébranlées aux premières difficultés, aux premiers revers militaires. Ces "révolutionnaires de demain" mais aujourd'hui chauvins nous citaient triomphalement les grèves de masse en Amérique et en Angleterre (tout en les condamnant et les déplorant parce qu'elles affaiblissaient la puissance des démocraties) comme preuve des avantages qu'offre la démocratie pour la lutte du prolétariat. En dehors du fait que le prolétariat ne peut déterminer la forme du régime qui convient le mieux, à un moment donné du capitalisme, et du fait que placer le prolétariat sur le terrain du choix : démocratie-fascisme, c'est lui faire abandonner son terrain propre de lutte contre le capitalisme, les exemples des grèves citées, des masses en Amérique ou en Angleterre, ne prouvaient nullement une plus grande maturation de la combativité des masses ouvrières dans ces pays, mais plutôt la plus grande solidité du capitalisme dans ces pays pouvant supporter des luttes partielles du prolétariat.
Loin de nier l'importance de ces grèves, et les soutenant intégralement comme manifestations de classe pour des objectifs immédiats, nous ne nous leurrons pas sur leur portée encore limitée et contingente.
Notre attention fut avant tout concentrée sur l'endroit où s'accomplissait un processus de décomposition des forces vitales du capitalisme et de fermentation révolutionnaire de la plus haute portée où la moindre manifestation extérieure prenait une acuité et posait l'imminence de l'explosion révolutionnaire. Déceler ces symptômes, suivre attentivement cette évolution, s'y préparer et participer à leur explosion, telle devait être et a été notre tâche dans cette période.
Une partie de la fraction italienne de la Gauche communiste nous taxant d'impatience, se refusait à voir dans les mesures draconiennes prises par le gouvernement allemand dans l'hiver 1942-43, tant à l'intérieur que sur les fronts, autre chose que la suite ordinaire de la politique fasciste et niait que ces mesures reflétaient un processus moléculaire interne. Et c'est parce qu'ils les niaient qu'ils se sont trouvés surpris et dépassés par les événements de juillet 1943, au cours desquels le prolétariat italien rompait le cours de la guerre et ouvrait celui de la guerre civile.
Enrichi par l'expérience de la première guerre, incomparablement mieux préparé à l'éventualité de la menace révolutionnaire, le capitalisme international a réagi solidairement avec une extrême habileté et prudence contre un prolétariat décapité de son avant-garde. A partir de 1943, la guerre se transforme en guerre civile. En l'affirmant nous n'entendons pas dire que les antagonismes inter-impérialistes ont disparu, ou qu'ils ont cessé d'agir dans la poursuite de la guerre. Ces antagonismes subsistaient et ne faisaient que s'amplifier, mais dans une mesure moindre et acquérant un caractère secondaire, en comparaison de la gravité présentant pour le monde capitaliste la menace d'une explosion révolutionnaire.
La menace révolutionnaire sera le centre des soucis et des préoccupations du capitalisme dans les deux blocs : c'est elle qui déterminera en premier lieu le cours des opérations militaires, leur stratégie et le sens de leur déroulement. Ainsi d'un accord tacite entre les deux blocs impérialistes antagonistes et afin de circonvenir et d'étouffer les premiers brasiers de la révolution, l'Italie, chaînon le plus faible et le plus vulnérable sera coupée en deux tronçons. Chaque bloc impérialiste sera chargé par des moyens propres, la violence et la démagogie, d'assurer l'ordre dans un des deux tronçons.
Cet état de cernement et de division de l'Italie dont la partie industrielle et le centre vital le plus important, le Nord, confié à l'Allemagne, et voué à la répression féroce du fascisme, sera maintenu en dépit de toute considération militaire, jusqu'après l'effondrement du gouvernement en Allemagne.
Le débarquement allié, le mouvement contournant des armées russes permettant la destruction systématique des centres industriels et de concentration prolétarienne, obéiront au même objectif central de cernement et de destruction préventives, face à une menace éventuelle d'explosion révolutionnaire. L'Allemagne même sera le théâtre d'une destruction et d'un massacre encore inégalés dans l'histoire.
A l'effondrement total de l'armée allemande, à la désertion massive, aux soulèvements des soldats, des marins et des ouvriers, répondront des mesures de représailles d'une sauvagerie féroce, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, la mobilisation des dernières réserves d'hommes jetés sur les champs de bataille et voués consciemment et inexorablement à l'extermination.
A rencontre de la première guerre impérialiste, où le prolétariat une fois engagé dans le cours de la révolution garde l'initiative et impose au capitalisme mondial l'arrêt de la guerre, dans cette guerre-ci dès le premier signal de la révolution en Italie, en juillet 1943, c'est le capitalisme qui se saisira de l'initiative et poursuivra implacablement une guerre civile contre le prolétariat, empêchera par la force toute concentration des forces prolétariennes, n'arrêtera pas la guerre même 3uand après l'effondrement et la disparition du gouvernement 'Hitler, l'Allemagne demandera avec insistance l'armistice, afin de s'assurer par un carnage monstre et un massacre préventif impitoyable, contre toute velléité de menace de révolution du prolétariat allemand.
Quand on sait que les terribles bombardements auxquels les alliés ont soumis l'Allemagne et qui ont eu pour effet la destruction de centaines de milliers de maisons d'habitation et le massacre de millions d'hommes, ont cependant laissé intacts comme nous annonce la presse alliée, 80% des usines, on saisit toute la signification de classe de ces bombardements "démocratiques".
Le chiffre total des morts de la guerre en Europe s'élève à 40 millions d'hommes dont les deux tiers à partir de 1943, à lui seul ce chiffre donne le bilan de la guerre impérialiste en général et de la guerre civile du capitalisme contre le prolétariat en particulier.
Aux sceptiques qui n'ont pas vu la guerre civile ni du côté du prolétariat, ni du côté du capitalisme, parce qu'elle ne s'est pas reproduite d'après les schémas connus et classiques nous laissons entre autre ces chiffres à leur méditation de sages.
Le trait original et caractéristique de cette guerre qui la distingue de 1914-1918, c'est la transformation brusque en guerre contre le prolétariat tout en poursuivant ses buts impérialistes. C'est la poursuite du massacre méthodique du prolétariat et ne s'arrêtant qu'après s'être assuré momentanément et partiellement il est vrai, contre le foyer de la révolution socialiste.
Comment cela fut-il possible, comment expliquer cette victoire momentanée mais incontestable du capitalisme contre le prolétariat ? (...) Comment se présentait la situation en Allemagne ?
L'acharnement avec lequel les alliés poursuivaient une guerre d'extermination, le plan de déportation massive du prolétariat allemand, plus particulièrement émis par le gouvernement russe, la méthodique et systématique destruction des villes, laissait peser la menace d'une extermination et d'une dispersion telle du prolétariat allemand, qu'avant qu'il ait pu esquisser le moindre geste de classe, il soit mis hors de combat pour des années.
Ce danger a existé effectivement, mais le capitalisme n'a pu réussir à appliquer que partiellement son plan. La révolte des ouvriers et des soldats, qui, dans certaines villes, se sont rendus maîtres des fascistes, a forcé les alliés à précipiter leur marche et à finir cette guerre d'extermination avant le plan prévu. Par ces révoltes de classe, le prolétariat allemand a réussi un double avantage : brouiller le plan du capitalisme, en le forçant à précipiter la fin de la guerre, et esquisser ses premières actions révolutionnaires de classe. Le capitalisme international a su mater momentanément le prolétariat allemand, et empêcher qu'il prenne la tête de la révolution mondiale, mais il n'a pas réussi à l'éliminer définitivement.
GCF, juillet 1945.
L'ETINCELLE N° l. Janvier 1945 Organe de la Fraction Française de la Gauche Communiste
MANIFESTE
La guerre continue.
La "libération" avait pu faire espérer aux ouvriers la fin du massacre et la reconstruction de l'économie, au moins en France.
Le capitalisme a répondu à cet espoir par le chômage, la famine, la mobilisation. La situation qui accablait le prolétariat sous l'occupation allemande s'est aggravée ; pourtant il n'y a plus d'occupation allemande.
La Résistance et le Parti communiste avaient promis la démocratie et de profondes réformes sociales ! Le gouvernement maintient la censure et renforce sa gendarmerie. Il s'est livré à une caricature de socialisation en nationalisant quelques usines, avec indemnités aux capitalistes ! L'exploitation du prolétariat reste et aucune réforme ne peut le faire disparaître. Pourtant la Résistance et le parti communiste sont aujourd'hui tout à fait d'accord avec le gouvernement : c'est qu'Us se sont toujours moqués de la démocratie et du prolétariat.
Ils n'avaient qu'un seul but : la guerre.
Ils l'ont, et c'est maintenant l'Union sacrée.
Guerre pour la revanche, pour le relèvement de la France, guerre contre l'hitlérisme, clame la bourgeoisie.
Mais la bourgeoisie a peur ! Elle a peur des mouvements prolétariens en Allemagne et en France, elle a peur de l'après-guerre
Il lui faut museler le prolétariat français ; elle accroît sa police, qu'elle enverra demain contre lui.
Il lui faut se servir de lui pour écraser la révolution allemande ; elle mobilise son armée.
La bourgeoisie internationale l'aide. Elle l'aide à reconstruire son économie de guerre pour maintenir sa propre domination de classe.
L'URSS l'aide, la première, et fait avec elle un pacte de lutte contre les prolétaires français et allemands.
Tous les partis, les socialistes, les "communistes" l'aident :
"Sus à la cinquième colonne, aux collaborateurs ! sus à l'hitlérisme î sus au maquis brun !"
Mais tout ce bruit ne sert qu'à cacher l'origine réelle de la misère actuelle : le capitalisme, dont le fascisme n'est que le fils.
A cacher la trahison aux enseignements de la révolution russe, qui s'est faite en pleine guerre et contre la guerre.
A justifier la collaboration avec la bourgeoisie au gouvernement.
A jeter à nouveau le prolétariat dans la guerre impérialiste.
A lui faire prendre demain les mouvements prolétariens en Allemagne pour une résistance fanatisée de l'hitlérisme !
Camarades ouvriers !
Plus que jamais la lutte tenace des révolutionnaires pendant la première guerre impérialiste, de Lénine, Rosa Luxemburg et Liebknecht doit être la notre !
Plus que jamais le premier ennemi à abattre est notre propre bourgeoisie !
Plus que jamais, face à la guerre impérialiste, se fait sentir la nécessité de la guerre civile 1
La classe ouvrière n'a plus de parti de classe -le parti "communiste" a trahi, trahit aujourd’hui, trahira demain.
L'URSS est devenue un impérialisme. Elle s'appuie sur les forces les plus réactionnaires pour empêcher la révolution prolétarienne. Elle sera le pire gendarme des mouvements ouvriers de demain : elle commence dès aujourd'hui à déporter en masses les prolétaires allemands pour briser toute leur force de classe.
Seule la fraction de gauche, sortie de ce "cadavre pourrissant" qu'est devenue la 2ème, la 3ème Internationale, représente aujourd'hui le prolétariat révolutionnaire.
Seule la gauche communiste s'est refusée à participer au dévoiement de la classe ouvrière par l'antifascisme et l'a, dès le début, mise en garde contre ce nouveau guet-apens.
Seule elle a dénoncé l'URSS comme le pilier de la contre-révolution depuis la défaite du prolétariat mondial en 1933 !
Seule elle restait, au déclenchement de la guerre, contre toute Union sacrée et proclamait la lutte de classe comme la seule lutte du prolétariat, dans tous les pays, y compris l'URSS.
Enfin, seule elle entend préparer les voies du futur parti de classe, rejetant toutes compromissions et front unique, et suivant dans une situation mûrie par l'histoire le dur chemin suivi par Lénine et la fraction bolchevique avant la première guerre impérialiste.
Ouvriers ! La guerre ce n'est pas seulement le fascisme ! C'est la démocratie et le "socialisme dans un seul pays" : l'URSS, c'est tout le régime capitaliste qui, en périssant, veut faire périr la société !
Le capitalisme ne peut pas vous donner la paix ; même sorti de la guerre, il ne peut plus rien vous donner.
Contre la guerre capitaliste, il faut répondre par la solution de classe : la guerre civile !
C'est de la guerre civile, jusqu'à la prise du pouvoir par le prolétariat, et seulement d'elle que peut surgir une société nouvelle, une économie de consommation et non plus de destruction !
Contre le patriotisme et l'effort de guerre ! Pour la solidarité prolétarienne internationale. Pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile.
La Gauche communiste (Fraction française)
M.Thorez, secrétaire général du Parti Communiste Français, déclarait en 1945 : "Les communistes ne formulent pas présentement des exigences socialiste ou communiste. Ils disent franchement qu'une seule chose préoccupe le peuple : gagner la guerre au plus vite pour hâter l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne, pour assurer le plus vite possible le triomphe de la démocratie, pour préparer la renaissance de la France démocratique et indépendante. Ce relèvement de la France est la tâche de la nation toute entière, la France de demain sera ce que ses enfants l'auront faite.
Pour contribuer à ce relèvement, le Parti communiste est un parti de gouvernement ! Mais il faut encore une armée puissante avec des officiers de valeur, y compris ceux qui ont pu se laisser abuser un certain temps par Pétain. Il faut remettre en marche les usines, en premier lieu les usines de guerre, faire plus que le nécessaire pour fournir les soldats en .armes."
Les Statuts de l'Internationale Communiste déclaraient en 1919 : "Souviens-toi de la guerre impérialiste ! Voila la première parole que l'Internationale Communiste adresse à chaque travailleur, quelles que soient son origine et la langue qu'il parle. Souviens-toi que du fait de l’existence du régime capitaliste, une poignée d'impérialistes a eu pendant 4 années, la possibilité de contraindre les travailleurs de partout à s entr'égorger l Souviens-toi que la guerre bourgeoise a plongé l'Europe et le monde entier dans la famine et le dénuement. Souviens-toi que sans le renversement du capitalisme, la répétition de ces guerres criminelles est non seulement possible mais inévitable !"
Evènements historiques:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [18]
Questions théoriques:
- Décadence [19]
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (1° partie)
- 4718 reads
Première partie : la Gauche italienne, 1922-1937
Nous publions ici la première partie d'un article consacré à la clarification de la définition du rapport Fraction-Parti telle qu'elle s'est progressivement affirmée dans l'histoire du mouvement révolutionnaire. Cette première partie traitera du travail de la Fraction de Gauche du Parti Communiste italien dans les années 1930, en insistant particulièrement sur les années décisives, de 1935 à 1937, années dominées par la guerre d'Espagne, pour répondre aux critiques exprimées à plusieurs reprises par les camarades de Battaglia Comunista à l'égard de "la Fraction", c'est-à-dire du groupe qui se constitue à la fin des années 1920 comme "fraction" du Parti Communiste d'Italie en lutte contre la dégénérescence stalinienne de celui-ci.
Comme nous avons déjà répondu plusieurs fois à ces critiques sur divers points particuliers ([1] [20]), ce qui nous intéresse aujourd'hui est de développer les éléments généraux du rapport historique entre "fraction" et parti. L'importance de ce travail pourrait paraître secondaire, à un moment où les communistes ne se considèrent plus depuis un demi-siècle comme des fractions des vieux partis passés à la contre-révolution. Mais, comme nous le verrons au cours de cet article, la Fraction est une donnée politique qui va au delà de la pure donnée statistique (partie du Parti), elle exprime substantiellement la continuité dans l'élaboration politique qui va du programme du vieux parti au programme du nouveau parti, conservé et enrichi parce qu'il condense les nouvelles expériences historiques du prolétariat. C'est la signification profonde de cette méthode de travail, de ce fil rouge que nous voulons faire ressortir pour les nouvelles générations, pour les groupes de camarades qui, dans le monde entier, sont à la recherche d'une cohérence de classe. Face à tous les imbéciles qui s'amusent à faire "table rase" de l'histoire du mouvement ouvrier antérieur à eux, le CCI réaffirme que ce n'est que sur la base de cette continuité du travail politique que pourra surgir le Parti communiste mondial, arme indispensable dans les batailles qui nous attendent.
LES CRITIQUES DE "BATTAGLIA COMUNISTA" ENVERS LA FRACTION ITALIENNE A L'EXTERIEUR
Tout d'abord, tentons d'exposer systématiquement, et sans les déformer, les positions de Battaglia sur lesquelles nous entendons polémiquer. Dans l'article "Fraction-Parti dans l'expérience de la Gauche italienne", est développée la thèse selon laquelle la Fraction, fondée à Pantin, dans la banlieue parisienne, en 1928 par les militants en exil, aurait rejeté hypothèse trotskyste de fondation immédiate de nouveaux partis, parce que les vieux partis de l'Internationale communiste n'étaient pas encore officiellement passés de l'opportunisme à la contre-révolution. "Ce qui revenait à dire que (...) si les partis communistes, malgré l'infection de l’opportunisme, n'étaient pas encore passés, avec armes et bagages, au service de l'ennemi de classe, on ne pouvait pas mettre à l'ordre du jour la construction de nouveaux partis. " Ceci est absolument vrai, même si, comme on le verra, ce n'était qu'une des conditions nécessaires à la transformation de la Fraction en Parti. A part cela, il peut être utile de rappeler que les camarades qui ont fondé la fraction en 1928, avaient déjà dû, en 1927, se séparer d'une minorité activiste qui considérait déjà les PC comme contre-révolutionnaires ("Hors de l'Internationale de Moscou !", disait-elle) et qui, rapidement, en ayant l'illusion que la crise de 1929 était un prélude immédiat à la révolution, adoptait la position de la Gauche allemande, qui elle même avait, en 1924 donné naissance à une éphémère "nouvelle" "Internationale communiste ouvrière".
Poursuivant sa reconstitution, Battaglia rappelle que la Fraction "...a surtout un rôle d'analyse, d'éducation, de préparation des cadres, qu'elle développe la plus grande clarté sur la phase dans laquelle elle agit pour se constituer en parti, au moment même où la confrontation entre les classes balaie l'opportunisme." (Rapport pour le Congrès de 1935). "Jusque là - poursuit BC -, les termes de la question semblaient être suffisamment clairs. Le problème Fraction-Parti a été 'programmatiquement' résolu du fait que la première dépendait du processus de dégénérescence qui était en cours dans ce dernier, (...) et non grâce à une élaboration théorique abstraite qui aurait élevé ce type particulier d'organisation des révolutionnaires à une forme politique invariante, valable pour toutes les périodes historiques de stagnation de la lutte de classe (...). L'idée que l'on ne peut envisager la possibilité de transformation de la fraction en parti que dans des situations 'objectivement favorables', c'est-à-dire en présence d'une reprise de la lutte de classe, reposait sur l'éventualité calculée que ce n'est que dans une telle situation ou dans les orages qui V accompagnent que se serait vérifiée dans les faits la trahison définitive des partis communistes. "
La trahison des PC a été publiquement déclarée en 1935, avec l'appui de Staline et du PCF (imité par tous les autres) aux mesures de réarmement militaire décidées par le gouvernement bourgeois de France "pour défendre la démocratie. Face à ce passage officiel du côté de l'ennemi de classe, la Fraction lançait le manifeste "En dehors des Partis communistes, devenus instruments de la contre-révolution" et se réunissait en congrès pour donner une réponse en tant qu'organisation à ces événements. L'article de Battaglia affirme que :
"Suivant le schéma développé au cours des années précédentes, la Fraction aurait dû accomplir sa tâche en fonction de cet événement et passer à la construction du nouveau parti.
Mais pour la mise en pratique, même si la perspective restait celle-là, il s'exprima au sein de la Fraction quelques tendances qui s'efforçaient de renvoyer le problème plutôt que de le résoudre dans ses aspects pratiques.
Dans le rapport de Jacobs sur lequel aurait dû se développer le débat, la trahison du centrisme et le mot d'ordre lancé par la Fraction de sortir des partis communistes (n'impliquait pas) 'sa transformation en parti, ni ne représentait la solution prolétarienne à la trahison du centrisme, solution qui ne sera ^ donnée que par les événements de demain et auxquels la fraction se prépare aujourd'hui.'(...)
Pour le rapporteur la réponse au problème de la crise du mouvement ouvrier ne pouvait pas consister en l'effort de souder les rangs dispersés des révolutionnaires pour redonner au prolétariat son organe politique indispensable, le parti (...), mais bien de lancer le mot d'ordre 'sortir des PC sans aucune autre indication, puisque 'il n'existe pas de solution immédiate au problème que pose cette trahison.' (...)
S'il était vrai que les dommages provoqués par le centrisme avaient fini par immobiliser la classe, politiquement désarmée, dans les mains du capitalisme (...), il était tout aussi vrai que la seule possibilité d'organiser une quelconque opposition à la tentative de l'impérialisme de résoudre ses propres contradictions par la guerre, passait par la reconstruction de nouveaux partis (...) de façon à ce que l'alternative guerre ou révolution ne soit pas seulement un slogan dont on se gargarise.
Les thèses de Jacobs créèrent au sein du congrès de la Fraction une forte opposition qui (...) divergeait sur l'analyse attentiste du rapporteur. Pour Gatto (...), il était urgent de clarifier le rapport Fraction-Parti, pas sur la base de petites formes mécaniques, mais bien sur la base des tâches précises qu'imposait la nouvelle situation :
'nous sommes d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas passer immédiatement à la fondation du parti, mais par ailleurs, il peut se présenter des situations qui nous imposent la nécessité de passer à sa constitution. La dramatisation du rapporteur peut conduire à une espèce de fatalisme.' Ce souci n'était pas vain puisque la Fraction devait rester dans l’attente jusqu'à son acte de dissolution en 1945."
Battaglia affirme ensuite que la Fraction est restée paralysée par celte divergence, en notant que "le courant partidiste , demeuré toutefois dans l'immobilisme le plus absurde, restait cohérent avec les positions exprimées au congrès, alors que dans le courant ' attentiste', et tout particulièrement chez son élément le plus prestigieux, Vercesi, les hésitations et les changements de route ne manquèrent pas. "
Les conclusions politique de Battaglia sur ce point sont inévitables : "soutenir que le parti ne peut surgir qu'en relation avec une situation révolutionnaire où la question du pouvoir est à l'ordre du jour, alors que dans les phases contre-révolutionnaires le parti 'doit' disparaître ou laisser la place aux fractions" signifie "priver la classe dans les périodes les plus dures et délicates d'un minimum de référence politique" avec "pour seul résultat de se faire dépasser par les événements. "
Comme on le voit, nous n'avons pas lésiné sur la place pour retracer de la façon la plus fidèle possible la position de Battaglia, de manière à la faire connaître aux camarades qui ne lisent pas l'italien. Pour résumer, Battaglia affirme que :
a) depuis sa fondation jusqu'au congrès de 1935, la Fraction ne faisait que défendre en réalité sa transformation en Parti de la reprise de la lutte de classe,
b) la minorité même qui défendait en 35 la formation du Parti, est restée politiquement cohérente, mais dans l'immobilisme pratique le plus complet les années suivantes (c'est-à-dire dans les années des occupations d'usines en France et de la Guerre d'Espagne) ;
c) les fractions (considérées comme des "organismes pas très bien définis", "des succédanés") ne sont pas en mesure d'offrir un minimum de référence politique au prolétariat dans les périodes contre-révolutionnaires. Ce sont là trois déformations de l'histoire du mouvement ouvrier. Voyons pourquoi.
LES CONDITIONS POUR LA TRANSFORMATION DE LA FRACTION EN PARTI
Battaglia soutient que le lien entre la transformation en parti et la reprise de la lutte de classe est une nouveauté introduite en 1935 dont on ne trouve pas trace si on remonte à la naissance de la Fraction en 1928. Mais si on veut remonter dans le temps, pourquoi s'arrêter en 1928 ? Il vaut mieux aller jusqu'en 1922, aux Thèses de Rome légendaires (approuvées par le 2ème congrès du PC d'Italie), qui constituent par définition le texte de base de la Gauche italienne :
"Le retour, sous l'influence de nouvelles situations et d'incitations à l'action exercées par les événements sur la masse ouvrière, à l’organisation d'un véritable Parti de classe, s'effectue sous la forme d'une séparation d'une partie du Parti qui, à travers les débats sur le programme, la critique des expériences défavorables à la lutte, et la formation au sein du Parti d'une école et d'une organisation avec sa hiérarchie (fraction), rétablit cette continuité dans la vie d'une organisation unitaire fondée sur la possession d'une conscience et d'une discipline d'où surgit le nouveau Parti."
Comme on le voit, les textes de base mêmes de la Gauche sont très clairs sur le fait que la transformation de la fraction en parti n'est possible que "sous l'influence de nouvelles situations et d'incitations à l'action exercées par les événements sur la masse ouvrière."
Mais venons-en à la Fraction et à son texte de base sur la question, "Vers l'Internationale 2 et 3/4 ?", publié en 1933 et que Battaglia considère comme "bien plus dialectique" que la position de 1935 :
"La transformation de la fraction en Parti est conditionnée par deux éléments intimement liés :
1. L'élaboration, par la fraction, de nouvelles positions politiques capables de donner un cadre solide aux luttes du Prolétariat pour la Révolution dans sa nouvelle phase plus avancée. (...)
2. Le renversement des rapports de classe du système actuel (...) avec l'éclatement de mouvements révolutionnaires qui pourront permettre à la Fraction de reprendre la direction des luttes en vue de l’insurrection." (Bilan n°l)
Comme on le voit, la position est restée identique à celle de 1922 et ne varie pas si on prend en considération les textes de base qui ont suivi. Nous lisons dans le "Rapport sur la situation en Italie" d'août 1935 :
"Notre fraction pourra se transformer en parti dans la mesure où elle exprimera correctement l'évolution du prolétariat qui sera à nouveau jeté sur la scène révolutionnaire et démolira le rapport de force actuel entre les classes. Tout en ayant toujours, sur la base des organisations syndicales, la seule position pouvant permettre la lutte des masses, notre fraction doit s'acquitter du rôle qui lui revient : formation des cadres en Italie aussi bien que dans l’émigration. Les moments de sa transformation en parti seront les moments mêmes de l’ébranlement du capitalisme."
Sur ce point, prenons directement en considération la phrase que Battaglia elle-même rapporte sur le Rapport pour le Congrès de 1935, en jugeant que "les termes de la question semblaient assez clairs." Dans cette phrase, on affirme textuellement que la transformation de la fraction en Parti est possible "dans les moments où la confrontation entre les classes balaie l'opportunisme"? C’est-à-dire, dans un moment de reprise du mouvement de classe." Effectivement, les termes de la question semblaient déjà clairs dans cette phrase. Par ailleurs, pour lever tous les doutes, il faut lire quelques lignes plus loin :
"La classe se retrouve donc dans le parti au moment où les conditions historiques déséquilibrent les rapports des classes et ï affirmation de V existence du parti est alors l’affirmation de la capacité d'action de la classe."
Plus clair que cela, on meurt ! Comme le disait souvent Bordiga, il suffit de savoir lire. Le problème, c'est que quand on veut réécrire l'histoire avec les lunettes déformantes d'une thèse préétablie, on est obligé de lire le contraire de ce qui est écrit.
Mais le plus stupéfiant, c'est que pour retomber sur leurs pieds, les camarades de Battaglia sont obligés de devenir incapables de lire ce qu'eux-mêmes ont écrit à propos du congrès de la Fraction en 1935 :
"Il convient ici de rappeler que la Gauche italienne abandonne le titre de ‘Fraction de gauche du PCI' pour celui de 'Fraction italienne de la Gauche Communiste Internationale' à un Congrès de 1935. Cela lui fut imposé du fait que contrairement à ses prévisions, la trahison ouverte des PC opportunistes au prolétariat n'attendit pas l'éclatement de la seconde guerre. (...) Le changement de titre marquait à la fois une prise de position par rapport à ce 'tournant' des PC officiels, et le fait que les conditions objectives ne permettaient toujours pas de passer à la formation de nouveaux partis. "
Comme à notre habitude, nous ne nous sommes pas appuyés sur telle ou telle phrase dite incidemment par tel ou tel membre de Battaglia, mais nous avons cité la Préface politique par laquelle le PCInt (Battaglia), en mai 1946, présentait aux militants des autres pays sa Plate-forme Programmatique, tout récemment adoptée à la Conférence de Turin. Ce même document de base, destiné à expliquer la filiation historique existante entre le PC d'Italie de Livourne 1921, la fraction à l'étranger et le PCInt de 1943, exprimait clairement qu'un des points clés de démarcation avec le trotskysme concernait : "...les conditions objectives requises pour que le mouvement communiste se reconstitue en partis influençant effectivement les masses, conditions dont Trotski ou bien ne tenait pas compte, ou dont une analyse erronée des perspectives lui faisait admettre l'existence dans la situation en cours. D'une part elle établissait (s’appuyant sur l'expérience de la fraction bolchevique) que le cours déformation du parti était essentiellement un cours où, la lutte de classe se livrant dans des conditions révolutionnaires, les prolétaires étaient amenés à se regrouper autour d'un programme marxiste restauré contre l'opportunisme et défendu jusque là par une minorité."
Comme on le voit, le PCInt lui-même dans ses textes officiels de 1946, ne s'écartait pas d'une virgule de la position sur cette question de la Fraction, dont, par ailleurs, il revendiquait officiellement les positions politiques. Celle qui, au contraire, s'en écarte si rapidement qu'elle en devient insaisissable, c'est bien Battaglia qui, dans la même discussion, réussit à aligner au moins quatre positions différentes. La concomitance entre reprise de la lutte de classe et reconstruction du Parti est en fait qualifiée par BC de :
a) somme toute "hypothétisable", de 1927 à 1935 ;
b) "fataliste" et "dans ses grandes lignes, mécaniciste", s'il s'agit de la Fraction entre 1935 et 1945 ;
c) tout à fait correcte, c'est ce qui ressort des textes, s'il s'agit du PCInt en 1946 ;
d) redevient "une conception anti-dialectique et liquidatrice" dans la nouvelle Plate-forme approuvée par Battaglia en 1952, dont on parlera plus en détail dans un second article. Mais laissons de côté les zigzags intéressés de Battaglia, et retournons au congrès de 1935.
LE DEBAT DE 1935 : FATALISME OU VOLONTARISME
De ce qui est écrit plus haut, on peut voir que ce n'est pas la majorité du congrès qui a introduit de nouvelles positions, mais la minorité qui a remis en question celles de toujours, en reprenant les formulations des adversaires politiques de la Fraction. Ainsi, Gatto accuse de "fatalisme' un rapport qui cependant répondait aux accusations de fatalisme qui étaient lancées à la Fraction par ceux-là qui, trotskystes en tête, refusaient le travail de fraction pour l'illusion de "mobiliser les masses". Piero affirme que "notre orientation doit changer, nous devons rendre notre presse plus accessible aux ouvriers", en faisant concurrence aux pseudo "ouvriers de l'opposition", spécialistes pour "accrocher les masses" moyennant l'adulation systématique de leurs illusions. Tullio tire des conclusions logiques en apparence : "si nous disons que quand il n'y a pas de parti de classe, il manque la direction, nous voulons dire que celle-ci est indispensable même dans les périodes de dépression", publiant cependant que Bilan avait déjà répondu à Trotsky :
"De la formule, la Révolution est impossible sans Parti communiste, on tire la conclusion simpliste qu'il faut déjà dès maintenant construire le nouveau Parti. C'est comme si des prémisses : sans insurrection, on ne peut plus défendre les revendications élémentaires des travailleurs, on déduisait lé nécessité de déchaîner immédiatement l'insurrection." (Bilan n°l.)
En réalité, ce qui ne tient pas, c'est la tentative de Battaglia de présenter le débat comme une confrontation entre ceux qui veulent le Parti déjà bien trempé au moment des affrontements révolutionnaires et ceux qui veulent l'improviser au dernier moment. La majorité du Congrès, à qui était posée l'alternative ridicule : "mais est-il nécessaire d'attendre que lies événements révolutionnaires se présentent pour passer à la fondation du nouveau parti, ou, inversement, ne serait-il pas mieux que les événements se manifestent avec la présence du parti " avait déjà répondu une fois pour toutes : "Si, pour nous, ce problème se limitait à un simple problème de volonté, nous serions tous d'accord et il n'y aurait personne qui s'efforcerait de discuter."
Le problème qui était posé au Congrès n'était pas un problème de volonté, mais de volontarisme, comme les années suivantes 1'ont démontré.
LE DEBAT DE 1935-37 : VERS LA GUERRE IMPERIALISTE OU VERS LA REPRISE DE CLASSE
En présentant le débat de 1935 comme une confrontation entre ceux qui voulaient le parti indépendamment des conditions objectives et ceux qui se "réfugiaient" dans l'attente de telles conditions, Battaglia oublie ce que la Préface de 1946 avait mis au clair, c'est que : "les constructeurs de Parti" ne se limitent pas à sous-estimer ou à ignorer les conditions objectives, mais ils sont aussi, nécessairement poussés "à admettre l'existence de telles conditions, sur la base d'une fausse analyse des perspectives." Et c'est justement cela le centre de la discussion en 1935, qui semble échapper complètement à Battaglia. La minorité activiste ne se borne pas à affirmer son "désaccord sur la constitution du parti seulement en période de reprise prolétarienne", mais est nécessairement contrainte de développer une fausse analyse des perspectives qui lui permette d'affirmer que s'il n'y a pas encore de véritable reprise prolétarienne, il y a cependant les premiers mouvements annonciateurs dont il faut prendre la direction, et ainsi de suite. Au congrès, cette remise en discussion des analyses de la Fraction sur le cours à la guerre impérialiste n'a pas été développée ouvertement par la minorité qui, probablement, ne se rendait pas encore bien compte de là où sa manie de fonder des partis devait nécessairement la conduire. Cette ambiguïté explique qu'à côté des activistes déclarés, provenant en grande partie du défunt "Réveil communiste", se trouvaient des camarades comme Tullio et Gatto Mammone, qui se sépareront de la minorité dès que le véritable objet de la discussion deviendra clair. Mais si la minorité ne révèle pas encore l'étendue de ses divergences (approuvant le rapport de Jacobs à l'unanimité), les éléments les plus lucides de la majorité en voient déjà toute l'ampleur :
"Il est facile d'apercevoir cette tendance, quand on examine la position soutenue par des camarades envers de récents conflits de classe, où ceux-ci défendirent que la fraction pouvait assurer également, dans la phase actuelle de décomposition du prolétariat, une fonction de direction dans ce mouvements, faisant par là abstraction du véritable rapport entre les forces" (Eieri)
"Ainsi, comme la discussion Va prouvé, on pourrait croire que nous puissions intervenir dans les événements actuels de désespoir (Brest-Toulon) pour en diriger le cours (...) Croire que la fraction puisse diriger des mouvements de désespoir prolétarien, c'est compromettre son intervention dans les événements de demain." (Jacobs)
Les mois suivant le Congrès voient une polarisation grandissante des deux tendances. Ainsi, Bianco, dans son article "Un peu de clarté, s'il vous plaît" (Bilan n° 28, janvier 1936), dénonce-t-il le fait que des membres de la minorité déclarent désormais ouvertement qu'ils rejettent le rapport de Jacobs qu'ils venaient à peine d'approuver, et attaque en particulier : "le camarade Tito qui est prolixe en gros mots comme 'changer de ligne' ; ne pas se borner à être présents 'mais prendre la tête, la direction du mouvement de renaissance communiste' : d'abandonner, en vue de former un organisme international, tout 'apriorisme obstructionniste' et 'nos scrupules de principe'. "
Les regroupements définitifs se font désormais jour (même si Vercesi dans le même numéro de Bilan tente de minimiser la portée des divergences). Déjà dans le numéro précédent du journal en langue italienne, Prometeo,Gatto avait pris ses distances avec la minorité, réaffirmant que "la Fraction s'exprimera comme parti dans le feu des événements" et pas avant que le prolétariat ne déchaîne "sa bataille émancipatrice."
Mais pour comprendre l'ampleur des errements que la minorité se préparait à faire, il faut prendre un peu de recul et considérer le rapport de force entre les classes dans ces années décisives et l'analyse qu'en faisaient les différentes forces de gauche. La Gauche italienne caractérisait la période comme contre-révolutionnaire se basant sur la dure réalité des faits : 1932, éradication politique des réactions au stalinisme, avec l'exclusion hors de l'Opposition de Gauche, de la Gauche italienne et des autres forces qui ne s'accommodaient pas des zigzags de Trotski ; 1933, écrasement du prolétariat allemand ; 1934, écrasement du prolétariat espagnol des Asturies ; 1935, écrasement du prolétariat autrichien, embrigadement du prolétariat français derrière le drapeau tricolore de la bourgeoisie. Face à cette course folle vers un massacre mondial, Trotski fermait les yeux pour maintenir le moral des troupes. Pour lui, jusqu'en 1933, le PC allemand pourri était toujours "la clé de la Révolution mondiale" ; et, si en 1933, le PC allemand s'écroulait face au nazisme, alors, ça voulait dire que la voie était dégagée pour fonder un nouveau parti, aussi bien qu'une nouvelle internationale, et si les militants contrôlés par le stalinisme n'y étaient pas, alors c'était l'aile gauche de la social-démocratie qui "évoluait vers le communisme", et ainsi de suite... Le manoeuvriérisme opportuniste de Trotski suscita donc des scissions à gauche de groupes de militants qui se refusaient à le suivre sur cette voie (Ligue des Communistes Internationalistes en Belgique, Union Communiste en France, Revolutionary Workers League en Amérique, etc.). Jusqu'en 1936 de tels groupes paraissaient se situer à mi-chemin entre la rigueur de la Gauche italienne et les acrobaties de Trotski. L'épreuve de 1936 prouvera que leur solidarité avec le trotskysme était beaucoup plus solide que leurs divergences. 1936 représente, dans les faits, le dernier sursaut désespéré de classe du prolétariat européen : entre mai et juillet, se succédèrent les occupations d'usines en France, la vague de lutte en Belgique, la réponse de classe du prolétariat de Barcelone au coup de Franco, à la suite de laquelle les ouvriers resteront pendant une semaine entière maîtres de la Catalogne. Mais c'est le dernier soubresaut. En l'espace de quelques semaines, le capitalisme réussit non seulement à circonscrire ces réactions, mais même à les dénaturer complète ment, en les transformant en des moments d'Union Sacrée pour la défense de la démocratie. Trotski ignore cette récupération, lui qui proclame que "la Révolution est commencée en France" et qui pousse le prolétariat espagnol à s'enrôler comme chair à canon dans les milices antifascistes pour défendre la république. Toutes les dissidences de gauche, de la LCI à l'UC, de RWL à une bonne partie des communistes de conseils s'y laissent prendre, au nom de "la lutte armée contre le fascisme", La minorité même de la Fraction italienne adhère dans les faits aux analyses de Trotski, proclamant qu'en Espagne, la situation reste "objectivement révolutionnaire" et que dans les zones contrôlées par les milices on pratique la collectivisation "sous le nez des gouvernements de Madrid et de Barcelone" (Bilan n°36, Documents de la minorité). L'Etat bourgeois survit et renforce son contrôle sur les ouvriers ? Il ne s'agit que d'une "façade", d'une "enveloppe vide, un simulacre, un prisonnier de la situation " parce que le prolétariat espagnol, en soutenant la République bourgeoise, ne soutient pas l'Etat, mais la destruction prolétarienne de l'Etat. En cohérence avec cette analyse, beaucoup de ses membres se rendirent en Espagne pour s'enrôler dans les milices antifasciste gouvernementales. Pour Battaglia, ces sauts périlleux à 360° veulent dire rester "cohérents avec eux-mêmes dans le plus complet immobilisme." Etrange conception de la cohérence de l'immobilisme
En réalité, la minorité a abandonné le cadre d'analyse de la Fraction, pour reprendre intégralement les acrobaties dialectiques de Trotski, contre lesquelles la Fraction avait déjà écrit, à l'occasion du massacre des mineurs dans les Asturies par la République démocratique en 1934 :
"Le terrible massacre de ces derniers jours en Espagne devrait mettre fin aux jeux d' équilibristes selon lesquels la République est certainement 'une conquête ouvrière' à défendre,mais à 'certaines conditions' et surtout dans 'la mesure où' elle n'est pas ce qu'elle est, ou à la condition qu'elle 'de vienne' ce qu'elle ne peut devenir, ou enfin, si, loin d'avoir la signification et les objectifs qu'elle a effectivement, elle s'apprête à devenir l'organe de la domination de la classe travailleuse. " (Bilan n° 12, octobre 1934.)
LA LIGNE DE PARTAGE HISTORIQUE DES ANNEES 1935-37
Seule la majorité de la Fraction italienne (et une minorité des communistes de conseils) restait sur la position défaitiste de Lénine face à la guerre impérialiste d'Espagne. Mais ce n'est que la Fraction qui tire toutes les leçons de ce tournant historique, en niant qu'il existerait encore des situations d'arriération où on pourrait lutter transitoirement pour la démocratie, ou pour la libération nationale, et en caractérisant comme bourgeoise et comme instrument de la guerre impérialiste toute forme de milice partisane antifasciste. Il s'agit de la position politique indispensable pour rester internationaliste dans le massacre impérialiste qui se prépare et, par conséquent, avoir les cartes en main pour contribuer à la renaissance du futur Parti communiste mondial. Les positions de la Fraction depuis 1935 (guerre sino-japonaise, guerre italo-abyssinienne) jusqu'en 1937 (guerre d'Espagne) constituent donc la ligne de partage historique qui signe la transformation de la Gauche italienne en Gauche communiste internationaliste et sélectionne les forces révolutionnaires à partir de ce moment-là.
Et quand nous parlons de sélection, nous parlons de sélection sur le terrain et pas dans les petits schémas théoriques dans la tête de quelques-uns. A la faillite en Belgique de la Ligue des Communistes répond l'apparition d'une minorité qui se constitue en Fraction belge de la Gauche communiste. A la faillite d'Union communiste en France répond la sortie de quelques militants qui adhèrent à la Fraction italienne et qui seront à l'origine, en pleine guerre impérialiste, de la Fraction française de la Gauche communiste. A la faillite en Amérique de la Revolutionary Workers League et de la Liga Comunista mexicaine correspond la rupture d'un groupe de militants mexicains et immigrés oui se constituent en Groupe des travailleurs marxistes sur les positions de la Gauche Communiste Internationale. Aujourd'hui encore, seuls ceux qui se situent en continuité absolue avec ces positions de principe, sans distinguo ou recherche d'une "troisième voie", ont aujourd'hui les bonnes cartes pour contribuer à la renaissance du Parti de classe.
Le CCI, comme on le sait, revendique intégralement cette délimitation programmatique. Mais quelle est la position de Battaglia ?
"Les événements de la Révolution espagnole ont mis en évidence les points forts comme les points faibles de notre propre tendance : la majorité de Bilan apparaît comme attachée à une formule, théoriquement impeccable qui a cependant le défaut de rester une abstraction simpliste ; la minorité apparaît, de son côté, dominée par le souci d'emprunter, de toute façon, le chemin d'un participationnisme qui n'a pas toujours été assez prudent pour éviter les pièges du jacobinisme bourgeois, même quand on est sur les barricades.
Puisqu'il existait la possibilité objective, nos camarades de Bilan auraient dû poser le problème, le même que devait poser plus tard notre parti face au mouvement de partisans, en appelant les ouvriers qui s'y battaient à ne pas tomber dans le piège de la stratégie de la guerre impérialiste"
Cette position que nous citons d'un numéro spécial de Prometeo consacré à la Fraction en 1958, n'est pas accidentelle, mais a été réaffirmée plusieurs fois, même récemment ([2] [21]) Comme on le voit, Battaglia se détermine pour une troisième voie, éloignée autant des abstractions de la majorité que de la participation de la minorité. Mais s'agit-il vraiment d'une troisième voie ou d'une reprise pure et simple des positions de la minorité ?
LA GUERRE D'ESPAGNE :
"PARUCIPATIONNISME"
OU "DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE" ?
Quelle est l'accusation portée à la majorité ? D'être restée inerte face aux événements, de s'être contentée d'avoir raison en théorie, sans cependant se donner la peine d'intervenir pour défendre une orientation correcte parmi les ouvriers espagnols. Cette accusation reprend mot à mot celle exprimée à ce moment-là par la minorité, les trotskystes, les anarchistes, les Poumistes, etc. : "dire aux ouvriers espagnols ce danger vous menace et ne pas intervenir nous mêmes pour combattre ce danger, c'est une manifestation d'insensibilité et de dilettantisme." (Bilan n°35, Textes de la minorité). Une fois établi que les accusations sont identiques, il faut encore dire qu'il s'agit de mensonges éhontés. La majorité s'est immédiatement mise à combattre aux côtés du prolétariat espagnol sur le front de classe, et pas dans les tranchées. Si on veut faire la différence avec la minorité, c'est que cette dernière a abandonné l'Espagne à la fin de 1936, tandis que la majorité y continuait son activité politique, jusqu'en mai 1937, quand son dernier représentant, Tulho, retourne en France, pour annoncer à la Fraction et aux ouvriers du monde entier que la République antifasciste en était venue à massacrer directement les prolétaires en grève à Barcelone.
Certes la présence de la majorité était plus discrète que celle des minoritaires qui avaient à leur disposition pour leurs communiqués la presse du Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM) de gouvernement, et qui devenaient généraux de brigade sur le front d'Aragon, comme leur porte-parole Condiari. Mitchell, Tullio, Candali, qui représentaient la majorité, agissaient au contraire dans la plus stricte clandestinité, avec le risque constant d'une arrestation par les escouades staliniennes -qui les recherchaient, d'être dénoncés par le POUM ou des anarchistes qui les considéraient plus ou moins comme des espions fascistes. Dans ces terribles conditions, ces camarades continuèrent à combattre pour soustraire au moins Quelques militants à la spirale de la guerre impérialiste, affrontant non seulement les risques mais aussi l'hostilité et le mépris des militants avec qui ils discutaient. Même les éléments les plus lucides, comme l'anarchiste Bemeri (ensuite assassiné par les staliniens) étaient déboussolés par l'idéologie au point de se faire les promoteurs de l'extension du régime d'économie de guerre - et de la militarisation de la classe qui en découlait - à toutes les usines plus ou moins grandes, et étaient totalement incapables de comprendre où se trouvait la frontière de classe, jusqu'à écrire que "les trotskystes, les bordiguistes, les staliniens, ne sont divisés que sur quelques conceptions tactiques". (Guerre de classe, octobre 1936). Malgré le fait que toutes les portes se soient claquées devant eux, les camarades de la majorité continuaient à frapper à r toutes les portes : c'est ainsi qu'en sortant d'une énième discussion infructueuse au local du POUM, ils trouvèrent les "killers" staliniens qui les attendaient et qui par pur hasard ne réussirent pas à les éliminer.
Notons au passage que la minorité qui en 1935 criait que le Parti devait être prêt à l'avance par rapport aux affrontements de classe théorise alors qu'en Espagne, c'est la révolution et qu'elle va vaincre, sans même une once de parti de classe. Au contraire, la majorité considère le parti comme le centre de son analyse et déclare qu'il ne peut y avoir de révolution en cours, étant donné qu'il ne s'est formé aucun parti et qu'il n'y a même pas la moindre tendance à l'apparition de petits noyaux qui iraient dans ce sens, malgré l'intense propagande faite par la fraction dans ce but. Ce n'était pas dans la majorité que se trouvaient ceux qui sous-estimaient l'importance du Parti... et de la Fraction. Face au naufrage de la minorité, qui à la fin eut l'illusion de trouver le parti de classe au sein du POUM, parti de gouvernement, on peut mesurer toute la justesse des mises en garde de la majorité au congrès de 1935, sur le danger d'en arriver "à dénaturer les principes mêmes de la Fraction."
Pour Battaglia, la minorité s'est rendue coupable d'un "participationnisme pas toujours (!) Assez prudent pour éviter les pièges bourgeois." Que veut dire une formulation aussi vague ? La différence entre la majorité et la minorité réside justement en ceci, que la première est intervenue pour convaincre au moins une avant-garde réduite de déserter la guerre impérialiste, alors que la seconde est intervenue pour y participer, à travers l'enrôlement volontaire dans les milices gouvernementales. Certes, Battaglia posséderait un atout extraordinaire dans sa manche si elle connaissait un moyen de participer à la guerre impérialiste qui soit tellement "prudent" que cela ne fasse pas le jeu de la bourgeoisie... Qu'est-ce que ça veut dire que la majorité aurait dû se comporter comme l’a fait ensuite le PCInt "face au mouvement des partisans" ? Cela signifie peut-être qu'elle aurait dû lancer l'appel au "front unique" aux partis staliniens, socialistes, anarchistes et poumistes, comme le PCInt l'a fait en 1944, en proposant le front unique aux Comités d'Agitation des PCI, PSI, PRI et anarcho-syndicalistes ? Battaglia pense probablement que "puisque les conditions objectives existaient", de telles propositions "concrètes" auraient permis à la Fraction de faire sortir de son chapeau de magicien le parti qui manquait tant. Espérons que Battaglia n'ait pas d'autres atouts dans sa manche, d'autres expédients miraculeux capables de transformer une situation objective contre-révolutionnaire en son exact contraire, chose certainement possible, "mais à certaines conditions" et surtout "dans la mesure où elle n’est pas ce qu'elle est", ou à la condition qu'elle "devienne ce qu'elle ne peut devenir" (Bilan n°12.)
Le problème est autre, c'est que Battaglia s'éloigne de la Fraction, dont elle se réclame pourtant, au moins sur deux points essentiels, les conditions pour la fondation de nouveaux partis et l'attitude à avoir, en période globalement contre-révolutionnaire, dans la confrontation avec des formations à façade prolétarienne, comme les milices antifascistes. Dans le prochain article, qui traitera de la période de 1937 à 1952, nous venons comment ces incompréhensions se manifestent ponctuellement dans la fondation du PCInt en 943 et dans 'ambiguïté de son attitude envers les partisans.
En nous penchant sur cette période tragique pour le mouvement ouvrier, nous démontrerons en outre combien est fausse l'affirmation de Battaglia qui dénie à un organe comme la Fraction toute capacité d'offrir à la "classe un minimum d'orientation politique dans les périodes les plus dures et délicates."([3] [22])
Beyle
[1] [23] Sur la Guerre d'Espagne, voir les articles dans la Revue Internationale n*50 et 54. Sur la Fraction italienne et ses positions politiques, voir les divers articles et documents publiés dans la Revue Internationale, et notre livre "La gauche communiste d'Italie. Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire" paru en français et italien (et prochainement en espagnol) ainsi que son "Complément" traitant des "Rapports entre la fraction de gauche du P.C. d'Italie et l'opposition de gauche internationale, 1929-1933".
[2] [24] Dans l'article "Le CCI et le cours historique", BC n*3, 1987, Battaglia force la dose : "la Fraction (...) évaluait dans les années 30 la perspective de la guerre comme un absolu", ce qui l'aurait conduite "à commettre des erreurs politiques", comme "la liquidation de toute possibilité d'intervention révolutionnaire en Espagne avant même que le prolétariat n'ait été défait."
[3] [25] Ces attaques à la Fraction, du nom de laquelle Battaglia se revendique, sont d'autant plus significatives qu'elles se produisent à un moment où différents groupes bordiguistes commencent à redécouvrir la Fraction après le silence entretenu par Bordiga (voir les articles parus dans "Il Comunista" de Milan, et la republication par "Il Partito Comunista" de Florence, du manifeste de la Fraction sur la Guerre d'Espagne). Battaglia et les bordiguistes en seraient-ils à s'échanger leurs rôles ?
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [26]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [27]