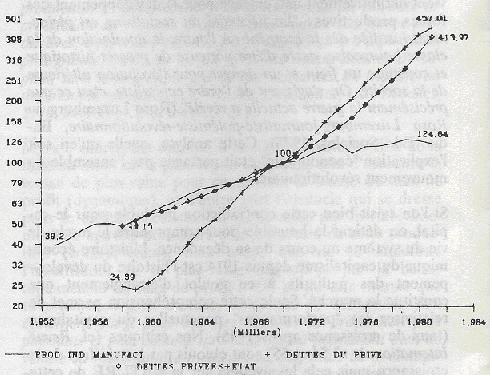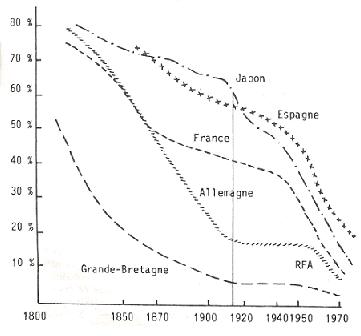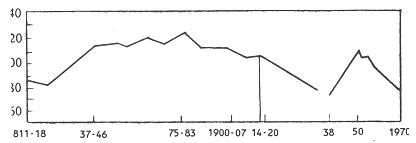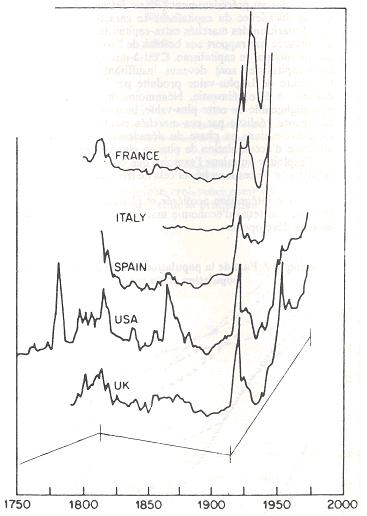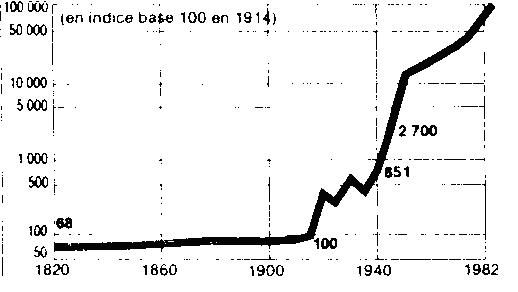Revue Internationale no 56 - 1e trimestre 1989
- 2794 reads
Editorial : FRANCE : les "coordinations" à l'avant-garde du sabotage des luttes
- 2671 reads
Les mouvements sociaux qui agitent la France depuis plusieurs mois dans presque toutes les branches du secteur public constituent une illustration éclatante de la perspective mise en avant par le CCI depuis de nombreuses années : face aux attaques de plus en plus brutales et massives d'un capital plongé dans une crise insurmontable (voir dans ce n° l'article sur la situation économique), la classe ouvrière mondiale n'est pas résignée, bien au contraire. Le profond mécontentement qu'elle a accumulé se transforme maintenant en une énorme combativité qui contraint la bourgeoisie à déployer des manoeuvres de plus en plus vastes et subtiles pour ne pas être débordée. Ainsi en France, elle a mis en oeuvre un plan très élaboré qui faisait appel non seulement aux différentes formes de syndicalisme (syndicalisme "traditionnel" et syndicalisme "de base") mais encore et surtout à des organes qui se prétendent encore plus "à la base" (puisqu'ils sont sensés s'appuyer sur les assemblées générales de travailleurs en lutte), les "coordinations", dont l'utilisation dans le sabotage des luttes ne va pas s'arrêter de sitôt.
Jamais, depuis de nombreuses années, "rentrée sociale" en France n'avait été aussi explosive que celle de l'automne 88. Depuis le printemps, il était clair que d'importants affrontements de classe se préparaient. Les luttes qui s'étaient déroulées entre mars et mai 88 dans les entreprises "Chausson" (construction de camions) et SNECMA (moteurs d'avions) avaient fait la preuve que la période de relative passivité ouvrière qui avait suivi la défaite de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 et janvier 87 était bien terminée. Le fait que ces mouvements aient éclaté et se soient développés alors que se déroulaient les élections présidentielles et législatives (pas moins de 4 élections en deux mois) était particulièrement significatif dans un pays où traditionnellement ce type de période est synonyme de calme social. Et cette fois-ci, le Parti socialiste revenu au pouvoir ne pouvait espérer aucun "état de grâce" comme en 81. D'une part les ouvriers avaient déjà appris entre 81 et 86 que l'austérité "de gauche" ne vaut pas mieux que celle "de droite". D'autre part, dès son installation, le nouveau gouvernement avait clairement mis les points sur les i : il était hors de question de remettre en cause la politique économique appliquée par la droite durant les deux années précédentes. Et elle avait mis à profit les mois d'été pour aggraver cette politique.
C'est pour cela que la combativité ouvrière que le cirque électoral du printemps avait partiellement paralysée ne pouvait manquer d'exploser dès l'automne en des luttes massives, en particulier dans le secteur public où les salaires avaient baissé de près de 10% en quelques années. La situation était d'autant plus menaçante pour la bourgeoisie que depuis les années du gouvernement PS-PC (81-84), les syndicats avaient subi un discrédit considérable et n'étaient plus en mesure dans beaucoup de secteurs de contrôler à eux seuls les explosions de colère ouvrière. C'est pour cette raison qu'elle a mis en place un dispositif visant à émietter, à disperser les combats de classe, où évidemment les syndicats avaient leur place, mais dont le premier rôle serait tenu pendant toute la phase initiale par des organes "nouveaux", "non syndicaux", "vraiment démocratiques" : les "coordinations".
UNE NOUVELLE ARME DE LA BOURGEOISIE CONTRE LA CLASSE OUVRIERE : LES "COORDINATIONS"
Le terme de "coordination" a été employé déjà en de multiples reprises ces dernières années dans différents pays d'Europe. Ainsi nous avons connu, au milieu des années 80 en Espagne, une "Coordinadora de Estibadores" (Coordination de dockers) ([1] [1]) dont le langage radical et la très grande ouverture (notamment en permettant aux révolutionnaires d'intervenir dans ses assemblées) pouvait faire illusion, mais qui n'était pas autre chose qu'une structure permanente du syndicalisme de base. De même, nous avons vu se constituer en Italie, au cours de l'été 87, un "Coordinamento di Macchinisti" (Coordination des conducteurs de train), qui s'est révélé rapidement comme étant de même nature. Mais la terre d'élection des "coordinations" est incontestablement, à l'heure actuelle, la France où, depuis l'hiver 86-87, toutes les luttes ouvrières importantes ont vu se manifester des organes portant ce nom :
- "coordinations" des "agents de conduite" (dite de Paris-Nord) et "intercatégorielle" (dite de Paris Sud-Est) lors de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 ([2] [2]);
- "coordination des instituteurs" lors de la grève de cette catégorie en février 87 ;
- "coordination Inter-SNECMA" lors de la grève dans cette entreprise au printemps 88 ([3] [3]).
Parmi ces différentes "coordinations", certaines sont de simples syndicats, c'est-à-dire des structures permanentes prétendant représenter les travailleurs dans la défense de leurs intérêts économiques. Par contre, d'autres de ces organes n’on pas à priori la vocation de se maintenir de façon permanente? Ils surgissent, ou apparaissent au grand jour, au moment des mobilisations de la classe ouvrière dans un secteur et disparaissent avec elles. Il en a été ainsi, par exemple des coordinations qui avaient surgi lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 86. Et c'est justement ce caractère "éphémère" qui, en donnant l'impression qu'ils sont des organes constitués par la classe spécifiquement pour et dans la lutte, qui les rend d'autant plus pernicieux.
En réalité, l'expérience nous a montré que de tels organes, quand ils n'étaient pas préparés de longs mois à l'avance par des forces politiques précises de la bourgeoisie, étaient "parachutés" par celles-ci sur un mouvement de luttes en vue de son sabotage. Déjà dans la grève des chemins de fer en France, nous avions pu constater comment la "coordination des agents de conduite", en fermant complètement ses assemblées à tous ceux qui n'étaient pas conducteurs, avait contribué de façon très importante à l'isolement du mouvement et à sa défaite. Or cette "coordination" s'était constituée sur la base de délégués élus par les assemblées générales des dépôts. Pourtant, elle avait été immédiatement contrôlée par des militants de la "Ligue Communiste" (section de la 4ème Internationale trotskiste) qui, évidemment, ont pris en charge le sabotage de la lutte comme c'est leur rôle. Mais avec les autres "coordinations" qui ont surgi par la suite, déjà avec la "coordination inter catégorielle des cheminots" (qui prétendait combattre l'isolement corporatiste), et plus encore avec la "coordination des instituteurs" qui est apparue quelques semaines après, on a constaté que ces organes étaient constitués de façon préventive avant que les assemblées générales n'aient commencé à envoyer des délégués. Et à l'origine de cette constitution on retrouvait toujours une force bourgeoise de gauche ou gauchiste preuve que la bourgeoisie avait compris le parti qu'elle pouvait tirer de ces organismes.
Mais l'illustration la plus claire de cette politique bourgeoise nous a été donnée par la constitution et les agissements de la "Coordination Infirmière" à qui la bourgeoisie a confié le rôle principal dans la première phase de sa manoeuvre : le déclenchement de la grève dans les hôpitaux en octobre 88. En fait cette "coordination" avait été constituée dès mars 88, dans les locaux du syndicat socialisant CFDT, par des militants de celui-ci. Ainsi, c'est directement le Parti socialiste, qui s'apprêtait à revenir au pouvoir, qui a porté sur les fonts baptismaux cette soi-disant organisation de lutte des travailleurs. Le déclenchement de la grève elle-même porte la marque de l'action du parti socialiste et donc du gouvernement. Il s'agissait pour la bourgeoisie (non pas ses forces d'appoint comme les gauchistes, mais directement ses forces dominantes, celles qui se trouvent au sommet de l'Etat) de lancer un mouvement de lutte dans un secteur particulièrement arriéré sur le plan politique afin de pouvoir "mouiller la poudre" du mécontentement qui s'accumulait depuis des années dans l'ensemble de la classe ouvrière. Il est clair que les infirmières qui allaient involontairement constituer l'infanterie de cette manoeuvre bourgeoise avaient elles aussi de réelles raisons d'exprimer leur mécontentement (des conditions de travail invraisemblables qui ne cessaient de s'aggraver et des salaires de misère). Mais l'ensemble des événements qui se sont déroulés sur plus d'un mois permet de mettre en évidence la réalité du plan bourgeois destiné à établir un contre-feu face à la montée du mécontentement ouvrier.
LES AGISSEMENTS DES "COORDINATIONS" DANS LA GREVE DES HOPITAUX EN FRANCE
En choisissant les infirmières pour développer sa manoeuvre, la bourgeoisie savait ce qu'elle faisait. C'est un secteur parmi les plus corporatistes qui soient, où le niveau de diplômes et de qualification requis a permis l'introduction de préjugés très forts et un certain mépris vis-à-vis d'autres personnels hospitaliers (aides soignantes, ouvriers de l'entretien, etc.) considérés comme "subalternes". De plus, en France, l'expérience de lutte est très faible dans ce secteur. L'ensemble de ces éléments donnait à la bourgeoisie la garantie qu'elle pourrait contrôler globalement le mouvement sans crainte de débordements significatifs, et en particulier que les infirmières ne pourraient en aucune façon constituer le fer de lance de l'extension des luttes.
Cette garantie était renforcée par la nature et la forme des revendications mises en avant par la "Coordination infirmière". Parmi celles-ci, la revendication d'un "statut" et de la "revalorisation de la profession" recouvrait en réalité la volonté de mettre en avant la "spécificité" et la "qualification particulière" des infirmières vis-à-vis des autres travailleurs de l'hôpital. De plus cette revendication contenait l'exigence répugnante de n'accepter dans les écoles d'infirmières que des élèves ayant leur baccalauréat. Enfin, dans la même démarche élitiste, la revendication d'une augmentation de 2 000 francs par mois (qui représentait de 20 à 30 %) était rattachée au niveau d'études des infirmières (baccalauréat < plus 3 ans), ce qui voulait dire que les autres travailleurs hospitaliers moins qualifiés, et encore moins payés, n'avaient aucune raison d'avoir les mêmes exigences et cela d'autant plus que, sans le prendre officiellement à son compte évidemment, la "Coordination" faisait et laissait dire qu'il ne fallait pas que les autres catégories revendiquent des augmentations de salaire car cela serait déduit des augmentations des infirmières.
Un autre indice de la manoeuvre est le fait que c'est dès le mois de juin que le noyau initial de la "Coordination infirmière" a planifié le début du mouvement pour le 29 septembre avec une journée de grève et une grande manifestation dans la capitale. Cela donnait le temps à la "Coordination" de bien se structurer et d'élargir son assise avant l'épreuve du feu. Ce renforcement de la capacité de contrôle des travailleurs par la "Coordination" s'est poursuivi dès la fin de la manifestation par une assemblée de plusieurs milliers de personnes où les membres de sa direction se sont présentés pour la première fois en public. Cette assemblée a constitué une première légitimation a posteriori de la "Coordination" où elle a "magouillé" du mieux possible pour empêcher que la grève ne démarre immédiatement, tant qu'elle n'aurait pas bien "les choses en main". Elle lui a permis également de bien affirmer sa "spécificité infirmière", notamment en "encourageant" les autres catégories qui avaient participé à la manifestation (preuve de l'énorme "ras-le-bol" existant), et qui se trouvaient dans la salle, à créer leurs "propres coordinations". Ainsi était mis en place le dispositif qui allait permettre un émiettement systématique de la lutte au sein des hôpitaux, de même que son isolement à l'intérieur de ce secteur. Les "coordinations" qui allaient se créer à partir du 29 septembre dans la foulée de la "Coordination infirmière" (pas moins de 9 dans le seul secteur de la santé) se sont chargées de compléter le travail de division de celle-ci parmi les hospitaliers, alors qu'il revenait à une "coordination des personnels de santé" (créée et contrôlée par le groupe trotskiste "Lutte ouvrière"), qui se voulait "ouverte" à toutes les catégories, d'encadrer les travailleurs qui rejetaient le corporatisme des autres "coordinations" et de paralyser toute tentative de leur part d'élargir le mouvement en dehors de l'hôpital.
Le fait que ce soit une "coordination" et non un syndicat qui ait lancé le mouvement (alors qu'elle avait été constituée par des syndicalistes), n'est évidemment pas le fait du hasard. En réalité, c'était le seul moyen permettant une mobilisation importante compte tenu du discrédit considérable que subissent en France les syndicats, notamment depuis le gouvernement de la "gauche unie" entre 1981 et 1984. Ainsi, les "coordinations" ont comme fonction d'assurer cette "mobilisation massive" qui est ressentie par tous les ouvriers comme une nécessité pour faire reculer la bourgeoisie et son gouvernement. Cette mobilisation massive, il y a un bon moment déjà que les syndicats ne l'obtiennent plus derrière leurs "appels à la lutte". En fait, dans de nombreux secteurs, il suffit souvent qu'une "action" soit appelée par tel ou tel syndicat, pour qu'un nombre important d'ouvriers considère que c'est une manoeuvre destinée à servir les intérêts de chapelle de ce syndicat et décide de s'en détourner. Cette méfiance, et le faible écho que rencontrent les appels syndicaux, ont d'ailleurs été souvent employés par la propagande bourgeoise pour faire entrer dans la tête des ouvriers l'idée d'une "passivité" de la classe ouvrière en vue de développer en son sein un sentiment d'impuissance et de démoralisation. Ainsi, seul un organisme ne portant pas l'étiquette syndicale était en mesure d'obtenir au sein de la corporation choisie par la bourgeoisie comme principal terrain de sa manoeuvre, une "unité", condition d'une participation massive derrière ses appels. Mais cette "unité" que la "Coordination infirmière" prétendait être seule à garantir contre les habituelles "chamailleries" entre les différents syndicats n'était que le revers de l'écoeurante division qu'elle a promue et renforcée parmi les travailleurs de l'hôpital. L'"anti-syndicalisme" qu'elle a affiché s'accompagnait de l'argument crapuleux suivant lequel les syndicats ne défendent pas les intérêts des travailleurs justement parce qu'ils sont organisés non par profession mais par secteur d'activité. Un des thèmes majeurs mis en avant par la "Coordination" pour justifier l'isolement corporatiste était que les revendications unitaires avaient pour résultat de "diluer" et "d'affaiblir" les revendications "propres" aux infirmières. Cet argument n'est pas nouveau. Il nous a notamment été servi lors de la grève des chemins de fer de décembre 86 par la "coordination des agents de conduite". On le retrouve également dans le discours corporatiste tenu par le "Coordinamento di Macchinisti" dans les chemins de fer italiens en 87. En fait, au nom de la "remise en cause" ou du "dépassement" des syndicats on en revient ici à une base d'organisation qui appartenait à la classe ouvrière au siècle dernier, lorsqu'elle a commencé par constituer des syndicats de métier, mais qui dans la période actuelle ne peut être moins bourgeoise que les syndicats eux-mêmes. Alors que la seule base sur laquelle peut aujourd'hui s'organiser la classe ouvrière est la base géographique, par-delà les distinctions entre entreprises et branches d'activité (distinctions que les syndicats ne cessent évidemment de cultiver dans leur travail de division et de sabotage des luttes), un organisme qui se constitue spécifiquement sur la base de la profession ne peut se situer que dans le camp bourgeois.
On voit ainsi le piège dans lequel les "coordinations" se proposent d'enfermer les ouvriers : ou bien ils "marchent" derrière les syndicats (et dans les pays où il existe le "pluralisme syndical" ils deviennent les otages des différents gangs qui entretiennent leurs divisions) ou bien ils se détournent des syndicats mais c'est pour se diviser d'une autre façon. En fin de compte les "coordinations" ne sont pas autre chose que le complément des syndicats, l'autre mâchoire de l'étau qui vise à emprisonner la classe ouvrière.
LE PARTAGE DU TRAVAIL ENTRE LES "COORDINATIONS" ET LES SYNDICATS
Cette complémentarité entre le travail des syndicats et celui des "coordinations" s'est révélée de façon claire dans les deux mouvements les plus importants qui se sont déroulés en France ces deux dernières années : dans les chemins de fer et dans les hôpitaux. Dans le premier cas, le rôle des "coordinations" s'est réduit essentiellement à "contrôler le terrain" en laissant le soin aux syndicats de mener les négociations avec le gouvernement. En cette circonstance elles ont d'ailleurs joué un rôle utile de rabatteurs pour le compte des syndicats en affirmant bien fort qu'elles ne leur contestaient nullement la responsabilité de "représenter" les travailleurs auprès des autorités (elles ont tout juste réclamé sans succès d'avoir un petit strapontin à la table de négociation). Dans le second cas, alors que les syndicats étaient bien plus contestés, la "Coordination infirmière" a été finalement gratifiée d'une place à part entière à cette même table. Après que le ministre de la santé ait au début refusé de la recevoir (à l'issue de la première manifestation du 29 septembre), c'est par la suite le premier ministre lui-même qui, le 14 octobre, après une manifestation rassemblant près de 100 000 personnes à Paris, lui a accordé cette faveur. C'était la moindre des récompenses que le gouvernement pouvait donner à ces gens qui lui rendaient de si fiers services. Mais le partage des tâches s'est également réalisé en cette circonstance : finalement, ce 14 octobre les syndicats (à l'exception du plus "radical", la CGT contrôlée par le PC) ont signé un accord avec le gouvernement alors que la "coordination" continuait à appeler à la lutte. Soucieuse d'apparaître jusqu'au bout comme un "véritable défenseur" des travailleurs, elle n'a jamais officiellement accepté les propositions du gouvernement. Le 23 octobre, elle a enterré le mouvement à sa façon en appelant à la "poursuite de la lutte sous d'autres formes" et en organisant de temps en temps des manifestations où l'assistance de moins en moins nombreuse ne pouvait que démobiliser les travailleurs. Cette démobilisation résultait également du fait que le gouvernement, s'il n'avait rien donné aux autres catégories d'hospitaliers et s'il avait refusé toute augmentation d'effectif du personnel infirmier (une des revendications importantes), avait accordé à celui-ci des augmentations de salaire non négligeables (de l'ordre de 10 %) sur des fonds (1,4 milliard de francs) qui d'ailleurs étaient déjà prévus à l'avance dans le Budget. Cette "demi-victoire" des seules infirmières (prévue et planifiée depuis longtemps par la bourgeoisie : on avait pu voir l'ancien ministre de la santé participer aux manifestations de la "Coordination" et même Mitterrand avait déclaré que les revendications des infirmières étaient "légitimes") présentait le double avantage d'aggraver encore la division entre les différentes catégories de travailleurs de l'hôpital et d'accréditer l'idée qu'en se battant sur un terrain corporatiste, notamment derrière une "coordination", on pouvait obtenir quelque chose.
Mais la manoeuvre bourgeoise visant à désorienter l'ensemble de la classe ouvrière ne s'arrêtait pas avec la reprise du travail dans les hôpitaux. La dernière phase de l'opération débordait largement le secteur de la santé et appartenait pleinement aux syndicats que le travail des coordinations avait remis en selle. Alors que pendant toute la montée du mouvement dans la santé, les syndicats et les groupes "gauchistes" avaient fait tout leur possible pour empêcher le démarrage de grèves dans d'autres secteurs (notamment dans les postes où la volonté de lutte était très forte), à partir du 14 octobre, ils ont commencé à appeler à la mobilisation et à la grève un peu partout. C'est ainsi que le 18 octobre la CGT a convoqué une "journée d'action inter catégorielle" et que le 20 octobre les autres syndicats, rejoints au dernier moment par la CGT, ont appelé à une journée d'action dans la fonction publique. Par la suite, les syndicats, et en première ligne la CGT, ont commencé à appeler systématiquement à la grève dans les différentes branches du secteur public, les unes après les autres : postes, électricité, chemins de fer, transports urbains des villes de province puis de la capitale, transports aériens, sécurité sociale... Il s'agit pour la bourgeoisie d'exploiter à fond la désorientation créée dans la classe ouvrière par le mouvement dans les hôpitaux au moment de son reflux, pour déployer sa manoeuvre dans tous les autres secteurs. On assiste à une "radicalisation" des syndicats - CGT en tête - qui font de la "surenchère" par rapport aux "coordinations" en appelant à "l'extension", qui organisent, là où ils conservent une influence suffisante, des grèves "jusqu'auboutistes" et minoritaires, faisant appel à des "actions de commando" (comme parmi les conducteurs des camions des postes qui ont bloqué les centres de tri) ce qui a pour effet de les isoler encore plus. A l'occasion, d'ailleurs, les syndicats n'hésitent pas à se coiffer ouvertement de la casquette des "coordinations" lorsque cela peut "aider" comme ce fut le cas aux postes où la CGT a créé la sienne.
Ainsi, le partage des tâches entre "coordinations" et syndicats couvre tout le champ social : aux premières il revenait de lancer et de contrôler à la base le mouvement "phare", le plus massif, celui de la santé ; aux seconds, après qu'ils aient négocié de façon "positive" avec le gouvernement dans cette branche, il revient maintenant la responsabilité de compléter le travail dans les autres catégories du secteur public. Et en fin de compte, l'ensemble de la manoeuvre a réussi puisque, aujourd'hui, la combativité ouvrière se retrouve dispersée en de multiples foyers de lutte isolés qui ne pourront que l'épuiser, ou paralysée chez les ouvriers qui refusent de se laisser entraîner dans les aventures de la CGT.
QUELLES LEÇONS POUR LA CLASSE OUVRIERE ?
Alors que, deux mois après le début du mouvement dans les hôpitaux, les grèves se poursuivent encore en France dans différents secteurs, ce qui met bien en évidence les énormes réserves de combativité qui s'étaient accumulées dans les rangs ouvriers, les révolutionnaires peuvent déjà en tirer un certain nombre d'enseignements pour l'ensemble de la classe.
En premier lieu, il importe de souligner la capacité de la bourgeoisie d'agir de façon préventive et en particulier de "susciter le déclenchement de mouvements sociaux de façon prématurée lorsqu'il n'existe pas encore dans l'ensemble du prolétariat une maturité suffisante permettant d'aboutir à une réelle mobilisation. Cette tactique a déjà été souvent employée dans le passé par la classe dominante, notamment dans des situations où les enjeux étaient encore bien plus cruciaux que ceux de la période actuelle. L'exemple le plus marquant nous est donné par ce qui s'est passé à Berlin en janvier 1919 où, à la suite d'une provocation délibérée du gouvernement social-démocrate, les ouvriers de cette ville s'étaient soulevés alors que ceux de la province n'étaient pas encore prêts à se lancer dans l'insurrection. Le massacre de prolétaires (ainsi que la mort des deux principaux dirigeants du Parti communiste d'Allemagne : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht) qui en a résulté a porté un coup fatal à la Révolution dans ce pays où, par la suite, la classe ouvrière a été défaite paquet par paquet.
Aujourd'hui et dans les années à venir, cette tactique visant à prendre les devants pour battre les ouvriers paquet par paquet sera systématiquement employée par la bourgeoisie alors que la généralisation des attaques économiques du capital commande une riposte de plus en plus globale et unie de la part de la classe ouvrière. L'exigence de l'unification des luttes qui est ressentie de façon croissante par les ouvriers est appelée à se heurter à une multitude de manoeuvres, impliquant un partage des tâches entre toutes les forces politiques de la bourgeoisie, et particulièrement la Gauche, les syndicats et les organisations gauchistes, visant à diviser la classe ouvrière et à émietter son combat. Ce que nous confirment les événements récents en France, c'est que parmi les armes les plus dangereuses mises en oeuvre par la bourgeoisie dans la conduite de cette politique, il faut ranger les "coordinations" dont l'utilisation se fera de plus en plus fréquente à mesure que se développera le discrédit des syndicats et la volonté des ouvriers de prendre en main leurs luttes.
Face aux manoeuvres de la bourgeoisie visant à chapeauter les luttes par ces fameuses "coordinations", il appartient à la classe ouvrière de comprendre que sa force véritable ne provient pas de ces prétendus organes de "centralisation" mais, en premier lieu, de ses assemblées générales à la base. La centralisation du combat de classe constitue un élément important de sa force, mais une centralisation précipitée, lorsqu'à la base n'existe pas un niveau suffisant de prise en main de la lutte par l'ensemble des travailleurs, lorsque ne«se manifestent pas des tendances significatives à l'extension, ne peut aboutir qu'au contrôle de l'ensemble du mouvement par des forces bourgeoises (en particulier les organisations gauchistes) et à son isolement, c'est-à-dire, deux éléments de sa défaite. L'expérience historique a démontré que plus on s'élève dans la pyramide des organes créés par la classe pour centraliser son combat, que plus on s'éloigne du niveau où l'ensemble des ouvriers peut s'impliquer directement dans celui-ci, et plus les forces de gauche de la bourgeoisie ont le jeu facile pour établir leur contrôle et développer leurs manoeuvres. Cette réalité on a pu la constater même dans des périodes révolutionnaires. C'est ainsi qu'en Russie, durant la plus grande partie de l'année 1917, le Comité exécutif des soviets a été contrôlé par les mencheviks et les socialistes révolutionnaires ce qui a conduit les bolcheviks pendant toute une période à insister pour que les soviets locaux ne se sentent pas liés par la politique menée par cet organe de centralisation. De même, en Allemagne, en novembre 1918, le Congrès des Conseils ouvriers ne trouve rien de mieux à faire qu'à remettre tout le pouvoir aux sociaux-démocrates passés à la bourgeoisie, prononçant ainsi l'arrêt de mort de ces mêmes conseils.
Cette réalité, la bourgeoisie l’a parfaitement comprise. C'est pour cela qu'elle va systématiquement susciter l'apparition d'organes de "centralisation" qu'elle pourra facilement contrôler en l'absence d'une expérience et d'une maturité suffisantes de la classe. Et pour mieux se garantir, elle va le plus souvent possible, notamment par l'entremise de ses forces gauchistes, fabriquer à l’avance de tels organes qui vont par la suite se faire "légitimer" par des simulacres d'assemblées générales empêchant de cette façon que celles-ci ne créent elles-mêmes de véritables organes de centralisation : comités de grève élus et révocables au niveau des entreprises, comités centraux de grève au niveau des villes, des régions, etc.
Les luttes récentes en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, ont fait la preuve que, quoi qu'en puissent dire les éléments conseillistes-ouvriéristes qui aujourd'hui se pâment devant les "coordinations", la classe ouvrière n'a pas encore atteint à l'heure actuelle la maturité suffisante lui permettant de constituer des organes de centralisation de ses luttes à l'échelle de tout un pays comme se proposent de le faire les "coordinations". Elle ne pourra pas prendre de raccourci et sera contrainte de déjouer pendant une longue période tous les pièges et obstacles que la bourgeoisie dispose devant elle. Elle devra en particulier poursuivre l'apprentissage de l'extension de ses luttes et d'une réelle prise en main de celles-ci à travers les assemblées générales souveraines sur les lieux de travail. Le chemin est encore long pour le prolétariat, mais il n'en existe pas d'autre.
FM. 22-11-88
Géographique:
- France [7]
Heritage de la Gauche Communiste:
Où en est la crise économique ? De la crise du crédit a la crise monétaire et a la récession ou le crédit n'est pas une solution
- 2644 reads
Un an après l'effondrement boursier d'octobre 1987 qui vit partir en fumée près de 2 000 milliards de dollars de capitaux spéculatifs (soit l'équivalent de près de 400 dollars par être humain), le capitalisme mondial semblerait en bonne santé : l'année 1988 s'annoncerait même, d'après les estimations actuelles, la meilleure depuis le début des années 80. Mais les années 1973 et 1978-79 qui ont précédé les grandes récessions de 1974-75 et 1980-82 furent aussi les plus brillantes en leur temps. La fuite dans le crédit n'est pas une solution éternelle. Ce qui s'annonce dans "l’euphorie" actuelle c'est une convulsion monétaire avec au bout une nouvelle récession mondiale.
D'ailleurs au lendemain même des élections américaines, le langage des propagandes officielles commence déjà à changer et le triomphalisme cède le pas aux appels à la prudence.
- "La fin du mandat Reagan est caractérisée par une expansion persistante depuis maintenant six ans, la plus longue de l’histoire américaine en temps de paix... En valeur absolue le déficit américain peut paraître important. Mais, comme le pays produit le quart du PNB mondial, le déficit américain est, en pourcentage, inférieur à la moyenne OCDE... La 'crise des déficits' américains est une astuce des relations publiques employée par l’establishment républicain traditionnel pour purger le parti d'hommes politiques populaires... Ce qu'il faut, c'est un système monétaire qui empêche les banques centrales de mettre en danger la prospérité économique." (P.C. Roberts, professeur au Centre d'études stratégiques, USA, un des théoriciens de la dite "économie de l'offre" ou "reaganomics")([1] [9]).
En d'autres termes, ce que disent certains économistes, c'est que les gigantesques déficits et l'endettement massif du capital américain ne constituent pas des problèmes majeurs. Les inquiétudes que le développement vertigineux de ces phénomènes soulève, seraient sans fondement réel et traduiraient tout au plus des "astuces" liées à des guerres de clans parmi les politiciens américains. Derrière cette affirmation d'autruche se trouve en fait posée la question de savoir si la fuite en avant dans le crédit ne serait pas, finalement, un remède éternel, un moyen de permettre à l'économie capitaliste de poursuivre, à condition que les autorités monétaires aient une politique adaptée, un développement ininterrompu : "L'expansion persistante... la plus longue de l'histoire américaine en temps de paix" confirmerait une telle possibilité.
En réalité, les fameuses six années d"'expansion" de l'économie américaine qui ont provisoirement empêché l'effondrement total de l'économie mondiale ([2] [10]) n'ont pas été le fruit d'une nouvelle découverte économique. Elles étaient une continuation de la vieille politique keynésienne de déficits étatiques et de la fuite en avant dans l'endettement. Et, contrairement à ce qu'affirme notre éminent professeur, l'ampleur de cet endettement - produit d'une véritable explosion du recours au crédit au cours des dernières années - loin d'être une question sans importance, pose DES A PRESENT des problèmes énormes aussi bien au capital américain qu'à l'économie mondiale et ouvre à brève échéance la perspective d'une nouvelle récession mondiale.
LES EFFETS DEVASTATEURS DE L'EXCES DE CREDIT
- "En 1987, l'Amérique importait près de deux fois plus qu'elle n'exportait. Elle dépensait 150 milliards de dollars de plus, dans les autres pays, qu'elle ne gagnait, et le gouvernement fédéral dépensait 150 milliards de dollars de plus sur le marché intérieur qu'il n'engrangeait de recettes fiscales. Les Etats-Unis comptant environ 75 millions de ménages, chacun d'entre eux a ainsi dépensé l'an dernier 2 000 dollars (12 500 F) de plus qu'il n'a gagné en moyenne et a emprunté le solde à l'étranger. " ([3] [11])
Les statistiques sont cette science qui permet d'affirmer que lorsqu'un bourgeois possède cinq automobiles et que sou voisin chômeur n'en possède aucune, ce dernier en possède tout de même deux et demie. La moyenne de dépenses à crédit pour chaque ménage américain n'est qu'une moyenne, mais elle donne une image de l'ampleur du phénomène de recours au crédit qui a caractérisé le capitalisme américain au cours des dernières années.
Cette situation a, dès à présent, des conséquences particulièrement significatives de l'état d'empoisonnement de la machine capitaliste aussi bien aux Etats-Unis que dans le reste du monde.
Aux Etats-Unis
L'année 1988, outre le record d'endettement global du capital américain, a vu trois autres records historiques particuliers être battus :
- le record de faillites bancaires : en octobre 1988 le nombre de ces faillites avait déjà pulvérisé le record de 1987;
- le record de paiement des autorités fédérales pour indemniser les clients de caisses d'épargnes en faillite;
- le record de la masse d'intérêts payés par le trésor américain sur sa dette : "D'un moment à l'autre, les comptables du gouvernement US enregistreront un moment remarquable dans les comptes fédéraux : les intérêts que le Trésor paie sur les 2 000 milliards de dollars de la dette nationale sont sur le point de dépasser le montant de l'énorme déficit du budget. Le gouvernement US paie quelques 150 milliards de dollars par an en intérêts, soit 14% du total de la dépense gouvernementale. De ces 150 milliards, de 10 à 15% vont aux investisseurs étrangers." (New York Times, 11 octobre 1988).
Cependant, l'effet immédiat le plus grave de cette course dans l'endettement est la hausse des taux d'intérêt qu'elle entraîne. Le Trésor américain a de plus en plus de mal a trouver de nouveaux prêteurs pour financer sa dette. Pour y parvenir il est contraint d'offrir des taux d'intérêts de plus en plus élevés. Le gouvernement avait été contraint de rabaisser ces taux en octobre 1987 pour freiner l'effondrement boursier, mais depuis lors, il a de nouveau été conduit à les remonter. Le taux des Bons du Trésor à trois mois est ainsi passé de 5,12 % fin octobre 87 à 7,20 en août 88.
Les conséquences immédiates sont déjà dévastatrices à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la dette elle-même : étant donné l'ampleur de l'endettement, on estime qu'un point de plus des taux d'intérêt se traduit par 4 milliards de dollars de plus à payer par an par le capital américain. Deuxièmement, et surtout, la hausse des taux d'intérêt entraîne un freinage inévitable de la machine économique, c'est-à-dire annonce une récession à plus ou moins brève échéance.
Dans le monde
Mais le capital des Etats-Unis n'est pas le seul endetté dans le monde, loin s'en faut, même s'il est devenu le premier débiteur de la planète. La hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis entraîne celle des taux d'intérêt dans le monde entier. Pour les pays de la périphérie, depuis longtemps confrontés à l'incapacité de faire face à leurs dettes, en particulier ceux d'Afrique et d'Amérique latine, cela veut dire une augmentation immédiate des intérêts à débourser et donc de leur dette déjà faramineuse. Leur faillite chronique pousse déjà leurs taux d'inflation vers de nouveaux records. Pour le Brésil, par exemple, il est prévu une inflation de 820% pour l'année 1988. Sur le plan des investissements, ceux-ci connaissent déjà une chute vertigineuse et généralisée.
Pour les capitaux créanciers des Etats-Unis, ceux qui bénéficient théoriquement en premier des déficits US car ils y trouvent dans l'immédiat un débouché pour leurs exportations (Japon et Allemagne en particulier), ils se trouvent de plus en plus en possession de montagnes de "promesses de paiement" américaines, libellées en dollars, sous toutes sortes de formes : bons du Trésor, actions, obligations, etc. Cela fait beaucoup de richesse sur le papier, mais que devient cette masse de papier du moment que le capital américain ne parvient pas à payer ou si - on y reviendra plus loin - les USA dévaluent le dollar ?
La thèse des économistes qui prétendent que la fuite en avant dans le crédit, en particulier aux Etats-Unis, n'est pas une véritable menace pour le capital mondial, est un leurre que la réalité dément dès à présent par les effets dévastateurs qu'elle exerce, même sans tenir compte des perspectives qu'elle ouvre pour l'avenir.
LE CREDIT N'EST PAS UNE SOLUTION ETERNELLE
Le capitalisme a toujours eu recours au crédit pour assurer sa reproduction. Il constitue un élément fondamental de son fonctionnement en particulier au niveau de la circulation. Sa généralisation par le capital constitue un accélérateur de son processus d'accumulation et en tant que tel il est un instrument indispensable à son bon fonctionnement. Mais il ne joue ce rôle que dans la mesure où le capital fonctionne dans des conditions d'expansion réelles, c'est-à-dire, si au bout du retardement qu'il crée entre le moment de la vente et le moment du paiement, il existe un remboursement réel.
- "Le maximum que puisse faire le crédit dans ce domaine -qui concerne la seule circulation - c'est de sauvegarder la continuité du processus productif, A CONDITION qu'existent toutes les autres conditions de cette continuité, c'est-à-dire, qu'existe réellement le capital contre lequel il doit être échangé. " (Marx, Grundrisse).
Or, le problème pour le capitalisme actuellement, aussi bien aux USA qu'ailleurs, c'est que "le capital contre lequel (le crédit) doit être échangé", "les autres conditions de cette continuité du processus productif n'existent pas.
Contrairement à ce qui se produit dans des conditions de véritable expansion, le capital ne recourt pas aujourd'hui au crédit pour accélérer un processus productif sain, mais pour retarder les échéances d'un processus productif embourbé dans la surproduction et le manque de débouchés solvables. Depuis la fin des années 1950-60, depuis la fin du processus de reconstruction qui suivit la deuxième guerre mondiale, le capitalisme n'a survécu qu'en poussant les manipulations économiques de toutes sortes à des extrêmes insoupçonnables, mais il n'a pas pour autant résolu son impasse de fond. Au contraire il n'a fait, et ne fait, que l'aggraver.
LA POURSUITE DE LA FUITE EN AVANT
Aux Etats Unis. Au lendemain du "krach" d'octobre 1987 les USA n'ont eu d'autre solution que de poursuivre leur endettement. Certains économistes estiment que les Banques centrales des autres pays ont dû ainsi racheter pour près de 120 milliards de dollars.
Dans les pays moins développés. Certains économistes avaient parlé de faire des moratoires et d'annuler tout simplement la dette des pays les plus pauvres. Comme nous l'avions prévu dans le n° 54 de cette revue, cela s'est réduit essentiellement à des promesses verbales et à quelques miettes.
Il est vrai que l'annulation de l'obligation de rembourser les crédits éliminerait le problème. Mais cela reviendrait à faire du capitalisme un mode de production qui ne produit plus pour le profit... ce qui n'est plus du capitalisme. Non, la "solution" trouvée a été d'ouvrir de nouveaux crédits. On assiste ainsi à la fin de 1988 à une spectaculaire ouverture de nouveaux crédits à ces pays : de nouveaux rééchelonnements des dettes sont accordés et le Mexique s'est même vu accorder un prêt d'urgence, par les Etats-Unis : 3,5 milliards de dollars, le prêt le plus important accordé à un pays débiteur depuis 1982.
Dans les pays de l'Est L'URSS, après toute une période où elle s'est attachée à réduire son endettement, revient quémander des crédits aux puissances occidentales, Perestroïka aidant. Des consortiums bancaires en Italie, RFA, France et Grande Bretagne devraient permettre à Moscou d'obtenir environ 7 milliards de dollars de crédits. Il en est de même pour la Chine qui connaît une situation de plus en plus analogue à celle des pays d'Amérique latine (inflation galopante, demande de nouveaux crédits pour pallier l'incapacité de rembourser ceux contractés auparavant).
LES PERSPECTIVES
L'économie capitaliste ne va pas vers une crise du crédit. Elle est déjà entièrement plongée dans une telle crise. C'est sur le plan monétaire que celle-ci devrait désormais se manifester.
- "Le système monétaire est essentiellement catholique, le système de crédit essentiellement protestant... The Scotch hâte gold (l’Ecossais hait Vor). Sous la forme de papier, l’existence monétaire des marchandises est de nature purement sociale. C'est la FOI qui sauve : la foi en la valeur monétaire considérée comme l’esprit immanent des marchandises, la foi dans le mode de production et son ordre prédestiné, la foi dans les agents individuels de la production tenus pour de simples personnifications du capital qui croît de lui-même.. Pas plus que le protestantisme ne peut s'émanciper des fondements du catholicisme, le système du crédit ne peut s'émanciper des fondements du système monétaire." (Marx, Le Capital, III, "Circulation, crédit, change", XVIII, Ed. La Pléiade, t. II, 1265).
En ce sens, Roberts ressent quelque chose de juste quand il nie le problème d'un excès de crédit pour les Etats-Unis et ne voit que celui des limites monétaires imposées par les banques centrales.
Mais ce qu'il ne voit pas c'est que ce qui en découle n'est pas que les banques centrales devront créer plus de monnaie, mais qu'elles en ont déjà créé trop et que c'est dans le domaine de la monnaie, dans la perte de "la FOI" dans la monnaie (et en premier lieu celle dans laquelle se fait la quasi-totalité du commerce mondial, LE DOLLAR) que s'exprimera dans le prochain temps la crise de surproduction capitaliste (dont la crise du crédit n'est qu'une manifestation superficielle).
Le capital américain, pas plus que les autres capitaux, ne peut pas et ne pourra rembourser ses dettes. Mais il est le plus puissant des gangsters. Et il dispose des moyens de faire violemment "réduire" par la force sa dette - une fois de plus - par ses propres créanciers. Contrairement aux autres Etats du monde, les Etats-Unis sont les seuls à pouvoir payer leur dette avec leur propre monnaie (les autres doivent la payer en devises et en particulier en dollars). C'est pourquoi, tout comme en 1973 et en 1979, ils n'ont d'autre issue que la dévaluation du dollar.
Mais une telle perspective aujourd'hui est l'annonce directe d'un nouveau marasme monétaire mondial ouvrant la porte à une nouvelle récession qui sera autrement plus profonde que celles de 1974-75 et 1980-82.
La dévaluation du dollar constitue d'une part une "ruine" sur le plan financier pour les principaux capitaux créanciers des Etats-Unis, et en premier lieu du Japon et de l'Allemagne... qui n'y pourront rien et qui par là même ne pourront en aucun cas jouer le fameux rôle de "locomotive" pour remplacer celle, défaillante, des USA. Mais d'autre part, cela constitue une barrière douanière qui ferme l'accès du marché américain - celui qui a servi depuis six ans de "locomotive" - pour l'ensemble de l'économie mondiale.
Comme nous l'écrivions dans le n° 54 de cette revue, seule l'attente des élections américaines retardait le déclenchement d'un tel processus. Quelle que soit sa vitesse, il apparaît désormais en marche.
Les six dernières années ont traduit une ambiance particulièrement troublante. La crise de l'économie mondiale, loin de se résorber ou de disparaître n'a cessé de se développer en profondeur : poursuite de la croissance du chômage dans presque tous les pays, développement de la misère dans des proportions inconnues jusqu'à présent dans les zones les plus pauvres de la planète, désertification industrielle au coeur même des centres vitaux du capitalisme, paupérisation des classes exploitées dans les pays les plus industrialisés; au niveau financier ça a été l'explosion de l'endettement et les plus grandes secousses boursières depuis un demi-siècle, le tout pataugeant dans une frénésie spéculative sans précédent dans l'histoire. Cependant, la machine capitaliste ne s'est pas réellement effondrée. Malgré des records historiques de faillites, malgré des craquements de plus en plus puissants et fréquents, la machine à profits a continué de tourner, concentrant de nouvelles fortunes gigantesques - produit du carnage auquel se livrent les capitaux entre eux - et affirmant une arrogance cynique sur les bienfaits des lois "du libéralisme mercantile". "Les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres", constatent souvent les journalistes économiques, mais la machine "tourne" et les résultats de 1988, du moins dans les statistiques, s'annoncent les meilleurs de la décennie.
Plus grand monde ne croit réellement à la possibilité d'une nouvelle période de "prospérité" économique, comme celle des années 1950-60. Mais la perspective d'un nouvel effondrement capitaliste comme celui de 1974-75 ou de 1980-82 semblerait s'éloigner grâce aux multiples manipulations des gouvernements sur la machine économique. Ni réelle reprise, ni véritable effondrement : l'incertitude pour l'éternité.
Il n'en est rien. Jamais le système capitaliste ne fut aussi malade. Jamais son corps ne fut aussi empoisonné par les doses massives de drogues et de médicaments auxquelles il a dû avoir recours pour assurer sa médiocre et effroyable survie des six dernières années. Sa prochaine convulsion, qui une fois encore, combinera récession et inflation, n'en sera que plus violente, plus profonde et plus étendue mondialement.
Les forces destructrices et autodestructrices du capital se déchaîneront, une fois de plus, avec une violence sans précédent; mais cela provoquera l'indispensable ébranlement qui contraindra le prolétariat mondial à porter ses luttes à des niveaux supérieurs et à tirer profit de toute l'expérience accumulée en particulier au cours des dernières années.
20-11-88, RV.
[1] [12] Le Monde, 25 octobre 1988.
[2] [13] Pour une analyse de la réalité de cette "expansion" et de ses effets sur l'économie mondiale, voir "La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire" dans la Revue Internationale n° 54, 3e trimestre 1988.
[3] [14] Stephen Marris, Le Monde, 25 octobre 1988
Récent et en cours:
- Crise économique [15]
Rubrique:
Algérie : la bourgeoisie massacre
- 2857 reads
Fin septembre et début octobre, l'Algérie a connu une vague sociale sans précédent dans son histoire depuis "l'Indépendance" de 1962. Dans les grandes villes et les centres industriels, grèves ouvrières massives et émeutes de la faim d'une jeunesse sans travail se sont succédé. Avec une barbarie inouïe, l'Etat "socialiste" algérien et le parti unique FLN ont massacré des centaines de jeunes manifestants. Cet Etat et ce parti, salués il y a 20 ans par les trotskystes et les staliniens comme "socialistes", ont opposé aux revendications "du pain et de la semoule" le plomb et la mitraille de l'armée. Assassinats, tortures, arrestations massives, état de siège et militarisation du travail, voilà la réponse de la bourgeoisie algérienne aux revendications des exploités.
1. Les grèves et les émeutes s'expliquent par la rapide détérioration de l'économie algérienne. Celle-ci, déjà en proie à la crise permanente des pays sous-développés s'effondre littéralement. La chute des cours du pétrole et du gaz algériens, dont le pays vit quasi exclusivement, l'épuisement de ces ressources vers l'an 2000, tout cela explique l'austérité draconienne des années 80. Comme la Roumanie de Ceausescu, l'Algérie de Chadli s'est engagée à rembourser sa dette auprès des banques mondiales, tâche à laquelle elle a travaillé activement. L'abandon du soutien de l'Etat à tous les secteurs (santé, alimentation, logement) s'est traduit par une situation effroyable pour les couches laborieuses. Des queues dès 6h du matin pour obtenir pain et semoule ; la viande introuvable, l'eau coupée pendant plusieurs mois ; l'impossibilité de trouver un logement, des salaires de misère bloqués, le chômage généralisé pour la jeunesse (65% des 23 millions d'habitants ont moins de 25 ans), tel est le résultat de 25 années de "socialisme" algérien, engendré par la lutte de "libération nationale". Face aux exploités, la bourgeoisie algérienne - parasitaire - se maintient totalement au travers d'une féroce dictature militaire. Les bureaucrates du FLN et les officiers de l'armée, qui ont la haute main sur l'appareil économique, vivent de spéculations, stockant les denrées alimentaires importées pour les revendre au prix fort sur le marché noir. Cela illustre toute la faiblesse de cette bourgeoisie. Si elle s'appuie de plus en plus sur le mouvement intégriste musulman qu'elle a encouragé ces dernières années, ce mouvement, - en dehors de fractions de la petite bourgeoisie et du lumpenprolétariat - est sans influence réelle sur la population ouvrière.
2. Le véritable sens des événements sociaux d'octobre, en réaction à la misère dramatique, c'est le surgissement net du prolétariat d'Algérie sur la scène sociale. Plus que lors des émeutes de 1980, 1985 et 1986, l'importance du mouvement ouvrier est incontestable. Dès fin septembre 88, des grèves éclataient dans toute la zone industrielle de Rouiba-Reghaia, à 30 km d'Alger, dont l'avant-garde est constituée des 13 000 ouvriers de la société nationale des véhicules industriels (ex-Berliet). De là, la grève s'étendait à toute la région d'Alger : Air Algérie, et surtout les postiers des FIT (Postes et télécommunications). Malgré la répression des ouvriers de Rouiba - arrosés par la police à coups de canon à eau - le mouvement s'étendait jusque dans les grandes villes de l'Est et de l'Ouest. En Kabylie, les tentatives de militaires et de policiers de dresser "Kabyles" contre "Arabes" - "ne soutenez pas les Arabes qui ne vous ont pas soutenu en 1985", claironnaient les voitures de police - n'ont rencontré que mépris et haine. Enfin, de façon significative, face aux grèves sauvages, le syndicat étatique UGTA a dû prendre ses distances avec le gouvernement, pour mieux prendre le "train en marche", et tenter de contrôler un tant soit peu le mouvement.
C'est dans ce contexte et cette ambiance qu'ont éclaté à partir du 5 octobre émeutes, pillages, destructions de magasins et édifices publics accomplis par des milliers de jeunes chômeurs, dont des enfants, auxquels se sont mêlés parfois provocateurs de la police secrète et intégristes. Ces émeutes ont été montées en épingle par les médias algériens et occidentaux pour mieux dissimuler l'étendue et le sens de classe des grèves. D'autre part, la bourgeoisie algérienne en a profité pour faire un bain de sang préventif, qu'elle a par la suite utilisé pour souligner la nécessité de "réformes" "démocratiques" et éliminer des fractions de son appareil d'Etat trop liées à l'armée et au FLN et inadéquates devant la menace prolétarienne.
Les émeutes de cette population très jeune, sans espoir et sans travail, ne sont pas la continuité des grèves ouvrières. Elles s'en distinguent nettement par leur absence de perspectives et leur trop facile utilisation et manipulation par l'appareil d'Etat. Il est vrai que cette jeunesse semble avoir manifesté un timide début de politisation en refusant de suivre et les mots d'ordre de l'Opposition à l'étranger (Ben Bella et Ait Ahmed, ex-chefs de FLN, éliminés par Boumediene) et les intégristes islamiques, qui ne sont qu'une création du régime et des militaires. Ici et là ces jeunes ont arraché le drapeau national algérien, ont saccagé mairies et sièges du FLN, détruit à Alger le siège du Polisario sahraoui, mouvement nationaliste soutenu par l'impérialisme algérien, et symbole de la guerre larvée avec le Maroc. Mais un tel mouvement doit être soigneusement distingué de celui des ouvriers en grève. La jeunesse en tant que telle n'est pas une classe. Composée aussi bien de jeunes chômeurs, de jeunes sans-travail tombés dans le lumpenprolétariat (appelés là bas les "gardiens du mur" en raison de leur oisiveté quotidienne), son action - séparée de l'action prolétarienne - est sans issue.
En s'attaquant seulement aux symboles de l'Etat, en pillant et détruisant aveuglément, ces révoltes sont impuissantes ; elles ne sont que des feux de paille ne pouvant guère contribuer au développement de la conscience et de la lutte ouvrières. Elles ne se différencient guère des émeutes périodiques des bidonvilles en Amérique latine. Elles traduisent la décomposition accélérée d'un système qui engendre dans les couches de sans-travail des explosions sans perspective historique.
L'absence - semble-t-il - d'organisation de la grève a sans doute permis à ces révoltes de passer au premier plan. Ce fait explique l'étendue de la répression policière et militaire (environ 500 morts, souvent très jeunes). L'armée n'a pas été contaminée ; elle n'a même pas connu un début de décomposition. Les 70 000 jeunes de l'armée de terre, ceux du contingent, sur une armée qui en compte 120 000, n'ont pas bougé.
C'est pourquoi, une fois l'eau rétablie dans les grandes villes, et les magasins "miraculeusement" réapprovisionnés, le gouvernement Chadli pouvait mettre fin à l'état de siège le 12 octobre. La grève générale de 48 heures en Kabylie et les quelques affrontements avec les policiers ont été un combat d'arrière-garde. L'ordre bourgeois a été rétabli avec quelques promesses "démocratiques" de Chadli (référendum sur la Constitution) et les appels au calme des imams (14 octobre) qui en appellent à une "république islamique" avec les militaires. Il s'agit en fait d'une pause dans une situation qui reste toujours explosive et se traduira par des mouvements sociaux ayant plus d'ampleur, où la présence du prolétariat sera plus visible et plus déterminante. Cette défaite est une première manche dans les affrontements futurs, de plus en plus décisifs, entre prolétariat et bourgeoisie. Des grèves sauvages ont d'ailleurs éclaté début novembre à Alger (7 novembre).
3. Malgré l'apparent "retour au calme", ces événements sociaux ont une importance historique considérable. En tant que tels ils ne peuvent être assimilés ni à l'Iran en 1979, ni aux événements actuels en Yougoslavie et au Chili. En aucun cas, les ouvriers et les jeunes sans-travail n'ont suivi les intégristes musulmans. Contrairement à ce qu'affirment la presse, les intellectuels bourgeois, le PC français, qui soutiennent peu ou prou Chadli, les intégristes sont l'arme idéologique des militaires, avec lesquels ils travaillent main dans la main. La religion, à la différence de l'Iran, n'a presque aucun impact sur les jeunes chômeurs et encore moins sur les ouvriers.
Mais le PLUS GRAND DANGER ACTUEL consisterait pour le prolétariat à croire dans les promesses de "démocratisation" et de rétablissement des "libertés", surtout depuis le référendum fin octobre (90% de votants pour Chadli). Le prolétariat n'a rien à espérer mais tout à craindre de telles promesses. Le bavardage démocratique ne fait que préparer d'autres ignobles massacres par la classe bourgeoise qui n'a rien à offrir d'autre que misère, plomb et mitraille aux exploités. C'est une leçon générale pour tous les prolétaires du monde : ON VOUS PROMET LA "DEMOCRATIE"; VOUS AUREZ D'AUTRES MASSACRES SI VOUS NE METTEZ PAS FIN A L'ATROCE BARBARIE CAPITALISTE!
Les événements d'octobre en Algérie ont une importance historique pour 4 raisons :
- ils sont dans le prolongement des grèves et émeutes de la faim qui ont secoué le Maroc et la Tunisie limitrophes depuis le début des années 80. Ils traduisent une réelle menace d'extension à tout le Maghreb, où ils ont déjà rencontré un large écho. La solidarité immédiate des gouvernements marocain et tunisien avec Chadli - en dépit d'appétits impérialistes contradictoires - est à la mesure de la peur qui a envahi la classe bourgeoise de ces pays ;
- ils montrent surtout -face aux GREVES OUVRIERES - la solidarité des grandes puissances impérialistes (France, USA) contre le prolétariat et leur soutien aux bains de sang pour rétablir "l'ordre". Déjà équipée en armes par la France, la RFA, les USA - qui ont pris la place des russes -, l'Algérie va être encore plus l'objet de soins attentifs du bloc américain sous forme d'armements et d'équipements de guerre civile.
Une fois de plus, se vérifie la Sainte Alliance de l'ensemble du monde capitaliste contre le prolétariat d'un pays, lequel n'affronte pas seulement "sa" bourgeoisie, mais toutes les bourgeoisies.
- en raison de l'importance de la classe ouvrière d'origine maghrébine, et surtout algérienne (presque 1 million d'ouvriers) en France, de tels événements ont déjà un impact énorme dans ce pays. L'unité du prolétariat contre la bourgeoisie en Europe occidentale et dans la périphérie immédiate se trouve posée, les conditions sont aujourd'hui propices pour la formation de minorités révolutionnaires dans le prolétariat algérien : dans un premier temps, dans l'immigration en France et en Europe, dans un second temps en Algérie, où le prolétariat est le plus développé, et même en Tunisie et au Maroc.
- Enfin, pour le prolétariat en Algérie, la grève généralisée est une première expérience d'envergure de confrontation avec l'Etat. Les prochains mouvements auront moins l'aspect d'un feu de paille. Ils se démarqueront plus nettement des révoltes des jeunes sans-travail.
A la différence des couches peu conscientes, perméables à la décomposition, le prolétariat ne s'attaque pas à des symboles, mais à un système, le capitalisme. Le prolétariat ne détruit pas pour aussitôt sombrer dans la résignation ; lentement, mais sûrement, il est appelé à développer sa conscience de classe, sa tendance à l'organisation. C'est dans ces conditions que le prolétariat, en Algérie comme d'ailleurs dans les pays du tiers monde, pourra orienter la révolte des jeunes sans-travail pour la canaliser vers la destruction de l'anarchie et de la barbarie capitalistes.
Chardin, 15-11-88
«Il n'existe pas de preuve plus flagrante de 1'impossibilité d'une révolution bourgeoise de nos jours que le caractère politique des régimes de "libération nationale". Ceux-ci sont inévitablement organisés dans le but avoué d'empêcher et, si nécessaire, de briser par la force tout embryon de lutte autonome de la classe ouvrière. La plupart d'entre eux sont des Etats policiers à parti unique, qui proscrivent le droit de grève. Leurs prisons sont remplies de dissidents. Nombreux sont ceux qui se sont illustrés dans l'écrasement sanglant de la classe ouvrière ; nous avons déjà mentionné la précieuse contribution de Ho-Chi-Minh à l'écrasement de la Commune ouvrière de Saigon ; nous pourrions aussi rappeler comment Mao a envoyé l'armée de "libération du peuple" "restaurer l'ordre" après les grèves, les débuts d'insurrection et les aventures ultra-gauchistes qu'avait provoqués la soi-disant "révolution culturelle". Nous devrions aussi nous souvenir de la répression des grèves des mineurs par Allende ou de celle exercée par la très "progressiste" junte militaire de Peron. La liste est pratiquement inépuisable. »
Nation ou Classe, brochure du CCI.
Géographique:
- Afrique [16]
Comprendre la décadence du capitalisme (6) : Le mode de vie du capitalisme en décadence
- 3932 reads
- Dans les deux articles précédents nous avons montré que tout mode de production est rythmé par un cycle ascendant et décadent (Revue Internationale n° 55) et qu'aujourd'hui nous vivons au coeur de la décadence du capitalisme (Revue Internationale n° 54). L'objet de cette contribution-ci est de mieux cerner les éléments qui ont permis au capitalisme de survivre tout au long de sa décadence et plus particulièrement de dégager les bases explicatives des taux de croissance d'après 1945 (les plus élevés de l'histoire du capitalisme). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut momentané du capitalisme est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc.) pour la réaliser viennent à épuisement, ouvrant la porte à une crise sans précédent.
La contradiction fondamentale du capitalisme
"Ce qui est décisif dans le processus de production c'est la question suivante : quels sont les rapports entre ceux qui travaillent et leurs moyens de production." (Rosa Luxemburg, Introduction à l'économie politique, Ed. 10/18). Dans le capitalisme le rapport qui lie les moyens de production et les travailleurs est constitué par le salariat. C'est le rapport social de production de base qui à la fois imprime la dynamique du capitalisme, et contient ses contradictions insurmontables ([1] [17]). Rapport DYNAMIQUE en ce sens que, pour vivre, le système doit constamment s'élargir, accumuler, étendre et pousser à bout l'exploitation salariale, aiguillonné par la baisse tendancielle du taux de profit (la péréquation de ce dernier découlant de la loi de la valeur et de la concurrence). Rapport CONTRADICTOIRE en ce sens que le mécanisme même de production de plus-value crée plus de valeur qu'il n'en distribue ; la plus-value étant la différence entre la valeur du produit du travail et le coût de la marchandise force de travail : le salaire. En généralisant le salariat, le capitalisme restreint ses propres débouchés, contraignant le système à constamment devoir trouver des acheteurs en dehors de sa sphère capital-travail :
"(...)Plus la production capitaliste se développe, et plus elle est obligée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate, mais dépend d'une extension constante du marché mondial (...). Ricardo ne voit pas que la marchandise doit être nécessairement transfonnée en argent. La demande des ouvriers ne saurait suffire, puisque le profit provient justement du fait que la demande des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il est d'autant plus grand que cette demande est relativement moindre. La demande des capitalistes entre eux ne saurait pas suffire davantage (..). Dire enfin que les capitalistes n'ont en somme qu'à échanger et consommer les marchandises entre eux, c'est oublier tout le caractère de la production capitaliste et oublier qu'il s'agit de mettre le capital en valeur (...). La surproduction provient justement du fait que la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, que sa consommation n'augmente pas au rythme de l'augmentation de la productivité du travail (...). Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :
1) Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs, acheteurs d'une très grande portion de leur produit;
2) Que la majeure partie des producteurs, des ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent de leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent, qu'ils produisent la plus-value, le surproduit. Il leur faut constamment être surproducteurs, produire au-delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs (...). La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital: produire à la mesure des forces productives, c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse de travail avec une masse donnée de capital, sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables (...)." (Marx, Le Capital, Ed.. Sociales, 1975, livre IV, t.II et livre III, t.I).
Marx a clairement montré, d'une part, l'inéluctabilité de la fuite en avant de la production capitaliste afin d'accroître la masse de plus-value pour compenser la baisse du taux de profit (dynamique), et d'autre part l'obstacle qui se dresse pour le capital : l'éclatement de la crise par le rétrécissement du marché nécessaire à l'écoulement de cette production (contradiction), bien avant que ne se manifeste l'insuffisance de la plus-value engendrée par la baisse tendancielle du taux de profit : "Or, au fur et à mesure que sa production s'est étendue, le besoin de débouchés s'est également élargi pour lui. Les moyens de production plus puissants et plus coûteux qu'il a créés lui permettent bien de vendre sa marchandise meilleur marché, mais ils le contraignent en même temps à vendre plus de marchandises, à conquérir un marché infiniment plus grand pour ses marchandises (...). Les crises deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes déjà du fait que, au fur et a mesure que la masse de produits et, par conséquent, 1e besoin de marchés élargis s'accroissent, le marché mondial se rétrécit de plus en plus et qu'il reste de moins en moins de marchés à exploiter, car chaque crise antérieure a soumis au commerce mondial un marché non conquis jusque là ou exploité de façon encore superficielle par le commerce" (Marx, Travail salarié et capital, Ed.. de Pékin, 1970).
Cette analyse fut systématisée et amplement développée par Rosa Luxemburg qui dégagea l'idée que, puisque la totalité de la plus-value du capital social global ne pouvait être réalisée, de par sa nature même, au sein de la sphère purement capitaliste, la croissance du capitalisme était dépendante de ses continuelles conquêtes de marchés pré-capitalistes ; l'épuisement relatif, c'est-à-dire eu égard aux besoins de l'accumulation, de ces marchés devra précipiter le système dans sa phase de décadence :
"Par ce processus, le capital prépare doublement son propre effondrement: d'une part, en s'étendant aux dépens des formes de production non capitalistes, il fait avancer le moment où l'humanité toute entière ne se composera plus effectivement que de capitalistes et de prolétaires et où l'expansion ultérieure, donc l'accumulation, deviendront impossibles. D'autre part, à mesure qu'il avance, il exaspère les antagonismes de classe et l'anarchie économique et politique internationale à tel point qu'il provoquera contre sa domination la rebellion du prolétariat intemational bien avant que l'évolution économique ait abouti à sa dernière conséquence : la domination absolue et exclusive de la production capitaliste dans le monde. (...) L'impérialisme actuel (...) est la dernière étape du processus historique (du capitalisme) : la période de concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe." (L'accumulation du capital, Ed.. Maspéro, 1967).
Outre son analyse du lien indissoluble entre les rapports de production capitalistes et l'impérialisme, qui montre que le système ne peut vivre sans s'étendre, sans être impérialiste par essence, ce que Rosa Luxemburg apporte de fondamental ce sont les outils d'analyse pour comprendre pourquoi, comment et quand le système entre dans sa phase de décadence. A cette question Rosa y répondra dès les prodromes de la guerre 1914-18, estimant que le conflit inter impérialiste mondial ouvre l'époque où le capitalisme devient définitivement une entrave pour le développement des forces productives : "La nécessité du socialisme est pleinement justifiée dès le moment où l'autre, la domination de la classe bourgeoise, cesse d'être porteuse de progrès historique et constitue un frein et un danger pour l'évolution ultérieure de la société. Or, s'agissant de l'ordre capitaliste, c'est ce que précisément la guerre actuelle a révélé" (Rosa Luxemburg, in Rosa Luxemburg jountaliste-polémiste-révolutionnaire, Badia. Ed.. Sociales, 1975). Cette analyse, quelle qu'en soit l'explication "économique" était partagée par l'ensemble du mouvement révolutionnaire.
Si l'on saisit bien cette contradiction insoluble pour le capital, on détient la boussole pour comprendre le mode de vie du système au cours de sa décadence. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement que constitue le marché. Seule cette compréhension permet de relativiser les "performances" ponctuelles du capitalisme (taux de croissance après 1945). Nos critiques (cf. Revue Intemationale n° 54 et 55) sont éblouis par les chiffres de la croissance mais cela les aveugle sur la NATURE de cette croissance. Ils s'écartent ainsi de la méthode marxiste qui s'efforce de dégager l'essence véritable cachée derrière l'existence des choses. C'est ce que nous allons tenter de montrer ([2] [18]).
Quand la réalisation de la plus-value prend le pas sur sa production
Globalement, en phase ascendante, la demande dépasse l'offre, le prix des marchandises est déterminé par les coûts de production les plus élevés qui sont ceux des secteurs et pays les moins développés. Ceci permet à ces derniers de réaliser des profits permettant une réelle accumulation et aux pays les plus développés d'encaisser des sur-profits. En décadence, c'est l'inverse, globalement l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les secteurs et les pays ayant les coûts les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est à perte ou de tricher avec la loi de la valeur pour survivre (cf. infra). Cela ramène leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas. Même les économistes bourgeois avec leur terminologie propre (prix de vente et de revient) constatent cette inversion : "Nous avons été frappés par l'inversion contemporaine de la relation entre prix de revient et prix de vente (...) à long terme le prix de revient conserve son rôle (...) Mais alors qu'hier, le principe était que le prix de vente pouvait TOUJOURS être fixé au-dessus du prix de revient, aujourd'hui il apparaît le plus souvent comme devant être soitmis au prix de marché. Dans ces conditions, lorsque l'essentiel n'est plus la production mais la vente, lorsque la concurrence se fait de plus en plus rude, les chefs d'entreprise partent du prix de vente pour remonter progressivement jusqu'au prix de revient (...) pour vendre, le chef d'entreprise a plutôt tendance aujourd'hui à considérer en premier le marché, donc à examiner d'abord le prix de vente. (...) Si bien que désormais, on assiste souvent au paradoxe que ce sont de moins en moins les prix de revient qui déterminent les prix de vente et de plus en plus l'inverse. Le problème est : ou bien renoncer à produire, ou bien produire au-dessous du prix de marché." (Fourastier J. et Bazil B., Pourquoi les prix baissent, Ed. Hachette - Pluriel).
Ce phénomène se marque spectaculairement dans la part démesurée que prennent les frais de distribution et de marketing dans le produit final. Ces fonctions sont assurées par le capital commercial qui participe au partage général de la plus-value. Ces frais sont donc inclus dans les coûts de production. En phase ascendante, tant que le capital commercial assurait l'augmentation de la masse de plus-value et du taux annuel de profit, par la réduction de la période de circulation des marchandises et le raccourcissement du cycle de rotation du capital circulant, il contribuait à la baisse généralisée des prix, caractéristique de cette période (cf. graphique 4). Ce rôle se modifie en phase de décadence. A mesure que les forces productives se heurtent aux limites trop étroites du marché, le rôle du capital commercial devient moins celui d'accroître la masse de plus-value que d'en assurer la réalisation. Ceci s'exprime dans la réalité concrète du capitalisme, d'une part par un accroissement du nombre de personnes employées dans la sphère de la distribution et de façon générale par une diminution relative du travail réellement productif et, d'autre part par l'accroissement des marges commerciales dans la plus-value finale. On estime que les frais de distribution atteignent aujourd'hui en moyenne entre 50 à 70 % du prix des marchandises dans les grands pays capitalistes. L'investissement dans les secteurs parasitaires du capitalisme commercial (campagne marketing, sponsoring, lobbing, etc.), secteurs qui vont au-delà de la fonction normale de distribution de la marchandise, prend de plus en plus le pas sur l'investissement réellement productif. Cela correspond purement et simplement à de la destruction de capital. productif. Ceci montre le caractère de plus en plus parasitaire du système.
Le crédit
"Le système de crédit accélère par conséquent le développement matériel des forces productives et la constitution d'un marché mondial; la tâche historique de la production capitaliste est justement de pousser jusqu'à un certain degré le développement de ces deux facteurs, base matérielle de la nouvelle forme de production. Le crédit accélère en même temps les explosions violentes de cette contradiction, les crises et, partant, les éléments qui dissolvent l'ancien mode de production." (Marx, Le Capital, Livre III).
En phase ascendante, le crédit a constitué un puissant moyen pour accélérer le développement du capitalisme par le raccourcissement du cycle de rotation du capital. L'avance sur la réalisation de la marchandise que constitue le crédit trouvait son dénouement grâce à la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés extra-capitalistes. En décadence ce dénouement est de moins en moins possible, le crédit se mue alors en un palliatif à l'incapacité de plus en plus grande du capital à réaliser la totalité de la plus-value produite. L'accumulation rendue momentanément possible par le crédit ne fait que développer un abcès insoluble qui débouche inévitablement dans la guerre inter-impérialiste généralisée.
Le crédit n'a jamais constitué une demande solvable en soi et encore moins en décadence comme voudrait nous le faire dire Communisme ou Civilisation (CoC) : "Parmi les raisons qui permettent au capital d'accumuler figure maintenant le crédit ; autant dire que la classe capitaliste est capable de réaliser la plus-value grâce à une demande solvable provenant de la classe capitaliste. Si, dans la brochure du CCI sur la Décadence du capitalisme, cet argument n'apparaît pas, il fait désormais partie de la panoplie de tout initié de la secte. On admet ici ce qui, jusque là, a été farouchement nié à savoir la possibilité de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation." (CoC n°22) ([3] [19]). Le crédit constitue une avance sur la réalisation de la plus-value et permet ainsi d'accélérer la clôture du cycle complet de la reproduction du capital. Ce cycle comprend, selon Marx - on l'oublie trop souvent -, la production ET la réalisation de la marchandise produite. Ce qui se modifie entre la phase ascendante et la phase décadente du capitalisme, ce sont les conditions dans lesquelles opère le crédit. La saturation mondiale des marchés permet de moins en moins, et de moins en moins vite, de récupérer le capital investi. C'est pourquoi le capital vit de plus en plus sur une montagne de dettes qui prend des proportions astronomiques. Le crédit permet ainsi de maintenir la fiction d'une accumulation élargie et de repousser l'échéance où le capital devra passer à la caisse. Chose qu'il est d'ailleurs incapable d'assurer, ce qui le pousse inexorablement à la guerre commerciale et à la guerre inter-impérialiste tout court. Les crises de surproduction en décadence n'ont de "solution" que dans la guerre (cf. Revue Internationale n° 54). Les chiffres du tableau n° 1 et le graphique n°1 illustrent ce phénomène.
Concrètement les chiffres du tableau n° 1 nous montrent que les Etats-Unis vivent sur 2,5 ans de crédits, l'Allemagne sur 1 an. Pour rembourser ces crédits, si tant est qu'ils le seront un jour, les travailleurs de ces pays devraient respectivement travailler 2,5 et 1 ans gratuitement. Ces chiffres illustrent également une croissance plus rapide des crédits que du P.N.B. indiquant que le développement économique se fait de plus en plus à crédit au cours du temps.
Ces deux exemples ne constituent nullement une exception mais sont illustratifs de l'endettement mondial du capitalisme. L'estimer constitue un exercice périlleux, surtout à cause du manque de statistiques fiables mais l'on peut supputer que ce dernier se monte à 1,5 à 2 fois le PNB mondial. Entre 1974 et 1984 le taux d'accroissement de cet endettement est d'environ 11 % tandis que celui du P.N.B. mondial oscille autour de 3,5 % !
Tableau 1. Évolution de l'endettement du capitalisme
|
|
Dette publique et privée |
(en % du PNB) |
Dette des ménages (en % du revenu disponible) |
|---|---|---|---|
|
|
RFA |
USA |
USA |
|
1946 |
|
|
19,6% |
|
1950 |
22% |
|
|
|
1955 |
39% |
166 % |
46,1 % |
|
1960 |
47% |
172% |
|
|
1965 |
67% |
181 % |
|
|
1969 |
|
200% |
61,8 |
|
1970 |
75 % |
|
|
|
1973 |
|
197% |
71,8% |
|
1974 |
|
199% |
93% |
|
1975 |
84% |
|
|
|
1979 |
100% |
|
|
|
1980 |
250% |
|
|
Sources : Economic Report of the President (0l/1970) / Survey of Current Business (07/1975) / Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6) / Statistical Abstract of United States (1973).
Graphique 1. Belgique, croissance comparée de l'endettement et de la production.
Source : Bulletin de l'IRES, 1982, n°80 (l'échelle de gauche est un indice d'évolution des deux indicateurs, qui, pour être comparés, ont été ramenés à l'indice 100 en 1970).
Le graphique n° 1 est illustratif de l'évolution de la croissance et de l'endettement dans la majorité des pays. L'accroissement des crédits est nettement supérieur à celui de la production industrielle manufacturière. Si précédemment la croissance s'effectuait de plus en plus à crédit (1958-74: production= 6,01 %, crédit=13,26 %), aujourd'hui, le simple maintien de la stagnation se réalise à crédit (1974-81 : production = 0,15 %, crédit = 14,08 %).
Depuis le début de la crise chaque reprise économique est supportée par une masse de crédits de plus en plus importante. La reprise de 75-79 a été stimulée par des crédits accordés aux pays du "tiers-monde" et aux pays dits "socialistes", celle de 83 a été entièrement supportée par un accroissement des crédits aux pouvoirs publics américains - essentiellement consacré aux dépenses militaires - et aux grands trusts d'Amérique du Nord, crédits servant aux fusions d'entreprises, donc non productifs. CoC ne comprend rien à ce processus et sous-estime complètement le crédit et son ampleur comme mode de survie du capitalisme dans sa phase de décadence.
Les marches extra-capitalistes
Nous avons vu précédemment (Revue Intentationale n° 54) que la décadence du capitalisme se caractérisait non par une disparition des marchés extra-capitalistes mais par leur insuffisance par rapport aux besoins de l'accumulation élargie atteints par le capitalisme. C'est-à-dire que les marchés extra-capitalistes sont devenus insuffisants pour réaliser l'entièreté de la plus-value produite par le capitalisme et destinée à être réinvestie. Néanmoins une partie encore non négligeable de cette plus-value, bien que décroissante, est encore réalisée par ces marchés extra-capitalistes. Le capitalisme dans sa phase de décadence, aiguillonné par une base d'accumulation de plus en plus restreinte, va tenter d'exploiter au mieux l'exutoire que constitue pour lui la subsistance de ces marchés et cela de trois façons :
Par une intégration accélérée et planifiée, surtout après 1945, des secteurs d'économie marchande subsistants dans les pays développés.
Graphique 2. Part de la population active agricole dans la population active totale.
Le graphique n° 2 montre que si, pour certains pays, l'intégration de l'économie marchande agricole au sein des rapports sociaux capitalistes de production est déjà réalisée dès 1914, pour d'autres (France, Japon, Espagne, etc.), elle s'effectue encore au cours de la décadence et de façon accélérée après 1945.
Jusqu'à la seconde guerre mondiale l'augmentation de la productivité du travail dans l'agriculture était plus faible que dans celle de l'industrie, résultat d'un plus lent processus de développement de la division du travail dû, entre autres, à un poids encore important de la rente foncière qui détourne une part des capitaux nécessaires à la mécanisation. Après la seconde guerre mondiale la croissance de la productivité du travail est plus rapide dans l'agriculture que dans l'industrie. Ceci se matérialise par une politique conjugant tous les moyens pour ruiner les entreprises agricoles familiales de subsistance relevant de la petite production marchande, et les transformer en entreprises purement capitalistes. C'est le processus d'industrialisation de l'agriculture.
Aiguillonnée par la recherche impérative de nouveaux marchés, la période de décadence se caractérise par une meilleure exploitation des marchés extra-capitalistes subsistants.
D'une part, le développement des moyens techniques, des communications, et la baisse des coûts de transport facilitent la pénétration - tant intensive qu'extensive - et la destruction de l'économie marchande de la sphère extra-capitaliste.
D'autre part, le développement de la politique de "décolonisation" soulage les métropoles d'un fardeau coûteux, leur permet de rentabiliser au mieux leurs capitaux et d'accroître les ventes aux anciennes colonies (payées par la sur-exploitation des populations autochtones). Ventes dont une part non négligeable est constituée par l'armement, nécessité première et absolue de l'édification d'un pouvoir étatique local.
En phase ascendante le contexte dans lequel se développe le capitalisme permet une homogénéisation des conditions de la production (conditions techniques et sociales, degré de productivité moyenne du travail, etc.). La décadence, par contre, accroît les iriégalités de développement entre pays avancés et sous-développés (cf. Revue Intemationale n° 54 et 23).
Alors qu'en ascendance la part des profits retirés des colonies (ventes, prêts, investissements) est supérieure à la part des profits résultant de l'échange inégal ([4] [20]), en décadence c'est l'inverse qui se produit. L'évolution sur longue période des termes de l'échange est un indicateur de cette tendance. La détérioration de ces derniers pour les pays dits du "tiers monde" est devenue extrêmement importante depuis la seconde décennie de ce siècle.
Le graphique n° 3 ci-dessous illustre l'évolution des termes de l'échange de 1810 à 1970 pour les pays du "tiers-monde", c'est-à-dire du rapport entre prix des produits bruts exportés et prix des produits industriels importés. L'échelle exprime un rapport de prix (x 100), ce qui signifie que lorsque cet indice est supérieur à 100, il est favorable aux pays du "tiersmonde", et inversement lorsqu'il est inférieur à 100. C'est au cours de la deuxième décennie de ce siècle que la courbe passe l'indice pivot de 100 et entame sa chute, seulement interrompue par la guerre de 1939-45 et la guerre de Corée (forte demande de produits de base dans un contexte de pénurie).
Graphique 3. Evolution des termes de l'échange 1810 à 1970
Sources : Emilio de Figueros, Economie appliquée, t. XXII, n°1 et 2, publié également dans Le Monde du 29/07/69.
Le capitalisme d'État
Nous avons vu précédemment (Revue Internationale n° 54) que le développement du capitalisme d'Etat est étroitement lié à la décadence du capitalisme ([5] [21]). Le capitalisme d'Etat est une politique globale qui s'impose au système dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. Il concourt à atténuer les contradictions insurmontables du capitalisme : au niveau social par un meilleur contrôle d'une classe ouvrière suffisamment développée pour constituer un réel danger pour la bourgeoisie ; au niveau politique pour maîtriser les tensions croissantes entre fractions de la bourgeoisie ; et au niveau économique pour modérer les contradictions explosives qui s'accumulent. A ce dernier niveau, qui nous occupe ici, l'Etat intervient par le biais d'une série de mécanismes :
Les tricheries avec la loi de la valeur.
Nous avons vu qu'en décadence une partie de plus en plus importante de la production échappe à la détermination stricte de la loi de la valeur (Revue Internationale n° 54). La finalité de ce processus est le maintien en vie d'activités qui autrement n'auraient pas survécu à l'impitoyable verdict de la loi de la valeur. Le capitalisme parvient ainsi pour un temps, mais pour un temps seulement, à éviter les conséquences des fourches caudines du marché.
L'inflation permanente est un des moyens qui répond à cette finalité. L'inflation permanente est d'ailleurs un phénomène typique, propre à la décadence d'un mode de production ([6] [22]).
Graphique 4. Evolution des prix de gros dans cinq pays développés de 1750 à 1950-70.
Alors qu'en ascendance la tendance globale des prix est stable ou le plus souvent décroissante, la période de décadence marque l'inversion de la tendance. 1914 inaugure la phase d'inflation permanente.
Graphique 5. Evolution des prix de détail en France de 1820 à 1982
Stables pendant un siècle, les prix en France explosent après la première guerre mondiale et surtout la seconde : ils sont multipliés par 1000 entre 1914 et 1982. Sources: INSEE pour la France.
Si une chute et une adaptation périodique des prix aux valeurs d'échange (prix de production) sont artificiellement interdites par un gonflement du crédit et de l'inflation, toute une série d'entreprises qui sont déjà tombées au-dessous de la moyenne de la productivité du travail de leur secteur peuvent alors échapper à une dévalorisation de leur capital et à la banqueroute. Mais ce phénomène ne peut qu'accroître à la longue le déséquilibre entre la capacité de production et la demande solvable. La crise est reportée mais en devient du coup plus ample. Historiquement, dans les pays développés, l'inflation est tout d'abord apparue avec les dépenses étatiques dues à l'armement et à la guerre. Ensuite, le développement du crédit et des dépenses improductives de tous ordres s'y ajoute et en devient la cause majeure.
Les politiques anti-cycliques : armée de l'expérience de la crise de 1929 - où le repli sur soi a considérablement aggravé la crise - la bourgeoisie s'est débarrassée des restes d'illusions libre-échangistes d'avant 1914. Les années 30, et plus encore après 1945 avec le keynésianisme, sont marquées par la mise en place de politiques capitalistes d'Etat concertées. Il serait illusoire de vouloir toutes les énumérer mais elles ont une seule et même finalité : maîtriser tant bien que mal les fluctuations économiques et artificiellement soutenir la demande.
L'intervention croissante de l'Etat dans l'économie. Ce point à déjà été largement traité dans des Revue Internationale antérieures, nous n'aborderons ici qu'un aspect encore relativement peu abordé à savoir, l'intervention de l'Etat dans le domaine social et ses implications économiques.
En phase ascendante, les hausses salariales, la baisse du temps de travail, les conquêtes au niveau des conditions de travail sont des "concessions arrachées de haute lutte au capital (...) la loi anglaise sur les dix heures de travail par jour, est en fait le résultat d'une guerre civile longue et opiniâtre entre la classe capitaliste et la classe ouvrière." (Marx, Le Capital). En décadence, les concessions faites par la bourgeoisie à la classe ouvrière, suite aux mouvements sociaux révolutionnaires des années 1917-23, sont, pour la première fois, des mesures prises pour calmer (journée des huit heures, suffrage universel, assurances sociales, etc.) et encadrer (conventions collectives, droits syndicaux, commissions ouvrières, etc.) un mouvement social qui ne s'assigne plus comme but l'obtention de réformes durables dans le cadre du système mais la conquête du pouvoir. Dernières mesures à être un sous-produit des luttes, elles marquent le fait qu'en décadence c'est l'Etat avec l'aide des syndicats qui organisent, encadrent et planifient les mesures sociales afin de prévenir et contenir le danger prolétarien. Ceci se marque par le gonflement des dépenses étatiques consacrées au domaine social (salaire indirect prélevé sur la masse salariale globale) :
Tableau 2. Dépenses de l'État dans le domaine social
En pourcentage du PNB
|
|
|
All |
Fr |
GB |
US |
|
ASCENDANCE |
1910 |
3.0% |
- |
3.7% |
- |
|
|
1912 |
- |
1.3% |
- |
- |
|
DÉCADENCE |
1920 |
20.4% |
2.2% |
6.3% |
- |
|
|
1922 |
- |
- |
- |
3.1% |
|
|
1950 |
27.4% |
8.3% |
16.0% |
7.4% |
|
|
1970 |
- |
- |
- |
13.7% |
|
|
1978 |
32.0% |
- |
26.5% |
- |
|
|
1980 |
- |
10.3% |
- |
- |
Sources : Ch. André & R. Delorme, op. cit. dans la Revue internationale n° 54.
En France, en plein calme social, l'Etat prend une série de mesures sociales : 1928-30 assurance maladie, 1930 enseignement gratuit, 1932 allocations familiales ; en Allemagne, assurance sociale élargie aux employés et ouvriers agricoles, aide aux chômeurs (1927). C'est au cours de la seconde guerre mondiale, c'est à dire au sommet de la défaite de la classe ouvrière qu'est conçu, discuté et planifié au sein des pays développés la mise en place du système actuel de sécurité sociale ([7] [23]), en France en 1946, en Allemagne en 1954-57 (loi sur la cogestion en 1951), etc.
Le but premier de toutes ces mesures vise à un meilleur contrôle social et politique de la classe ouvrière, à accroître sa dépendance vis-à-vis de l'Etat et des syndicats (salaire indirect). Mais la conséquence secondaire de ces mesures sur le plan économique est l'atténuation des fluctuations de la demande dans le secteur II de la production (biens de consommations), là où apparaît en premier la surproduction.
L'instauration de revenus de remplacement, de programmation des hausses salariales ([8] [24]) et le développement du crédit à la consommation participent du même mécanisme.
Armements, guerres, reconstruction
En période de décadence du capitalisme, les guerres et la production militaire n'ont plus aucune fonction de développement global du capital. Ils ne constituent ni des champs d'accumulation du capital ni des moments de centralisation politique de la bourgeoisie - cf. guerre Franco-Prussienne de 1871 pour l'Allemagne (voir Revue Internationale n° 51, 52, 53).
Les guerres sont la plus haute expression de la crise et de la décadence du capitalisme. "A Contre-courant" (ACC) se refuse à un tel constat. Pour ce "groupe" les guerres ont une fonctionnalité économique au travers du processus de dévalorisation du capital suite aux destructions, de même, elles accompagnent un capitalisme en développement toujours croissant dont elles expriment le degré grandissant des crises. Ainsi les guerres ne recèlent aucune différence qualitative entre l'ascendance et la décadence du capitalisme : "A ce niveau nous tenons à relativiser même l'affirmation de guerre mondiale (...). Toutes les guerres capitalistes ont donc essentiellement un contenu international (...). Ce qui change réellement n'est pas le contenu mondial invariant (n'en déplaise aux déeadentistes) mais bien l'étendue et la profondeur chaque fois plus réellement mondiale et catastrophique." (n° 1). ACC mobilise deux exemples à l'appui de sa thèse, la période des guerres Napoléoniennes (1795-1815) et le caractère encore local (sic!) de la première guerre MONDIALE par rapport à la seconde. Ces exemples sont totalement inopérants. Les guerres Napoléoniennes se situent à la charnière entre deux modes de production, ce sont les dernières guerres d'Ancien Régime (décadence féodale), elles ne peuvent être prises comme caractéristiques des guerres de type capitaliste. Si Napoléon, par ses mesures économiques, va favoriser le développement du capitalisme, il va, sur le plan politique, entamer une campagne guerrière dans le droit fil de la tradition d'Ancien Régime. La bourgeoisie ne s'y trompera d'ailleurs pas, après l'avoir soutenu dans un premier temps, elle le lâchera par la suite, trouvant ses campagnes trop coûteuses et supportant de plus en plus mal un blocus continental qui étouffe son développement. Quant au second exemple il faut un sacré culot ou une bonne dose d'ignorance historique pour le soutenir. La question n'est pas tant de comparer la première à la seconde guerre mondiale mais de les comparer aux guerres du siècle dernier, chose que ACC se garde bien de réaliser. Là, l'évidence ne peut échapper à personne.
Après la démence des guerres d'Ancien Régime, celles-ci se sont adaptées et circonscrites aux nécessités du capital conquérant le monde, telles que nous les avons longuement décrites dans la Revue Internationale n° 54, pour se muer à nouveau dans l'irrationalité la plus complète en décadence du système capitaliste. Avec l'approfondissement des contradictions du capital il est normal que la seconde guerre mondiale soit plus ample et destructrice que la première, mais dans leurs grandes caractéristiques elles sont identiques et s'opposent aux guerres du siècle dernier.
Quant à l'explication de la fonction économique de la guerre par la dévalorisation du capital (hausse du taux de profit - PV/CC+CV - par destruction de capital constant) elle ne tient pas debout. D’une part parce que l'on constate que les travailleurs (CV) sont également fauchés au cours de la guerre et d'autre part parce que la croissance de la composition organique du capital se poursuit pendant la guerre. S'il y a accroissement momentané du taux de profit dans l'immédiat après-guerre, c'est d'une part parce qu'il y a augmentation du taux de plus-value due à 1a défaite et la sur-exploitation de la classe ouvrière et d'autre part, grâce à l'accroissement de la plus-value relative engendrée par le développement de la productivité du travail.
A l'issue de la guerre le capitalisme se trouve toujours face au même problème de la nécessité d'écouler la totalité de sa production. Ce qui a changé c'est d'une part, la diminution momentanée de la masse de la plus-value destinée à être réinvestie qui doit être réalisée (les destructions de la guerre ont fait disparaître la surproduction d'avant guerre) et d'autre part, le désengorgement du marché par l'élimination de concurrents (les USA s'accaparent l'essentiel des marchés coloniaux des anciennes métropoles européennes).
Quant à la production d'armement, sa motivation première est également imprimée par la nécessité de survivre dans un environnement inter-impérialiste quel qu'en soit le coût. Ce n'est que subséquemment qu'elle joue un rôle économique. Bien que constituant une stérilisation de capital et se soldant par un bilan nul, au niveau du capital global, après un cycle de production, elle permet au capital de décaler ses contradictions dans le temps ET dans l'espace. Dans le temps parce que la production d'armements entretient momentanément la fiction de la poursuite de l'accumulation et dans l'espace parce qu'en instiguant en permanence des foyers de guerres localisées et en vendant une grande part de cette production dans le "tiersmonde", le capital opère un transfert de valeur de ces derniers pays vers les plus développés ([9] [25]).
L'épuisement des palliatifs
Employés partiellement APRES la crise de 1929 sans pouvoir la résoudre (New Deal, Front Populaire, plan De Man, etc.) les moyens mis en oeuvre par le capitalisme pour reporter l'échéance de sa contradiction fondamentale, et décrit ci-dessus, ont déjà été amplement utilisés dès le début et tout au long de la période qui va de la guerre à la fin des années 60. Ils viennent tous aujourd'hui à épuisement. Ce à quoi nous assistons ces vingt dernières années c'est à la fin de l'efficacité de ces palliatifs.
La poursuite de la croissance militaire est une nécessité (car poussée par les besoins impérialistes toujours plus importants), mais elle ne constitue plus un palliatif temporaire. De par leur ampleur les coûts de cette production grèvent directement le capital productif. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à un ralentissement de sa croissance (sauf au USA, 2,3 % de croissance pour 1976-80 et 4,6 % pour 1980-86) et à une diminution de la part du "tiers-monde" dans les achats, encore que de plus en plus de dépenses militaires soient masquées, dans la "recherche" notamment. Quoi qu'il en soit, les dépenses militaires mondiales continuent d'augmenter chaque années (3,2 %, 1980-85) à un rythme supérieur à celui du PNB mondial (2,4 %).
L'emploi massif de crédits est arrivé à un point tel qu'il provoque de graves secousses monétaires (cf. octobre noir de 1987). Le capitalisme n'a plus d'autre choix que de naviguer entre le danger de la reprise de l'hyper-inflation (crédits inconsidérés) et de la récession (taux d'intérêts élevés pour contenir le crédit). Avec la généralisation du mode production capitaliste, la production se détache de plus en plus du marché, la réalisation de la valeur des marchandises et de la plusvalue se complique davantage. Le producteur ignore de plus en plus si ses marchandises trouveront un débouché réel, si elles rencontreront un "dernier consommateur". En permettant une expansion de la production sans rapport avec les capacités d'absorption du marché, le crédit retarde l'échéance des crises mais aggrave le déséquilibre et rend par conséquent la crise plus violente quand elle éclate.
Le capitalisme peut de moins en moins supporter des politiques inflationnistes pour artificiellement soutenir l'activité économique. Une telle politique suppose des taux d'intérêts élevés (car inflation déduite il ne reste plus grand chose de l'intérêt sur les sommes déposées). Mais des taux d'intérêts bancaire élevés impliquent un taux de profit élevé dans l'économie réelle (en règle général le taux d’intérêt doit être inférieur au taux de profit moyen). Or, c'est de moins en moins possible, les méventes, la crise de surproduction font chuter 1a rentabilité du capital investi et ne permettent plus de dégager un taux de profit suffisant pour payer les intérêts bancaires. Ce différentiel en tenaille s'est concrétisé en octobre 1987 par la panique boursière que l'on connaît.
Les marchés extra-capitalistes sont tous sur-exploités, pressurés à fond, et ils sont loin de constituer un exutoire possible.
Aujourd'hui c'est la rationalisation des faux frais qui est de mise, le développement des secteurs improductifs aggrave plus qu'il ne soulage du fait de leur sur-développement.
Ces palliatifs employés abondamment depuis 1948 n'étaient déjà pas fondés sur une base saine mais leur épuisement actuel engendre une impasse économique d'une gravité sans précédent. La seule politique possible aujourd'hui est l'attaque frontale de la classe ouvrière, attaque que tous les gouvernements de droite comme de gauche, à l'Est comme à l'Ouest appliquent avec zèle. Cependant cette austérité qui fait payer cher la crise à la classe ouvrière, au nom de la compétitivité de chaque capital national, ne porte pas en elle même une une "solution" à la crise globale au contraire, elle ne fait que réduire encore plus la demande solvable.
Conclusions
Si nous nous sommes penchés sur les éléments explicatifs de la survie du capitalisme en décadence ce n'est pas par souci académique comme nos censeurs mais dans un but militant. Ce qui nous importe c'est de mieux comprendre les conditions du développement de la lutte de classe en la renlaçant dans le seul cadre valable et cohérent : la décadence, en saisissant toutes les modalités introduites par le capitalisme d'Etat et en comprenant toute l'urgence et l'enjeu de la situation actuelle par la reconnaissance de l'épuisement de tous les palliatifs à la crise catastrophique du capitalisme (cf. Revue Internationale n° 23, 26, 27, 31).
Marx n'a pas attendu d'avoir achevé Le Capital pour s'engager et prendre position dans la lutte de classe. Rosa Luxemburg et Lénine n'ont pas attendu d'accorder leurs violons sur l'analyse économique de l'impérialisme avant de prendre position sur la nécessité de fonder une nouvelle internationale, de lutter contre la guerre par la révolution, etc. D'ailleurs derrière leurs différences (Lénine = baisse tendancielle du taux de profit et monopole, Rosa Luxemburg = la saturation des marchés) il y a un profond accord sur toutes les questions cruciales pour la lutte de classe et notamment la reconnaissance de la faillite historique du mode de production capitaliste qui met à l'ordre du jour la révolution socialiste :
"De tout ce qui a été dit plus haut de l'impérialisme, il ressort qu'on doit le caractériser comme un capitalisme de transition ou, plus exactement, comme un capitalisme AGONISANT. (...) le parasitisme et la putréfaction caractérisent le stade historique suprême du capitalisme c'est-à-dire l'impérialisme. (...) L'impérialisme est le prélude de la révolution sociale du prolétariat. Cela s'est confirmé, depuis 1917, à l'échelle mondiale."( Lénine, L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Oeuvres complètes, Ed.. de Moscou, t. 22). Si ces deux grands marxistes se sont tellement fait attaquer à propos de leur analyse économique c'est moins pour celle-ci que pour leur prise de positions politiques. De même, derrière l'attaque dont le CCI est l'objet sur les questions économiques se cache en réalité un refus de l'engagement militant, une conception conseilliste du rôle des révolutionnaires, une non reconnaissance du cours historique actuel aux affrontements de classes et une non conviction de la faillite historique du mode de production capitaliste.
C.Mcl
- "Les rapports juridiques, pas plus que les formes de l'Etat, ne peuvent s"expliquer ni par eux-même, ni par la prétendue évolution de l'esprit humain ; bien plutôt, ils prennent leurs racines dans les conditions matérielles de la que Hegel, à l'exemple des anglais et des français du XVIIIe siècle, comprend dans leur ensemble sous le nom de "société civile" ; et c'est dans l'économie politique qu'il convient de chercher l'anatomie de la société civile...
- "ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de productions existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de dévekloppement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociales." Marx, Avant-propos à la crtique de l'économie politique.
[1] [26] C'est pourquoi Marx a toujours été très clair sur le fait que le dépassement du capitalisme et l'avènement du socialisme supposent l'abolition du salariat : "Sur leur bannière, il leur faut effacer cette devise conservatrice : 'Un salaire équitable pour une journée de travail équitable', et inscrire le mot d'ordre révolutionnaire: Abolition du salariat!' (... ) pour l'émancipation finale de la classe ouvrière, c'est-à-dire pour abolir enfin le salariat". (Marx, Salaire, prix et plus-value, Ed.. La Pléiade).
[2] [27] Nous ne prétendons pas ici avancer une explication détaillée des mécanismes économiques et de l'histoire du capitalisme depuis 1914 mais simplement poser les éléments majeurs qui ont permis sa survie et nous centrer sur les moyens qu'il a déployés pour repousser l'échéance de sa contradiction fondamentale.
[3] [28] Nous devons signaler ici qu'à part quelques questions "légitimes", bien qu'académiques, cette brochure-critique n'est qu'un ramassis de déformations motivé par la politique de "qui veut tuer son chien prétend qu'il a la rage".
[4] [29] La loi de la valeur règle l'échange sur la base de l'équivalence des quantités de travail. Mais, compte tenu du cadre national des rapports sociaux capitalistes de production et des différences nationales croissantes des conditions de la production (productivité et intensité du travail, composition organique du capital, salaires, taux de plus-value, etc.) au cours de la décadence, la péréquation du taux de profit parvenant à la formation d'un prix de production opère essentiellement dans le cadre national. II existe donc des prix de production différents d'une même marchandise dans différents pays. Ceci implique qu'au travers du commerce mondial le produit d'une journée de travail d'une nation plus développée sera échangée contre le produit de plus d'une journée de travail d'une nation moins productive ou à salaires nettement inférieurs... Les pays exportateurs de produits finis peuvent vendre leurs marchandises au-dessus de leur prix de production mais tout en restant en dessous du prix de production du pays importateur. Ils réalisent ainsi un sur-profit par transfert de valeurs. Ex. : un quintal de blé US revient en 1974 à 4 h de salaire d'un manceuvre aux Etats-Unis mais à 16 h en France du fait de la plus grande productivité de l'agriculture outre Atlantique. Les entreprises agro-industrielles US peuvent vendre leur blé en France au-dessus de leur prix de production (4 h) tout en restant plus compétitives que le blé français (16 h) - ceci explique le redoutable protectionnisme du marché agricole de la CEE face aux produits US et les incessantes querelles sur cette question.
[5] [30] Pour la FECCI cela n'est plus vrai. C'est le passage de la domination formelle à la domination réelle qui explique le développement du capitalisme d'Etat. Or, si cela était, nous devrions statistiquement constater une progression continue de la part de l'Etat dans l'économie puisque ce passage de domination se déroule sur toute une période et, de plus, cette progression devrait débuter au cours de la phase ascendante. Manifestement ce n'est pas du tout le cas. Les statistiques que nous avons publiées nous montrent une rupture nette en 1914. En phase ascendante la part de l'Etat dans l'économie est FAIBLE et CONSTANTE (elle oscille autour de 12 %) alors qu'elle croît au cours de la décadence pour atteindre aujourd'hui une moyenne avoisinant les 50 % du P.N.B. Ceci confirme notre thèse de l'indissoluble lien entre le développement du capitalisme d'Etat et la décadence et infirme catégoriquement celle de la FECCI.
[6] [31] Au terme de cette suite d'articles, il faut être aveugle comme nos censeurs pour ne pas voir la rupture constituée par la première guerre mondiale dans le mode de vie du capitalisme. Toutes les séries statistiques sur le long terme publiées dans l'article montrent cette rupture : production industrielle mondiale, commerce mondial, prix, intervention de l'Etat, termes de l'échange et armements. Seule l'analyse de la décadence et son explication par la saturation mondiale des marchés permet de comprendre cette rupture.
[7] [32] A la demande du gouvernement anglais, le député libéral Sir William Beveridge rédige un rapport, publié en 1942, qui servira de base pour édifier le système de sécurité sociale en GB mais inspirera également tous les systèmes de sécurité sociale des pays développés. Le principe est d'assurer à TOUS, en contre partie d'une cotisation prélevée sur le salaire, un revenu de remplacement en cas de "risque social" (maladie, accident, décès, vieillesse, chômage, maternité, etc.).
[8] [33] C'est également au cours de la seconde guerre mondiale que la bourgeoisie au Pays-Bas planifie avec les syndicats la hausse progressive des salaires selon un coefficient qui est fonction de la hausse de la productivité tout en lui étant inférieur.
[9] [34] CoC aime quand 2 et 2 font a, dès qu'on leur explique que quatre peut être obtenu en faisant 6 moins 2 c'est, pour eux, contradictoire. C'est pourquoi CoC revient "au CCI et d ses considérations contradictoires sur l'armement. Si d'un côté tes armements fournissent des débouchés d la production au point que par exempte la reprise économique après ta crise de 1929 serait due exclusivement d l'économie d'armement, d'un autre côté nous apprenons que l'armement n'est pas une solution aux crises et donc que tes dépenses d'armements sont pour le capital un gaspillage inouï pour !e développement des forces productives, une production d inscrire au passif du bilan définitif." (n' 22 p. 23)
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [36]
Vingt ans depuis 1968 : l'évolution du milieu politique depuis 1968 (3ème partie)
- 2627 reads
LES DEUX PREMIERES PARTIES DE CET ARTICLE SONT PARUES DANS LES NUMEROS 53 ET 54 DE LA REVUE INTERNATIONALE
Le milieu de l’année 1983 est marqué par la reprise de la lutte de classe. Sabotées par les manoeuvres du syndicalisme de base impulsé par la gauche et les gauchistes, déboussolées par le passage de la gauche dans l'opposition, les luttes de 78-80 en occident ont été dévoyées, et leur reflux ponctué par la répression brutale de décembre 1981 en Pologne, préparée par le travail de sape de Solidarnosc. Après trois ans de recul, la combativité retrouvée du prolétariat ne va cesser de s'affirmer sur l'ensemble de la planète : après les grèves massives des ouvriers de Belgique à l'automne 1983, ce sont successivement la Hollande, la R.FA., la Grande-Bretagne, les U.S A., la Suède, la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Corée, la Pologne, et la liste n'est pas exhaustive, qui sont marqués par des luttes significatives de la classe ouvrière.
Comment le milieu politique prolétarien et les organisations qui le constituent, vont-ils réagir ? Comment va être assumée la responsabilité essentielle des révolutionnaires, une nouvelle fois posée avec acuité par la lutte de classe en développement : celle de la nécessité de l'intervention des révolutionnaires au sein des luttes de leur classe
Quelles vont être les conséquences de l'accélération de l'histoire sur tous les plans : économique, militaire et social, sur la vie du milieu politique prolétarien ? Le redéploiement de la lutte de classe porte en lui le développement potentiel du milieu révolutionnaire. Cette revitalisation de la lutte ouvrière va-t-elle permettre au milieu politique prolétarien de surmonter la crise qu'il a traversée dans la période précédente ? Va-t-elle lui permettre de dépasser les difficultés et les faiblesses qui le marquent depuis la reprise historique de la lutte de classe en 1968 ?
UN MILIEU POLITIQUE AVEUGLE FACE A LA LUTTE DE CLASSE
"Les formidables affrontements de classe qui se préparent seront également une épreuve de vérité pour les groupes communistes : ou bien, ils seront capables de prendre en charge ces responsabilités et ils pourront apporter une contribution réelle au développement des luttes, ou bien ils se maintiendront dans leur isolement actuel et ils seront balayés par le flot de l’histoire sans avoir pu mener à bien la fonction pour laquelle la classe les a fait surgir. "
Adresse du CCI aux groupes politiques prolétariens (2° trimestre 1983).
Le CCI sera la seule organisation à reconnaître pleinement dans les mouvements de classe de l'année 1983 les signes d'une reprise internationale de la lutte de classe. Pour l'ensemble des autres groupes du milieu prolétarien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour ceux-ci, les luttes ouvrières qui se développent sous leurs yeux, à partir de 1983, n'ont rien de significatif ; elles restent encore sous l'emprise des appareils syndicaux, donc elles ne peuvent être l'expression d'une reprise prolétarienne !
En dehors du CCI., la plupart des organisations du milieu politique prolétarien qui ont survécu à la décantation et à la crise de la fin des années 70 et du début des années 80, théorise, comme un seul homme, que nous sommes toujours en période de contre-révolution. Les plus anciennes organisations du milieu révolutionnaire, chacune à sa manière, affirment donc que depuis la débâcle prolétarienne des années 30, il n'y a pas grand-chose de changé, notamment celles issues du P.C.I. de 1945, c'est-à-dire les différents groupes de la diaspora bordiguiste d'une part (P.C.I.-Programme communiste ou II Partito Comunista par exemple) et Battaglia Comunista (regroupée avec la C.W.O. de G.B. au sein du B.I.P.R.) d'autre part. Quant au F.O.R., lui qui au plus profond de la défaite ouvrière dans les années 30 voit la révolution triomphante en Espagne, aujourd’hui, il ne voit dans les luttes ouvrières que leur faiblesse !
Les micro-sectes parasitaires, incapables d'exprimer une cohérence propre, soit développent un académisme bordiguisant tout à fait stérile comme par exemple Communisme ou Civilisation en France, soit sombrent dans une dérive anarcho-conseilliste; les deux tendances n'étant d'ailleurs absolument pas contradictoires comme le montre un groupe tel que le G.C.I. Mais le point commun reste toujours une négation bornée de la réalité de la lutte de classe présente. Même les vestiges du milieu "moderniste" issues de 1968, participent à leur manière à cette négation généralisée de la combativité en développement du prolétariat dans les années 80. Ainsi on a pu voir surgir de manière éphémère mais significative en France une revue au titre évocateur : La Banquise.
La vision, généralisée en dehors du CCI., selon laquelle le cours historique est toujours à la contre-révolution, traduit à l'évidence une sous-estimation dramatique de la lutte de classe depuis 1968 et ne peut donc que se manifester négativement sur le plan essentiel pour les révolutionnaires qu'est celui de leur intervention au sein des luttes. Cette situation déjà évidente à la fin des années 60, lorsque les organisations alors constituées, telles le P.CI.(Programme communiste) et le P.CI.(Battaglia comunista) sont étrangement absentes, car elles ne voient pas la lutte de classe qui se déroule sous leurs yeux et nient l'importance significative des luttes ouvrières de mai 68 en France - grève la plus massive que le prolétariat ait jamais menée en France pourtant-, se confirme à la fin des années 70. L'intervention du CCI dans la vague de lutte qui se redéploie, va être la cible des critiques de l'ensemble du milieu prolétarien. Cette vision du cours historique prend un tour encore plus aigu avec la reprise des luttes depuis 1983.
LA QUESTION DE L'INTERVENTION AU COEUR DES DEBATS
Depuis le début du renouveau de la lutte de classe qui marque les années 80, l'intervention des organisations politiques révolutionnaires dans les luttes ouvrières, en dehors de, celle du CCI., va être quasiment inexistante. Les groupes politiquement les plus faibles vont aussi être, bien sûr, les plus absents de l'intervention directe dans les luttes. Après un activisme tous azimuts au début des années 80, le G.C.I., alors que la lutte de classe se développe, va s'enfoncer dans un académisme douillet, tandis que le F.O.R., pour justifier son inexistence sur le terrain de la lutte de classe, va se réfugier derrière la théorisation de son manque de moyens matériels ([1] [37]) ! Tout à fait significatif est le fait que, malgré leurs rodomontades, ces groupes n'ont, durant cette période qui s'est ouverte depuis 1983, pas dû faire plus de tracts qu'une seule main ne compte de doigts, sans parler même de leur contenu.
Le B.I.P.R. quant à lui, exprime certainement une autre solidité politique que celle des groupes que nous venons de citer; pourtant, son intervention au sein des luttes n'est guère plus reluisante. Cela est d'autant plus grave que cette organisation constitue en dehors du CCI. le principal pôle de regroupement au sein du milieu politique prolétarien international. La volonté effective d'intervention de ce groupe lors de la longue grève des mineurs en Grande-Bretagne en 1984 ne va malheureusement pas se répéter dans les luttes qui vont suivre. Malgré une présence effective de membres du B.I.P.R. en France, celui-ci ne développera aucune intervention lors de la grève des cheminots en 1986 et, si Battaglia Comunista intervient dans la lutte des travailleurs de l'école en 1987 en Italie, ce sera avec de longues semaines de retard sous la sollicitation insistante de la section du CCI dans ce pays.
Cette faiblesse de l'intervention du B.I.P.R. trouve son origine dans ses conceptions politiques erronées qui ont déjà été au coeur des débats des conférences internationales des groupes de la Gauche communiste qui se sont déroulées en 1977, 1978 et 1980. Cela s'exprime essentiellement sur deux plans :
- une incompréhension de la période historique présente qui entraîne l'incompréhension des caractéristiques de la lutte de classe dans cette période et se traduit par une sous-estimation profonde de celle-ci. Ainsi, la C.W.O. peut écrire au groupe Alptraum du Mexique à propos des luttes en Europe : "Nous ne pensons pas que la fréquence et l'extension de ces formes de luttes indiquent -tout au moins jusqu'à aujourd’hui- une tendance vers leur développement progressif Par exemple, après les luttes des mineurs britanniques, des cheminots en France, nous avons l'étrange situation dans laquelle les couches agitées sont celles de la petite-bourgeoisie /", et de citer ensuite, entre autres, comme exemple de la petite-bourgeoisie, les enseignants !
- de graves confusions sur la question du parti qui se traduisent par une incompréhension du rôle des révolutionnaires. Toujours à Alptraum qui a publié cette lettre dans Comunismo n° 4, le B.I.P.R. peut ainsi écrire : "Il n'existe pas un développement significatif des luttes parce qu'il n'existe pas le parti; et le parti ne pourra exister sans que la classe ne se trouve dans un processus de développement des luttes". Comprenne qui pourra dans cette étrange dialectique, mais dans ces conditions, c'est toute la question du rôle décisif de l'intervention des révolutionnaires qui est escamotée en attendant le surgissement du 'deus ex-machina', du parti avec un grand P.
Durant toute cette période, le CCI. qui ne se proclame pas Parti comme le P.C.I.(Battaglia comunista), a, quant à lui, essayé de développer son intervention dans la mesure de ses forces, essayant de s'élever à la hauteur des responsabilités historiques qui sont celles des révolutionnaires vis-à-vis de leur classe. Pas une lutte significative, là où existent des sections du CCI. , dans laquelle les positions révolutionnaires n'aient été défendues, et où l'intervention du CCI n'ait tenté de pousser la dynamique ouvrière, de briser l'étau syndical, d'impulser l'extension, que ce soit par tracts, par des prises de paroles dans les assemblées ouvrières, par la diffusion de notre presse, etc. Il ne s'agit pas ici de tirer gloriole de ce fait ni de s'étaler démesurément, mais de poser simplement ce que doit être l'intervention des révolutionnaires lorsque le prolétariat développe ses luttes et que l'impact de leurs idées s'en trouve donc facilité.
Dans ces conditions, il n'est par conséquent pas surprenant que les débats et polémiques entre les différents groupes communistes sur la question de l'intervention proprement dite soient finalement restés plutôt maigres. Face à la vacuité de l'intervention des autres groupes, il n'a pu y avoir de réels débats sur le contenu d'une intervention qui n'existait pas. Il a fallu revenir aux principes de base sur le rôle des révolutionnaires que le CCI. a défendus avec vigueur. Quant à la critique des autres groupes vis-à-vis du CCI., elle s'est en général bornée à dire que le CCI surestimait la lutte de classe et sombrait dans l'activisme !
De fait, les questions de la reconnaissance du développement réel de la lutte de classe et du rôle des révolutionnaires dans la question de l'intervention vont constituer la ligne de démarcation au sein du milieu communiste qui polarisera, durant les années 80, tous les débats en son sein.
LES DEBATS AU SEIN DU CCI ET LA FORMATION DE LA F.E.CCI.
Les tendances délétères de la propagande bourgeoise qui a durant ces années imposé un black-out sur la réalité des grèves pour mieux en nier l'existence, n'ont pas seulement poussé l'ensemble des autres organisations prolétariennes à rester aveugles face aux luttes ouvrières, à les sous-estimer profondément, mais ont aussi pesé sur le CCI. De la lutte au sein du CCI contre ces tendances à la sous-estimation de la lutte de classe va naître un débat qui a pour fondement les questions de la conscience de classe et du rôle des révolutionnaires. Ce débat va ensuite se développer pour poser :
- la question du danger que constitue dans la période actuelle le conseillisme qui cristallise une tendance à nier la nécessité de l'organisation politique et donc à nier la nécessité d'une intervention organisée au sein de la classe;
- la question de l'opportunisme comme expression de l'infiltration de l'idéologie dominante au sein des organisations du prolétariat.
Ces débats vont être la source d'un renforcement politique et de clarifications essentielles au sein du CCI. Ils vont permettre un renforcement de la capacité d'intervention au sein des luttes par une meilleure compréhension du rôle actif des révolutionnaires dans le processus de développement de la conscience dans la classe, et une meilleure réappropriation de l'héritage des fractions révolutionnaires du passé qui va s'exprimer dans une vision plus adéquate du processus de dégénérescence et de trahison des organisations de la classe au début du siècle et dans les années 30.
Se trouvant réduits à une petite poignée, plus dilettante que militante, des camarades en désaccord vont saisir le premier prétexte venu pour se retirer, dès le début de ses travaux, du 6e Congrès du CCI., fin 1985, contents de se "libérer" du "carcan" de l'organisation, et vont se constituer en "Fraction Externe" du CCI., prétendant être les défenseurs "orthodoxes" de la plate-forme du CCI. Cette scission irresponsable traduit une incompréhension profonde de la question de l'organisation et donc une sous-estimation grave de sa nécessité. Plus que toutes les arguties théoriques et le tombereau de calomnies que la F.E.CCI a pu déverser sur le CCI pour justifier son existence de secte, ce qui détermine son surgissement, c'est une sous-estimation de la lutte de classe et du rôle essentiel des révolutionnaires dans leur intervention au sein de celle-ci. La F.E.CCI., si parfois elle reconnaît formellement la reprise des luttes prolétariennes depuis 1983, s'est engagée ainsi dans les mêmes ornières de passivité académique où patauge malheureusement déjà la majorité des organisations plus anciennes du milieu prolétarien, comme nous venons de le voir. Elle qui se proclame le défenseur orthodoxe de la plate-forme du CCI., va peu à peu, depuis 1985, se trouver une multitude de nouvelles divergences qui constituent autant d'abandons de la cohérence dont elle entendait pourtant se faire le "dernier" défenseur ! La F.E.CCI a ouvert la boîte de Pandore, et comme l'ont fait avant elle d'autres scissions du CCI. tels le P.I.C et le G.C.I., c'est à d'autres abandons bien plus graves, mettant en cause la plate-forme dont elle se réclame, qu'elle se prépare dans la dynamique où elle se trouve entraînée pour valider son existence séparée.
LE POIDS DE LA DECOMPOSITION SOCIALE ET LA DECANTATION AU SEIN DU MILIEU REVOLUTIONNAIRE
Cette nouvelle scission est-elle le signe d'une crise du CCI., l'indice d'un affaiblissement politique et organisationnel de l'organisation qui constitue aujourd’hui le principal pôle de regroupement et de clarté au sein du milieu prolétarien? Bien au contraire, ce que la F.E.CCI. exprime, c'est la résistance à la mise en adéquation des activités des révolutionnaires aux besoins de la lutte de classe à un moment où le prolétariat reprend de manière déterminée la voie de la lutte et où se pose de façon aiguë la nécessité de l'intervention, c'est-à-dire de ne pas rester au balcon à regarder la lutte ouvrière qui passe de manière "critique", mais d'être partie prenante de ces luttes, de défendre en leur sein les positions révolutionnaires à un moment où il peut se développer un réel écho à celles-ci. C'est parce que le CCI a su poursuivre la clarification théorique et politique, et le renforcement organisationnel indispensable pour jouer son rôle d'organisation de combat de la classe que les éléments les moins convaincus qui préfèrent les discussions académiques au feu de la lutte de classe l'ont quitté. Paradoxalement, même si tout départ de militants ne peut en aucun cas être quelque chose de souhaitable et si on ne peut que regretter la scission irresponsable qui a donné lieu à la formation de la F.E.CCI et n'a fait qu'apporter un peu plus de confusion dans le milieu qui n'en a nullement besoin, c'est à un renforcement politique et organisationnel du CCI qu'on assiste durant cette période et qui va se concrétiser par sa plus grande capacité à assurer une présence des idées révolutionnaires au sein de la lutte de classe en plein développement.
Cependant, si le surgissement de la F.E.CCI ne traduit pas une crise du CCI qui signifierait, dans la mesure où c'est la principale organisation du milieu, une crise de l'ensemble du milieu prolétarien, elle n'en traduit pas moins les difficultés qui pèsent de manière persistante sur les groupes révolutionnaires depuis le ressurgissement du prolétariat sur la scène de l'histoire en 1968.
Ces difficultés trouvent leur origine, comme nous l'avons vu, dans l'inadéquation théorique et politique fondamentale de la majorité des groupes qui ne voient pas la lutte de classe qui se déroule sous leurs yeux et sont par conséquent bien incapables de se revitaliser à son contact. Mais là n'est pas la seule explication. L'immaturité organisationnelle, produit de décennies de rupture organique d'avec les fractions révolutionnaires issues de l'Internationale communiste, qui marque le milieu prolétarien ressurgi au lendemain de 1968, se concrétise dans un sectarisme pesant, entrave le nécessaire processus de clarification et de regroupement au sein du milieu communiste, va être le biais par lequel s'infiltre l'idéologie dominante dans son aspect le plus pernicieux, celui de la décomposition.
Une des caractéristiques spécifiques de la période historique présente est que, alors que la fuite en avant de la bourgeoisie dans la guerre est freinée par la combativité prolétarienne et que par conséquent la voie à une nouvelle guerre impérialiste généralisée, n'est pas ouverte, le développement lent de la crise et de la lutte de classe n'a pas permis que surgisse encore clairement au sein de la société la perspective prolétarienne de la révolution communiste. Cette difficulté est inhérente au fait que c'est justement face à la crise que la classe ouvrière doit développer ses luttes et sa prise de conscience révolutionnaire. Cette situation de "blocage" se traduit dans le pourrissement sur pied, la décomposition générale de l'ensemble de la vie sociale et de l'idéologie dominante. Avec l'accélération de la crise au dé but des années 80, cette décomposition n'a cessé de s'accentuer. Elle touche particulièrement les couches petites-bourgeoises qui n'ont aucun avenir historique, mais elle tend aussi malheureusement à manifester ses effets pervers sur la vie du milieu prolétarien. C'est la forme que tend à prendre le processus de sélection de l'histoire, de décantation politique au sein du milieu dans la période présente.
Le poids de la décomposition environnante tend à se traduire de différentes manières au sein du milieu prolétarien, on peut notamment citer :
- La multiplication des micro-sectes. Le milieu communiste a connu ces dernières années de multiples petites scissions qui toutes traduisent la même faiblesse, aucune d'elles n'a représenté un quelconque apport à la dynamique de regroupement en se situant clairement par rapport aux pôles de débat déjà existants, mais au contraire, elles se sont enfermées dans leur spécificité pour constituer de nouveaux aspects de confusion dans un milieu prolétarien déjà trop dispersé et émietté. On peut ainsi citer, en dehors de la F.E.CC. dont nous avons déjà trop parlé, A Contre Courant qui quitte le CCI en 1988. S'il exprime une réaction positive face à la dégénérescence du G.C.I., il n' est pas pour autant dans sa critique capable d'aller au-delà d'un retour aux sources de ce groupe, origines qui portent déjà les germes de tous les déboires qu'il a connus ultérieurement. Il en est ainsi aussi de la scission récente du F.O.R. qui s'est réfugié derrière de fausses arguties organisationnelles sans être capable de publier une quelconque argumentation politique. De plus, on a vu ressurgir ou naître, en France par exemple, une multitude de petites sectes parasitaires comme Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons, Cahiers Communistes, etc., qui représentent quasiment autant de points de vue que les quelques individus qui les composent et qui, de flirts en divorces, n'en finissent pas d'alimenter la confusion au sein du milieu politique et face à la classe en fournissant de lamentables caricatures d'organisations prolétariennes. Tous ces groupuscules irresponsables constituent autant de repoussoirs pour des éléments sérieux qui tentent de se rapprocher d'une cohérence révolutionnaire.
- Une perte du cadre normal de débat au sein du milieu révolutionnaire. Ces dernières années ont été marquées par de graves dérapages polémiques au sein du milieu prolétarien dont le CCI. a été la cible essentielle. Que le CCI. soit au centre des débats cela est parfaitement normal dans la mesure où il constitue le principal pôle au sein du milieu révolutionnaire actuel, cependant, cela ne peut en aucun cas justifier les imbécillités dangereuses qui ont pu être écrites sur son compte. Ainsi la mauvaise foi et le dénigrement systématique de la F.E.CCI. qui trouve sa cohésion dans "l’anti-CCI", le F.O.R. qui traite le CCI. de "capitaliste" parce que celui-ci serait riche, et pire encore, le G.C.I. qui édite un article intitulé "Une fois de plus le CCI. du côté des flics contre les révolutionnaires" ! Ces dérapages, plus que l'imbécillité de ceux qui en sont les auteurs traduisent une grave perte de vue de ce qui constitue l'unité du milieu politique prolétarien face à toutes les forces de la contre-révolution et les principes qui doivent présider aux rapports existants en son sein afin de le protéger.
- L'érosion des forces militantes, face au poids dominant de l'idéologie capitaliste, notamment dans ses variantes petites-bourgeoises, la perte de vue de ce qu'est le militantisme révolutionnaire, la perte de conviction et le repli dans le confort "familial" sont un phénomène qui, de tout temps, a pesé sur les organisations révolutionnaires. Cependant dans la période actuelle, cette usure de la conviction militante par l'idéologie dominante s'en trouve accentuée de par la décomposition environnante. De plus, la confrontation aux difficultés de l'intervention dans la lutte de classe est un puissant facteur d'hésitation pour les convictions les moins ancrées, et souvent, tout autant que le retrait pur et simple du militantisme sans divergences réelles, la fuite en avant dans l'académisme stérile, loin du combat que mène la classe est l'expression d'une même peur des implications pratiques du combat révolutionnaire : confrontation avec les forces de la bourgeoisie, répression, etc.
Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que l'usure de l'idéologie dominante dans sa forme décomposée affecte en priorité les organisations politiquement et organisationnellement les plus faibles. Ces dernières années, leur dégénérescence s'est accélérée. L'exemple le plus clair en est le G.C.I. Sa fascination morbide pour la violence l'a mené dans une dérive de plus en plus forte vers le gauchisme et l'anarchisme qui s'est traduite par exemple dans un soutien aux actions du Sentier Lumineux du Pérou, organisation maoïste s'il en est ou encore, récemment, dans le soutien totalement irresponsable aux luttes en Birmanie embrigadées derrière la bannière démocratique et où les ouvriers sont allés au casse-pipe face à l'armée ! Le F.O.R. qui aujourd'hui encore, nie de manière psychotique la crise, s'enfonce dans les marécages modernistes et son outrance verbale cache de plus en plus mal sa vacuité théorique et pratique. Quant à la F.E.CCI., sa critique-critique systématique de la cohérence du CCI la pousse dans une incohérence toujours plus grande et dans sa presse semble s'exprimer autant de points de vue qu'il y a de militants !
De son côté, la diaspora bordiguiste ne s'est pas remise de l'effondrement du P.C.I. (Programme communiste) ([2] [38]) et végète tristement en fournissant son obole au syndicalisme de base. Tous ces groupes, incapables de se situer dans la lutte de classe aujourd'hui parce que fondamentalement ils la nient ou la sous-estiment trop profondément, sont donc incapables de se régénérer à son contact et leur avenir risque d'avoir rapidement l'odeur nauséabonde des poubelles de l'histoire.
Les organisations qui sont l'expression de réels courants historiques au sein du milieu communiste parce qu'elles expriment une plus grande cohérence théorique et une plus grande expérience organisationnelle, sont mieux à même de résister au poids délétère de l'idéologie dominante. Ce n'est certainement pas par hasard si aujourdhui le CCI. et le B.I.P.R. sont les principaux pôles de regroupement au sein du milieu prolétarien. Cependant, cela n'est certainement pas une garantie d'immunisation contre les virus de l'idéologie dominante. Même les organisations les plus solides n'ont pas échappé aux effets pernicieux de la décomposition environnante. L'exemple du P.C.I. bordiguiste qui, à la fin des années 70, était la principale (au moins au niveau numérique) organisation du milieu et qui s'est définitivement effondré (2) au début des années 80, en est le plus parfait exemple. Ces dernières années, le départ du CCI. des éléments qui allaient former la F.E.CCI., ou plus récemment, le départ acerbe des éléments du Noyau nord d'Accion Proletaria, la section en Espagne du CCI., tout comme la participation d'un élément du B.I.P.R. en France à une pseudo-conférence réunissant à Paris la F.E.CCI., Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons et des individus isolés, validant ainsi ce bluff pour ensuite quitter le B.I.P.R. devant le désaveu rencontré, sont autant d'éléments qui montre que la vigilance et le combat contre les effets de la décomposition de l'idéologie sont une priorité.
Le CCI., pour sa part a su prendre clairement position sur ces questions : en diagnostiquant la crise du milieu prolétarien en 1982, en soulignant en 1984 le danger de l'infiltration de l'idéologie dominante qui trouve son expression politique au niveau historique dans l'opportunisme et le centrisme, en posant aujourd'hui dans l'analyse des spécificités de la période actuelle, notamment le poids de la décomposition de l'idéologie capitaliste environnante. Ce faisant, il s'est armé politiquement et renforcé organisa-tionnellement. Le B.I.P.R. quant à lui, préfère faire la politique de l'autruche, la crise du milieu au début des années 80, il l'a splendidement niée, déclarant péremptoirement que ce n'était que la crise des autres groupes. Il est vrai que Battaglia comunista et par la suite le B.I.P.R. n'ont pas connu de scission, mais cela en soi est-il significatif de la vitalité d'une organisation ? Durant les longues années qui ont précédé l'éclatement final du P.CI. (Programme communiste) en 1983, il n'avait pas connu de scissions significatives.... Le manque de débats internes, la sclérose politique ne se traduisent pas le plus souvent par des scissions politiques, mais par un déboussolement politique croissant qui se traduit par une hémorragie militante dans le désenchantement sans qu'il y ait clarification, ni pour ceux qui partent, ni pour ceux qui restent.
Pour le B.I.P.R., son repli de l'intervention dans la lutte de classe, sa théorisation de la contre-révolution persistante sont autant de facteurs inquiétants pour son avenir.
Devant ce bilan des difficultés que traverse le milieu politique, doit-on tirer la conclusion que le milieu communiste n'est pas sorti de sa crise du début de la décennie qui s'était pleinement exprimée dans la disparition du bordiguisme comme principal pôle de référence au sein du milieu prolétarien?
Avec la reprise de la lutte de classe, le développement du milieu prolétarien
La situation du milieu prolétarien est aujourd’hui bien différente de celle qui détermine la crise de 1982-83 ([3] [39]) :
- L’échec des Conférences des groupes de la Gauche communiste, sept ans plus tard, même s'il pèse encore, est digéré;
- nous ne sommes plus dans une période de recul de la lutte de classe, au contraire, celle-ci a repris depuis cinq ans maintenant ;
- l'organisation la plus importante du milieu prolétarien n'est plus une organisation sclérosée et dégénérée comme l'était le P.C.I. bordiguiste.
En ce sens, le milieu politique n'est pas, malgré les faiblesses très graves qui continuent de le marquer et dont nous venons de tracer un rapide bilan, dans la même situation de crise que celle qui l'a marqué au début de la décennie. Au contraire, depuis 1983, le développement de la lutte de classe en même temps qu'il crée le terrain pour un écho renforcé des positions révolutionnaires tend à faire surgir de nouveaux éléments au sein du milieu prolétarien. Même si, à l'image de la lutte de classe dont il est le produit, ce surgissement d'un nouveau milieu révolutionnaire est un processus lent, il n'en est pas moins significatif de la période présente.
L'apparition d'un milieu politique prolétarien à la périphérie des principaux centres du capitalisme mondial comme au Mexique avec Alptraum qui publie Comunismo et le Grupo Proletario Internacionalista qui publie Revolucion Mundial, en Inde avec les groupes Communist Internationalist et Lai Pataka et le cercle Kamunist Kranti, en Argentine avec le groupe Emancipacion Obrera, est extrêmement important pour l'ensemble du milieu prolétarien, alors que durant des années, nul écho des positions révolutionnaires ne semblait surgir de ces pays marqués par le sous-développement capitaliste. Bien sûr, tous ces groupes n'expriment pas le même degré de clarté, et leur survie reste fragile étant donnés leur manque d'expérience politique, leur éloignement du centre politique du prolétariat que constitue l'Europe, les conditions matérielles extrêmement précaires dans lesquelles ils doivent se développer. Cependant, le simple constat de leur existence est la preuve de la maturation générale de la conscience de classe qui est en train de se développer au sein du prolétariat mondial.
Le surgissement de ces groupes révolutionnaires à la périphérie du capitalisme pose de manière cruciale la responsabilité des organisations révolutionnaires déjà existantes qui ont tenté de se réapproprrier l'expérience historique du prolétariat qui fait cruellement défaut aux nouveaux groupes surgissant sans connaissance réelle des fractions révolutionnaires du passé, sans même une connaissance des débats qui ont animé le milieu communiste depuis deux décennies, sans expérience organisationnelle. La situation de dispersion du milieu politique ancien marqué par le sectarisme est une entrave dramatique au nécessaire processus de clarification dans lequel ces nouveaux éléments qui surgissent au sein du milieu révolutionnaire doivent s'engager. Vu de loin, il est extrêmement difficile de s'y retrouver dans le dédale des multiples groupes existant en Europe et d'apprécier à leur juste mesure l'importance politique des différents groupes et des débats existants.
Les mêmes difficultés qui affectent le milieu politique ancien centré sur l'Europe pèsent d'un poids encore plus fort sur les nouveaux groupes qui surgissent à la périphérie, par exemple le sectarisme d'un groupe comme Alptraum au Mexique ou du cercle Kamunist Kranti en Inde sont malheureusement à signaler, mais il est extrêmement important de comprendre que la confusion politique que ces groupes et éléments peuvent manifester, est d'une nature différente de celle des groupes existants en Europe : si dans le premier cas elle exprime une immaturité de jeunesse renforcée par le poids de l'isolement, dans le second elle est l'expression d'une sclérose précoce ou d'une dégénérescence sénile.
L'influence des groupes anciens va être déterminante pour l'évolution des nouveaux groupes qui surgissent. Ceux-ci ne peuvent développer leur cohérence, se renforcer politiquement, survivre comme expression révolutionnaire qu'en brisant leur isolement, en s'intégrant aux débats existants au sein du milieu politique international, en se rattachant aux pôles historiques déjà existants. Les influences négatives d'un groupe tel que le G.C.I. qui nie l'existence d'un milieu politique prolétarien et véhicule des confusions extrêmement graves vont peser de tout leur poids sur l'évolution d'un groupe tel que Emancipacion Obrera en Argentine, renforçant de plus ses faiblesses intrinsèques. De même, l'académisme de petite secte de Communisme ou Civilisation avec qui Alptraum développe son activité, ne peut mener ce dernier qu'à la stérilité. Le B.I.P.R., dans l'ensemble, a développé une attitude plus correcte vis-à-vis des nouveaux groupes qui surgissaient ; cependant, celle-ci reste entachée par l'opportunisme des conceptions organisa-tionnlles qui ont présidé à la naissance du B.I.P.R. ([4] [40]) : par exemple, l'intégration hâtive de Lai Pataka comme expression du B.I.P.R. en Inde. De plus, la sous-estimation grave de la lutte de classe que tous ces groupes anciens expriment, tend à entraver fortement l'évolution des nouveaux groupes qui surgissent, en les privant de la compréhension fondamentale de ce qui a déterminé leur naissance : le développement international actuel de la lutte ouvrière.
Le CCI. quant à lui, parce qu'il a fait dès son origine, au lendemain de 1968, le constat de la passivité et de la confusion politique des organisations qui existaient alors, notamment chez le P.CI.(Programme communiste) et le P.CI.(Battaglia comunista), prend particulièrement à coeur ses responsabilités vis-à-vis des nouveaux groupes qui surgissent au sein du milieu prolétarien De la même manière que l'intervention au sein de la lutte de classe, l'intervention vis-à-vis des groupes que la lutte de classe fait naître pour notre organisation est une priorité.
Dans la presse du CCI. ont été publiés, loin de tout esprit sectaire, des textes de Emancipacion Obrera, Alptraum, du G.P.I., de Communist Internationalist, et de tous les groupes dont il a été fait mention dans notre presse, les faisant souvent ainsi connaître à l'ensemble du milieu révolutionnaire, contribuant ainsi grandement à briser leur isolement. Pas un de ces groupes avec lequel une importante correspondance n'ait été échangée, pas un qui n'ait reçu notre visite, afin de permettre des discussions approfondies et contribuer ainsi à une meilleure connaissance réciproque et à la clarification nécessaire, non pas pour faire du recrutement et pousser à une intégration prématurée au sein du CCI., mais pour permettre leur réelle solidification politique, leur survie, étape indispensable pour qu'un regroupement que nous estimons toujours nécessaire puisse se faire dans la plus grande clarté.
Si l'apparition de nouveaux groupes dans des pays éloignés des centres traditionnels du prolétariat est un phénomène particulièrement important, tout à fait significatif du développement actuel de la lutte de classe et de ses effets sur la vie du milieu politique, notre insistance ne signifie en aucun cas qu'il n'y a point un développement corollaire là où le milieu politique est déjà présent, bien au contraire. Mais ce développement ne prend pas la même forme, parce que le milieu politique est déjà présent avec ses organisations. Le surgissement de nouveaux éléments tend à se traduire non pas par l'apparition de nouveaux groupes mais par l'apparition d'éléments qui se rapprochent des groupes déjà existants. Les nouveaux éléments qui surgissent, contrairement à la situation de 1968 et de ses lendemains, marquée par le poids du milieu étudiant qui déterminait des préoccupations théoriques générales, le font au contact direct de la lutte ouvrière, produits en son sein. De nouveau, sur ce plan, la question de l'intervention apparaît comme cruciale pour permettre à ces éléments de rejoindre le milieu prolétarien, d'en renforcer les capacités militantes. Le développement actuel des comités de lutte et des cercles de discussion est l'expression du développement de la conscience qui est en train de s'opérer dans la classe. Pour les groupes prolétariens aujourd'hui, sous-estimer la question de l'intervention revient à se couper de ce qui détermine leur vie, cela est particulièrement évident en ce qui concerne le développement des ressources militantes, l'arrivée d'un sang neuf. Les organisations qui ne voient pas cela aujourd'hui, se condamnent à la stagnation d'abord, à la sclérose et à la régression ensuite, à la démoralisation et à la crise plus tard.
Avec le renouveau de la lutte de classe, une nouvelle génération de révolutionnaires est en train de naître. Non seulement l'avenir, mais déjà le présent sont porteurs d'une nouvelle dynamique de développement du milieu prolétarien. Mais cette dynamique ne signifie pas simplement que le relatif isolement des révolutionnaires de leur classe est en train de se briser de façon immédiate, ni que tout va s'en trouver facilité, elle signifie d'abord une décantation accélérée au sein du milieu prolétarien. Rien n'est gagné d'avance, l'avenir des organisations prolétariennes, leur capacité à forger demain le parti communiste mondial indispensable à la révolution communiste dépend de leur capacité présente à assumer les responsabilités pour lesquelles la classe les a produites. Tels sont les enjeux des débats et de l'activité présents du milieu communiste. Les organisations incapables d'assumer dès aujourd'hui leurs responsabilités, d'être partie prenante du combat de classe, ne sont d'aucune utilité pour le prolétariat et pour cette raison, le processus historique apportera sa sanction.
J.J.
[1] [41] Voir l'édifiant article intitulé "Hé ! Ceux du CCI." dans Alarme n° 37-38.
[2] [42] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
[3] [43] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
[4] [44] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [45]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [46]
1918 - 1919: il y a 70 ans ; a propos de la révolution allemande, II
- 3236 reads
Dans le n° 55 de la Revue Internationale, nous avons abordé quelques-uns des traits généraux les plus marquants de l’échec du mouvement révolutionnaire en Allemagne de novembre 1918 à janvier 1919, et les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce mouvement. Nous revenons dans cet article sur la politique contre-révolutionnaire systématique que mena dans cette période le SPD passé dans le camp de la bourgeoisie.
Au début de novembre 1918, la classe ouvrière en Allemagne avait été capable de mettre fin à la première guerre mondiale par sa lutte de masse, par le soulèvement des soldats. Pour couper l'herbe sous les pieds du mouvement, pour éviter un aiguisement plus fort des contradictions de classe, la classe dominante avait été obligée de mettre fin à la guerre sous la pression de la classe ouvrière, et de faire abdiquer le Kaiser ; il lui fallait ensuite éviter que la flamme de la révolution prolétarienne, qui s'était allumée un an plus tôt par la révolution d'octobre 1917 en Russie, n'embrasât aussi l'Allemagne. Tous les révolutionnaires étaient conscients que la classe ouvrière en Allemagne était au centre de l'extension internationale des luttes révolutionnaires : "Pour la classe ouvrière allemande nous sommes en train de préparer... une alliance fraternelle, du pain et une aide militaire. Nous allons tous exposer nos vies, pour aider les ouvriers allemands à pousser en avant la révolution qui a commencé en Allemagne." (Lénine, 1er octobre 1918, "Lettre à Sverdlov").
Tous les révolutionnaires étaient d'accord sur le fait que la révolution devait aller plus loin : "La révolution a commencé. Nous ne nous devons pas nous réjouir de ce qui a été réalisé, nous ne devons pas avoir le sentiment d'un triomphe sur l’ennemi écrasé, mais nous devrions faire la plus forte autocritique, pousser courageusement notre énergie ensemble, pour continuer ce que nous avons commencé. Parce que ce que nous avons réalisé est peu, et l’ennemi n’a pas été défait. " (Rosa Luxemburg, "Le début", 18 novembre 1918).
S'il avait été plus facile pour la classe ouvrière en Russie de renverser la bourgeoisie, la classe ouvrière en Allemagne avait affaire à une classe dominante autrement plus forte et plus intelligente, qui n'était pas seulement mieux armée du fait de sa force économique et politique, mais qui avait tiré des leçons des événements de Russie, et qui jouissait du soutien des classes dominantes des autres pays. Mieux encore, ce qui fut son atout décisif c'est que la bourgeoisie disposait du soutien du parti social-démocrate passé de son côté : "Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe contre classe, programme contre programme, épée contre bouclier. (...) Dans la révolution d'aujourd'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uniforme de la classe dominante, mais sous le drapeau du 'parti social-démocrate'. Si la question cardinale de la révolution était ouvertement et honnêtement posée dans les termes de capitalisme ou socialisme, les grandes masses du prolétariat n'auraient eu aucun doute ou hésitation. (...) Mais l'histoire ne nous rend pas les choses aussi faciles et confortables. La domination de classe bourgeoise mène aujourd'hui sa dernière lutte historique mondiale sous un drapeau étranger, sous le drapeau de la révolution elle-même. C'est un parti socialiste, c'est-à-dire la création la plus originale du mouvement ouvrier et de la lutte de classe, qui est lui-même devenu l'instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. Le fond, la tendance, la politique, la psychologie, la méthode, tout cela est capitaliste de bout en bout. Seuls restent le drapeau, l'appareil et la phraséologie du socialisme." ("Une victoire à la Pyrrhus", Rosa Luxemburg, 21 décembre 1918, Oeuvres choisies, vol.4, p. 472). Comme déjà pendant la première guerre mondiale, le SPD devait être le plus loyal défenseur du capital pour écraser les luttes ouvrières.
ARRET DE LA GUERRE, GOUVERNEMENT SPD-USPD ET REPRESSION
Le 4 novembre 1918, l'appel du commandement militaire à la flotte, enjoignant d'appareiller pour une nouvelle bataille navale contre l'Angleterre - ordre que même certains généraux considéraient comme suicidaire - déclencha la mutinerie des marins de Kiel, sur la mer Baltique. Devant à la répression de la mutinerie, une vague de solidarité avec les marins se développa comme une traînée de poudre dans les premiers jours de novembre, à Kiel, puis dans les principales villes d'Allemagne. Tirant les leçons de l'expérience russe, le commandement militaire du général Groener, véritable détenteur du pouvoir en Allemagne, décida de mettre fin immédiatement à la guerre. L'armistice, réclamé aux Alliés dès le 7 novembre, fut signé le 11 novembre 1918. Avec ce cessez-le-feu la bourgeoisie éliminait un des facteurs les plus importants de radicalisation des conseils d'ouvriers et de soldats. La guerre avait arraché aux ouvriers leurs acquis, mais la plupart d'entre eux croyaient que, une fois la guerre terminée, il serait possible de revenir à la vieille méthode gradualiste et pacifique pour "faire avancer les choses". Beaucoup d'ouvriers se sont engagés dans le combat, avec la "paix" et la "république démocratique" comme principaux objectifs de la lutte. Une fois la "paix" et la "république" obtenues, au mois de novembre 1918, le combat de classe avait perdu l'aiguillon qui l'avait fait se généraliser, et cela se ressentira tout au long des luttes qui se poursuivront.
Le commandement militaire, levier central du pouvoir de la bourgeoisie, avait eu assez de perspicacité pour comprendre qu'il avait besoin d'un cheval de Troie pour arrêter le mouvement. Wilhelm Groener, chef suprême du commandement militaire, déclarera plus tard à propos de l'accord du 10 novembre 1918 avec Friedrich Ebert, dirigeant du SPD et chef du gouvernement :
"Nous avons formé une alliance pour combattre la révolution dans la lutte contre le bolchevisme. Le but de l'alliance que nous avons constituée le soir du 10 novembre était le combat sans merci contre la révolution, le rétablissement d'un pouvoir gouvernemental de l'ordre, le soutien de ce gouvernement par la force des armes et l'appel d'une assemblée nationale dès que possible. (...) A mon avis, il n'y avait aucun parti en Allemagne à ce moment avec assez d'influence dans le peuple, particulièrement parmi les masses, pour reconstruire une force gouvernementale avec le commandement militaire. Les partis de droite avaient complètement disparu et il était bien sûr hors de question de travailler avec les radicaux extrémistes. Il ne restait rien d'autre à faire pour le commandement militaire que de former une alliance avec les sociaux-démocrates majoritaires. "
Les cris de guerre les plus sournois du SPD contre les luttes révolutionnaires furent "unité des ouvriers", "pas de lutte fratricide", "unité du SPD et de l'USPD". Face à la dynamique vers une polarisation croissante entre les deux forces opposées, poussant à une situation révolutionnaire, le SPD s'efforça de masquer les contradictions entre les classes. D'un côté il ne cessa de cacher et déformer son propre rôle au service du capital pendant la guerre, de l'autre il s'appuya sur la confiance dont il jouissait encore parmi les ouvriers, résultant du rôle prolétarien qu'il avait joué avant la guerre pendant plus de trente ans. Il contracta une alliance avec l'USPD - composé d'une droite qui se distinguait à peine des sociaux-démocrates majoritaires, d'un centre hésitant, et d'une aile gauche, les Spartakistes -, dont le centrisme favorisa la manoeuvre du SPD. L'aile droite de l'USPD rejoignit en novembre le conseil des commissaires du peuple, qui était dirigé par le SPD, en d'autres termes le gouvernement bourgeois du moment.
Quelques jours après la création des conseils, ce gouvernement commença les premiers préparatifs d'une répression militaire systématique : organisations de Corps francs (troupes de mercenaires), rassemblant des unités de soldats républicains et des officiers fidèles au gouvernement, pour enrayer l'effondrement de l'armée et avoir de nouveaux chiens sanglants à sa solde.
Il était difficile pour les ouvriers de percer le rôle du SPD. Ancien parti ouvrier, puis protagoniste de la guerre et défenseur de l'Etat démocratique capitaliste, le SPD développait d'un côté un langage ouvrier "en défense de la révolution", et de l'autre il faisait, soutenu par l'aile droite de l'USPD, la chasse aux sorcières contre la "révolution bolchevik" et ceux qui la soutenaient, les Spartakistes.
Liebknecht, au nom des Spartakistes, écrivait dans le Rote Fahne du 19 novembre 1918 : "Ceux qui appellent le plus fort à l'unité (...) trouvent maintenant un écho surtout parmi les soldats. Ce n'est pas étonnant. Les soldats sont loin d'être tous prolétaires. Et la loi martiale, la censure, le bombardement de la propagande officielle n'ont pas manqué d'avoir un effet. La masse des soldats est révolutionnaire contre le militarisme, contre la guerre, et contre les représentants ouverts de l'impérialisme. Par rapport au socialisme, elle est encore indécise, hésitante, immature. Une grande partie des soldats prolétariens, comme les ouvriers, considèrent que la révolution a été accomplie, que nous devons seulement maintenant établir la paix et démobiliser. Ils veulent qu'on les laisse en paix après autant de souffrances. Mais ce n'est pas n'importe quelle unité qui nous rend forts. L'unité entre un loup et un agneau condamne l'agneau à être dévoré par le loup. L'unité entre le prolétariat et les classes dominantes sacrifie le prolétariat. L'unité avec les traîtres signifie la défaite. (...) La dénonciation de tous les faux amis de la classe ouvrière, est dans ce cas notre premier devoir (...) ".
Pour affaiblir les SPARTAKISTES, fer de lance du mouvement révolutionnaire, une campagne fut lancée contre eux: outre les calomnies systématiques qui présentaient Spartakus comme composé d'éléments corrompus, pillards, terroristes, les Spartakistes étaient interdits de parole. Le 6 décembre, les troupes gouvernementales occupèrent le journal de la Ligue Spartakus, le Rote Fahne (Drapeau rouge), le 9 puis le 13 décembre, le quartier général de la Ligue fut occupé par les soldats. Liebknecht fut dénoncé comme terroriste, responsable de l'anarchie et du chaos. Le SPD appela au meurtre de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht dès le début de décembre. Ayant tiré les leçons des luttes en Russie, la bourgeoisie allemande était déterminée à utiliser tous les moyens possibles contre les organisations révolutionnaires en Allemagne. Sans hésitation elle utilisa la répression contre elles dès le premier jour et ne cacha jamais ses intentions de tuer les dirigeants les plus importants.
CONCESSIONS REVENDICATIVES ET CHANTAGE AU RAVITAILLEMENT
Dès le 15 novembre, les syndicats et les capitalistes avaient conclu un accord pour limiter la radicalisation des ouvriers en faisant quelques concessions économiques. Ainsi fut accordée la journée de 8 heures sans réduction de salaire (en 1923 elle repassa à 10-12 heures). Surtout, des " conseils d'usine" (Betriebsrâte) furent instaurés systématiquement, dont l'objectif était de canaliser l'initiative des ouvriers dans les usines, et de les soumettre au contrôle de l’Etat. Ces conseils d'usine furent formés pour contrecarrer les conseils ouvriers. Les syndicats jouèrent un rôle primordial dans la mise en place de cet obstacle.
Enfin, le SPD lança la menace d'une intervention des Etats-Unis, qui bloquerait la fourniture de l'approvisionnement alimentaire au cas où les conseils ouvriers continueraient à "déstabiliser" la situation.
LA STRATEGIE DU SPD : DESARMER LES CONSEILS OUVRIERS
C'est surtout contre les conseils ouvriers que la bourgeoisie concentra son offensive. Elle essaya d'empêcher que le pouvoir des conseils ouvriers n'arrivât à saper, à paralyser l'appareil d'Etat.
- Dans certaines villes, le SPD prit l'initiative de transformer les conseils d'ouvriers et de soldats en "parlements populaires", moyen par lequel les ouvriers se trouvaient "dilués" dans "le peuple", ce qui leur ôtait toute possibilité de reprendre un rôle dirigeant vis-à-vis de l'ensemble de la classe travailleuse (c'est ce qui arriva à Cologne par exemple, sous la direction de K. Adenauer, qui sera plus tard chancelier).
- Les conseils ouvriers furent privés de toute possibilité concrète de mettre réellement en pratique les décisions qu'ils prenaient. Ainsi, le 23 novembre, le Conseil exécutif de Berlin (les conseils de Berlin avaient élu un Conseil exécutif, Vollzugsrai) n'opposa aucune résistance lorsque ses prérogatives lui furent retirées des mains, quand il renonça à exercer le pouvoir pour le laisser au .gouvernement bourgeois. Dès le 13 novembre, sous la pression du gouvernement bourgeois et des soldats qui le soutenaient, le Conseil exécutif avait renoncé à créer une garde rouge. Le Conseil exécutif se trouva ainsi confronté au gouvernement bourgeois sans avoir aucune arme à sa disposition, alors que dans le même temps, le gouvernement bourgeois s'occupait à rassembler des troupes en masse.
- Après que le SPD eût réussi à entraîner l'USPD au gouvernement, promulguant une frénésie d'"unité" entre les "différentes parties de la social-démocratie", il poursuivit son intoxication des conseils ouvriers. Dans le Conseil exécutif de Berlin comme dans les conseils des autres villes, le SPD insista sur l’égalité du nombre de délégués dans les conseils entre SPD et USPD. Avec cette tactique, il eut plus de mandats que le rapport de forces dans les usines ne lui en aurait alloués. Le pouvoir des conseils ouvriers comme organes essentiels de direction politique et organes de l'exercice du pouvoir fut ainsi encore plus déformé et vidé de tout contenu.
Cette offensive de la classe dominante se mena parallèlement à la tactique des provocations militaires. Ainsi, le 6 décembre les troupes fidèles au gouvernement occupèrent le Rote Fahne, arrêtèrent le Conseil exécutif de Berlin et provoquèrent un massacre parmi les ouvriers qui manifestaient (plus de 14 tués). Même si pendant cette phase, la vigilance et la combativité de la classe n'étaient pas encore brisées - le jour suivant les provocations, d'énormes masses d'ouvriers (150 000) prirent la rue -, et même si la bourgeoisie devait encore compter avec une résistance courageuse des ouvriers, le mouvement était très dispersé. L'étincelle de la révolte avait embrasé une ville après l'autre mais la dynamique de la classe ouvrière à la base, dans les usines, n'était pas très forte.
Dans une telle situation, l'impulsion au mouvement doit venir de plus en plus fortement de la base : des comités d'usine doivent se former, dans lesquels les ouvriers les plus combatifs se regroupent, des assemblées générales doivent se tenir, des décisions être prises, leur réalisation étant contrôlée, et les délégués doivent rendre compte aux assemblées générales qui les ont mandatés et si nécessaire être révoqués. Des initiatives doivent être prises. Bref, la classe doit mobiliser et rassembler toutes ses forces à la base par-delà les usines, les ouvriers doivent exercer un contrôle réel sur le mouvement. Mais en Allemagne le niveau de coordination englobant des villes et des régions n'avait pas été atteint ; au contraire l'aspect dominant était encore l'isolement entre les différentes villes, alors qu'une unification des ouvriers et de leurs conseils par delà les limites des villes est un pas essentiel dans le processus pour faire face aux capitalistes. Lorsque les conseils ouvriers surgissent et se confrontent au pouvoir de la bourgeoisie, une période de double pouvoir s'ouvre et ceci requiert que les ouvriers aussi centralisent leurs forces à une échelle nationale et même internationale. Cette centralisation ne peut ne peut qu'être le résultat d'un processus que les ouvriers contrôlent eux-mêmes. En arrière-plan de la dispersion du mouvement qui prévalait encore, l'isolement des différentes villes, le conseil des ouvriers et des soldats de Berlin, poussé par le SPD, convoqua un congrès national des conseils d'ouvriers et de soldats du 16 au 22 décembre. Ce congrès devait constituer une force centralisatrice avec une autorité centrale. En réalité, les conditions pour une telle centralisation n'étaient pas encore mûres, parce que la pression et la capacité de la classe à donner une impulsion dans ses propres rangs et à contrôler le mouvement n'étaient pas assez fortes. La dispersion était encore le trait dominant. Cette centralisation artificielle, PREMATUREE, à l'initiative du SPD, qui était plus ou moins "imposée" aux ouvriers au lieu d'être un produit de leur lutte, constitua un très grand obstacle pour la classe ouvrière.
Ce n'est pas surprenant si la composition des conseils ne correspondait pas à la situation politique dans les usines, si elle ne suivait pas les principes de responsabilité devant les assemblées générales et de révocabilité des délégués : la répartition des délégués correspondait plutôt aux pourcentages de votes pour les partis, sur la base du scrutin de 1910. Le SPD sut aussi comment utiliser l'idée courante à l'époque qu'un tel conseil devait travailler suivant les principes des parlements bourgeois. Ainsi, par une série de trucs parlementaires, de manoeuvres de fonctionnement, le SPD parvint à garder le congrès sous son contrôle. Après l'ouverture du congrès les délégués mirent en place immédiatement des fractions : sur 490 délégués, 298 étaient des membres du SPD, 101 de l'USPD, parmi lesquels 10 Spartakistes, 100 "divers".
Ce congrès était en fait une assemblée autoproclamée, qui parlait au nom des ouvriers, mais qui dès le début devait trahir les intérêts des ouvriers.
- Une délégation d'ouvriers russes, qui devait assister au congrès sur invitation du Conseil exécutif de Berlin, fut refoulée à la frontière sur ordre du gouvernement SPD '."L'Assemblée générale réunie le 16 décembre ne traite pas de délibérations internationales mais seulement d'affaires allemandes, dans lesquelles les étrangers ne peuvent bien sûr pas participer. (...) La délégation russe n'est rien d'autre que des représentants de la dictature bolchevik", telle fut la justification du Vorwarts, organe central du SPD (n° 340, 11 décembre 1918). C'est ainsi que la perspective d'unification des luttes à travers l'Allemagne et la Russie, ainsi que leur extension internationale, furent combattues par le SPD. Avec l'aide des manoeuvres tactiques du praesidium, le congrès rejeta la participation de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht : ils ne furent même pas admis comme observateurs sans droit de vote, sous prétexte qu'ils n'étaient pas des ouvriers des usines de Berlin.
Pour faire pression sur le congrès, la Ligue Spartakus organisa une manifestation de masse le 16 décembre 1918 à laquelle participèrent 250 000 ouvriers, parce que de très nombreuses délégations d'ouvriers et de soldats qui voulaient présenter leurs motions au congrès avaient été pour la plupart rejetées ou écartées.
Le congrès signa son arrêt de mort quand il décida d'appeler à la formation d'une assemblée constituante le plus tôt possible, assemblée qui devait détenir tout le pouvoir de la société. L'appât de la démocratie parlementaire bourgeoise tendu par la bourgeoisie entraîna la majorité des ouvriers dans le piège. L'arme du parlement bourgeois fut le poison utilisé contre l'initiative des ouvriers. Enfin le congrès mit en avant l'écran de fumée des "premières mesures de socialisation" qui devaient être prises, alors que la classe ouvrière n'avait même pas pris le pouvoir.
La question centrale, celle du désarmement de la contre-révolution, du renversement du gouvernement bourgeois fut ainsi repoussée à l’arrière-plan. "Prendre des mesures politico-sociales dans des usines particulières est une illusion tant que la bourgeoisie détient encore le pouvoir politique." (IKD, Der Kommunist).
Le congrès fut un succès total pour la bourgeoisie. Pour les Spartakistes il signifiait l'échec : "Le point de départ et la seule acquisition tangible de la révolution du 9 novembre, a été la formation des conseils d'ouvriers et de soldats. Le premier congrès de ces conseils a décidé de détruire cette seule acquisition, de voler au prolétariat ses positions de pouvoir, de démolir le travail du 9 novembre, d'emporter la révolution. (...) Puisque le congrès des conseils a condamné le véritable organe des conseils d'ouvriers et de soldats qui lui a donné son mandat, à n'être que l'ombre de lui-même, il a donc violé ses compétences, trahi le mandat que les conseils d'ouvriers et de soldats lui ont remis, il a détruit le sol sous les pieds de sa propre existence et autorité. (...) Les conseils d'ouvriers et de soldats déclareront nul et vide le travail contre-révolutionnaire de leurs délégués infâmes." ("Les esclaves d'Ebert", Rosa Luxemburg, 2 décembre 1918, ibid., vol. 4, p. 469). Dans quelques villes, Leipzig par exemple, les conseils locaux d'ouvriers et de soldats protestèrent contre les décisions du congrès. Mais la centralisation préventive des conseils les fit tomber rapidement dans les mains de la bourgeoisie. La seule voie pour combattre cette manoeuvre était d'accroître la pression de la "base", des usines, de la rue.
Encouragée et renforcée par les résultats de ce congrès, la bourgeoisie en vint alors à provoquer des confrontations militaires. Le 24 décembre, la Division de la marine du peuple, une troupe d'avant-garde, fut attaquée par les troupes gouvernementales. Plusieurs marins furent tués. Une fois encore un orage d'indignation éclata parmi les ouvriers. Le 25 décembre, un nombre important d'ouvriers prit la rue. En arrière-plan de ces actions contre-révolutionnaires ouvertes du SPD, l'USPD se retira du gouvernement le 29 décembre. Le 30 décembre et le 1er janvier la Ligue Spartakus et les IKD formèrent le parti communiste (KPD) dans le feu des luttes. A son congrès de fondation un premier bilan du mouvement fut tiré. Nous reprendrons le contenu des débats à ce congrès à une autre occasion. Le KPD, par la voix de Rosa Luxemburg, souligna : "Le passage de la révolution de soldats prédominante le 9 novembre 1918 à une révolution ouvrière spécifique, la transformation du superficiel, purement politique, dans le lent processus de règlement de comptes général économique entre le travail et le capital, réclame de la classe ouvrière révolutionnaire un niveau complètement différent de maturité politique, d'éducation, de ténacité de celui qui a suffi pour la première phase de début." ("Le 1er congrès", 3 janvier 1919, Die Rote Fahne).
LA BOURGEOISIE PROVOQUE UNE INSURRECTION PREMATUREE
Après avoir rassemblé un nombre suffisant de troupes loyalistes surtout à Berlin, après avoir mis en place un nouvel obstacle contre les conseils ouvriers avec le résultat du "congrès" de Berlin et avant que la phase de luttes économiques puisse prendre un plein essor, la bourgeoisie voulait marquer des points décisifs contre les ouvriers sur le plan militaire.
Le 4 janvier 1919, le superintendant de la police de Berlin, qui était membre de l'aile gauche de l'USPD, fut écarté par les troupes gouvernementales. Au début de novembre le quartier général de la police avait été occupé par les ouvriers et les soldats révolutionnaires, et jusqu'en janvier il n'était pas encore tombé aux mains du gouvernement bourgeois. Une fois de plus une vague de protestation éclata contre le gouvernement. A Berlin des centaines de milliers de gens prirent la rue le 5 janvier. Le Vorwarts, journal du SPD, fut occupé aussi bien que d'autres organes de presse de la bourgeoisie. Le 6 janvier, il y eut encore plus de manifestations de masse avec des centaines de milliers de participants.
Bien que la direction du KPD fît constamment de la propagande sur la nécessité de renverser le gouvernement bourgeois avec le SPD à sa tête, elle ne pensait pas que le moment était venu pour le faire ; en fait, elle mettait en garde contre une insurrection prématurée. Cependant, avec la présence écrasante des masses dans les rues, qui fit que beaucoup de révolutionnaires pensaient que les masses ouvrières étaient prêtes pour l'insurrection, un "comité révolutionnaire" fut fondé le soir du 5 janvier 1919, dont la tâche était de mener la lutte pour le renversement du gouvernement et de prendre temporairement en main les affaires gouvernementales, une fois le gouvernement bourgeois expulsé des bureaux. Liebknecht rejoignit ce "comité". En fait, la majorité du KPD considérait que le moment de l'insurrection n'était pas encore venu, et insistait sur l'immaturité des masses pour un tel pas en avant. Il est vrai que les gigantesques manifestations de masse à Berlin avaient exprimé un rejet énorme du gouvernement SPD, mais bien que le mécontentement s'accrut dans de nombreuses villes, la combativité et la détermination dans les autres villes étaient en retard. Berlin se trouva totalement isolé. Pire même : après que le congrès national des conseils en décembre et le conseil exécutif de Berlin eussent été désarmés, les conseils ouvriers à Berlin ne furent plus un lieu de centralisation, de prise de décisions et d'initiative des ouvriers. Ce "comité révolutionnaire" n'émanait pas de la force des conseils ouvriers, il n'avait même pas un mandat. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas eu une vue d'ensemble de l'état d'esprit des ouvriers et des soldats. Il ne prit à aucun moment la direction du mouvement à Berlin ou dans d'autres villes. En fait, il finit par n'avoir aucun pouvoir et manqua lui-même d'orientation. Ce fut une insurrection sans conseils.
Les appels du comité furent sans effet, ils n'étaient même pas pris au sérieux par les ouvriers. Les ouvriers étaient tombés dans le piège des provocations militaires. Le SPD n'hésita pas dans sa contre-offensive. Ses troupes envahirent les rues et entamèrent des combats de rue avec les ouvriers armés. Les jours qui suivirent, les ouvriers de Berlin durent subir un terrible bain de sang. Le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht furent assassinés par les troupes fidèles au SPD. Avec le bain de sang des ouvriers de Berlin, l'assassinat des principaux dirigeants du KPD, la tête du mouvement avait été brisée, l'arme féroce de la répression s'était abattue sur les ouvriers. Le 17 janvier, la Rote Fahne fut interdite. Le SPD intensifia sa campagne démagogique contre les Spartakistes et justifia l'ordre d'assassiner Rosa et Karl : "Luxemburg et Liebknecht eux-mêmes (...) sont maintenant victimes de leur propre tactique de terreur sanguinaire (...). Liebknecht et Luxemburg n'étaient plus des sociaux-démocrates depuis longtemps, parce que pour les sociaux-démocrates les lois de la démocratie sont sacrées, et qu'ils ont rompu avec ce principe. Parce qu'ils enfreignirent ces lois, nous devions les combattre et nous devons encore le faire (...) ainsi l'écrasement du courant Spartakiste signifie pour l’ensemble du peuple, en particulier pour la classe ouvrière, un acte de sauvegarde, quelque chose que nous étions obligés de faire pour le bien-être de notre peuple et pour l'histoire".
Alors que pendant les journées de juillet 1917 en Russie, les bolcheviks avaient réussi à empêcher une insurrection prématurée malgré la résistance des anarchistes, pour pouvoir jeter tout leur poids dans un soulèvement victorieux en octobre, le KPD ne parvint pas à le faire en janvier 1919. Et un des plus importants dirigeants, Karl Liebknecht, surestima la situation et se laissa emporter par la vague de mécontentement et de colère. La majorité du KPD vit la faiblesse et l'immaturité du mouvement ; elle ne put cependant éviter le massacre.
Comme un membre du gouvernement le déclara le 3 février 1919 : "Dès le début un succès des gens de Spartakus était impossible, parce que, grâce à notre préparation, nous les avons forcés à une insurrection immédiate.".
Avec le massacre du prolétariat à Berlin, le coeur du prolétariat avait été touché, et après le bain de sang des Corps francs à Berlin, ces derniers purent être déplacés vers d'autres centres de résistance prolétarienne dans d'autres régions d'Allemagne ; car au même moment dans quelques villes, qui étaient isolées les unes des autres, des républiques avaient été proclamées depuis le début de novembre 1918 (le 8 en Bavière, le 10 à Brunswig et à Dresde, le 10 à Brème), comme si la domination du capital pouvait être renversée à travers une série d'insurrections isolées et dispersées. Aussi les mêmes troupes contre-révolutionnaires marchèrent sur Brème en février. Après avoir fait subir un nouveau bain de sang, elles procédèrent de même dans la Ruhr en Allemagne centrale en mars, et en avril 100 000 contre-révolutionnaires marchèrent sur la Bavière pour écraser la "République de Bavière". Mais même avec ces massacres la combativité de la classe ne fut pas immédiatement brisée. Beaucoup de chômeurs manifestèrent dans les rues tout au long de l'année 1919, il y eut encore un grand nombre de grèves dans différents secteurs, luttes contre lesquelles la bourgeoisie n'hésita jamais à employer la troupe. Pendant le putsch du général Kapp en avril 1920 et pendant les soulèvements en Allemagne centrale (1921) et à Hambourg (1932), les ouvriers témoignèrent encore de leur combativité, jusqu'en 1923. Mais avec la défaite du soulèvement de janvier 1919 à Berlin, avec les massacres dans beaucoup d'endroits d'Allemagne au cours de l'hiver 1919, la phase ascendante avait été brisée, le mouvement privé de son coeur et sa direction avait été décapitée.
La bourgeoisie était parvenue à enrayer l'extension de la révolution prolétarienne en Allemagne, en empêchant la partie centrale du prolétariat de rejoindre la révolution. Après une autre série de massacres des mouvements en Autriche, en Hongrie, en Italie, les ouvriers en Russie restèrent isolés et furent alors exposés aux attaques de la contre-révolution. La défaite des ouvriers en Allemagne, ouvrit la voie à une défaite internationale de toute la classe ouvrière, et pava le chemin d'une longue période de contre-révolution.
QUELQUES LEÇONS DE LA REVOLUTION ALLEMANDE
C'est la guerre qui avait catapulté la classe ouvrière dans ce soulèvement international, mais en même temps il en résultait que :
- la fin de la guerre écartait la cause première de la mobilisation aux yeux de la plupart des ouvriers ;
- la guerre avait divisé profondément le prolétariat, en particulier à la fin de celle-ci entre pays "vaincus", où les ouvriers se sont lancés à l'assaut de la bourgeoisie nationale, et pays "vainqueurs" où le prolétariat subissait le poison nationaliste de la "victoire".
Pour toutes ces raisons, il doit être clair pour nous aujourd'hui combien les conditions de la guerre étaient vraiment défavorables à l'époque pour le premier assaut à la domination capitaliste. Seuls des simples d'esprit pourraient croire que l'éclatement d'une troisième guerre mondiale aujourd'hui fournirait un terrain plus fertile pour un nouvel assaut révolutionnaire.
Malgré les spécificités de la situation, les luttes en Allemagne nous ont laissé tout un héritage de leçons. La classe ouvrière aujourd'hui n'est plus divisée par la guerre, le développement lent de la crise a empêché un embrasement spectaculaire des luttes. Dans les innombrables confrontations d'aujourd'hui, la classe acquiert plus d'expérience et développe sa conscience (même si ce processus n'est pas toujours direct et souvent sinueux).
Cependant, ce processus de prise de conscience sur la nature de la crise, les perspectives du capitalisme, la nécessité de sa destruction, s'oppose exactement aux mêmes forces qui déjà en 1914, 17, 18, 19, étaient à l'oeuvre : la gauche du capital, les syndicats, les partis de gauche et leurs chiens de garde, les représentants de l'extrême gauche du capital. Ce sont eux qui, aux côtés d'un capitalisme d'Etat beaucoup plus développé et de son appareil de répression, empêchent la classe ouvrière de parvenir à poser la question de la prise du pouvoir plus rapidement.
Les partis de gauche et les gauchistes, comme les sociaux-démocrates qui à l'époque assumèrent le rôle de bourreau de la classe ouvrière, se posent encore aujourd'hui comme amis et défenseurs des ouvriers, et, les gauchistes comme les syndicalistes d'"opposition" auront aussi dans le futur la responsabilité d'écraser la classe ouvrière dans une situation révolutionnaire.
Ceux qui comme les trotskystes parlent aujourd'hui de la nécessité d'amener ces partis de gauche au pouvoir, pour mieux les dévoiler, ceux qui aujourd'hui clament que ces organisations, bien qu'elles aient trahi dans le passé, ne sont pas intégrées à l'Etat, et qu'on peut soit les reconquérir, soit faire pression sur elles pour "changer leur orientation", maintiennent les pires illusions sur ces gangsters. Les "gauchistes" ne jouent pas seulement un rôle de sabotage des luttes ouvrières. La bourgeoisie ne pourra pas se limiter à laisser la gauche dans l'opposition ; le moment venu, elle aura à amener ces gauchistes au gouvernement pour écraser les ouvriers.
Alors que, à l'époque, beaucoup de faiblesses de la classe ouvrière pouvaient s'expliquer du fait de l'entrée récente du capitalisme dans sa période de décadence, ce qui n'avait pas laissé le temps de clarifier beaucoup de choses, aujourd'hui aucun doute n'est permis après soixante-dix ans d'expérience concernant :
- la nature des syndicats,
- le poison du parlementarisme,
- la démocratie bourgeoise et le simulacre de libération nationale.
Les révolutionnaires les plus clairs montrèrent déjà à l'époque le rôle dangereux de ces formes de lutte propres aux années de prospérité historique du capitalisme. Toute confusion et illusion sur la possibilité de travailler dans les syndicats, dans l'utilisation des élections parlementaires, toute tergiversation sur le pouvoir des conseils ouvriers et le caractère mondial de la révolution prolétarienne, auront des conséquences fatales.
Bien que les Spartakistes, aux côtés des Radicaux de gauche de Brème, Hambourg et de Saxe aient fait un héroïque travail d'opposition pendant la guerre, il n'en demeure pas moins que la fondation tardive du Parti communiste a été une faiblesse décisive de la classe. Nous avons essayé de montrer le contexte historique plus large des causes de celle-ci. Néanmoins, l'histoire n'est pas condamnée au fatalisme. Les révolutionnaires ont un rôle conscient à jouer. Nous devons tirer toutes les leçons des événements en Allemagne et de la vague révolutionnaire en général. Aujourd'hui il revient aux révolutionnaires non de se lamenter sans cesse sur la nécessité du parti, mais de constituer les fondations réelles de la construction du parti. Il ne s'agit pas de s'autoproclamer "dirigeants", comme le font aujourd'hui une douzaine d'organisations, mais de continuer le combat pour la clarification des positions programmatiques, prendre le rôle d'avant-garde dans les luttes quotidiennes de la classe - ce qui requiert aujourd'hui pas moins qu'à l'époque une dénonciation vigoureuse du travail de la gauche du capital, et de montrer les perspectives larges et concrètes de la lutte de classe. La pré condition réelle pour remplir cette tâche est d'assimiler toutes les leçons de la vague révolutionnaire, en particulier les événements en Allemagne et en Russie. Nous reviendrons sur les leçons des événements d'Allemagne sur la question du parti dans un prochain article de cette revue.
Dino
"La classe des capitalistes impérialistes, dernier rejeton des classes exploiteuses, surenchérit en bestialité, en cynisme effronté, en ignominie sur tous ses prédécesseurs. Pour défendre son Saint des Saints: le profit et le monopole de l’exploitation, elle emploiera les dents et les ongles, elle utilisera au maximum chacune des méthodes froidement implacables qui ont fait leur apparition quotidienne dans l'histoire de la politique coloniale et dans la dernière guerre mondiale. Elle déchaînera le ciel et l'enfer contre la révolution prolétarienne. Elle mobilisera la paysannerie contre les villes, elle excitera les couches arriérées du prolétariat à frapper leur propre avant-garde ; elle fera de ses officiers des organisateurs de massacres, elle paralysera chaque mesure socialiste par les mille et un moyens de la résistance passive, (...) Elle transformera plutôt le pays en un tas de ruines fumantes qu'elle ne renoncera de bon gré à l'esclavagisme du salariat. "
"Toutes ces résistances devront être brisées pas à pas, avec un poing de fer, avec une énergie inébranlable. Il faut opposer à la violence de la contre-révolution la violence révolutionnaire du prolétariat tout entier. Aux guets-apens, aux pièges et aux traquenards de la bourgeoisie, l'implacable clarté du but, la vigilance et l'initiative permanentes des masses ouvrières."
(...)
"La lutte pour le socialisme est la plus violente des guerres civiles que l'histoire ait jamais vue, et la révolution prolétarienne doit prendre, en vue de cette guerre civile, toutes les dispositions nécessaires, elle doit acquérir, pour le mettre à profit, l'art de combattre et de vaincre. "
"Que veut Spartakus ?", Programme de la Ligue Spartakus, 14 décembre 1918, rédigé par Rosa Luxemburg,
Géographique:
- Allemagne [47]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [48]