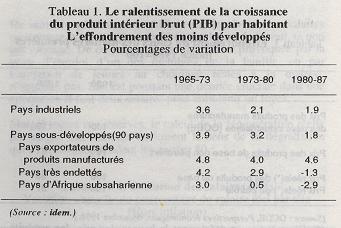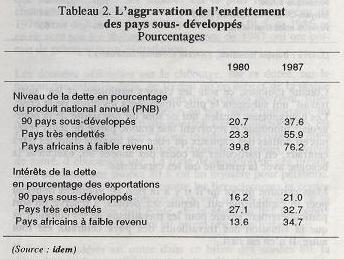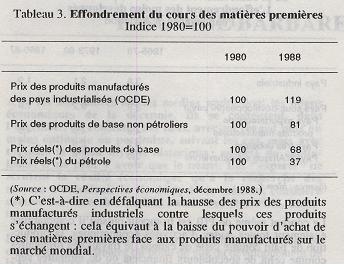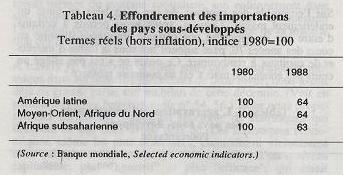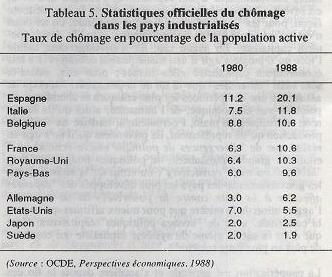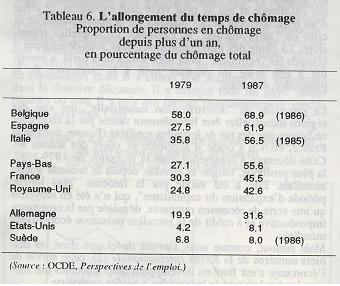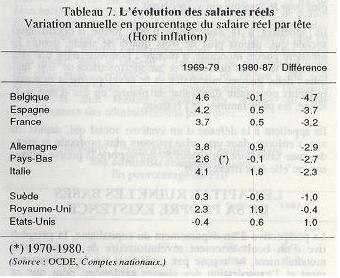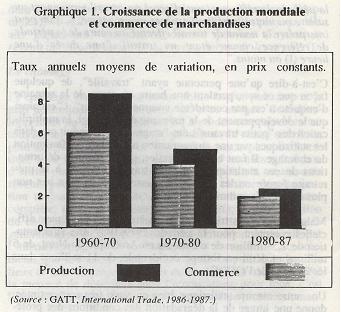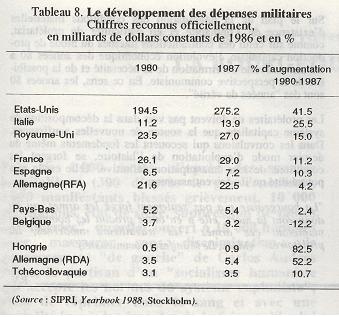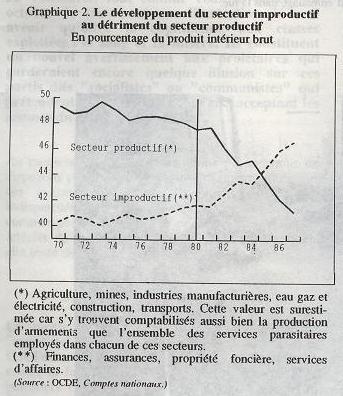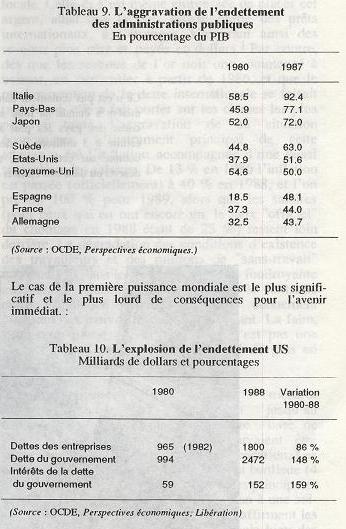Revue Internationale no 57 - 2e trimestre 1989
- 2823 reads
La décomposition du capitalisme
- 3113 reads
L'impasse dans laquelle se trouve acculé le système capitaliste nous donne chaque jour plus l'image d'une société en train de courir à sa propre perte. Aux guerres et aux massacres qui, depuis la fin de l'holocauste de la seconde guerre mondiale, se perpétuent à la périphérie du capitalisme viennent aujourd'hui s'ajouter d'autres manifestations de la barbarie de ce système décadent dont l'agonie prolongée ne peut engendrer que destructions sur destructions. Les catastrophes "naturelles" ou accidentelles qui se sont multipliées ces derniers temps dans toutes les parties du monde, le développement du banditisme, du terrorisme, de l'usage et du trafic des drogues sont aujourd'hui autant de manifestations du phénomène de décomposition générale qui gangrène l'ensemble du corps de la société capitaliste.
Si l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence était la condition rendant possible le renversement de ce système par la révolution prolétarienne, la perpétuation de cette décadence n'est pas sans danger pour la classe ouvrière. Cette putréfaction du capitalisme, en se propageant à toutes les couches de la société, comporte un risque de contamination de la seule classe porteuse d'un avenir pour l'humanité. Face à la gravité des enjeux contenus dans cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, il revient aux révolutionnaires, non pas de consoler les ouvriers de leur misère et de leurs souffrances en leur masquant toute l'horreur de ce monde pourrissant, mais d'en souligner, au contraire, toute l'ampleur afin de les mettre en garde contre le danger de cette contamination qui les menace quotidiennement.
L'annonce de catastrophes provoquées par des phénomènes "naturels" ou par des accidents, tuant ou mutilant chaque jour une multitude de vies humaines, est aujourd'hui entrée dans le quotidien de l'actualité. Ces derniers mois, il ne s'est pas passé une semaine sans que les médias ne nous renvoient les images apocalyptiques de ces catastrophes frappant tantôt les pays sous-développés, tantôt les grandes métropoles industrielles du monde occidental. La banalisation de ces événements chaque jour plus meurtriers, leur accumulation partout dans le monde, n'engendrent pas seulement une insécurité croissante pour la classe ouvrière comme pour l'ensemble de la population. Elles sont de plus en plus ressenties comme une menace qui risque d'engloutir toute l'espèce humaine au même titre que la guerre nucléaire.
EN S'ENFONÇANT DANS LA DÉCADENCE LE CAPITALISME NE PEUT ENGENDRER QUE TOUJOURS PLUS DE DESTRUCTIONS
Pluies torrentielles au Bangladesh faisant plus de 30 millions de victimes en septembre 1988, sécheresse au Sahel qui, ces dernières années, a provoqué des famines comme jamais l'humanité n'en a connues ; cyclones au large des Caraïbes ou à l'ile de la Réunion, détruisant sur leur passage les habitations de la population locale ; tremblement de terre en Arménie où, en quelques minutes, ce sont des villes entières qui ont été rasées, ensevelissant sous leurs décombres des dizaines de milliers d'êtres humains... Toutes ces catastrophes à grande échelle qui ont ravagé ces derniers mois les pays sous-développés ne constituent pas un phénomène localisé aux États du "tiers-monde" ou du bloc de l'Est.
Elles tendent à se généraliser aux régions du monde les plus industrialisées comme en témoigne la succession effarante d'accidents d'avions ou de trains qui se sont soldés, ces derniers mois, par plusieurs centaines de victimes au cœur des grandes métropoles d'Europe occidentale.
Et ce n'est certainement pas, comme voudrait nous le faire croire la bourgeoisie, à la fatalité, à une quelconque "loi des séries" ou aux "forces incontrôlables de la nature" qu'il faut distribuer toutes ces destructions, toutes ces pertes en vies humaines. Ces "explications" dont s'accommode fort bien la classe dominante n'ont d'autre objectif que celui de dégager la responsabilité de son système, d'en cacher toute la barbarie et la pourriture. Car le véritable responsable de toutes ces tragédies, de ces souffrances humaines indicibles, c'est bien le capitalisme lui-même et cette succession effarante de catastrophes "naturelles" ou "accidentelles" n'est que l'expression la plus spectaculaire d'une société moribonde, d'une société qui part en lambeaux.
Ces tragédies font éclater au grand jour la faillite totale d'un mode de production -le capitalisme- qui est entré depuis la première guerre mondiale dans sa période de décadence. Cette décadence signifie qu'après toute une période de prospérité où il a été capable de faire accomplir un bond gigantesque aux forces productives et aux richesses de la société en créant et unifiant le marché mondial, en étendant son mode de production à toute la planète, ce système a atteint depuis le début du siècle ses propres limites historiques. Ce déclin du capitalisme se traduit aujourd'hui par le fait qu'il ne peut désormais engendrer à l'échelle planétaire que toujours plus de destruction et de barbarie, de famines et de massacres.
C'est en particulier cette décadence qui explique que les pays du "tiers-monde" n'aient pu se développer : ils sont arrivés trop tard sur un marché mondial déjà constitué, déjà partagé, déjà saturé (cf. notre brochure La décadence du capitalisme). C'est elle qui condamne ces pays, malgré tous les discours hypocrites sur leur prétendu "développement", à être aujourd'hui les premières victimes de toute la barbarie du capitalisme moribond, les lieux privilégiés, si l'on peut dire, de l'horreur absolue.
En se prolongeant, l'agonie du capitalisme, fait apparaître aujourd'hui dans toute leur horreur les traits les plus saillants de cette décadence en même temps qu'éclatent au grand jour les contradictions internes, insolubles de ce système.
Certes, on ne peut reprocher au capitalisme d'être à l'origine d'un tremblement de terre, d'un cyclone ou de la sècheresse. En revanche, on peut mettre à son passif le fait que tous ces cataclysmes liés aux phénomènes naturels se transforment en immense catastrophe sociale, en gigantesque tragédie humaine.
Ainsi, le capitalisme dispose de forces technologiques telles qu'il est capable d'envoyer des hommes sur la Lune, de produire des armes monstrueuses susceptibles de détruire des dizaines de fois la planète, mais en même temps il ne se donne pas les moyens -pour protéger les populations des pays exposés aux cataclysmes naturels- de construire des digues, de détourner des cours d'eau, d'édifier des maisons qui puissent résister aux tremblements de terre ou aux ouragans.
Pire encore, ce n'est pas seulement dans l'incapacité du capitalisme à prévenir ces catastrophes qu'éclatent dans toute leur nudité les contradictions du système, mais aussi dans son inaptitude à remédier aux effets dévastateurs de ces catastrophes. Ce que la bourgeoisie appelle aujourd'hui l'"aide internationale" aux populations sinistrées est un ignoble mensonge. Ce sont tous les États, tous les gouvernements de la classe dominante, qui sont directement responsables des souffrances et de la détresse de ces centaines de millions d'êtres humains qui tombent chaque jour comme des mouches, victimes de la dysenterie, du choléra ou de la faim.
Alors que des dizaines de millions d'enfants sont aujourd'hui menacés par la famine, dans les grands centres industriels du capitalisme, ce sont des milliers de tonnes de lait qu'on détruit chaque année pour éviter une chute brutale des cours sur le marché. Alors que dans les pays ravagés par la mousson ou les cyclones, la population en est réduite à se battre pour une ration de céréales, les gouvernements des pays de la CEE prévoient de geler 20 % des terres cultivables pour cause de... surproduction !
Mais cette barbarie effroyable qu'engendre le capitalisme décadent ne se traduit pas seulement par son impuissance à soulager les souffrances des populations victimes de ces cataclysmes. C'est la crise permanente, insoluble, de ce système qui est elle-même une immense catastrophe pour toute l'humanité, comme le révèle en particulier le phénomène de paupérisation croissante de millions d'êtres humains réduits à l'indigence, à la misère la plus totale. L'incapacité du capitalisme décadent à intégrer dans le processus de production d'immenses masses de sans-travail ne touche pas seulement les pays arriérés. C'est au cœur même des États les plus industrialisés que la misère atroce dans laquelle sont plongés des dizaines de millions de prolétaires révèle chaque jour plus toute la pourriture de ce système. Non seulement à travers le développement massif du chômage auquel aucune "politique économique" n'est en mesure de remédier, mais encore à travers la généralisation de la pauvreté qui touche de plus en plus les ouvriers au travail. Et c'est dans l'État le plus riche du monde que cette paupérisation croissante de la classe ouvrière des pays les plus développés est aujourd'hui particulièrement édifiante avec le phénomène de clochardisation de masses immenses d'ouvriers. Ainsi, aux USA, ce sont maintenant des millions de travailleurs, pour la plupart salariés à plein temps (représentant 15% de la population et vivant au-dessous du seuil de pauvreté), qui sont transformés en sans-abri et contraints de dormir sur les trottoirs, dans les cinémas pornographiques (les seuls qui restent ouverts la nuit) ou dans des voitures, faute de pouvoir se payer un logement.
Plus le capitalisme est asphyxié par sa crise de surproduction généralisée, moins il est capable d'assurer le minimum vital à ceux qu'il exploite, de venir à bout des famines qui, dans des pays comme l'Éthiopie ou le Soudan, prennent aujourd'hui la forme de véritables génocides. Plus il avance dans la maîtrise de la technique, moins il l'utilise au service de la sécurité des populations.
Face à cette effarante réalité, que peuvent valoir toutes les campagnes "humanitaires" d'"aide aux sinistrés et aux affamés" orchestrées par les grandes "démocraties" occidentales, tous les appels aux "élans de solidarité" lancés par des célébrités de tous bords ? Quelle est l'"efficacité" réelle de toutes les entreprises caritatives qui, dans les pays avancés, distribuent des repas aux plus pauvres et les hébergent pour quelques nuits ? Quelle signification accorder aux subsides misérables distribués par certains États à ceux qui n'ont plus rien ? Au mieux, toutes ces aides réunies ensemble ne représentent qu'une goutte d'eau dans un océan de misère et de famine. Lorsqu'elles sont adressées aux pays du "tiers-monde", elles ne font que repousser de quelques semaines les échéances tragiques pour les populations concernées. Quand elles sont mises en place dans les pays avancés, elles permettent tout juste d'éviter que ceux-ci ne ressemblent pas trop aux précédents. En réalité, ces "aides" et ces "campagnes de solidarité" ne sont pas autre chose que de sinistres mascarades, un racket sordide et cynique dont la seule "efficacité" véritable réside dans leur capacité à acheter des "bonnes consciences", à faire oublier l'absurdité et la barbarie du monde actuel.
Car, aux meilleurs sentiments et à l'humanisme bourgeois, il y a des limites. Malgré les larmes de crocodile des curés et autres âmes charitables de tout poil, malgré la "bonne volonté" affichée par les gouvernements, ces limites sont dictées par le fait que la bourgeoisie ne peut détourner les lois de son système, et cela d'autant moins qu'après trois quarts de siècle de décadence, ces lois lui échappent totalement comme en témoignent aujourd'hui les catastrophes accidentelles en série qui frappent la population des pays les plus industrialisés.
Ces derniers mois, la multiplication des accidents ferroviaires, notamment dans le réseau urbain des grandes villes des pays les plus avancés, comme la France et la Grande-Bretagne, ont démontré que l'insécurité ne menaçait pas seulement les populations des pays sous-développés, mais le monde entier et dans tous les moments de la vie. Et, contrairement aux mensonges crapuleux de la bourgeoisie, ce ne sont pas les défaillances de tel ou tel conducteur de train qui sont responsables des accidents ferroviaires comme celui de la gare de Lyon à Paris en juin 1988 ou celui de Clapham Junction au sud de Londres en décembre 1988 ; ce n'est pas à une mauvaise gestion de l'économie que l'on doit l'état de délabrement actuel des moyens de production, la vétusté des moyens de transports, qui, chaque jour, tuent ou mutilent des centaines de vies humaines dans les pays les plus industrialisés.
Ces accidents en cascade ne sont que les conséquences désastreuses des politiques de "rationalisation" de la production où tous les États, dans leur quête insatiable de profit, de compétitivité face à l'aggravation de la crise économique mondiale, cherchent à faire des petites économies, au mépris des vies humaines, en grignotant sur tout ce qui concerne la sécurité des ouvriers et de l'ensemble de la population. "Rationalisation" totalement irrationnelle où, en fait de rentabilité, le capitalisme se livre aujourd'hui à une destruction de plus en plus massive de forces productives. Destruction de force de travail non seulement avec le développement du chômage mais aussi avec les pertes en vie humaines et les mutilations que provoquent ces catastrophes de même que tous les accidents de travail résultant de cette "rationalisation". Destruction de moyens technologiques avec les fermetures d'usines, mais aussi avec les dégâts matériels causés par tous ces "accidents".
De même, des phénomènes tels que la pollution croissante qui empoisonne les cours d'eau, l'atmosphère et la population des villes, les "accidents" d'usines chimiques comme ceux de Seveso en Italie et de Bhopal en Inde, qui fit plus de 2000 morts, les catastrophes nucléaires comme celles de Three Miles Island et de Tchernobyl, les "marées noires" qui, régulièrement, viennent détruire la flore et la faune des littoraux, compromettant pour des décennies ou plus les réserves alimentaires des océans (comme on vient encore de le voir dans l'Antarctique), la destruction par les aérosols de la couche d'ozone qui protège les êtres vivants des rayons ultra-violets, la disparition rapide des forêts amazoniennes, principal poumon de la planète..., tous ces méfaits attribués par les écologistes au "progrès technologique" ne sont pas autre chose que des manifestations de la logique irrationnelle, suicidaire, du capitalisme décadent, de son incapacité totale à maîtriser les forces productives qu'il a mises en œuvre et qui risquent de compromettre pour des siècles, ou même définitivement, l'équilibre de la planète nécessaire à la vie de l'espèce humaine.
Et cette logique suicidaire, cet engrenage du capitalisme décadent dans la destruction, prend des dimensions bien plus terrifiantes encore avec la production massive d'engins de mort toujours plus sophistiqués. Toute la technologie la plus avancée est aujourd'hui orientée vers la production d'armements dans la perspective de massacres infiniment plus meurtriers encore que ceux qui se déchaînent à l'heure actuelle - même en temps de "paix" - dans les pays périphériques. Pour ce monstre sanguinaire qu'est le capitalisme décadent, l 'horreur ne connaît pas de limite.
Mais toutes ces destructions qu'engendre ce système moribond ne sont que la partie visible de l'iceberg. Elles ne sont que les manifestations caricaturales d'un phénomène plus général qui affecte tous les rouages de la société capitaliste. Elles ne traduisent rien d'autre que la réalité d'un monde en pleine décomposition.
LA DÉCOMPOSITION IDÉOLOGIQUE DE LA SOCIETE CAPITALISTE
Cette décomposition ne se limite pas au seul fait que le capitalisme, malgré tout le développement de sa technologie, se retrouve de plus en plus soumis aux lois de la nature, qu'il est incapable de maîtriser les moyens qu'il a mis en œuvre pour son propre développement. Elle n'atteint pas seulement les fondements économiques du système. Elle se répercute aussi dans tous les aspects de la vie sociale à travers une décomposition idéologique des valeurs de la classe dominante qui, en continuant de s'effondrer, entraînent à présent avec elles un écroulement de toute valeur rendant possible la vie en société, notamment par une tendance à l'atomisation croissante des individus.
Cette décomposition des valeurs bourgeoises n'est pas un phénomène nouveau. Elle était déjà marquée dès la fin des années 1960 par l'apparition de phénomènes marginaux qui pouvaient encore colporter l'illusion d'une possibilité de constituer les îlots d'une autre société, fondés sur d'autres rapports sociaux, au sein même du capitalisme.
C'est cette décomposition des valeurs de la classe dominante qu'exprimait déjà l'apparition des idéologies de type "communautaire" -fruit de la révolte des couches petites bourgeoises frappées par l'aggravation de la crise capitaliste et particulièrement affectées par la décomposition sociale- telles qu'elles furent véhiculées par le mouvement hippie ou encore par toutes sortes de courants préconisant le "retour à la terre", à la "vie naturelle", etc. En fondant leur existence sur une prétendue "critique radicale", contestataire du travail salarié, de la marchandise, de l'argent, de la propriété privée, de la famille, de la "société de consommation", etc., toutes ces communautés se présentaient comme autant de "solutions alternatives", "révolutionnaires", à l'effondrement des valeurs bourgeoises et à l'atomisation des individus. Toutes trouvaient leur justification dans l'illusion qu'il suffisait de "changer les mentalités" en multipliant ces expériences communautaires pour construire un monde meilleur. Cependant, ces idéologies minoritaires édifiées sur du sable - puisqu'elles émanaient de couches sociales qui, contrairement au prolétariat, n'ont aucun avenir historique - ne se contentaient pas de véhiculer des illusions, comme le confirme aujourd'hui leur faillite totale. Leur projet mégalomaniaque n'était, en réalité, qu'une parodie grotesque du communisme primitif. Cette nostalgie du retour à un type de société archaïque et dépassé depuis des millénaires ne traduisait rien d'autre qu'une idéologie parfaitement réactionnaire dont l'essence religieuse s'est d'ailleurs révélée par le fait que tous ces thèmes "purificateurs" furent amplement repris presque à la lettre par les sectes mystiques telles que Moon, Krishna et autres "Enfants de Dieu" qui se sont développées par la suite sur les décombres de ces communautés.
Aujourd'hui, les communautés des années 1970 ont cédé la place soit à ces sectes religieuses - pour la plupart largement exploitées, voire manipulées par l'État capitaliste et les services secrets des grandes puissances -, soit à des phénomènes plus éphémères encore tels que les grands rassemblements au sein des concerts rock organisés par des institutions bourgeoises comme SOS Racisme en France ou Amnesty International et qui, au nom de grandes causes humanitaires -la faim dans le monde ou la lutte contre l'Apartheid-, ne peuvent offrir aux nouvelles générations qu'un ersatz de communauté et de solidarité humaines.
Mais cette décomposition idéologique de la société capitaliste se traduit surtout depuis quelques années par le développement, au cœur des grandes métropoles industrielles, d'idéologies de type nihiliste -telle l'idéologie "punk", par exemple -, expressions d'une société qui est de plus en plus aspirée vers le néant.
Aujourd'hui, l'impasse économique dans laquelle est acculé le système capitaliste engendre une misère et une barbarie telles que c'est l'image d'un monde sans avenir, un monde au bord du gouffre, qui tend à s'imposer à toute la société. C'est l'évidence de cette impasse depuis le début des années 80 qui est venue balayer toutes les "solutions alternatives" de la décennie précédente. À l'utopie du "peace and love" des communautés hippies s'est substitué le "no future" des bandes de "punks", "hooligans" ou "skin heads" semant la terreur au cœur des grandes villes. Ce n'est plus l'amour, le pacifisme, la non-violence béate des idéologies marginales de la période précédente, mais la haine, la violence, le désir de tout casser, qui animent maintenant cette frange de la jeunesse livrée à elle-même dans un monde sans espoir, un monde qui n'a rien d'autre à lui offrir que la perspective du chômage, de la misère et d'une barbarie croissante.
Toute la vie sociale est aujourd'hui asphyxiée par les relents nauséabonds de cette décomposition des valeurs dominantes. C'est le règne de la violence, de la "débrouille individuelle", du "chacun pour soi", qui gangrène toute la société, et particulièrement ses couches les plus défavorisées, avec son lot quotidien de désespoir et de destruction : chômeurs qui se suicident pour fuir la misère, enfants qu'on viole et qu'on tue, vieillards qu'on torture et assassine pour quelques centaines de francs... Partout, l'insécurité, la terreur permanente, la loi de la jungle, le terrorisme, qui se développent de plus en plus dans les grandes concentrations industrielles, sont aujourd’hui une manifestation criante de l'état avancé de décomposition de cette société.
Quant aux médias, ils sont le reflet et le propagateur de cette décomposition. A la télévision, au cinéma, la violence est omniprésente, le sang et l'horreur éclaboussent quotidiennement les écrans, y compris dans les films destinés aux enfants. De façon systématique, obsédante, l'ensemble des moyens de communication participe à une gigantesque entreprise d'abrutissement des populations, et particulièrement des ouvriers. Tous les moyens sont bons : depuis l'occupation généralisée des écrans par les spectacles sportifs, où s'affrontent des "héros" gonflés aux anabolisants, jusqu'aux appels à participer à toutes sortes de loteries et autres jeux de hasard grâce auxquels, en échange des dernières pièces de monnaie qu'on peut grappiller dans leurs poches, on vend, semaine après semaine, ou même jour après jour, l'espoir illusoire d'une vie meilleure à ceux que la misère prend à la gorge. En fait, c'est l'ensemble de la production culturelle qui, aujourd'hui, exprime la pourriture de la société. Non seulement le cinéma et la télévision, mais également la littérature, la musique, la peinture ou l'architecture, ne savent de plus en plus qu'exprimer et générer l'angoisse, le désespoir, l'éclatement de la pensée, le néant.
Une des manifestations les plus flagrantes de toute cette décomposition est à l'heure présente le développement de plus en plus massif de la drogue. Sa consommation prend aujourd'hui une signification nouvelle, exprimant non plus la fuite dans les chimères, comme c'était le cas dans les années 70, mais une fuite en avant effrénée dans la folie et le suicide. Ce n'est plus pour "planer" collectivement autour d'un "joint" de marijuana que toute cette partie de la jeunesse s'accroche aux drogues les plus dures, mais pour "s'éclater", "se défoncer".
Et c'est toute la société qui est maintenant affectée par ce cancer et non pas les seuls consommateurs. En particulier, ce sont les États eux-mêmes qui sont aujourd'hui gangrénés de l'intérieur par un tel phénomène. Non seulement ceux du "tiers-monde", comme la Bolivie, la Colombie, le Pérou, où l'exportation de la drogue est la principale activité leur permettant de maintenir leur économie à flot, mais également les USA, qui sont aujourd'hui un des premiers producteurs du monde de cannabis avec une exploitation représentant la troisième récolte nationale en valeur après le mais et le soja.
Là encore, le capitalisme se trouve confronté à une contradiction insurmontable. D'un côté, ce système ne peut tolérer l'usage massif de la drogue (dont la consommation annuelle aux USA représente environ 250 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la défense US), qui, en favorisant le développement de la criminalité, des maladies mentales ou des épidémies comme le SIDA, constitue une véritable calamité du point de vue strictement économique ; de l'autre, c'est le trafic de cette marchandise qui constitue aujourd'hui un des piliers de l'État, comme on le voit, non seulement dans les pays sous-développés tels le Paraguay ou le Surinam, mais également au sein de l'État "démocratique" le plus puissant du monde, les USA.
Ainsi, c'est en grande partie grâce aux exportations de cannabis que sont financés les services secrets américains, à tel point que Bush, qui se fait aujourd'hui le champion de la campagne anti-drogue aux USA, a lui-même directement trempé dans le trafic en tant que chef de la CIA. Et toute cette corruption liée au commerce de la drogue, ce pourrissement dont se nourrit aujourd'hui l'État capitaliste à travers les mœurs de gangsters de ses dirigeants, ne sont pas une spécificité des pays producteurs de drogue. Tous les États sont directement contaminés comme en témoigne encore tout récemment le scandale du blanchiment des "narco-dollars" dans lequel était impliqué le mari de l'ex-ministre de la Justice d'un pays aussi "propre" que la Suisse.
Ce n'est d'ailleurs pas uniquement autour de la drogue que se développe toujours plus la corruption de l'appareil politique de la bourgeoisie : la pourriture ne cesse de progresser dans tous les domaines. A l'heure actuelle, à tous les horizons de la planète, il ne se passe pas un mois sans qu'éclate un nouveau scandale éclaboussant les plus hauts dignitaires de l'État (et comme toujours, ces scandales ne révèlent qu'une infime partie de la réalité). Par exemple, en ce moment même, au Japon, nous en arrivons à une situation où ce sont pratiquement tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, qui sont mouillés dans une énorme affaire de corruption. La pourriture est telle que la bourgeoisie a les plus grandes peines du monde à trouver des hommes politiques "présentables" pour remplacer les ministres démissionnaires, et lorsqu'elle pense avoir enfin découvert un tel "oiseau rare", un "véritable incorruptible", c'est pour qu'on découvre au bout de quelques jours qu'il n'avait pas été parmi les derniers à se faire généreusement "arroser".
Et le Japon n'est pas, évidemment, le seul pays avancé où se produisent de tels événements. Dans un pays comme la France, c'est le Parti socialiste, dont les thèmes électoraux, pourtant, dénoncent traditionnellement "les puissances d'argent", qui se trouve en première ligne d'une affaire de "délit d'initié" (utilisation des informations secrètes obtenues dans l'entourage du pouvoir pour s'enrichir en quelques heures), et c'est un ami intime d'un président réputé pour ses dénonciations de l'"argent corrupteur" qui figure parmi ceux qui s'en sont mis plein les poches. D'ailleurs, la spéculation boursière, qui constitue le moyen de cet enrichissement, est elle-même significative, par l'ampleur phénoménale qu'elle est en train de prendre, de la pourriture de la société capitaliste où la bourgeoisie, tels les "flambeurs" de la roulette, draine la plus grande partie de ses capitaux, non pas vers les investissements productifs, mais vers les "coups de dés" destinés à rapporter gros, tout de suite. De plus en plus, les Bourses ressemblent aux salles de jeu de Las Vegas.
Si, jusqu'à présent, le capitalisme avait pu repousser à la périphérie (les pays sous-développés) les manifestations les plus extrêmes de sa propre décadence, cette pourriture lui revient aujourd'hui comme un boomerang, le touchant en son cœur même. Et cette décomposition qui gagne les grands centres industriels n'épargne désormais aucune classe sociale, aucune classe d'âge, même pas les enfants.
Jusque maintenant on connaissait la criminalité et la délinquance des enfants dans les pays du "tiers-monde" où le marasme économique chronique plonge depuis des décennies les populations dans une misère atroce et le chaos généralisé. Aujourd'hui, la prostitution des enfants sur les trottoirs de Manille ou les mœurs de gangsters des gamins de Bogota ne sont plus des fléaux lointains et exotiques. C'est au cœur même de la première puissance mondiale, dans l'État le plus développé des USA - la Californie - qu'apparaît maintenant ce phénomène, aux portes de la Silicon Valley, région où se trouve concentrée la technologie la plus avancée du monde. Aucune image ne peut résumer de façon plus édifiante les contradictions insolubles que porte en lui le capitalisme décadent. D'un côté, une accumulation gigantesque de richesses, de l'autre, une misère effroyable qui entraîne aujourd'hui des bandes d'enfants dans des mœurs suicidaires : fuite en avant de fillettes à peine pubère dans la prostitution quand ce n'est pas, en quête d'une raison de vivre, dans la maternité ; fuite en avant dans la consommation et le trafic de drogue, où ce sont des gosses de huit à dix ans qui sont happés dans la spirale infernale du banditisme, du meurtre organisé (dans la seule ville de Los Angeles, ce ne sont pas moins de 100 000 enfants - membres de gangs responsables de 387 meurtres en 1987 - qui se partagent le marché de détail de la drogue).
Mais ce n'est pas seulement aux USA que le capitalisme pourrissant sème chaque jour le désespoir et la mort au sein des jeunes générations. Dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, outre le développement pharamineux, ces dix dernières années, de la délinquance et de la toxicomanie chez les adolescents, le taux de suicides parmi les jeunes prend aujourd'hui des proportions désastreuses. Ainsi, la France, par exemple, est actuellement, avec la Belgique et la RFA, un des pays d'Europe occidentale qui connaît le taux de suicides le plus élevé chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans. Avec une moyenne officielle de 1000 suicides par an, représentant plus de 13 % du taux de mortalité dans cette tranche d'âge (alors qu'il est de 2,5 % pour l'ensemble de la population), les chiffres ont triplé entre 1960 et 1985. Sans compter les tentatives de suicide manquées qui, elles, sont dix fois plus nombreuses dans cette même tranche d'âge !
Toutes les manifestations de décomposition de cette société qui regarde aujourd'hui mourir ses enfants nous renvoient ainsi l'image hallucinante d'un monde qui court à sa propre perte. Le capitalisme est semblable à un organisme qui est arrivé au bout du rouleau et dont le maintien artificiel en vie ne peut se traduire que par un pourrissement de tous ses organes.
SEUL LE PROLÉTARIAT PEUT SORTIR LA SOCIETE DE CETTE IMPASSE
La décomposition générale de la société n'est pas un phénomène nouveau. Toutes les sociétés décadentes du passé ont connu un tel phénomène. Mais, comparées à celles des modes de production antérieurs, les manifestations de pourrissement de la société actuelle prennent les formes d'une barbarie jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. De plus, contrairement aux sociétés du passé, où plusieurs modes de production pouvaient exister simultanément dans différentes régions du monde, le capitalisme est devenu un système universel, un système qui a soumis le monde entier à ses propres lois. De ce fait, les différentes calamités pouvant toucher telle ou telle partie de la planète se répercutent inévitablement partout ailleurs, comme en témoigne, par exemple, l'extension à tous les continents de maladies telles que le SIDA. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, c'est toute la société humaine qui est menacée d'être engloutie par les manifestations de ce phénomène de décomposition. Par ailleurs, une telle barbarie est liée au fait qu'il n’existe aucune possibilité pour que surgissent, au sein du capitalisme, les fondements d'une nouvelle société. Alors que dans le passé, les rapports sociaux de même que les rapports de production d'une nouvelle société en gestation pouvaient éclore au sein même de l'ancienne société en train de s'effondrer (comme c'était le cas pour le capitalisme qui a pu se développer au sein de la société féodale en déclin), il n'en est plus de même aujourd'hui. La seule alternative possible ne peut être que l'édification, SUR LES RUINES DU SYSTÈME CAPITALISTE, d'une autre société - la société communiste - qui pourra apporter une pleine satisfaction des besoins humains grâce à un développement considérable, un épanouissement et une maîtrise des forces productives que les lois mêmes du capitalisme rendent impossibles. Et la première étape de cette régénération de la vie sociale ne peut être que le renversement du pouvoir de la bourgeoisie par la seule classe qui soit aujourd'hui en mesure d'offrir un avenir à l'humanité, le prolétariat mondial :
"C'est parce que dans le prolétariat développé l’abstraction de toute humanité, et même de toute APPARENCE d'humanité, est achevée en pratique ; c'est parce que les conditions d'existence du prolétariat résument toutes les conditions d'existence de la société actuelle parvenues au paroxysme de leur inhumanité ; c'est parce que, dans le prolétariat l'homme s'est perdu lui-même, mais a acquis en même temps la conscience théorique de cette perte et, qui plus est, se voit contraint directement, par la MISERE désormais inéluctable, impossible à farder, absolument impérieuse-expression pratique de la NECESSITE - à se révolter contre cette inhumanité : c'est pour toutes ces raisons que le prolétariat peut et doit se libérer lui-même. Toutefois, il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses propres conditions d'existence. Il ne peut abolir ses propres conditions d'existence sans abolir TOUTES les conditions d'existence inhumaines de la société actuelle que sa propre situation résume." (K. Marx, La Sainte Famille.)
Ce que Marx écrivait déjà au siècle dernier, à l'époque où le capitalisme était un système florissant, est encore plus vrai aujourd'hui. Face à cette décomposition qui menace la survie même de l'homme, seul le prolétariat, de par la place qu'il occupe dans les rapports de production capitaliste, est en mesure de sortir l'humanité de sa préhistoire, de construire une véritable communauté humaine.
Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis vingt ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la forme ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle.
C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique.
Plus le capitalisme va s'enfoncer dans sa propre décadence, plus il va prolonger son agonie, moins la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme sera épargnée par tous les effets dévastateurs de la putréfaction de ce système.
Ce sont en particulier les nouvelles générations de prolétaires qui sont aujourd'hui directement menacées par ce danger de contamination qui gangrène toutes les couches de la société. Le désespoir menant au suicide, l'atomisation et la débrouille individuelle, la drogue, la délinquance et tout autre phénomène de marginalisation -tel que la clochardisation des jeunes chômeurs qui n'ont jamais été intégrés au processus de production- sont autant de fléaux qui risquent d'exercer une pression vers la dissolution et la décomposition du prolétariat et, partant, d'affaiblir ou même de remettre en cause sa capacité à réaliser sa tâche historique de renversement du capitalisme.
Toute cette décomposition, qui infeste de plus en plus les jeunes générations, peut ainsi porter un coup mortel à la seule force porteuse d'avenir pour l'humanité. De la même façon que le déchaînement de la guerre impérialiste au cœur du monde "civilisé" avait, comme le disait Rosa Luxemburg en 1915 dans La Brochure de Junius, anéanti, décimé, en quelques semaines "les troupes d'élite du prolétariat international, fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations", de même le capitalisme pourrissant peut faucher, dans les années à venir, la "fine fleur" du prolétariat, qui constitue notre seule force, notre seul espoir.
Face à la gravité des enjeux que pose cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, les révolutionnaires doivent alerter le prolétariat contre le risque d'anéantissement qui le menace aujourd'hui. Ils doivent, dans leur intervention, appeler la classe ouvrière à trouver dans toute cette pourriture qu'elle subit quotidiennement en plus des attaques économiques contre l'ensemble de ses conditions de vie une raison supplémentaire, une plus grande détermination pour développer ses combats et forger son unité de classe. De la même façon qu'elle doit comprendre que ses luttes contre la misère et l'exploitation portent en elles l'abolition de la barbarie guerrière, de même elle doit prendre conscience que le développement, l'unification de ses combats, sont seuls en mesure de sortir l'humanité de l'enfer capitaliste, de ce suicide collectif vers lequel la décomposition de ce vieux monde entraîne toute la société.
Les luttes actuelles du prolétariat mondial pour son unité et sa solidarité de classe, notamment dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, constituent l'unique lueur d'espoir au milieu de ce monde en pleine putréfaction. Elles seules sont en mesure de préfigurer un certain embryon de communauté humaine. C'est de la généralisation internationale de ces combats que pourront enfin éclore les germes d'un monde nouveau, que pourront surgir de nouvelles valeurs sociales. Et ces valeurs ne s'étendront à l'ensemble de l'humanité qu'avec l'édification par le prolétariat d'un monde débarrassé des crises, des guerres, de l'exploitation et des miasmes de toute cette décomposition. Le désespoir dans lequel se trouvent plongées de plus en plus toutes les couches non exploiteuses de la société ne pourra ainsi être surmonté que lorsque la classe ouvrière s'acheminera DE FAÇON CONSCIENTE dans cette perspective.
Et c'est au prolétariat le plus concentré, le plus expérimenté du monde -celui des pays d'Europe occidentale - que revient la responsabilité historique de se porter à l'avant-garde de la classe ouvrière mondiale dans sa marche vers ce but. L'étincelle qui surgira de ses combats sera seule en mesure de déclencher l'incendie de la révolution prolétarienne.
Avril (22/2/1989)
Questions théoriques:
- Décomposition [1]
Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme
- 10343 reads
A la fin des années 80, les médias multiplient les bilans économiques de la décennie. Ils se contentent, dans l'ensemble, de constater des faits, avec un regard plus ou moins optimiste ou pessimiste, suivant les cas, mais avec toujours la même myopie historique : au-delà du capitalisme, il ne peut y avoir que le néant. Les "experts" ne scrutent la réalité économique qu'à la recherche des moyens d'entretenir la vie du système existant, considéré comme un ensemble de lois naturelles, éternelles, indestructibles.
Pourtant, depuis la seconde guerre mondiale, les années 80 ont été les plus barbares du point de vue du développement de la misère dans le monde, les plus violentes contre la classe ouvrière, mais aussi été les plus autodestructrices pour le capital, dont les contradictions internes se sont exacerbées à l'extrême.
Si nous examinons cette réalité, ce n'est pas pour larmoyer sur la misère croissante ni pour chercher des remèdes pour la machine capitaliste en proie aux pires difficultés. Ce dont il s'agit, c'est de dénoncer, une fois encore le renforcement de l'exploitation et de la barbarie dans laquelle la survie des lois capitalistes plonge de plus en plus l'humanité; mais aussi, de mettre en évidence l'affaiblissement économique des fondements mêmes du système capitaliste, son enfermement dans ses propres contradictions. Bref, il s'agit de mesurer l'évolution économique des années 80 à l'aune de la maturation des conditions de la révolution communiste.
A travers les différents articles analysant la situation économique dans les numéros précédents de cette revue, nous avons déjà en grande partie tirée un bilan de cette décennie. (Voir en particulier Revue Internationale n° 54, 56.) Nous nous proposons ici surtout de fournir un ensemble de statistiques qui illustrent ce que nous avons déjà dit. Les statistiques économiques, même les plus déformées, contredisent violemment ceux qui saluent les années 80 comme celles d'un nouveau capitalisme, plus "agressif et plus "efficace", qui aurait retrouvé sa force et une capacité à améliorer les conditions matérielles d'existence de la société.
Nous utiliserons évidemment les statistiques officielles, seules disponibles, en sachant ce qu'elles valent. Contrairement à la période où Marx devait passer des journées dans les bibliothèques de Londres à la recherche de quelques maigres statistiques pour analyser l'évolution du système économique qu'il combattait, aujourd'hui, le capitalisme offre, du moins dans les pays les plus développés, un énorme ensemble de statistiques. Celles-ci sont le produit du développement de la tendance au capitalisme d'Etat, qui exige une gestion plus "globale" de l'économie et du fait qu'il s'agit de gérer une machine de plus en plus complexe et contradictoire. Mais il faut considérer en outre la volonté des gouvernements de fournir de prétendus justificatifs économiques aux politiques dites d'"austérité" qu'ils imposent aux classes exploitées. Quelles que soient les déformations, parfois énormes, de la réalité que ces statistiques contiennent (nous y reviendrons), elles tendent à mentir toujours dans le sens de la défense de l'ordre établi. Le fait qu'elles permettent de mettre en évidence les faillites et les faiblesses de ce système ne peut que renforcer, dans la plupart des cas leur pouvoir démonstratif.
Pour tirer un bilan économique de ces années, nous distinguerons deux aspects de la réalité qui, bien qu'étant étroitement liés et dépendants entre eux, n'en sont pas moins distincts : d'une part, l'évolution des conditions d'existence de l'ensemble de l'humanité et en particulier de celles de la classe ouvrière; d'autre part, la "santé" des mécanismes internes de la machine capitaliste, le développement de ses contradictions.
LE CAPITAL CONDUIT L'HUMANITE A L'AGONIE
Pour le capitalisme, assurer la subsistance des exploités ne constitue pas un objectif mais un "pis aller", un "frais de production". Comme les systèmes d'exploitation du passé (esclavagisme, féodalisme), le capitalisme est contraint de nourrir la classe exploitée pour pouvoir en extirper du surtravail. Mais, à la différence de l'esclave et du serf féodal, qui telles les bêtes de somme, étaient toujours nourris, quel que fut le travail à faire, le prolétaire du capitalisme n'a accès aux biens nécessaires à sa subsistance qu'à condition d'être embauché :
"...le prolétariat, la classe des travailleurs modernes, qui ne vivent qu'autant qu'ils trouvent du travail, et qui ne trouvent de l'ouvrage qu'autant que leur travail accroît le capital. Ces travailleurs sont obligés de se vendre morceau par morceau, telle une marchandise; et, comme tout autre article de commerce, ils sont livrés à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché." (Marx, Le Manifeste communiste, "Bourgeois et prolétaires".)
C'est pourquoi tout ralentissement de la croissance capitaliste se traduit inévitablement par un développement de la misère et de la pauvreté. Dans le capitalisme, décadent, où l'essor des forces productives rencontre une entrave chronique, la misère matérielle connaît une extension et une ampleur sans précédent dans l'histoire. La réalité des pays sous-développés ([1] [2]) en est une des manifestations les plus criantes. Dans ces pays vit, à côté d'une bourgeoisie locale étalant ses richesses et régnant souvent avec les formes les plus barbares d'oppression, une partie croissante de l'humanité dans des conditions de pauvreté absolue. Quel est le bilan des années 80 à l'égard de cette réalité ?
La Banque mondiale, cet organisme financier international chargé plus spécifiquement des pays qu'il appelle hypocritement "en voie de développement", tire un bilan catastrophique dans son dernier rapport de 1988 :
"La pauvreté s'aggrave : entre 1970 et 1980, le nombre de mal nourris est passé de 650 millions â 730 millions dans les pays en développement (Chine exclue). Et, depuis 1980, la situation a encore empiré : les taux de croissance économique se sont tassés, les salaires réels ont diminué et la croissance de remploi s'est ralentie dans la plupart de ces pays. Les fortes baisses des prix des produits de base ont réduit les revenus ruraux et les dépenses publiques affectées aux services sociaux ont diminué en valeur réelle.
On manque de données complètes sur la pauvreté, en particulier pour les années les plus récentes, mais des données fragmentaires provenant de divers pays confirment l'impression générale d'une dégradation des conditions sociales dans bien des pays. Les auteurs d'une étude récente ont constaté que le nombre de personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté a augmenté au moins jusqu en 1983-1984 au Brésil, au Chili, au Ghana, à la Jamaïque, au Pérou et aux Philippines, et que la tendance à l'amélioration des normes de santé, de nutrition et d'éducation des enfants s'était, dans bien des cas, nettement inversée. Selon d'autres sources, la ration calorique quotidienne par habitant aurait diminué entre 1965 et 1985 dans 21 des 35 pays en développement à faible revenu. Entre 1979 et 1983, l'espérance de vie a baissé dans neuf pays d'Afrique subsaharienne. En Zambie, le nombre des nourrissons et des enfants morts de malnutrition a doublé entre 1980 et 1984 et, au Sri Lanka, la consommation calorique des 10 % de la population les plus pauvres a diminué de 9 % entre 1979 et 1982. Au Costa Rica, la baisse des salaires réels en 1979-1982 a accru le nombre de pauvres de plus de deux tiers. Dans les pays en développement à faible revenu, le montant réel par habitant des dépenses publiques d'éducation et de santé a stagné entre 1975 et 1984. Dans six d'entre eux, le nombre de médecins, rapporté à la population, a diminué entre 1965 et 1981 et, dans douze pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne, les taux de scolarisation dans le primaire ont baissé. "
(Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1988.)
On ne pourrait accuser une des principales institutions bancaires internationales d'anti-capitalisme. Pourtant, son bilan est sévère. C'est que la réalité est trop criante. Et que, de toute façon, pour les "experts" de la Banque mondiale, un tel bilan n'est qu'un appel à plus de capitalisme, plus de développement capitaliste. En aucun cas, ils n'envisageraient même l'idée qu'il puisse s'agir d'une inadéquation définitive des lois économiques capitalistes elles-mêmes ; pour eux, celles-ci sont aussi "naturelles" que la loi de la pesanteur. Alors qu'ils assistent à une des périodes les plus critiques et aberrantes, du point de vue économique, de l'humanité, alors qu'ils mesurent, statistiques en main, l'écroulement barbare du mode de production qu'ils représentent, ils prétendent qu'il ne s'agit en réalité que de "divergences de politique macro-économique" entre les grandes puissances, de politiques budgétaires trop "laxistes" ou trop restrictives", ou enfin de la réduction par les gouvernements des pays les plus développés des "dépenses affectées à la lutte contre la pauvreté". Ils ne montrent l'aggravation de la misère que pour mieux affirmer qu'on peut la combattre, avec de "bonnes politiques" capitalistes, alors que c'est la survie même du système capitaliste qui engendre de plus en plus cette misère.
La paupérisation est générale et s'accélère depuis la fin des années 70. Les années 80 l'ont vu s'approfondir et s'étendre, plongeant les pays les moins développés dans la banqueroute pure et simple. La Banque mondiale fournit des chiffres parlants à cet égard :
Le concept même de PIB est trompeur puisqu'il comptabilise également toutes sortes d'activités économiques, la production de pain comme celle de canons, le travail des prolétaires comme celui de spéculateurs financiers ou de militaires supposés produire l'équivalent de leur revenu. Il ne s'en dégage pas moins clairement l'appauvrissement qui caractérise les années 80.
Le cas des "pays exportateurs de produits manufacturés" regroupe une minorité de pays dont le caractère exceptionnel ne fait que mettre plus en relief l'effondrement de l'ensemble. Il suffit de rappeler que cinq pays (Brésil, Mexique, Taiwan, Corée du Sud, Singapour) réalisent 75 % des exportations manufacturières de l'ensemble des pays sous-développés.
Sur l'ensemble des capitaux de ces pays pèse en outre un endettement massif. Celui-ci, après avoir permis à certains d'entre eux de connaître une certaine croissance illusoire au cours des années 70, pèse aujourd'hui sous la forme d'intérêts et de capitaux à rembourser. Ce poids ne s'est pas allégé au cours des années 80 mais s'est au contraire renforcé :
Un des facteurs principaux qui entretient le sous-développement de ces pays est le fait que la quasi-totalité d'entre eux tirent leur revenu extérieur essentiellement de l’exportation de produits de base, agricole ou minéral. Or le cours de ces produits s'effondre dès que la machine industrielle des pays les plus développés se ralentit. Cet effondrement des cours se trouve en outre renforcé par la hausse des prix des produits manufacturés par les pays les plus industriels. Le ralentissement général de la croissance mondiale au cours des années 80 n'a pas manqué d'agir fortement en ce sens :
Le poids de l'endettement, intérêts et capitaux à rembourser, l'effondrement des cours de leurs produits d'exportation, font retomber sur ces pays les effets de la crise des années 80 de façon particulièrement dévastatrice. La bourgeoisie s'y est vue contrainte de réduire de façon draconienne les importations traduisant cela par une chute des investissements et par une réduction massive de la consommation des classes exploitées et de l'ensemble de la population marginalisée :
Comme toujours, ce sont les classes exploitées et les "sans-travail" qui subissent le plus violemment les effets de la crise. Les bourgeoisies locales, qui ne sont qu'une partie de la bourgeoisie mondiale et reçoivent une grande partie de leurs revenus en dollars des capitaux qu'elles ont investis dans les pays centraux, en particulier au cours des années 80, exécutent la besogne avec la brutalité qui les caractérise.
Mais certains diront qu'il n'y a là rien de vraiment nouveau pour le capitalisme qui, depuis ses débuts, a réservé un sort particulièrement sévère pour les travailleurs de ses colonies, et que la situation des travailleurs des pays centraux est tout autre. Il n'en est rien.
LE CAPITAL SAIGNE A BLANC LE PROLETARIAT DANS LES PAYS LES PLUS INDUSTRIALISES
L'aggravation des conditions d'existence des travailleurs dans les pays moins industrialisés au cours des années 80 s'est accompagnée d'une attaque non moins violente dans les zones les plus développées, même si le niveau de départ y est beaucoup plus élevé et que la classe ouvrière y dispose d'une force qui lui permet de mieux résister. Dans un récent rapport la Commission européennes de Bruxelles estimait qu'il y avait dans la CEE, en 1985 (date des dernières estimations disponibles), 40 millions de personnes, 6 millions de plus que dix ans auparavant, considérées comme pauvres ("ayant un revenu inférieur à la moitié du revenu moyen de leurs pays").
Le chômage
Le chômage constitue sans aucun doute la plus puissante et la plus déterminante manifestation de cette attaque. Son développement au cours des années 80 a eu des conséquences sur tous les aspects de la vie de l'ensemble de la classe ouvrière : pour les chômeurs ayant la "chance" de percevoir une allocation, avec ou sans "stages de formation" et autres "travaux d'utilité publique", cela a été une chute rapide et continue du revenu; pour ceux qui n'ont pas eu cette chance (une proportion toujours plus grande), ça a été l'indigence, la misère complète; pour les travailleurs restés actifs, la généralisation du chômage s'est traduite par une baisse des salaires, par la généralisation de la précarité de toute situation de travail, par l'intensification de l'exploitation sous menace de licenciements, par le renforcement de la répression politique dans les lieux de travail; pour les jeunes de la classe ouvrière, ça a été la menace de désespoir dans l'atomisation; pour tous, c'est l'étau d'acier du capitalisme qui s'est serré de plusieurs crans.
Depuis le milieu des années 80, après l'explosion mondiale du chômage qui a accompagné la récession de 1979-82, les gouvernements de certains pays, tels les Etats-Unis ou l'Angleterre affirment, chiffres à l'appui, être parvenus à faire baisser le chômage. En réalité, ils sont surtout parvenus à modifier les statistiques et les définitions du "chômage".
Mais, même en prenant en compte les statistiques les plus officielles et les plus déformées, le bilan des années 80, mises à part quelques rares exceptions, fait ressortir une augmentation générale et nette du chômage dans les pays les plus industrialisés :
On imagine mal à quel point ces chiffres sous-estiment consciemment, déguisent délibérément la réalité. Au cours des années 80, il y a eu une série de révisions de la façon de comptabiliser le chômage : la raison invoquée a été celle de standardiser internationalement les mesures, la définition modèle étant celle du Bureau international du travail (BIT).
Les estimations, car il s'agit toujours d'"estimations", sont basées sur des sondages, et partiellement, et dans certains pays, sur les listes de chômeurs inscrits dans les bureaux de chômage. Dans les enquêtes, les chômeurs sont définis comme ceux qui ne sont pas des "personnes au travail". Et ce dernier ensemble est défini comme les "personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature; (...) on peut interpréter la notion de travail effectué au cours de la période de référence comme étant un travail d'une durée d'une heure (!) au moins."
C'est-à-dire qu'une personne ayant "travaillé", de quelque façon que ce soit, pendant une heure au cours de la semaine d'enquête n'est pas considérée comme "chômeur". C'est ainsi que le développement de la précarité de l'emploi, la multiplication des "petits travaux", des "stages", ne se traduit pas dans les statistiques par une augmentation mais par une diminution du chômage. Il faut encore signaler, parmi d'autres déformations de ces statistiques, que les travailleurs mis à la préretraite forcée ou les jeunes "en formation" ne sont pas non plus considérés comme chômeurs.
Malgré toutes ces tricheries grossières, les statistiques officielles comptent, pour la période 1979-1987 une augmentation de 1,5 million de chômeurs en Amérique du Nord, de 6 millions et demi en Europe occidentale, de 11 millions dans les 24 pays de l'OCDE.
Une autre mesure statistique, bien qu'aussi très sous-estimée, donne une image de la dégradation des conditions des prolétaires des pays industrialisés : la proposition de chômeurs de "longue durée". Celle-ci n'a fait qu'augmenter au cours des années 80 :
Les salaires réels
S'il est des chiffres que les gouvernements déforment, ce sont ceux qui mesurent les salaires en termes "réels", c'est-à-dire compte tenu de la perte de pouvoir d'achat de la monnaie par l'inflation. Et pour cause, c'est sur leur base que le gouvernement fixe le niveau des salaires. Il est connu que, dans tous les pays, les indices des prix à la consommation sont toujours sous-estimés ne fût-ce que parce que les biens de première nécessité, qui ont une part si importante pour les bas revenus, sont sous-représentés dans le calcul de ces indices. Quel ouvrier ne s'est pas indigné en regardant les chiffres de l'inflation annoncés à la télévision et leur décalage avec ce qu'il constate tous les jours dans les magasins ?
Une autre façon de déformer la réalité est le calcul des rémunérations par salarié. Pour ce faire, les statistiques disponibles sont celles de "la masse salariale", c'est-à-dire la somme de TOUS les salaires, y compris ceux des hauts fonctionnaires, cadres, dirigeants d'entreprise, etc., qui sont aussi considérés "salariés" même si l'essentiel de leur revenu est fait de plus-value extirpée aux prolétaires tout comme les revenus des capitalistes actionnaires.
De manière générale, les chiffres sur le niveau des salaires concernent le revenu par salarié ou par heure de travail, et non par ménage. De ce fait, la baisse de revenu provoquée par la perte d'emploi d'un des membres de la famille, ou par l'entretien de jeunes au chômage restés à la maison, n'apparaît pas. Elle est pourtant une donnée cruciale dans une époque où il faut deux salaires pour entretenir un foyer.
Malgré toutes ces réserves, le calcul de la rémunération réelle par salarié fait ressortir nettement le sens de la dégradation qui s'est réalisée pendant les années 80 :
Ces chiffres sont des moyennes annuelles et font apparaître des taux parfois encore positifs pour 1980-87. En réalité, au début des années 80, la variation des salaires réels par tête est dans beaucoup de cas négative. C'est en Suède, la "socialiste", que l'attaque contre les salaires est la plus importante : la chute du salaire réel par tête, par rapport à son niveau de 1976, était déjà de -6 % en 1980; elle atteint -14 % en 1986, et ce ne sont pas les légères augmentations de 1987 qui ont permis de rattraper cette dégradation.
Les données officielles sur le chômage, sur sa durée, sur le niveau des salaires réels, ne livrent qu'un aspect de la réalité de la dégradation de la condition de la classe ouvrière. Elles ne prennent pas en considération qu'une partie importante du revenu des ouvriers, en particulier en Europe occidentale, est fournie par le capital sous forme indirecte à travers les dites "dépenses sociales" : allocations chômage, retraites, services de santé, d'éducation, etc. La forte dégradation de ces prestations au cours des années 80 n'est un mystère pour personne. La multiplication des luttes contre les licenciements et contre la détérioration des conditions de travail qui en découle, de la part des travailleurs de l'école, de la santé ou des transports publics, au cours des années 80, en est une manifestation.
Il faut considérer en outre dans ce bilan des années 80, la dégradation des conditions générales d'existence provoquée par le développement de phénomènes telle la pollution (rendre nocifs à l'existence humaine l'air, les eaux, la terre, les villes, etc.) la désorganisation croissante de la production et donc de la vie sociale - sauf la répression - la décomposition qui se généralise. (Voir dans cette revue l'article "La décomposition de la société capitaliste".)
Dans les pays les plus industrialisés comme dans les pays sous-développés et dans les pays de l'Est, qui pour beaucoup entrent dans cette dernière catégorie (nous traiterons spécifiquement du bilan des années 80, dans les pays de l'Est, dans le prochain numéro de la Revue Internationale) pour la classe ouvrière, pour l'ensemble de la population qui ne fait pas partie des classes dominantes, le bilan des années 80 est totalement négatif.
Certains "experts" se chargent de consoler la population en expliquant, à longueur de temps sur les antennes, que cela aurait pu être bien pire si de tels sacrifices n'avaient pas été consentis; qu'il s'agit de secousses de "la restructuration après les deux chocs pétroliers des années 70". Mais que, demain, cela ira mieux à condition que chacun sache travailler encore plus dur et accepter plus de privations. "Rendre compétitif le capital national face à la concurrence étrangère", telle est la rengaine éternelle à laquelle aboutissent tous les "raisonnements" des "experts économistes" : "Sacrifiez-vous encore plus pour le système qui vous détruit !"
Ils appellent à la sauvegarde d'une forme d'organisation sociale qui, depuis plus de trois quarts de siècle, depuis la première guerre mondiale, a plongé l'humanité dans une des périodes les plus difficiles et autodestructrices de son histoire : deux guerres mondiales et le développement des instruments pour faire disparaître la planète en cas d'une troisième, les pires famines de l'histoire.
Ils appellent à la défense d'un système social qui, depuis 20 ans, s enfonce dans une crise toujours plus profonde et étendue, une crise dont les années 80 ont apporté la preuve définitive qu'elle était irréversible.
LE CAPITAL RUINE LES BASES DE SA PROPRE EXISTENCE
La perspective d'un dépassement du capitalisme, la perspective d'un bouleversement révolutionnaire de l'ordre établi mondialement, ne repose pas seulement sur le mécontentement et l'exaspération des classes exploitées; pour que ce mécontentement puisse s'unifier, se renforcer et aboutir à un processus révolutionnaire international - et c'est seulement à cette échelle qu'il peut véritablement exister-, il faut qu'éclate ouvertement l'incapacité définitive du système dominant de remplir sa fonction économique élémentaire. Il faut que la machine d'exploitation s'affaiblisse dans ses fondements, qu'elle se trouve de plus en plus bloquée par ses propres contradictions. Pour reprendre la fameuse formule de Lénine : "Il ne suffît pas que ceux d'en bas ne veuillent plus, encore faut-il que ceux d'en haut ne puissent plus." De ce point de vue, le bilan des années 80 est une confirmation du développement des conditions de la perspective révolutionnaire.
Les années 80 sont, en effet, clairement marquées par un nouveau ralentissement simultané de la croissance de la production et du commerce mondial :
Un des traits les plus significatifs de ce ralentissement est le fait qu'il a été plus marqué dans le commerce que dans la production. Pour le capitalisme, qui est le système marchand par excellence et qui ne peut vivre sans expansion, ce signe d'un rétrécissement de ses marchés est la manifestation de sa crise de "surproduction" et l'annonce de nouvelles régressions. La chute des importations des pays sous-développés y compris les "pétroliers", dont nous avons déjà parlé, a constitué à elle seule un puissant frein à la croissance de la production mondiale.
Le processus de "désertification industrielle", qui voit des régions industrielles être littéralement rasées par la crise pour ne laisser que des tas de ferrailles rouillées (Ecosse, nord de la France, etc.) n'a cessé d'accélérer au cours des années 80. Cette décennie a commencé dans la récession de 1979-1982, la plus profonde, longue et étendue depuis la seconde guerre mondiale. Elle a été suivie par la fameuse "plus longue période d'expansion du capitalisme", qui n'a été en moyenne qu'une sorte de récession rampante, déguisée par la croissance improductive et à crédit de la première puissance économique mondiale.
Mais surtout, comme nous l'avons développé dans les derniers numéros de la Revue Internationale ([2] [3]), cette survie de l'économie s'est faite en développant deux maladies qui rongent les fondements de la machine à profits capitaliste:
1. la croissance du secteur improductif de l'économie (militarisme mais aussi tous les autres secteurs parasitaires) ([3] [4]), au détriment du secteur productif.
2. l'explosion du crédit et de l'endettement mondial.
Le développement du secteur improductif
Les chiffres officiels concernant les dépenses militaires des gouvernements sont encore parmi le moins fiables et les plus sous-estimés. Aux raisons politiques évidentes s'ajoutent le prétexte du "secret militaire". Mais, encore une fois, malgré les déformations grossières, l'observation des données les plus officielles donne une idée de l'ampleur du développement des frais militaires, en particulier aux Etats-Unis :
En grande partie, la "reprise" d'après 1982 a servi à produire le réarmement des Etats-Unis.
Mais, parallèlement à la gangrène militariste, le capitalisme des années 80 a vu se développer celle d'un ensemble d'activités tout aussi parasitaires, tel le secteur financier : banques et assurances, une grande partie du secteur commercial : marketing, publicité, la bureaucratie étatique : police, etc. C'est là un phénomène typique de l'époque de décadence du capitalisme, mais il a connu une accélération importante dans la dernière décennie. Il a marqué tous les pays, industrialisés ou non. Il a pris des formes particulièrement spectaculaires aux Etats-Unis :
Pour certains "experts", il n'y a là rien de très grave. Peu importe au capitaliste que ses profits viennent de la spéculation boursière ou de la production de gaz chimiques, du moment qu'il obtient un profit. Mais, de même que la production d'engins de destruction doit être inscrite avec le signe négatif et que la valeur créée par les services financiers repose sur du vent, de même les profits qui en découlent s'avèrent être, tôt ou tard, au niveau du capital global, des profits fictifs. L'effondrement boursier d'octobre 1987, détruisant 2000 milliards de dollars en quelques jours, est là pour le montrer et annoncer l'avenir.
L'endettement
Le recours massif au crédit par une fuite en avant dans l'endettement est aussi une des caractéristiques majeures des années 80. Nous en avons longuement traité dans la Revue Internationale n° 56, mettant en avant son caractère de palliatif provisoire et de source de difficultés dont les effets auto-destructeurs sur le capital se font sentir dès à présent, tout en préparant de futures catastrophes pour le capital. Nous avons déjà illustré dans le tableau 2 l'ampleur du phénomène pour les pays sous-développés. Rappelons ici ce qu'a été son développement dans les pays industrialisés. Le tableau 9 montre le saut réalisé, pendant les années 80, par l'endettement des administrations publiques :
L'accroissement vertigineux des intérêts de cet endettement, dont personne ne sait comment il pourrait être effectivement remboursé; la multiplication des faillites du système bancaire aux Etats-Unis et la crise des caisses d'épargne, qui contraint le gouvernement Bush à emprunter de nouvelles sommes faramineuses pour rembourser les épargnants et tenter d'empêcher un vent de panique; la hausse irrésistible des taux d'intérêt aux Etats-Unis, et par suite dans le monde, annonciatrice d'une nouvelle récession; la confirmation de l'accélération de l'inflation dans tous les pays, tels sont les aboutissements des politiques "miraculeuses" ("libéralisme reaganien" et autres "perestroïka") au bout des années 80.
Le capital mondial n'est pas parvenu à surmonter les difficultés qu'il avait déjà subies si violemment dans les années 70. Il n'a pu survivre qu'en les aggravant.
Les années 80 ont, plus que toutes autres, mis en lumière la faillite des lois économiques capitalistes, le caractère décadent et barbare de ce mode de production. Le capitalisme est né "dans le sang et dans la boue" (Marx). Après une période de croissance et d'extension, il agonise comme une aberration anachronique, une puissance de mort et de destruction.
Sur le plan de la dégradation des conditions matérielles d'existence de l'humanité et en particulier du prolétariat, comme sur celui des contradictions internes du mode de production capitaliste, l'évolution économique des années 80 a été une nouvelle confirmation de la nécessité et de la possibilité de la perspective communiste. En ce sens, les années 80 sont des "années de vérité".
Les prolétaires ne doivent pas voir dans la décomposition du système capitaliste que la source de nouvelles souffrances. Dans les convulsions qui secouent les fondements même du dernier mode d'exploitation de l'histoire, se forgent les conditions de leur émancipation définitive. Telle est la responsabilité qu'ils doivent assumer.
"La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui donneront la mort; elle a en outre produit les hommes qui manieront ces armes - les travailleurs modernes, les prolétaires. " (Marx, Le Manifeste communiste.)
RV.
[1] [5] Nous employons ce terme pour désigner la réalité de tous ces pays, généralement anciennes colonies, qui, arrivés trop tard sur le marché mondial, n'y ont été intégrés qu'en fonction des impératifs des principales puissances dominantes (monoculture, marginalisation des populations par la destruction sans avenir des modes de production pré-capitaliste, etc.). Le terme "pays en développement", tel qu'il est pudiquement employé par les organismes économiques internationaux, n'est qu'un hypocrite mensonge : leurs propres statistiques montrent comment l'écart entre pays développés et sous-développés s'est creusé dans les dernières décennies. Cet écart était évalué à 7 300 dollars de revenu par habitant en 1967, à 10 000 en 1980 et à 12 000 en 1987. Les camarades du groupe Emancipacion Obrera, en Argentine insistent souvent sur le fait que des pays comme l'Argentine ont un degré de développement économique bien plus avancé que des pays comme la Bolivie ou le Tchad. Ce qui est vrai, mais ne change rien à l'existence de traits communs et importants.
[2] [6] Voir en particulier Revue Internationale n° 56.
[3] [7] Pour une définition du concept d'"improductivité" d'un secteur économique, voir notre brochure La décadence du capitalisme.
Questions théoriques:
- Décadence [8]
- L'économie [9]
Emeutes de la faim et répression sanglante au Venezuela : la bourgeoisie massacre
- 3749 reads
Près de 1000 morts, d'après des sources hospitalières (300 d'après le gouvernement), 3 000 manifestants blessés grièvement, 10 000 arrestations, état de siège, suppression de toutes les "libertés", quartier ouvert à 10 000 hommes pour massacrer sans discrimination : le gouvernement "de gauche" de Carlos Andrés Pérez, le partisan d'un "socialisme humaniste qui accepte les normes du système capitaliste", vient de réprimer dans le sang et avec une brutalité inouïe,les émeutes de la faim qu'il a lui même provoquées par un train de mesures qui, du jour au lendemain, ont fait doubler le prix des transports collectif et tripler celui de certains biens de première nécessité. Telles sont les "normes du système capitaliste" en crise. Telle est la réalité qui se cache derrière les discours "humanistes" des fractions "de gauche" du capital qui n'ont rien à envier dans ce domaine à celles "de droite".
Les événements de la première semaine de mars au Venezuela, tout comme ceux d'Algérie en octobre dernier, sont une illustration du seul avenir qu'offre le capitalisme aux classes exploitées : le sang et la misère. Ils constituent un nouvel avertissement aux prolétaires qui garderaient encore quelque illusion sur ces partis dits "socialistes" ou "communistes" qui prétendent les représenter tout en "acceptant les normes du système capitaliste".
Au moment où nous mettons sons presse, nous ne disposons pas encore de toutes les informations sur ces événements. Mais dés à présent il est indispensable de dénoncer ce nouveau massacre commis par la bourgeoisie pour la défense de ses intérêts de classe et les mensonges avec lesquels elle tente de les recouvrir.
DES EMEUTES DE LA FAIM
La presse, en particulier celle de la gauche "socialiste", celle des amis européens du président C.A.Pérez, tente de nier qu'il s'est agi de révoltes contre la faim. Le Venezuela, un des grands pays pétroliers du monde, serait un "pays riche". Les récentes mesures du gouvernement n'auraient eu comme objectif que de faire comprendre à la population que la période de la "manne pétrolière" est terminée et qu'il s'agit -pour "le bien des familles" - de s'adapter aux nouvelles conditions de l'économie mondiale. En somme, les "pauvres" du Venezuela auraient pris de mauvaises habitudes de riches. D s'agissait de les faire revenir à la réalité. Le cynisme de la bourgeoisie est sans limites.
Même aux moments des plus fortes hausses des prix du pétrole, au milieu et à la fin des années 70, la richesse des "pétrodollars" est évidemment restée pour l'essentiel aux mains de la classe dominante locale. Celle-ci s'est même empressée de placer cet argent, ainsi que la plus grosse partie des prêts internationaux, à l'étranger, s'assurant ainsi des revenus plus sûrs et payés en dollars ([1] [10]). Par contre, dés que les revenus de l'or noir ont commencé à baisser, en particulier à partir de 1986, et que le remboursement de la dette internationale se faisait trop lourd, elle a fait porter sur les classes les plus pauvres toute l'aggravation de sa situation économique. L'instrument principal de cette attaque a été l'inflation accompagnée d'une quasi stagnation des salaires. De 13 % en 1986 l'inflation est passée (officiellement) à 40 % en 1988, et l'on prévoit 100 % pour 1989, alors que les salaires (pour ceux qui en ont encore un, le taux "officiel" du chômage en 1988 étant de 25 %) restent loin derrière. La dégradation des conditions d'existence des travailleurs et des millions de "sans-travail" marginalisés dans les bidonvilles, a été foudroyante au cours des dernières années. Jamais le contraste entre l'opulence des riches et le dénuement croissant des pauvres n'a été aussi criant. La faim, pour cette partie de la population, n'est pas une menace pour l'avenir mais une réalité de plus en plus oppressante depuis des années.
C'est pourquoi les récentes mesures gouvernementales, qui impliquent jusqu'au triplement du prix du lait en poudre - base de l'alimentation des enfants - ne pouvaient être vécues que comme la plus brutale provocation. Les émeutes qui ont explosé à Caracas et sa banlieue (4 millions d'habitants) mais aussi dans les principales villes du pays, n'étaient pas une réaction à une soi-disant "baisse de standing", comme l'affirment les dandys de la gauche bien pensante, mais bien des émeutes de la faim : des réactions spontanées à l'aggravation d'une misère devenue insupportable. "Nous préférons nous faire tuer plutôt que continuer à mourir de faim" ont crié des manifestants à la soldatesque déchaînée.
La classe ouvrière peut imposer un rapport de force à la bourgeoisie par la grève et le combat politique de classe. Mais les masses des "sans-travail", les populations marginalisées des pays sous-développés ne peuvent, par elles-mêmes, répondre aux attaques du capital que par l'action désespérée des pillages et des émeutes sans issue. Le fait que leurs premières actions aient consisté à piller des épiceries (dont beaucoup pratiquent la pénurie pour faire monter les prix) et des supermarchés d'alimentation, dit clairement que c'est de la faim qu'il s'agit.
Les émeutes de début mars au Venezuela sont tout d'abord cela : la réponse des masses marginalisées aux attaques de plus en plus barbares du capitalisme mondial en crise. Elles font partie des secousses qui ébranlent de plus en plus fortement les fondements mêmes de la société capitaliste en décomposition.
LE VERITABLE VISAGE DE LA DEMOCRATIE BOURGEOISE
Mais la barbarie du capitalisme décadent ne s'arrête pas au niveau économique. La répression à laquelle s'est livrée la bourgeoisie au Venezuela est éloquente. A l'ampleur de la boucherie il faut ajouter sa sauvagerie : blessés achevés sur le trottoir, enfants assassinés devant les parents, chambre de torture installée dans une pension de famille désaffectée, etc.
Jamais la bourgeoisie vénézuélienne, qui a pourtant gouverné avec des régimes militaires pendant des décennies, ne s'était livrée à un tel carnage. En une semaine la réalité a fait voler en éclats le mythe tant vanté de "la démocratie, rempart contre la dictature militaire". La "démocratie" n'est que le masque anesthésiant de la pire brutalité bourgeoise. C'est ce qu'a clairement montré le travail, main dans la main, du gouvernement d'Accion Democratica, parti membre de l'Internationale socialiste, et des gorilles de l'année pour protéger leurs biens, leur argent, leurs lois, leur système.
Ceux qui aujourd'hui se lamentent sur les "dangers que ces événements font courir à la fragile démocratie vénézuélienne" sont les mêmes qui ont préparé la répression en faisant croire qu'en votant aux récentes élections, pour C.A.Pérez ou tout autre, "on serait protégés des militaires".
C'EST LA BOURGEOISIE MONDIALE QUI S'EST LIVREE A UN BAIN DE SANG AU VENEZUELA
Mais le président C.A.Pérez n'est pas seulement le représentant de la bourgeoisie locale. Sa réaction en défense des intérêts de sa classe est la même que celle de tout gouvernement bourgeois qui se sent menacé. Un aréopage de chefs d'Etats s'est chargé de le lui manifester cérémonieusement, quelques semaines avant le massacre, au cours de son intronisation comme nouveau président. Fidel Castro lui à même déclaré : "Il faut un leader à l'Amérique Latine, et ce sera toi.". Quelques mois auparavant il se réunissait à Paris, dans une conférence de l'Internationale socialiste. Les socialistes suédois, anglais, les Willy Brandt d'Allemagne, Mitterrand de France, Craxi d'Italie, Kreysky d'Autriche, Gonzales d'Espagne, Soares du Portugal, Papandreou de Grèce, etc. tous ces vibrants "démocrates socialistes", "humanistes" reconnaissent chaleureusement ouvertement comme l'un des leurs celui qui restera comme le boucher de Caracas.
Les "démocrates" du monde entier cherchent à présenter le gouvernement vénézuélien comme une "victime du FMI". Celui-ci serait une sorte de "monstre impitoyable", venu d'on ne sait où, pour contraindre les bourgeois des pays les plus endettés à exploiter et à engendrer toujours plus de misère et d'oppression, à être des bourgeois. Mais, en réclamant le remboursement de la dette, en réprimant ceux qui s'attaquent à l'ordre établi, le FMI et C.A.Pérez ne font qu'appliquer les "nonnes du système capitaliste", les normes de tous les bourgeois du monde. C'est leur "ordre" qui a été rétabli au Venezuela, celui qu'ils font régner dans tous les pays et pour le maintient duquel ils n'ont jamais hésité à employer les méthodes les plus barbares.».
Un "ordre" qui pourrit sur pied dans la barbarie et que seul le prolétariat mondial pourra détruire.
Pour la classe ouvrière, au Venezuela comme dans tous les pays et en particulier dans les plus industrialisés ces événements constituent, en ce sens, un nouveau rappel des responsabilités historiques qui sont les siennes.
[1] [11] Le montant des investissements de la bourgeoisie à vénézuélienne à l'étranger (aux Etats-Unis en particulier) est supérieur au montant de la dette extérieure du pays : 30 milliards de dollars. C'est dire toute l'hypocrisie de la bourgeoisie locale qui prétend justifier par les "diktats du FMI", la misère qu'elle impose.
Géographique:
- Vénézuela [12]
1919 : fondation de l'Internationale Communiste
- 5326 reads
Parmi les nombreux anniversaires historiques à célébrer en cette année 1989, il en est un que les médias et les historiens passent sous silence, ou bien, quand ils l'évoquent -en général très rapidement-, c'est pour en dénaturer consciemment la signification. En mars 1919 s'est tenu le premier congrès de l'Internationale Communiste, le congrès de constitution de la 3e Internationale.
En fêtant l'anniversaire de la révolution française de 1789 -tout comme pour le bicentenaire des Etats-Unis-, les historiens grassement payés au service de la bourgeoisie insistent sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de démocratie, de nation, présentées comme les principes absolus et définitifs enfin trouvés pour l'accession au "bonheur" de l'humanité. Deux siècles d'exploitation, d'affrontement des classes, de misère et de guerres impérialistes ont dévoilé la réalité du capital masquée derrière ces belles paroles. Pour la bourgeoisie, l'objectif de ces célébrations est de faire oublier que "le capitalisme est né dans le sang et la boue" (K. Marx), qu'il est né de la lutte ^des classes, et surtout qu'il est une société transitoire appelée à disparaître comme tous les autres modes de production avant lui.
Pour la bourgeoisie de 1989, l'anniversaire de la constitution de l'Internationale communiste lui rappelle la réalité et l'actualité de la lutte des classes dans le capitalisme en crise d'aujourd'hui, de l'existence du prolétariat comme classe exploitée et révolutionnaire, et l'annonce de sa propre fin.
LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALE EN 1919
La constitution de l'IC éveille aussi de très mauvais souvenirs pour l'ensemble de la classe capitaliste et ses serviteurs zélés. En particulier, l'angoisse qu'elle eut au sortir de la première guerre mondiale devant le flot montant, et qui paraissait alors à tous inéluctable, de la vague révolutionnaire internationale. 1917: révolution prolétarienne victorieuse en Russie en octobre, mutineries dans les tranchées ; 1918 : abdication de Guillaume II et signature précipitée de l'armistice devant les mutineries et la révolte des masses ouvrières en Allemagne ; mouvements ouvriers à partir de 1919 : insurrections ouvrières en Allemagne, instauration sur le modèle russe de républiques des conseils ouvriers en Bavière et en Hongrie, début de grèves de masse ouvrières en Italie et en Grande-Bretagne ; mutineries dans la flotte et les troupes françaises, ainsi que dans des unités militaires britanniques, re rusant d'intervenir contre la Russie soviétique...
C'est Lloyd George, le Premier ministre du gouvernement britannique de l'époque, qui exprime le mieux la frayeur de la bourgeoisie internationale devant le pouvoir des soviets ouvriers en Russie, devant la force du mouvement révolutionnaire, lorsqu'il déclarait, en janvier 1919, que Vil tentait actuellement d'envoyer un millier de soldats britanniques en occupation en Russie, les troupes se mutineraient", et que "si l'on entreprenait une opération militaire contre les bolcheviks, l'Angleterre deviendrait bolchevique et il se créerait un soviet à Londres.(...) L'Europe tout entière est gagnée par l'esprit révolutionnaire. Il y a chez les ouvriers un sentiment profond, non seulement de mécontentement, mais de colère et de révolte contre les conditions d'avant-guerre.L'ordre établi, sous ses aspects politique, social, économique, est remis en question par les masses de la population d'un bout à l'autre de l'Europe." (Cité par E.H. Carr, La révolution bolchevique, Editions de Minuit, 1974.)
La constitution de l'IC marque -nous le savons aujourd'hui- le point culminant de la vague révolutionnaire qui va pour le moins de 1917 à 1923 et qui parcourut le monde entier, traversant l'Europe de part en part, atteignant l'Asie (Chine) et le "nouveau" continent, Canada (Winnipeg) et USA (Seattle) jusqu'à l'Amérique latine. Cette vague révolutionnaire est la réponse du prolétariat international à la première guerre mondiale, à quatre années de guerre impérialiste entre les Etats capitalistes pour le partage du monde. L'attitude des partis et des militants de la social-démocratie, de la 2e Internationale engloutie en 1914 face à la guerre impérialiste mondiale, allait déterminer celle qu'ils allaient prendre face à la révolution et à l'Internationale communiste.
-
"La 3e Internationale Communiste s'est constituée à la fin du carnage impérialiste de 1914-1918, au cours duquel la bourgeoisie des différents pays a sacrifié 20 millions de vies.
Souviens-toi de la guerre impérialiste ! Voilà la première parole que l’Internationale communiste adresse à chaque travailleur, quelles que soient son origine et sa langue. Souviens-toi que, du fait de l'existence du régime capitaliste, une poignée d'impérialistes a eu, pendant quatre longues années, la possibilité de contraindre les travailleurs de partout à s'entre—égorger ! Souviens-toi que la guerre bourgeoise a plongé l'Europe et le monde entier dans la famine et le dénuement! Souviens-toi que sans le renversement du capitalisme, la répétition de ces guerres criminelles est non seulement possible, mais inévitable !" (Statuts de l'Internationale communiste, 2e Congrès, juillet 1920.)
LA CONTINUITE DE L'I.C. AVEC LA 2e INTERNATIONALE
La 2e Internationale et la question de la guerre impérialiste
Dans le Manifeste Communiste (1848), K. Marx énonce un Mes principes essentiels de la lutte du prolétariat contre le capitalisme : "Les ouvriers n'ont pas de patrie." Ce principe ne signifiait pas que les ouvriers devaient se désintéresser de la question nationale, mais au contraire qu'ils devaient définir leur prise de position et leur attitude sur cette question et celle des guerres nationales en fonction du développement même de leur propre lutte historique. La question des guerres et l'attitude du prolétariat a toujours été au centre des débats dans la le Internationale (1864-1873) tout comme dans la 2e Internationale (1889-1914). Dans la majeure partie du XIXe siècle, le prolétariat ne pouvait rester indifférent aux guerres d'émancipation nationale contre la réaction féodale et monarchique, en particulier contre le tsarisme.
C'est au sein de la 2e Internationale que les marxistes, particulièrement derrière Rosa Luxemburg et Lénine, surent reconnaître le changement de période dans la vie du capitalisme survenu à l'aube du XXe siècle. Le mode de production capitaliste se trouve alors à son apogée et règne maintenant sur l'ensemble de la planète. S'ouvre ensuite la période de "l'impérialisme, stade suprême du capitalisme", comme le dit Lénine. Dans cette période, la guerre européenne à venir sera une guerre impérialiste et mondiale, opposant les différentes nations capitalistes pour la dispute et le partage des colonies et du monde. C'est principalement rafle gauche de la 2e Internationale qui mena le combat pour armer l'Internationale et le prolétariat, dans la situation nouvelle, contre l'aile opportuniste qui abandonnait chaque jour un peu plus les principes de la lutte prolétarienne. Un des moments essentiels de cette bataille politique est le congrès international de Stuttgart en 1907, où Rosa Luxemburg, tirant les leçons de l'expérience de la grève de masse en Russie de 1905, lie la question de la guerre impérialiste à la question de la grève de masse et de la révolution prolétarienne :
-
"J'ai demandé la parole, dit Rosa Luxemburg, au nom des délégations russe et polonaise pour vous rappeler que nous devons tirer sur ce point (la grève de masse en Russie et la guerre, NDLR.) la leçon de la grande Révolution russe... La Révolution russe n’a pas surgi seulement comme un résultat de la guerre ; elle a aussi servi à mettre fin à la guerre. Sans elle, le tsarisme aurait sûrement continué la guerre..." (Cité par B.D. Wolfe, Lénine, Trotski, Staline, Calmann-Lévy, 1951.)
La Gauche fait adopter un amendement de la plus haute importance à la résolution du congrès, présenté par Rosa Luxemburg et Lénine :
-
"Si néanmoins une guerre éclate, les socialistes ont le devoir d oeuvrer pour qu'elle se termine le plus rapidement possible et d'utiliser par tous les moyens la crise économique et politique provoquée par la guerre pour réveiller le peuple et de hâter ainsi la chute de la domination capitaliste." (Cité dans "La résolution sur la position envers les courants socialistes et la conférence de Berne", Premier congrès de l'Internationale communiste, Pierre Broué, EDI, 1974.)
En 1912, le congrès de Bâle de la 2e Internationale réaffirme cette position face aux menaces de plus en plus fortes de guerre impérialiste en Europe :
-
"Que les gouvernements bourgeois n'oublient pas que la guerre franco-allemande donna naissance à l'insurrection révolutionnaire de la Commune et que la guerre russo-japonaise mit en mouvement les forces révolutionnaires de Russie. Aux yeux des prolétaires, il est criminel de s'entretuer au profit du gain capitaliste, de la rivalité dynastique et de la floraison des traités diplomatiques." (Ibid.)
La trahison et la mort de la 2e Internationale
Le 4 août 1914 éclate la première guerre mondiale. Gangrenée par l'opportunisme, emportée par la tempête chauvine et guerrière, la 2e Internationale éclate et se meurt dans la honte : les principaux partis qui la composent -et surtout les partis social-démocrates allemand, français et anglais aux mains de directions opportunistes- votent les crédits de guerre, appellent h la "défense de la patrie", à l'"union sacrée" avec la bourgeoisie contre "l'étranger", et sont même récompensés en France par des postes de ministre pour leur renoncement à la lutte de classe. Ils reçoivent l'appui "théorique" du "centre" (entre les ailes droite et gauche de l'Internationale) quand Kautsky, "le pape du marxisme", séparant la guerre et la lutte de classe, déclare cette dernière possible seulement en "temps de paix". Et bien sûr impossible en "temps de guerre".
-
"Pour les ouvriers conscients (...), le krach de la 2e Internationale, c'est l'abominable trahison, par la majorité des partis social-démocrates, de leurs convictions, des solennelles déclarations des congrès internationaux de Stuttgart et de Bâle, des résolutions de ces congrès, etc." (Lénine, "Le krach de la 2e Internationale", 1915, dans le recueil Contre le Courant, Maspéro, 1970.)
Seuls quelques partis résistent à la tempête : principalement le» partis italien, serbe, bulgare et russe. Ailleurs, des militants bien souvent isolés, essentiellement de la Gauche, tels RosaLuxemburg et les "Tribunistes" hollandais autour de Pannekoek et Gorter, vont rester fidèles à l'internationalisme prolétarien et à la lutte de classe, et essayer de se regrouper.
La mort de la 2e Internationale signifie une lourde défaite pour le prolétariat, qu'il paiera de son sang dans les tranchées. Nombre d'ouvriers révolutionnaires vont disparaître dans la boucherie. Pour les "social-démocrates révolutionnaires", c'est la perte de leur organisation internationale, qui est à reconstruire :
-
"La 2e Internationale est morte vaincue par l'opportunisme. A bas l'opportunisme, et vive la 3e Internationale débarrassée non seulement des transfuges (...) mais aussi de l'opportunisme !" (Lénine, "Situation et tâches de l'Internationale socialiste", 1er octobre 1914, Ibid.)
Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal : un pas vers la construction de l'Internationale communiste
En septembre 1915 se tient "la conférence socialiste internationale de Zimmerwald". Elle devait être suivie d'une seconde conférence en avril 1916 à Kienthal, toujours en Suisse. Malgré les conditions de guerre et de répression, des délégués de 11 pays y participent, d'Allemagne, d'Italie, de Russie, de France, etc.
Le Manifeste de Zimmerwald reconnaît la guerre comme une guerre impérialiste. La majorité de la conférence se refuse à dénoncer la droite opportuniste des partis social-démocrates passés dans le camp de l'"union sacrée" et à envisager la scission d'avec elle. Cette majorité centriste est pacifiste, et défend le mot d'ordre de la "paix".
Unie derrière les représentants de la fraction bolchevik, Lénine et Zinoviev, la "gauche zimmerwaldienne" défend la nécessité de la rupture et de la construction de la 3e Internationale. Contre le pacifisme, elle affirme que "la lutte pour la paix sans action révolutionnaire est une phrase creuse et mensongère" (Lénine) et elle oppose au centrisme le mot d'ordre de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Ce mot d'ordre, précisément, est indiqué par les résolutions de Stuttgart et de Bâle." (Lénine.) Bien que la Gauche se renforce d'une conférence à l'autre, elle ne réussit pas à convaincre les délégués et reste minoritaire. Pourtant, elle tire un bilan positif :
-
"La deuxième conférence de Zimmerwald (Kienthal) constitue indiscutablement un progrès, c'est un pas en avant. (...) Que faire donc demain? Demain, continuer à lutter pour notre solution, pour la social-démocratie révolutionnaire, pour la 3e Internationale ! Zimmerwald et Kienthal ont montré que notre voie était la bonne." (Zinoviev, 10 juin 1916, Ibid.)
La rencontre et le combat communs des gauches de différents pays durant les conférences a permis la constitution du "premier noyau de la 3e Internationale en formation", devait reconnaître Zinoviev en mars 1918.
La réalisation par le prolétariat des résolutions des congrès de Stuttgart et de Bâle
Nous l'avons vu précédemment, la révolution prolétarienne, en Russie de 1917, ouvre une période de vague révolutionnaire dans toute l'Europe. La menace prolétarienne décide la bourgeoisie internationale à mettre fin au carnage impérialiste. Le mot d'ordre de Lénine se réalise : le prolétariat russe puis international transforme la guerre impérialiste en guerre civile. Le prolétariat rend ainsi honneur à la Gauche de la 2e Internationale en appliquant la fameuse résolution de Stuttgart.
La guerre a rejeté définitivement la droite opportuniste des partis sociaux-démocrates dans le camp de la bourgeoisie. La vague révolutionnaire met au pied du mur les pacifistes du centre, et va mener à son tour une grande partie d'entre eux -surtout les dirigeants, comme Kautsky - à rejoindre l'ennemi de classe. Il n'existe plus d'Internationale. Les nouveaux partis qui se constituent en rupture avec la social-démocratie commencent à adopter l'appellation de "parti communiste", en même temps que la vague révolutionnaire nécessite et pousse à la constitution du parti mondial du prolétariat, la 3e Internationale.
La constitution de pic et la continuité politique et principielle avec la 2e Internationale
L'Internationale, qui prend le nom d'Internationale communiste, se forme donc en mars 1919 sur la base de la rupture organique avec la droite des partis de la défunte 2e Internationale. Pour autant, elle ne rejette pas les principes et les apports de celle-ci :
-
"Rejetant loin de nous toutes les demi-mesures, les mensonges et la paresse des partis socialistes officiels surannés, nous nous considérons, nous communistes, rassemblés dans la 3e Internationale, comme les continuateurs directs des efforts héroïques et du martyre de toute une longue série de générations révolutionnaires, depuis Babeuf jusqu'à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Si la 1e Internationale a prévu le développement de l'histoire et préparé ses voies, si la 2e a rassemblé et organisé des millions de prolétaires, la 3e Internationale, elle, est l'Internationale de l'action de masse ouverte, de la réalisation révolutionnaire, l'Internationale de l’action." ("Manifeste de l'IC", P. Broué, Ibid.)
Les courants, les fractions, les traditions et les positions défendues et approfondies par la Gauche, qui vont être à la base de l'IC, sont apparus et se sont développés au sein de la 2e Internationale :
-
"l'expérience est là pour nous prouver que c'est seulement un groupement sélectionné dans le milieu historique où s'est développé le prolétariat d'avant-guerre : la 2e Internationale, que la lutte prolétarienne contre la guerre impérialiste a pu être poussée à ses conséquences extrêmes car il est le seul ayant pu formuler un programme avancé de la révolution prolétarienne et, par là, le seul qui ait pu jeter les bases pour le nouveau mouvement prolétarien." ("Bilan" n° 34, Bulletin théorique de la fraction italienne de la Gauche communiste, août 1936.)
Au-delà d'individus tels Lénine, Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, au-delà même des groupes et fractions des partis social-démocrates tels les bolcheviks, les gauches allemande, hollandaise, italienne, etc., il existe une continuité politique et organique entre la Gauche de la 2e Internationale, la Gauche de Zimmerwald et la 3e Internationale. C'est sur l'initiative du Parti communiste (bolchevik) de Russie -ex-Parti ouvrier social-démocrate (bolchevik) de Russie adhérant à la 2e Internationale- et du Parti communiste d'Allemagne -ex-Ligue Spartacus- qu'est convoqué le premier congrès de la nouvelle Internationale. Les bolcheviks ont animé et entraîné la Gauche à Zimmerwald. Celle-ci, véritable lien organique et politique entre la 2e et la 3e Internationale comme "fraction de gauche" de la 2e, tire le bilan de son combat passé et indique la nécessité de l'heure :
-
"Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal eurent leur importance à une époque où il était nécessaire d'unir tous les éléments prolétariens décidés sous une forme ou une autre à protester contre la boucherie impérialiste. (...) Le groupement de Zimmerwald a fait son temps. Tout ce qui était véritablement révolutionnaire dans le groupement de Zimmerwald passe et adhère à l’Internationale communiste." ("Déclaration des participants à Zimmerwald", P. Broué, Ibid.)
Nous insistons particulièrement sur la continuité qui existe, entre les deux Internationales. En effet, nous l'avons vu, l'IC ne surgit pas du néant au niveau organique. Il en est de même au niveau de son programme et de ses principes politiques. Ne pas reconnaître le fil historique qui les relie serait tombé dans l'anarchisme, incapable de comprendre le déroulement de l'histoire, ou céder au spontanéisme le plus mécanique en voyant l'IC comme le produit du seul mouvement révolutionnaire des masses ouvrières.
Ne pas reconnaître la continuité, c'est l'impossibilité de comprendre en quoi l'IC rompt avec la 2e Internationale. Car, s'il y a continuité entre les deux -continuité de principe s'exprimant entre autre dans la résolution de Stuttgart-, il y a aussi une rupture. Rupture matérialisée dans le programme politique de l'IC, dans ses positions politiques et dans sa pratique organisationnelle et militante comme "parti communiste mondial". Rupture au travers des faits eux-mêmes, dans l'emploi des armes et la répression sanguinaire, par le gouvernement de Kerenski, auquel participent mencheviks et socialistes-révolutionnaires, membres de la 2e Internationale, contre le prolétariat et les bolcheviks en Russie, par le gouvernement social-démocrate de Noske-Scheidemann contre le prolétariat et le KPD en Allemagne.
Ne pas reconnaître cette "rupture dans la continuité", c'est rendre impossible aussi la compréhension de la dégénérescence de l'IC dans les années 20 et le combat qu'ont mené en son sein, et par la suite dans les années 30 en dehors, car exclues, les fractions de la Gauche Communiste "italienne", "allemande" et "hollandaise" pour ne citer que les plus importantes. C'est de ces fractions de gauche, de leur défense des principes communistes et de leur travail de bilan critique de l'IC et de la vague révolutionnaire de 1917-23, que les groupes communistes d'aujourd'hui et les positions qu'ils défendent sont le produit.
Ne pas reconnaître l'héritage de la 2e, l'héritage politique du prolétariat, rend incapable de comprendre les fondements des positions de l'IC, ni la validité actuelle de certaines d'entre elles parmi les plus importantes, ni les apports des fractions des années 30. C'est-à-dire être incapable de défendre de manière conséquente, assurée et déterminée les positions révolutionnaires aujourd'hui.
LA RUPTURE DE L'I.C. AVEC LA 2e INTERNATIONALE
Le programme politique de l’I.C.
Trotski rédige fin janvier 1919 la Lettre d'invitation au congrès de constitution de l'IC, qui détermine les principes politiques que veut se donner la nouvelle organisation. Elle est en fait le projet de "Plate-forme de l'Internationale communiste" et en fournit un bon résumé. Elle se base sur les programmes des deux principaux partis communistes :
-
"La reconnaissance des principes suivants établis sous forme de programme et élaborés à partir des programmes de la Ligue Spartacus en Allemagne et du Parti communiste (bolchevik) de Russie, doit, selon nous, servir de base à la nouvelle Internationale." ("Lettre d'invitation au 1er congrès", P. Broué, Ibid.)
La Ligue Spartacus n'existe plus alors, depuis la constitution du Parti communiste allemand le 29 décembre 1918. Ce dernier, le KPD, vient de perdre ses principaux dirigeants, Rosa | Luxemburg et Karl Liebknecht, assassinés par la social-démocratie lors de la répression terrible qu'a subie le prolétariat berlinois en janvier. C'est donc au moment où elle se constitue que l'IC connaît sa première défaite en même temps que le prolétariat international. A deux mois de sa constitution, elle vient de perdre deux de ses dirigeants au prestige, à ( la force et aux capacités théoriques et politiques comparables à ceux de Lénine et de Trotsky. C'est Rosa Luxemburg qui a le plus développé dans ses écrits et prises de position, à la fin du siècle dernier, le point qui va devenir la clé de voûte du programme politique de la 3e Internationale.
Le déclin historique irréversible du capitalisme
Pour Rosa Luxemburg, il est clair qu'avec la guerre de 1914, s'est ouverte la période de décadence du mode de production capitaliste. Cette position ne souffre plus de contestation après le carnage impérialiste :
-
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l'humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme." ("Discours sur le Programme" au congrès de fondation du KPD, dans Spartacus et la commune de Berlin, Editions Spartacus.)
Cette position est réaffirmée avec force par l'Internationale dans le premier point de la Lettre d'invitation au congrès :
-
"1° La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et sera celle de l’effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n’est pas abattu." Et
"Une nouvelle époque est née : l’époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat." ("Plate-forme de l'Internationale communiste", P.Broué, Ibid.)
Les implications politiques de l’époque de décadence du capitalisme
Pour tous ceux qui se situent sur le terrain de l'Internationale communiste, le déclin du capitalisme a des conséquences sur les conditions de vie et de lutte du prolétariat. Contrairement à la position du centre pacifiste, à Kautsky par exemple, la fin de la guerre ne signifie pas le retour à la vie et au programme d'avant-guerre. Là se situe un des points de rupture entre la 2e Internationale morte et la 3e :
- "Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. (...)"La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement." (La crise de la social-démocratie, dite Brochure de Junius, Rosa Luxemburg, 1915, Editions La Taupe.)
L'ouverture de la période de déclin de la société capitaliste, marquée par la guerre impérialiste, signifie de nouvelles conditions de vie et de lutte pour le prolétariat international. La grève de masse en Russie en 1905, le surgissement pour la première fois d'une nouvelle forme d'organisation unitaire des masses ouvrières, les soviets, la formation de conseils ouvriers, l'avaient annoncée. Rosa Luxemburg (Grève de masse, parti et syndicats, 1906) et Trotsky (1905) tirèrent les leçons essentielles de ces mouvements de masse. Avec R.Luxemburg, l'ensemble de la Gauche mena le débat sur la grève de masse et la bataille politique au sein de la 2e Internationale contre l'opportunisme des directions syndicales et des partis social-démocrates, contre leur vision d'une évolution pacifique et graduelle vers le socialisme. En rupture avec la pratique social-démocrate, l'IC affirme que :
- "La méthode fondamentale de la lutte est l’action de masse du prolétariat, y compris la lutte ouverte à main armée contre le pouvoir d'Etat du capital." ("Lettre d'invitation au congrès").
La révolution et la dictature du prolétariat
L'action des masses ouvrières mène à l'affrontement avec l'Etat bourgeois. L'apport le plus précieux de l'IC est sur l'attitude du prolétariat révolutionnaire face à l'Etat. Rompant avec le réformisme de la social-démocratie, reprenant la méthode marxiste et les leçons des expériences historiques : la Commune de Paris, 1905, et surtout l'insurrection d'Octobre 1917 puis la destruction de l'Etat capitaliste en Russie et l'exercice du pouvoir des conseils ouvriers, l’IC se prononce clairement et sans ambiguïté pour la destruction de l'Etat bourgeois et la dictature du prolétariat, la dictature des masses ouvrières organisées dans les conseils ouvriers.
Dans la Lettre d'invitation déjà citée, on lit :
- "2° La tâche du prolétariat consiste maintenant à s'emparer du pouvoir d'Etat. La prise du pouvoir signifie la destruction de l'appareil d'Etat de la bourgeoisie et l'organisation d'un nouvel appareil du pouvoir prolétarien.
- "3° Le nouvel appareil du pouvoir doit représenter la dictature de la classe ouvrière, et, dans certains endroits aussi celle des petits paysans et des ouvriers agricoles (...). Le pouvoir des conseils ouvriers ou des organisations ouvrières est sa forme concrète.
- "4° La dictature du prolétariat doit être le levier de l’expropriation immédiate du Capital, de l'abolition de la propriété privée des moyens de production et de sa transformation en propriété sociale."
Cette question est un point essentiel du congrès qui voit la présentation et l'adoption des "Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne" présentées par Lénine.
Les thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat
Les thèses commencent par dénoncer la fausse opposition entre la démocratie et la dictature "car, dans aucun pays capitaliste civilisé, il n'existe de 'démocratie en général', mais seulement une démocratie bourgeoise." La Commune de Paris a montré le caractère dictatorial de la démocratie bourgeoise. Défendre la démocratie "pure" dans le capitalisme, c'est défendre dans les faits la démocratie bourgeoise, la forme par excellence de la dictature du capital. Quelle liberté de réunion pour les ouvriers ? Quelle liberté de presse ? Lénine répond :
- "La 'liberté de presse' est également un des principaux mots d'ordre de la 'démocratie pure'. Néanmoins, les ouvriers savent (...) que cette liberté est un leurre, tant que les meilleures imprimeries et les plus gros stocks de papier sont accaparés par les capitalistes, et tant que le pouvoir du capital demeure sur la presse, ce pouvoir qui s'exprime dans le monde entier d'autant plus cyniquement que la démocratie et le régime républicain sont plus développés, par exemple comme en Amérique. Pour conquérir une véritable égalité et une véritable démocratie pour les travailleurs, pour les ouvriers et les paysans, on doit retirer aux capitalistes la possibilité d'embaucher des écrivains, d'acheter des maisons d'éditions et de corrompre la presse. A cet effet, il est nécessaire de secouer le joug du capital, de renverser les exploiteurs et de briser leur résistance." ("Thèses sur la démocratie et la dictature du prolétariat", P.Broué, Ibid.)
Revendiquer et défendre la démocratie pure, comme les kautskystes, est un crime contre le prolétariat après l'expérience de la guerre et de la révolution, continuent les thèses. C'est pour les intérêts des différents impérialismes, d'une minorité de capitalistes, que des millions d'hommes ont été massacrés dans les tranchées et que dans tous les pays, démocratiques ou non, s'est édifiée la "dictature militaire de la bourgeoisie". C'est la démocratie bourgeoise qui a assassiné Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg alors qu'ils étaient arrêtés et emprisonnés par le gouvernement social-démocrate.
- "Dans un tel état de fait, la dictature du prolétariat ne se légitime pas seulement en tant que moyen de renverser les exploiteurs et de briser leur résistance, mais aussi par le fait qu'elle est nécessaire à la masse des travailleurs comme unique moyen de défense contre la dictature de la bourgeoisie, qui a mené à la guerre et qui prépare de nouvelles guerres.(...)"La différence fondamentale entre la dictature du prolétariat et la dictature des autres classes (...) consiste en ce que (...) la dictature du prolétariat est la répression par la violence de la résistance des exploiteurs, c'est-à-dire de la minorité infime de la population des grands propriétaires fonciers et des capitalistes. (...)"
La forme de la dictature du prolétariat déjà élaborée en fait, c'est-à-dire le pouvoir des soviets en Russie, le système des conseils ouvriers en Allemagne, les Shop-stewards Committees et autres institutions soviétiques dans d'autres pays signifient et réalisent précisément pour les classes laborieuses, c'est-à-dire pour l'énorme majorité de la population, une possibilité effective de jouir des droits et libertés démocratiques, comme il n'en a jamais existé, même approximativement, dans les meilleures républiques démocratiques bourgeoises." (Ibid.)
Seule la dictature du prolétariat à l'échelle mondiale peut détruire le capitalisme, abolir les classes, et assurer le passage au communisme.
- "L'abolition du pouvoir d'Etat est l’objectif que se sont assigné tous les socialistes, Marx en tête. Tant que cet objectif n'est pas réalisé, la démocratie véritable, c'est-à-dire l’égalité et la liberté, est irréalisable. Seule la démocratie soviétique ou prolétarienne conduit pratiquement à ce résultat, car elle commence aussitôt à préparer le dépérissement complet de tout Etat, en associant les organisations des masses laborieuses à la gestion de l'Etat." (Ibid.)
La question de l'Etat est cruciale au moment où la vague révolutionnaire déferle en Europe et à l'heure où la bourgeoisie de tous les pays mène la guerre civile contre le prolétariat en Russie, quand l'antagonisme entre le travail et le capital, entre le prolétariat et la bourgeoisie atteint son degré le plus extrême et le plus dramatique. C'est concrètement que se pose aux révolutionnaires la nécessité de la défense de la dictature du prolétariat en Russie et de l'extension internationale de la révolution, du pouvoir des soviets à l'Europe. Pour ou contre l'Etat de la dictature du prolétariat en Russie et la vague révolutionnaire. "Pour" signifie l'adhésion à l'Internationale communiste, et la rupture politique et organique avec la social-démocratie. "Contre" veut dire la défense de l'Etat bourgeois et le choix définitif du camp de la contre-révolution. Et pour les courants centristes hésitants devant l'alternative, ce sera l'éclatement et la disparition. Les périodes révolutionnaires ne laissent pas de place à la politique timorée du "juste milieu".
AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONTINUER LE TRAVAIL DE L'I.C.
Le changement de période historique définitivement révélé avec la guerre de 1914-1918 détermine la rupture entre les positions politiques de la 2e et de la 3e Internationales. Nous venons de le voir sur la question de l'Etat. Le déclin du capitalisme et ses conséquences sur les conditions de vie et de lutte pour le prolétariat posaient toute une série de nouveaux problèmes : fallait-il toujours participer aux élections et se servir du parlementarisme ? Face aux conseils ouvriers, les syndicats qui ont participé à l’"union sacrée", étaient-ils encore des organisations ouvrières ? Quelle attitude adopter vis-à-vis des luttes de libération nationale dans l'époque des guerres impérialistes ?
L'IC ne sait pas répondre à ces nouvelles questions. Elle se constitue plus d'un an après octobre 1917 en Russie, deux mois après la première défaite du prolétariat à Berlin. Les années qui suivent, sont marquées par la défaite et le recul de la vague révolutionnaire internationale et, par conséquent, par l'isolement croissant du prolétariat en Russie. Cet isolement est la raison déterminante de la dégénérescence de l'Etat de la dictature du prolétariat. Ces événements vont rendre incapable l'IC de résister au développement de l'opportunisme. A son tour, elle en mourra.
Pour tirer un bilan de l'IC, il faut évidemment la reconnaître comme le Parti communiste international qu'elle fut. Pour ceux qui n'y voient qu'une organisation bourgeoise -du fait de sa dégénérescence ultérieure- il est impossible d'en tirer un bilan et des leçons. Le trotskisme lui, se revendique des "Quatre premiers congrès" sans critique. Il n'a jamais vu que, là où le premier rompait avec la 2e Internationale, les congrès suivants marquaient un recul : en opposition à la scission accomplie au 1er Congrès avec la social-démocratie, le 3e propose à cette dernière l'alliance dans le "Front unique". Après avoir reconnu son passage définitif dans le camp de la bourgeoisie, elle réhabilite la social-démocratie au 3e Congrès. Cette politique d'alliance avec les partis social-démocrates allait mener le trotskisme à l’'entrisme", c'est-à-dire à entrer dans ces partis dans les années 30 au mépris des principes mêmes du 1er Congrès. Cette politique d'alliance, de capitulation, aurait dit Lénine, devait précipiter encore plus le courant trotskyste dans la contre-révolution avec le soutien au gouvernement républicain bourgeois dans la guerre d'Espagne et ensuite la participation dans la 2e guerre impérialiste mondiale, trahissant ainsi Zimmerwald et l'Internationale.
C'est au sein de l’IC que, dès le début des années 20, s'est créée une nouvelle Gauche pour essayer de lutter contre la dégénérescence : en particulier les Gauches italienne, allemande et hollandaise. Ces fractions de Gauche, qui ont été exclues tout au long des années 1920, continuèrent leur combat politique pour assurer la continuité entre l'IC qui se mourait et le "parti de demain" en tirant un bilan de la vague révolutionnaire et de l'Internationale communiste. "Bilan" était précisément le nom de la revue de la Fraction italienne de la Gauche communiste dans les années 1930.
En continuité avec les principes de l'Internationale, ces groupes ont critiqué les faiblesses de sa rupture avec la 2e Internationale. Leur travail obscur au plus profond de la contre-révolution, leur défense des principes communistes dans les années 30 et au cours de la 2e guerre impérialiste mondiale, ont permis le surgissement et l'existence des groupes communistes d'aujourd'hui, qui, à défaut d'une continuité organique, assurent la continuité politique. Les positions défendues et élaborées par ces groupes répondent aux problèmes soulevés dans l'IC par la nouvelle période de décadence du capitalisme.
C'est donc sur la base du bilan critique accompli par les Fractions de la Gauche communiste que l'IC vit actuellement et vivra dans le Parti communiste mondial de demain.
Aujourd'hui, face à l'exploitation et à la misère croissantes, le prolétariat doit adopter la même position que la Gauche de Zimmerwald :
- Non à l'union sacrée avec sa bourgeoisie dans la guerre économique !
Non aux sacrifices pour sauver l'économie nationale !
Vive la lutte de classe !
Transformation de la guerre économique en guerre civile !
Face à la catastrophe économique, face à la décomposition de la société, face à la perspective d'une troisième guerre impérialiste mondiale, auxquelles nous mène le capitalisme, l'alternative historique reste la même qu'en 1919 : destruction du capitalisme et instauration de la dictature du prolétariat au niveau mondial, socialisme ou barbarie.
L'avenir appartient au communisme.
R.L.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Conscience de classe et parti - GPI, Mexique : débat avec le BIPR
- 3796 reads
Avertissement préliminaire :
Parmi les divers groupes politiques prolétariens avec lesquels le GPI a pu prendre contact et établir un échange de publications, le BIPR (et, au sein de celui-ci, plus particulièrement le Parti Communiste Internationaliste -PCInt) a été un des rares groupes à s'être donné la peine de faire une critique directe et élaborée de nos positions, telles qu'elles sont exprimées dans Revolucion Mondial. C’est une attitude du BIPR que nous saluons. Les questionnements dont nous ont fait part ces camarades sont d'ordres divers, mais ils tournent tous autour d'une préoccupation centrale : selon eux, le GPI « a adopté de manière immédiate et manquant de sens critique toutes les positions qui caractérisent particulièrement le CCI au sein du camp prolétarien ». Bien entendu, ils expliquent ceci par le contact "direct et exclusif avec le CCI" qui a été « à l'origine dit GPI, bien que -poursuivent les camarades - vu que nous sommes convaincus que le CCI (sans nier sont mérite d'être une organisation de militants sincères et fidèles à la classe prolétarienne) ne représente pas un pôle de regroupement valable pour la constitution du parti révolutionnaire international, nous croyons que les camarades du GPI doivent faire des pas ultérieurs vers un réel processus de clarification, de décantation et de sélection des positions utiles à la constitution d’un pôle révolutionnaire au Mexique (...) la discussion politique sérieuse et les faits qui en découleront pourront démontrer que nous avons raison" ([1] [16])
Que le GPI s'est constitué sous l'influence du CCI, reprenant de manière immédiate ses positions (ou, si on veut le poser dans une autre perspective : que nous sommes un résultat du travail militant du CCI), c'est quelque chose que nous n'avons jamais omis de signaler. Nous avons déjà dit qu'actuellement, face aux faiblesses du milieu révolutionnaire international, face à l'absence d'un pôle unique de référence et de regroupement des forces révolutionnaires, les nouveaux militants surgissent sous l'influence déterminante de tel ou tel groupe, héritant autant ses mérites que ses déficiences, se trouvant d'emblée devant la nécessité de "prendre parti" face aux divergences existantes dans le milieu.
Mais il n'est pas juste de dire que le GPI a adopté ses positions avec peu de sens critique. Car nous avons reconnu dès le début l'existence d'un camp de groupes politiques prolétariens, ce qui veut dire que nous ne considérons pas le CCI comme le détenteur de "toute la vérité" et nous aurons l'occasion d'exposer nos divergences avec lui. Bien que, a dire vrai, la connaissance des positions des autres regroupements nous a laissé la certitude que le CCI, au moins, est parmi ceux qui maintiennent la plus grande cohérence théorique politique.
Nous insistons une fois encore sur le fait que le GPI considère que sa consolidation ne pourra se faire qu'en approfondissant les positions politiques auxquelles, il est parvenu, notamment en les confrontant sérieusement à celles que soutiennent les différents groupes du milieu communiste international. Que nous sommes ouverts à la discussion et à la collaboration avec d'autres groupes, jusqu'au point où le permet le maintien des principes prolétariens, car nous nous considérons comme une minuscule partie du processus vers la constitution du Parti Communiste Mondial.
C'est dans ce sens que nous publions ici notre prise de position sur la conception du BIPR de la conscience de classe et de la fonction du parti.
Nous pensons que les conditions pour le regroupement des révolutionnaires en un nouveau parti international sont encore loin d'être données ; probablement seul un événement très important de la lutte de classe permettra une polarisation claire et effective des forces révolutionnaires existantes. Nous n'avons pas encore idée de la forme concrète que prendra cette polarisation. Ce qui est certain c’est que la nécessité d'un parti communiste à échelle mondiale se pose au prolétariat de manière chaque fois plus urgente, et ses minorités révolutionnaires doivent aujourd'hui s'efforcer de déblayer le chemin qui conduit à sa constitution, en posant les bases pour que les différents groupes existants en viennent au regroupement avec la plus grande définition politique possible en commençant par la mise au clair des points d'accord et de désaccord qui existent sur la fonction du parti communiste dans la classe ouvrière.
De toute évidence le GPI ne fait ici que s' « immiscer » dans le débat fondamental qui a occupé les révolutionnaires depuis de nombreuses années et qui a connu récemment deux moments importants lors des conférences convoquées par le PCInt et ensuite avec les réponses à la "Proposition Internationale" fait en 1986 par Emancipacion Obrera). Et si nous entrons dans ce débat avec les camarades du PCInt c'est parce que tous les points qu'ils ont mis en discussion nous renvoient à la question de la conscience de classe et du parti. Nous sommes loin de prétendre apporter maintenant une solution de dernière instance à la question. Mais si nous arrivons au moins à poser clairement ce qui constitue à nos yeux les faiblesses du BIPR (et de ceux qui partagent ses positions), nous considérerons que nous avons atteint le but de cet article.
Nos critiques se réfèrent fondamentalement à l'article la conscience de classe dans la perspective marxiste (Revue Communiste n° 2), à la plate-forme du BIPR et à la correspondance que nous a envoyée le PCint directement.
1. DONNEES DU PROBLEME
Dans l'article "La conscience de classe dans la perspective marxiste", le BIPR expose sa conception sur le sujet, essayant a la fois de démontrer que dans la polémique qui tournait autour de Lénine et de Rosa Luxembourg au sujet de la formation de la conscience de classe et la fonction du parti, le premier avait raison et la deuxième se trompai( et avec elle, ses "héritiers" actuels).
II y a en effet, dans le milieu communiste international, une tendance à présenter les divergences actuelles sur le parti (et sur tous les sujets) comme une reproduction ou une continuation des anciens débats qui ont animé de tout temps les révolutionnaires. C'est là le résultat non d'un exercice académique, mais de l'effort réel des regroupements politiques prolétariens de ne pas perdre le fil historique des positions révolutionnaires.
II est évident cependant que le débat actuel ne peut pas être exactement le même qu'il y a presque un siècle. "Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts" depuis lors : le prolétariat a vécu non seulement la vague révolutionnaire la plus grandiose qu'on ait connue jusqu'à nos jours, mais aussi la plus longue période de contre-révolution. Pour les minorités révolutionnaires actuelles il y a une immense accumulation d'expériences qui pose les bases de la clarification d'une série de problèmes qui vont se poser au prolétariat dans sa lutte, mais en même temps elles éprouvent une plus grande difficulté à faire cette clarification, étant donné leur existence précaire. C'est ainsi que le débat actuel entre les révolutionnaires sur le rapport conscience de classe - parti reproduit apparemment les mêmes divergences qu'entre la tendance exprimée par Lénine et celle exprimée par Rosa Luxembourg, mais il cache une divergence beaucoup plus profonde, plus grave que celle qui séparait ces deux dirigeants du prolétariat.
En effet, au début du siècle la préoccupation des révolutionnaires portait sur le processus par lequel les masses prolétariennes arrivent à la conscience de classe, c'est-à-dire, à la compréhension de l'antagonisme irréconciliable entre bourgeoisie et prolétariat et la nécessité ainsi que la possibilité d'une révolution communiste ; si cette préoccupation subsiste encore, elle est doublée par une autre, plus générale et élémentaire, plus « primitive » pourrait-on dire : celle de savoir si, de manière générale, les masses prolétariennes arrivent ou non -d'une manière ou d'une autre- à la conscience de classe. Une partie du milieu révolutionnaire actuel, y compris le BIPR, considère que "le parti communiste est le seul ou le principal dépositaire de la conscience de classe", jusqu'à la destruction de l'Etat bourgeois et l'instauration de la dictature du prolétariat, et que ce n'est qu'à ce moment que les masses acquerront une conscience de classe. L'autre partie, dans laquelle s'inscrit le GPI, considère que la condition fondamentale préalable pour la destruction de l'Etat bourgeois et l'instauration de la dictature du prolétariat, c'est la prise de conscience de classe du prolétariat, de masses déterminantes de la classe (au moins la majorité des prolétaires des grandes villes). De là qu'il existe un véritable abîme dans la conception défendue sur la fonction du parti (et plus spécifiquement sur le rôle que doivent jouer actuellement les minorités révolutionnaires organisées). Au fond, le débat ne concerne pas le rôle plus ou moins décisif que joue le parti dans le processus de constitution du prolétariat en classe pour soi ; le problème majeur n'est pas de définir si le parti Il oriente" ou "dirige", mais une question plus générale : qu'entend-on par "classe pour soi" `?
Ainsi par exemple, nous pourrions peut-être nous mettre d'accord sur le fait que la fonction du parti est de "diriger" le prolétariat. Mais cet accord ne serait qu'apparent : car à partir du moment ou l'on considère "idéaliste" que les masses prolétariennes puissent développer une conscience révolutionnaire comme condition préalable à 1a prise du pouvoir, il est évident que par "direction" il faut entendre alors un rapport essentiellement identique à celui qui existe, par exemple, entre l'officier et les soldats dans l'armée moderne, ou entre le patron et les ouvriers clans l'usine, c'est-à-dire, un rapport dans lequel seul le dirigeant connaît les buts réels poursuivis, tandis que, pour la partie dirigée, ces buts demeurent dans l'obscurité, confus, voilés par des nuages idéologiques -et c'est pour cela même qu'elle se laisse diriger ; il s'agit alors d'une direction imposée (que ce soit de manière patriarcale ou de manière autoritaire), d'un rapport de dominant à dominés. Pour nous, au contraire, la direction du parti communiste n'est pas autre chose que la compréhension, la conviction profonde que développe l'ensemble de la classe ouvrière de la justesse des positions programmatiques et des mots d'ordre du parti, lesquels sont l'expression du mouvement même de la classe. Une conviction à laquelle parviennent les masses à travers les enseignements historiques qu'elles tirent de leurs luttes, auxquelles le parti participe en tant qu'avant-garde. Entre le parti et la masse prolétarienne il existe un rapport d'un type nouveau, propre 3 la classe ouvrière.
Ainsi, pour les uns, la constitution du prolétariat en classe signifie que le parti, seul dépositaire de la conscience prolétarienne-révolutionnaire, se met à la tête des masses, lesquelles, malgré toutes leurs expériences de lutte, demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise. Pour d'autres, au contraire, la constitution du prolétariat en classe signifie que les masses, grâce à leur expérience et à l'intervention du parti, développent une conscience prolétarienne révolutionnaire. Le BIPR soutient la première position. Nous la deuxième. Le GPI serait-il submergé dans l'idéalisme ?
II. COMMENT LE BIPR ESSAIE D'APPROFONDIR LENINE
Une des premières questions qui ressortent de l'article cité du BIPR, c'est la nouvelle formulation qu'il fait des thèses que Lénine a exprimées dans son ouvrage Que Faire ?. Mais les changements introduits par les camarades dans la terminologie employée par Lénine n'entraînent pas tant une "précision" de sa pensée qu'une distorsion de celle-ci, derrière laquelle se trouve un déplacement du débat de la question de "comment est-ce que les masses arrivent à la conscience de classe ?" A celle de savoir si, en général, il est possible qu'elles y arrivent. C'est pour cela que, bien que nous ne partagions pas la démarche de Lénine selon laquelle la conscience est apportée à la classe ouvrière de l'extérieur, avant d'essayer de "critiquer" Lénine, nous devrons le "défendre", essayer de restituer sa pensée, exprimer clairement quelles étaient sa préoccupation et ses intentions dans le combat contre le courant "économiste" (pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, disons clairement que quand nous nous référons à "Lénine" ou a n'importe quel autre révolutionnaire, nous ne recherchons pas si celui-ci "se trompait" ou s'il était "infaillible" en tant que personne. Nous le prenons comme représentant d'un courant politique à un moment donné ; et ce n'est que parce que tel ou tel courant s'exprime plus clairement dans tel ou tel ouvrage que nous pouvons le prendre comme "spécimen").
Bien. Lénine appelle conscience trade-unioniste (syndicaliste) la "conviction qu'il faut s'unir en syndicats, se battre contre !es patrons, réclamer du gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ouvriers..." ([2] [17]), et conscience social démocrate (nous dirions aujourd'hui communiste) la "conscience de l'opposition irréductible de leurs intérêts (celui des ouvriers) avec tout ordre politique et social existant" ([3] [18]). D'après Lénine, la classe ouvrière, à partir de ses luttes spontanées, de résistance, n'est capable d'atteindre qu'une conscience tride-unioniste -de là que la conscience communiste doive lui être "apportée de l'extérieur" par le parti.
Le BIPR modifie la formulation de Lénine en posant que "l'expérience immédiate de la classe ouvrière la mène à prendre conscience de son identité de classe et de la nécessité de lutter collectivement (...)", que "les conditions d'existence du prolétariat, ses luttes et ses réflexions sur celles-ci , élèvent sa conscience au point qu'il peut se reconnaître comme une classe à part et se définir par la nécessité de lutter contre la bourgeoisie. Mais identité de classe ne veut pas dire conscience communiste." ([4] [19]) Et un peu plus haut il signalait que 'pour que l'identité de classe se transforme en conscience communiste, l'organisation des prolétaires 'en classe, et donc en parti politique si nécessaire". Nous verrons tout de suite plus précisément ce que le BIPR entend quand il parle de "transformation". D'abord il faut signaler que les camarades appellent ici « conscience de identité de classe » ce que Lénine appelait « conscience trade-unioniste ».
Ceci dit, Lénine posait que si l'élément spontané est la forme embryonnaire du conscient. "puisque les masses ouvrières sont incapables d’élaborer elles-mêmes une idéologie indépendante dans le cours de leur mouvement, le problème se pose en ces seuls termes : il faut choisir entre idéologie bourgeoise ou idéologie socialiste. Il n'y a pas de milieu (…) le développement spontané du mouvement ouvrier aboutit justement à le subordonner à l'idéologie bourgeoise (...) c’est pourquoi notre tâche, celle de la social-démocratie, est de combattre la spontanéité de détourner le mouvement ouvrier de cette tendance spontanée du trade-unioniste à se réfugier sous l'aile de la bourgeoisie, pour l'attirer sous l'aile de la social-démocratie révolutionnaire (le parti prolétarien de l'époque).([5] [20])
I1 y a lieu de demander alors : de quel côté le BIPR situe-t-il cette "conscience de l'identité de classe" qu'élaboreraient les ouvriers '? Et il répond : "les expériences acquises par la classe ouvrières dans son combat contre la bourgeoisie son politiquement revêtues par les analyses et les interprétations de la bourgeoisie elle-même . elles donnent seulement naissance un sentiment (?) d'identité de classe qui reste une forme de conscience bourgeoise" ([6] [21]). Ainsi donc, en faisant tout un détour (en remplaçant "conscience" par "sentiment") le BIPR nous dit que la conscience d'identité de 1a classe ouvrière est... une forme de la conscience bourgeoise. Retenons ceci qui, d'emblée. n'est que l'introduction d'une énorme confusion de termes dans le marxisme. Mais nous ne faisons que commencer ; le BIPR (fort maintenant expliquer comment l'identité de classe, c'est-à-dire, cette forme de conscience bourgeoise "se transforme en conscience communiste" :
« une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et, notamment, cette partie des idéologues bourgeois qui se sont élevés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique" (Manifeste du Parti Communiste). Sous une forme lapidaire, on trouve là la conception matérialiste de la conscience de classe. La lutte spontanée de la classe ouvrière peut élever sa conscience jusqu'au niveau de l'identité de classe, lui permettant de se rendre compte qu'elle n'est pas une fraction du 'peuple", mais une classe en soi (sic). C’est un préalable indispensable pour que puisse s'opérer le saut qualitatif vers la conscience de classe (l'apparition d’une classe pour soi,. mais celui-ci ne peut intervenir que si la "philosophie", que si la compréhension théorique du mouvement historique dans son ensemble se développe et s’empare de la classe. C'est-à-dire si la classe parvient à se convaincre de la nécessite d'un parti Porteur d'une interprétation scientifique globale. Une telle analyse globale est nécessairement élaborée au-dehors de la lutte de classe (bien qu'elle y puise en partie ses matériaux) et au dehors de l'existence quotidienne de l'ensemble du prolétariatt, même si des prolétaires isoles participent à son élaboration ([7] [22]).
Un trouve dans ce paragraphe du BIPR une telle quantité de confusions qu'il nous est très difficile de choisir par où commencer. Essayons de reprendre le raisonnement. Le BIPR nous offre ici trois "niveaux" de conscience -appelons-les ainsi- :
- Premier niveau : conscience de l'identité de classe, laquelle n'est plus considérée maintenant comme identité de classe en opposition aux patrons, mais seulement comme "différenciation d'avec le 'peuple"'. Le BIPR rabaisse par là cet "embryon de conscience" produit des luttes dont parlait Lénine, au niveau de la "connaissance" vulgaire de n'importe quel ouvrier, ou encore de n'importe quel enfant, qui sait faire la distinction entre "ouvriers", "paysans", etc. Mais en même temps, le BIPR signale cette identité comme un préalable indispensable pour que puisse s'opérer le saut vers la conscience de classe. Cependant le BIPR nous disait il y a un instant que cette "identité de classe" n'était pas autre chose qu'une forme de la conscience bourgeoise. D'où il résulte que la conscience bourgeoise est un préalable indispensable pour... la conscience prolétarienne : en d'autres termes! la seule chose que nous disent les camarades c'est que, pour que le prolétariat parvienne à être une "classe pour soi" il a besoin, avant, d'être une "classe en soi", ou, pour que le prolétariat parvienne à la conscience de classe, c'est un préalable indispensable qu'il ne l'ait pas.
Deuxième niveau : la conscience de classe. Par un saut qualitatif le prolétariat devient classe pour soi. En quoi consiste ce saut ? En la conviction des masses de la nécessité d'un parti porteur, lui, de la conscience communiste. Mais cette conviction implique-t-elle que les masses prolétariennes rompent, en fin de comptes, avec l'idéologie bourgeoise? D'après le raisonnement du BIPR non. Les masses ne peuvent pas développer la conscience communiste avant la prise du pouvoir et, comme il n'y a pas de "milieu", alors le saut qualitatif en question, en réalité, n'en est pas un.
Le prolétariat, d'après le BIPR, se constitue en classe pour soi, mais les masses prolétariennes demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise. II y aurait lieu de demander alors : sur quelle base les masses sont-elles "convaincues" de la nécessité d'un parti communiste ? II n'en existe aucune, mis à part cette même idéologie bourgeoise. Autrement dit : comment est ce que les masses reconnaissent le parti "juste" ? Etann donné qu'elles demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise et que, donc, elles ne peuvent pas comprendre les positions révolutionnaires du parti, une telle "conviction" devient un pur hasard, quelque chose qui dépend non pas de la justesse des positions du parti, mais de l'habileté plus ou moins grande à manoeuvrer de celui-ci par rapport aux autres partis (bourgeois et petits-bourgeois) qui essaieront aussi de "convaincre" les masses. C'est à cela que le BIPR réduit la constitution du prolétariat en classe pour soi.
Troisième niveau : la conscience communiste, compréhension théorique du mouvement, interprétation scientifique globale dont le parti est porteur. D'où provient elle ? Avant nous comprenions, avec Marx, que "Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découvert par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classes existante. d'un mouvement historique qui s’opère sous nos yeux ." (Manifeste communiste). Mais maintenant le BIPR, "approfondissant" Lénine, a découvert que les thèses, théoriques des communistes se fondent sur les analyses élaborées au-dehors de la lutte de classe (bien qu'elles y puisent leurs matériaux) par tel ou tel idéologue bourgeois ou par tel ou tel prolétaire isolé qui s'élève au niveau d'idéologue. Très bien. Mais la lutte de classe est la forme d'existence réelle des classes, son processus, sa forme de mouvement ; les classes n'existent que dans la lutte. Affirmer, donc, comme le fait le BIPR, que la conscience communiste s'élabore en dehors de la lutte des classes revient à dire qu'elle s'élabore en dehors des classes, de manière indépendante, à la marge de celles-ci, et notamment à la marge du prolétariat. Et en effet, le raisonnement du BIPR tend à faire une différence entre ce qui serait la conscience de classe du prolétariat da conviction de la nécessité du parti), et ce qui serait la conscience communiste, faisant de cette dernière une sorte de... "philosophie" inaccessible aux profanes.
Certes, on peut trouver dans l'article du BIPR de magnifiques paragraphes qui contredisent ce qui précède, comme là où il est dit que "le parti doit étudier en profondeur la réalité sociale, les contradictions qui travaillent la société bourgeoise, sa courbe historique ; en même temps qu'il doit intervenir concrètement dans la lutte de classe. Il cherche ainsi à souder toutes les parcelles de conscience communiste provenant de la lutte de classe, à les fondre dans une vision globale et homogène et à rassembler tous ceux qui souscrivent à cette analyse en une seule et même force capable d'intervenir, capable d'intégrer l'expérience de la classe ouvrière dans un cadre communiste cohérent" ([8] [23]). Ainsi formulée, la question de l'élaboration de la théorie communiste n'a rien à voir avec la conception selon laquelle elle serait l'oeuvre d'idéologues qui se situent en dehors de la lutte de classes. Mais ce n'est pas nous mais le BIPR qui doit choisir une de ces deux positions qui sont en contradiction.
En quoi consiste donc l'approfondissement de Lénine fait par le BIPR ?
D'après Lénine, les masses prolétariennes ne peuvent pas, par elles-mêmes, à partir de leurs luttes spontanées, s'élever à la conscience communiste. A cause de cela le parti doit leur insuffler cette conscience, la leur apporter, car il soutient que "la conscience socialiste des masses ouvrières est la seule base qui peut nous garantir le triomphe ". « Le parti doit avoir toujours la possibilité de révéler à la classe ouvrière l'antagonisme hostile entre ses intérêts et ceux de la bourgeoisie ». La conscience de classe atteinte par le parti « doit être diffusée parmi les masses ouvrières avec un zèle croissant ». Si on trouve des ouvriers dans l'élaboration de la théorie socialiste, "ils n'y participent que dans la mesure ou ils parviennent à acquérir les connaissances plus ou moins parfaites de leur époque et à les faire progresser. Or, pour que les ouvriers y parviennent plus souvent, il faut s'efforcer le plus possible d'élever le niveau de conscience des ouvriers en général." (Le BIPR a cité la première partie de cet extrait de Lénine, mais il a "oublié" de citer la seconde).
Que la tache du parti est de "tirer profit des étincelles de conscience politique que la lutte économique a fait pénétrer dans l'esprit des ouvriers pour élever ceux-ci au niveau de la conscience politique social-démocrate" (c'est-à-dire communiste). Que la "conscience politique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. La seule sphère dans laquelle on peut trouver ces connaissances et celle des rapports de toutes les classes entre elles". Que le militant communiste est partisan du "développement intégral de la conscience politique du prolétariat". Que "la sociale-démocrate (le parti) est toujours en première ligne ... proposant un matériel abondant pour le développement de la conscience politique et de l’activité politique du prolétariat". Enfin, que le parti doit s'occuper « d’une agitation politique multiforme, c'est-à-dire, d'un travail qui justement tend à rapprocher et à fusionner en un tout la force destructive spontanée de la foule et la force destructive consciente de l'organisation des révolutionnaires ».
A l'opposé de cela, le BIPR considère qu’ « admettre que l'ensemble ou même la majorité de la classe ouvrière, compte tenu de la domination du capital, peut acquérir une conscience communiste avant la prise du pouvoir et l'instauration de la dictature du prolétariat, c'est purement et simplement de l'idéalisme » ([9] [24])
Les camarades devraient étendre leur critique au-delà de Rosa Luxembourg et de ses "héritiers". Au-delà de leur critique à Engels, dont ils qualifient de "crétinisme social-démocrate" son affirmation selon laquelle "Le temps des coups de main, des révolutions exécutées par de petites minorités conscientes à la tête des masses inconscientes et passé. Là où il s'agit d'une transformation complète de l'organisation de la société, il faut que les masses elles-mêmes y coopèrent, qu'elles aient déjà compris elles-mêmes de quoi il s'agit, pour quoi elles interviennent (avec leur corps et avec leur vie).(...). Mais pour que les masses comprennent ce qu'il y a à faire, un travail long, persévérant est nécessaire" ([10] [25]) Des formules de ce type « impliquent -d'après le BIPR- une surestimation du degré de conscience communiste auquel pourrait s'élever le prolétariat grâce au parti » ([11] [26])
Mais alors le BIPR devrait étendre sa critique, disions-nous, à Lénine lui-même,car apparemment lui aussi "surestimait" le degré de conscience communiste auquel pouvait s'élever le prolétariat, au point de considérer le travail du parti d'élever cette conscience comme sa tache de base et fondamentale, au point de considérer que la conscience communiste des masses est la seule garantie pour le triomphe de la révolution.
Tout le combat de Lénine exprimé dans le Que faire ? était dirigé contre "les économistes", contre ceux qui - objectivement- maintenaient les ouvriers au niveau du trade-unionisme, dans le spontanéisme qui conduit les ouvriers à rester sous la domination de l'idéologie bourgeoise. Et voici que le BIPR, pour soi-disant combattre le "spontanéisme", au lieu de chercher comment élever la conscience des masses, érige au contraire en théorie le maintien de ces masses sous la domination de l'idéologie bourgeoise.
Les camarades ne se sont pas aperçus qu'en essayant d'approfondir Lénine, ce qu'ils ont fait -sans le vouloir, bien entendu-, c'est se rapprocher de ces mêmes "économistes" que Lénine combattait. La thèse du BIPR selon laquelle les masses ne peuvent pas se débarrasser de la domination idéologique de la bourgeoisie avant la prise du pouvoir, ce qui ne leur laisse d'autre choix que de se convaincre de la nécessité d'un parti porteur, lui, de la conscience communiste, ressemble trop à la thèse fondamentale de l"'économisme" : "que les ouvriers s'occupent de la lutte trade-unioniste et qu'ils laissent aux intellectuels marxistes la lutte politique".
Et ainsi, alors que pour Lénine la constitution du prolétariat en classe pour soi signifiait élever les masses à la conscience communiste, fonder ainsi en un tout le mouvement spontané et le socialisme scientifique, pour le BIPR par contre, la constitution du prolétariat en classe pour soi signifie le maintien des masses sous la domination de l'idéologie bourgeoise, la fusion en un tout de l'idéologie bourgeoise avec la conscience communiste. C'est à cela que se réduit sa "dialectique".
Dans le prochain numéro de Revolucion Mundial nous poursuivrons ce travail. Nous aborderons les fondements du marxisme sur la conscience du prolétariat et la fonction du parti.
Ldo. (Octobre 1988)
[1] [27] Lettre du BIPR au GPI, 19 mars 1988.
[2] [28] Que Faire ? , Lénine, Ed. Seuil.
[3] [29] Ibid.
[4] [30] "La conscience de classe dans la perspective marxiste",. Revue Communiste n° 2.
[5] [31] Que Faire ?
[6] [32] "La conscience de classe dans la perspective marxiste",. Revue Communiste
[7] [33] idem
[8] [34] idem
[9] [35] idem
[10] [36] Introduction d'Engcls aux luttes de Classe en France. cité dans le Même article de la Revue Communiste.
[11] [37] idem
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [39]